Boualem SANSAL

Photo: Kamel Bencheikh et Boualem Sansal.
L’ALGÉRIE RESTE UNE TERRE TRAGIQUE OU LA JUSTICE ATTEND SON ACCOMPLISSEMENT : LA LIBERTÉ DE BOUALEM SANSAL !
par Christophe DAUPHIN
« L'Algérie reste une de ces terres tragiques où la justice attend son accomplissement. La colère prépare les matins généreux. Chaque jour dans les rues, l’homme y est humilié. Il sent peser sur lui la peur et le désordre, l’inégalité qu’engendre le régime des plus forts… Je salue ceux qui auront vu clair à temps… »
Jean Sénac (in Lettre d'un jeune poète algérien, 1950).
« Une étymologie fantaisiste et prémonitoire fait du prénom de Boualem Sansal le « porte-drapeau » - Bou alam. Enfermer le porte-drapeau n’empêchera pas le vent de souffler. »
Jean-Marie Le Clézio (in Le Point, 28 novembre 2024),
Une arrestation à l’aéroport d’Alger
L’écrivain Boualem Sansal, 75 ans, a été arrêté – par la police, dès sa descente de l’avion, à l’aéroport d’Alger, le 16 novembre 2024. La justice algérienne lui reproche des propos tenus lors d’une interview (in Frontières, 2 octobre 2024), durant laquelle il émet des critiques sur le soutien par l’Algérie au Front Polisario, tout en évoquant l’ex-appartenance marocaine historique de l’ouest de l’Algérie : « Ce qu’ont fait les militaires, c’est inventer le Polisario pour déstabiliser le Maroc... Ils ne voulaient pas que les Algériens se disent : peut-être que si on faisait comme le Maroc, ça serait mieux ; ils seraient plus libres, il y aurait du tourisme, les choses se passeraient un peu mieux... Quand la France a colonisé l’Algérie, toute la partie ouest faisait partie du Maroc… La France a décidé arbitrairement de rattacher tout l’est du Maroc à l’Algérie… » Ces propos sont jugés « négationnistes », « d’intelligence avec l’ennemi » et « d’atteinte au sentiment national », par le pouvoir algérien. L’Agence Presse Service algérienne réagit en ces termes aux réactions françaises dénonçant la détention arbitraire de Boualem Sansal, écrivain algérien, mais aussi français, depuis 2024 : « La France prend la défense d’un négationniste, qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’Histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie. »
Une nouvelle crise franco-algérienne
Quelles sont les causes de cette nouvelle crise franco-algérienne ? Premièrement, le Sahara occidental. Un territoire de 266.000 km2, qui dispose des plus grandes réserves mondiales de phosphate, et qui n’a toujours pas trouvé de statut définitif sur le plan juridique, depuis le départ des colonisateurs espagnols et la signature des accords de Madrid, le 14 novembre 1975, qui partagent le Sahara occidental entre deux tiers pour le Maroc et un tiers pour la Mauritanie. Ce territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraouie démocratique, proclamée par le Front Polisario en 1976. Ce dernier est un mouvement dont l’objectif est l’indépendance totale du Sahara occidental, revendication soutenue par l’Algérie. Depuis le cessez-le-feu de 1991 (un conflit militaire oppose le Maroc et la Mauritanie au Front Polisario, sur le territoire du Sahara occidental de 1975 à 1991), le Maroc contrôle et administre environ 80 % du territoire, tandis que le Front Polisario en contrôle 20 %.
Deuxièmement, l’historique des frontières de l’Algérie avec le Maroc, qui s’étendent sur plus de 1.700 kilomètres. Mais, en fait de quoi s’agit-il ? Cette question n’en n’est plus une, depuis la signature, le 15 juillet 1972, par Houari Boumediene et Hassan II du traité qui délimite les frontières de l’Algérie et du Maroc. Mais, les crises sont continuelles entre les deux pays. Après la guerre des Sables de 1963, vient la guerre du Sahara occidental de 1975 à 1991, la fermeture de la frontière algéro-marocaine en 1994, la rupture des relations diplomatiques, en 1976, à l’initiative du Maroc, puis, une nouvelle fois, le 24 août 2021, à l’initiative de l’Algérie… Mais, en définitive, existe-il un pays avec lequel le pouvoir algérien, qui tient le pays fermé et replié sur lui-même, s’entend ? Rappelons cependant que, durant la guerre de Libération, le Maroc a été l’un des quatre États à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) le jour de sa proclamation, le 19 septembre 1958, tout en demeurant un soutien constant de l’Algérie, devenant une base arrière pour les combattants algériens qui bénéficient de camps d’entraînement, en sus de la livraison, par le Maroc, d’armes, d’argent et de médicament au FLN.
L’arrestation de Boualem Sansal n’intervient pas à n’importe quel moment : elle fait suite à la visite, au Maroc, du président français Emmanuel Macron, lequel, le 29 octobre 2024 - soit vingt-sept jours après l’entretien de Sansal -, réaffirme, après son courrier du 30 juillet 2024 adressé au roi Mohammed VI, devant le Parlement du Maroc à Rabat, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental : « Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine… » À Alger, où l’on soutient le Front Polisario, et le principe d’autodétermination comme seule solution au conflit, cette déclaration met le feu aux poudres. « Cette position n’est hostile à personne », assure Emmanuel Macron, lequel, s’affranchissant du droit international, lance un pavé dans la mare des fragiles relations franco-algériennes. Alger a d’ores et déjà rappelé son ambassadeur, pour la troisième fois en trois ans. « C’est une vieille stratégie du régime algérien : « On arrête quand on a besoin, nous confie une source proche du pouvoir. Le 16 novembre dernier, Boualem Sansal a été appréhendé à sa descente d’avion. Selon nos informations, le régime algérien utiliserait l’arrestation de l’écrivain pour mettre la pression sur Emmanuel Macron : C’est un message passé à la France. Tous vos hommes, on va les arrêter, nous livre un membre du premier cercle du président algérien. Selon cette même source, cette arrestation est un avertissement : Tebboune veut faire comprendre à la France qu’il faut laisser l’Algérie tranquille », rapporte, le 26 novembre 2024, le média en ligne Blast.
Mais, dans cette triste (elle l’est souvent) actualité franco-algérienne, il n’y a pas que les questions du Sahara occidental et des frontières de l’Algérie avec le Maroc. D’autres tensions existent en ce moment, comme l’attribution, le 4 novembre 2024, du prix Goncourt à Kamel Daoud, lui-même très critique envers le pouvoir algérien, pour son roman Houris. Pour « féliciter » l’auteur de cette première dans l’histoire de la littérature algérienne, le pouvoir algérien s’est empressé de lancer des poursuites judiciaires contre le romancier, l’accusant, par le biais d’une survivante de la guerre civile, que Daoud aurait dépossédée de son histoire personnelle, de « diffamation des victimes du terrorisme et la violation de la loi sur la réconciliation nationale ». Kamel Daoud, qui a toujours été soutenu par Boualem Sansal, est interdit de séjour dans le pays. Boualem Sansal et avec Kamel Daoud, l’un des plus grands écrivains issus d’un pays qui n’est pas avare de talents, tant en prose qu’en poésie, dans la droite ligne de Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, Kateb Yacine ou Rachid Boudjedra…
Écrivain, essayiste, intellectuel, Sansal est aussi une conscience, celle de l’homme totalement libre qui se désole que « les hommes n’aient pas vu la solution ; elle crève les yeux, elle est dans la sortie de l’âge des religions et des dieux et dans l’entrée dans l’âge de l’homme et des étoiles. » Sansal ajoute : « Accepter encore et encore de subir les mêmes charlatans qui se prennent pour des guides spirituels, s’agenouiller devant des dictateurs qui ne pensent qu’au pouvoir, continuer à suivre une route qui ne mène nulle part, voilà où on en est malgré les lanceurs d’alertes qui ne cessent de pointer du doigt les pièges tendus. Le monde dans lequel nous vivons est désespérant et l’Algérie illustre bien cet étrange engrenage. Après s’être débarrassée de l’assujettissement occasionné par plus d’un siècle de présence coloniale française, ce pays s’est engouffré corps et âme dans les politiques népotiques, claniques et mafieuses. La corruption est devenue une méthode de gestion, ce qui a ouvert la voie aux violences engendrées par la montée de l’islamisme et de la division ethnique. De l’autre côté de la Méditerranée, ce sont d’autres violences qui surgissent et qui régissent la vie des peuples. La consommation effrénée de programmes télévisés débiles, des hamburgers qui dégoulinent « de matières grasses, toutes aussi cancérigènes les unes que les autres, les sels les plus corrosifs, et dissimulés sous des codes indéchiffrables, un savant dosage de drogues dures, la magie diffusée par la beauté des emballages… »
Autre tension franco-algérienne : Les Accords franco-algérien de 1968. Le parti Les Républicains a déposé un texte, rejeté par l’Assemblée nationale (151 voix contre 114), le 7 décembre 2023, pour dénoncer ces accords, qui confèrent un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d’emploi en France. « Avant 1968, explique Karim Dendene (in le site de l’Alliance solidaire des Français de l’étranger, 13 décembre 2023), Conseiller des Français de l’étranger dans la circonscription d’Alger, la circulation des Algériens était régie par les Accords d’Évian. Cela consistait en une liberté totale de circulation et de résidence en France. Les Accords de 1968 sont venus restreindre cette liberté, suivis de trois avenants qui, chacun, ont apporté leur lot de restrictions... Quels sont les avantages ? Par exemple en matière d’établissement, un Algérien porteur d’un projet commercial ou artisanal n’a pas à prouver, préalablement à l’obtention du premier titre de séjour, la viabilité de son activité. Ce n’est pas le cas pour les étrangers relevant du droit commun (Ceseda). Les avantages de ce statut concernent aussi le regroupement familial. Les durées de titres de séjours sont plus longues, tandis que les délais pour être rejoint par la famille sont plus courts. De même, en dehors de toute vie privée ou familiale établie sur le territoire français, les ressortissants algériens peuvent solliciter un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour, contre 5 ans dans le cadre du droit commun, sous condition de ressources suffisantes… Pourquoi ce statut fait-il aujourd’hui débat en France ? Je ne sais pas. Lorsqu’on écoute certains débats en France, on a le sentiment que les Algériens seraient libres d’y circuler et de s’y établir comme bon leur semble. Or, le plus souvent, ce n’est pas le cas… Je le répète, l’accord de 1968 ne confère pas que des avantages aux Algériens. »
L’appel à une dénonciation des Accords de 1968 fait grincer des dents à Alger. D’autant que, le 28 novembre 2024, les députés de la Droite républicaine remettent la question à l’ordre du jour devant l’Assemblée nationale : « Fin juillet 2024, l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris, en réponse à la reconnaissance par la France du plan marocain pour le Sahara occidental. À cette date l’Algérie est toujours sans ambassadeur à Paris. En mars 2024, les Présidents français et algérien avaient convenu et annoncé une visite du Président algérien en France pour la fin septembre‑début octobre, force est de constater que cette visite n’a pas eu lieu et qu’aucune date n’est avancée pour une telle visite. L’arrestation et l’emprisonnement à Alger fin novembre 2024, de l’écrivain franco‑algérien M. Boualem Sansal contribue à raviver les tensions. Ces difficultés, compte tenu de la mauvaise volonté manifestée et réitérée par les autorités algériennes rendent l’hypothèse d’une renégociation des accords de 1968 annoncée fin 2023 par Mme Elisabeth Borne, alors Première ministre, inenvisageables. C’est donc une dénonciation unilatérale de cet accord, par les autorités françaises, que les députés de la Droite Républicaine souhaitent proposer. »
De « l’utile à l’agréable » ou de « la mauvaise foi à l’infamie »
Boualem a évoqué, sans partager le point de vue du pouvoir, la question du Sahara occidental et l’histoire des frontières maroco-algériennes, et cela relève de son droit d’expression et non d’un crime. Imagine-t-on en France, que l’écrivain Jean-Marie Le Clézio soit mis en accusation d’atteinte à l’intégrité du territoire national, en lien avec des actes de terrorisme, comme l’est Sansal en Algérie, s’il critiquait la politique étrangère française et déclarait, ce qui est juste, que Nice (ville de sa naissance, de son enfance et de sa jeunesse) et la Savoie appartenaient au royaume de Sardaigne, avant d’être annexés très récemment par la France en 1860 ? Mais, au palais d’El Mouradia (résidence officielle du président algérien), sur les hauteurs d’Alger, on voit les choses différemment. Un peu comme si Abdelmadjid Tebboune, président depuis 2019, avait littéralement pris aux mots l’excellent humoriste franco-algérien kabyle Fellag, qui a été mon voisin : « Quand un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse ! »
Alors, non, bien sûr, Le Clézio n’a rien dit de l’annexion à la France de la Savoie et du comté de Nice. Mais, à l’instar de nombreux poètes et écrivains, dont des lauréats, comme lui, du Prix Nobel de littérature (Annie Ernaux, Orhan Pamuk out Wole Soyinka), il a signé l’appel (Tribune in Libération, 23 novembre 2024), initiée par Kamel Daoud : « Exigeons la libération immédiate de Boualem Sansal et de tous les écrivains emprisonnés pour leurs idées… Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y va de la liberté, du droit à la culture et de nos vies à nous, écrivains ciblés par cette terreur. »
Dans son hommage, intitulé, Boualem Sansal, le porte-drapeau (in Le Point, 28 novembre 2024), Le Clézio écrit également cela : « Dans un petit livre d’une drôlerie grinçante, Lettre d’amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et nations de la terre, Boualem Sansal établit la liste des responsabilités du décervelage humain, par ordre d’importance : l’argent, la religion, le fast-food et els jeux d’arène. Ceux à qui Sansal s’adresse pour les réveiller de leur sommeil hypnotique, ce sont ces hommes, ces femmes, ordinaires victimes des tisserands maudits qui nouent les fibres de la camisole de force de la religion et du pouvoir, et qui utilisent la vertu morale pour cacher, comme le disait Florence Nightingale, leur dépravation sous les oripeaux de la vertu. Les guerres, on le voit encore chaque jour où que l’on regarde, excellent dans cet art de la fourberie. Le dire comme le fait Sansal, le répéter, sur tous les tons, sur tous les modes de la narration, avec sérieux, avec gouaille, avec l’humour indispensable aux faibles, avec emportement parfois, demande un peu d’obstination et beaucoup de courage. Contre la vengeance des puissants, nous devons, nous qui n’avons aucun pouvoir autre que celui des mots – comme Boualem Sansal – résister, à tout prix. Ce n’est pas une question de civilisation, ou de démocratie. Ces mots-là sont souvent à double entente et peuvent être tordus à loisir par ceux qui les ont mis en avant pour gagner leur trône. C’est une question d’honnêteté. Nous devons faire à la vérité l’honneur de croire qu’elle triomphera. Une étymologie fantaisiste et prémonitoire fait du prénom de Boualem Sansal le « porte-drapeau » - Bou alam. Enfermer le porte-drapeau n’empêchera pas le vent de souffler. »
On l’a compris, l’arrestation de Boualem ne repose pas que sur des points d’histoire. Il n’est pas non plus qu’une victime collatérale d’un énième règlement de compte franco-algérien et son arrestation n’est pas qu’un signal envoyé au président français. Peut-être lui reproche-ton aussi, au passage, les origines berbères de sa famille, qui est originaire du Rif marocain ? Plus sûrement, « l’occasion faisant le larron », elle était trop belle pour ne pas la saisir. Pourquoi ne pas joindre « l’utile à l’agréable ? » ou plutôt, « la mauvaise foi à l’infamie ? », a-t-on du se dire du côté d’El Mouradia : « Réglons son compte à Boualem Sansal et faisons-le taire ! »
Le grand écrivain et intellectuel inflexible de 2084 : la fin du monde (Gallimard, 2015), qui vient d’obtenir la nationalité française, critique du pouvoir politique algérien, qui censure ses livres, menacé par les islamistes, n’a jamais cédé aux multiples menaces et pressions des uns et des autres, tout en refusant de quitter l’Algérie. Il en paye aujourd’hui les conséquences, après bien d’autres, avec cette arrestation de nature politique, visant à museler l’homme, son œuvre et sa parole. Évidemment, Boualem Sansal est emprisonné pour ses opinions, qui dérangent un pouvoir totalitaire et rien d’autre. Nous devons toutes et tous être Boualem Sansal, qui a été placé en détention en vertu de l’article 87 bis du code pénal algérien, qui réprime l’ensemble des atteintes à la sûreté de l’État. Rien que cela !.. Nous devons toutes et tous être Boualem Sansal, comme nous devions et devons, mais hélas, sans y parvenir, tous « être Charlie », le 7 janvier 2015 comme aujourd’hui.
Car, comme l’écrit (in Le Matin d’Algérie, 28 novembre 2024), le poète franco-algérien Kamel Bencheikh, ami que je partage avec Boualem : « Le cas Boualem Sansal dépasse les frontières des clivages politiques ou idéologiques. Il pose une question universelle et essentielle : celle de la liberté d’exprimer, de critiquer, de remettre en cause. Soutenir Sansal, c’est défendre le droit de penser et de créer librement, un fondement indispensable à toute société démocratique et équitable. La question n’est pas de savoir si l’on partage ses idées, mais de comprendre que son combat est celui de toutes les consciences éprises de liberté. La littérature, espace de création et de pensée, ne saurait s’épanouir sous la menace ou la contrainte. L’arrestation de Boualem Sansal est une injustice manifeste, un symbole de répression et d’intolérance. Face à cette situation, une seule exigence s’impose : sa libération immédiate et sans condition… Nous ne lâcherons pas un pouce aux ennemis de la liberté de penser et de s’exprimer sur tous les sujets. Rien ! »
Les accusations qui pèsent sur Boualem Sansal, lui font risquer la prison à perpétuité, voir même la peine de mort (la dernière exécution en Algérie remonte à 1993). Ses critiques acerbes contre le régime algérien, l’islamisme et la gouvernance en place, sont à l’origine de son arrestation, comme une sanction suprême « pour l’ensemble de son œuvre », soit, pour avoir de vive voix comme dans ses œuvres, combattu l’islamisme et la prise en otage de tout un pays par un clan militaro-affairiste. Boualem Sansal doit être libéré et non pas risquer de terminer sa vie dans les geôles d’un régime corrompu.
Boualem Sansal, né le 15 octobre 1949, à Theniet El Had (Algérie), a suivi une formation d’ingénieur de l’École nationale polytechnique, puis un doctorat d’économie. Il a été tour à tour, enseignant, consultant et haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie algérien. Il commence à écrire en 1997, pendant la « décennie noire », alors que la guerre civile et la terreur islamiste s’abattent sur son pays. En dix ans, les violences font entre 100.000 et 150 000 morts des milliers de disparus et un million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d’exilés.
En 1999, il publie chez Gallimard, son premier roman, Le Serment des barbares, qui connaît un très grand succès. Sous la forme d’un roman policier, ce roman est un réquisitoire enflammé, au style puissant et généreux contre l’histoire du dernier demi-siècle en Algérie. Deux hommes sont assassinés. Moh est un parrain de la région, richissime, intouchable, mouillé dans tous les trafics, toutes les corruptions et Abdallah Bakour, un pauvre type, un anonyme. Cette deuxième enquête est confiée à Larbi, un vieux flic usé. En remontant les pistes, il démonte petit à petit les rouages de la dérive du pays. Ce premier roman est décrit comme une épopée rabelaisienne dans l’Algérie d’aujourd’hui.
En 2003, Boualem Sansal est un rescapé du séisme meurtrier qui touche sa région à Boumerdès. La même année, il publie en France, après L’Enfant fou de l’arbre creux (2022), son troisième roman, Dis-moi le paradis, une description de l’Algérie post-coloniale. Le ton est très critique envers le pouvoir de Boumediene, et dénonce la corruption à tous les niveaux de l’industrie et de la politique, l’incapacité à gérer le chaos qui a suivi l’indépendance, et attaque violemment les islamistes. Il critique également l’arabisation de l’enseignement. En réponse à ce livre, le pouvoir le limoge de son poste au ministère algérien de l’Industrie.
En 2005, s’inspirant de son histoire personnelle, il écrit Harraga (« brûleur de route »), surnom que l’on donne à ceux qui partent d’Algérie, souvent en radeau dans des conditions dramatiques, pour tenter de passer en Espagne. Son livre Poste restante, Alger, une lettre ouverte à ses compatriotes, est censuré dans son pays. Son roman Le Village de l'Allemand, en 2008, est censuré en Algérie, car il établit un parallèle entre islamisme et nazisme. Le livre raconte l’histoire du SS Hans Schiller, qui fuit en Égypte après la défaite allemande, et se retrouve ensuite à aider l’Armée de libération algérienne, pour finalement devenir un héros de guerre et se retirer dans un petit village perdu. Le livre s’inspire d’un destin réel, découvert par la presse dans les années 1980.
En 2011, il publie un livre très personnel, écrit trois mois après la mort de sa mère. Ce nouveau roman, Rue Darwin, est l'histoire d’une famille prise dans la guerre d’Algérie. En 2015, paraît son livre le plus fameux : 2084 : la fin du monde, un roman de science-fiction, inspiré par 1984 d’Orwell, qui évoque un monde fondé sur l’amnésie et la soumission à un dieu unique et où le pouvoir religieux extrémiste a lancé une nouvelle langue, l’abilang : « l’abilang n’était pas une langue de communication comme les autres puisque les mots qui connectaient les gens passaient par le module de la religion. » Suivent les romans, Le Train d’Erlingen ou la Métamorphose de Dieu (2018), Abraham ou La Cinquième alliance (2020), Vivre : le compte à rebours (2024). Boualem Sansal est également l’auteur de huit essais, de Poste restante : Alger (2006) à Le français, parlons-en ! (éd. du Cerf, 2024), en passant par Gouverner au nom d’Allah, islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe (2013) ou Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre (2021).
Boualem Sansal déclare (in Philosophie magazine, 2024) : « Les Algériens ont fait en octobre 1988 leur « printemps », qui s’est soldé par un lamentable échec. Un double échec, puisque, loin d’avoir gagné la démocratie, ils ont et la dictature et les islamistes, plus forts que jamais, et plus que cela : alliés comme larrons en foire. Échaudés par la guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts et ruiné le pays, ils regardent le Printemps arabe avec pitié. « On en reparlera », disent-ils, paraphrasant en cela de Gaulle qui, au moment où les Algériens fêtaient l’indépendance en juillet 1962, avait lancé : « On en reparlera dans une trentaine d’années ! » ; il voulait sans doute dire que les Algériens n’attendraient pas longtemps pour se déchirer. Cela s’est malheureusement révélé exact. Les Algériens sont désabusés, ils pensent que le désordre actuel dans les pays arabes débouchera sur une violence généralisée et donc, à la clé, une intervention des militaires, qui se considéreront fondés à faire un coup d’État pour « sauver » le pays et « la paix dans le monde ». Ces « va-et-vient » correspondent à un mouvement historique : la démocratie ne peut s’imposer que sur la longue durée. Les handicaps de nos pays sont une réalité. Après les militaires sont venus les islamistes, qui seront chassés à leur tour, et ensuite viendra le tour des démocrates, quand les gens réaliseront que ce n’est pas dans les extrêmes qu’il faut chercher la solution, mais au centre. Les Algériens pensent, pour l’avoir durement expérimenté, que ce type de révolte de « printemps » n’est pas efficace, il installe un désordre et une misère qui ne font que renforcer le pouvoir et les islamistes. En l’état actuel des choses en Algérie, la seule révolte à laquelle croient les jeunes Algériens est l’exil. Mais tous ne peuvent pas partir… »
L’Algérie est algérienne depuis la fin de la guerre de Libération et les Accords d’Évian, le 18 mars 1962, qui mettent fin à cent-trente-deux années de colonisation française, dont sept années et cinq mois de guerre. Mais, quand, l’Algérie appartiendra-t-elle aux Algériens ? La « issaba », « le gang qui a pillé le pays », n’est plus aux commandes, nous dit-on. Mais qui est aux commandes ? Qui a enfermé Boualem Sansal ? L’Algérie reste une de ces terres tragiques où la justice attend son accomplissement. La colère prépare-t-elle des matins généreux, comme l’annonçait Yahia El Ouahrani ? Quand le soleil bronzera-t-il le corps du peuple ? pouvons-nous planter notre certitude dans els yeux du soleil ?
Boualem Sansal ai été incarcéré avec son cancer de la prostate et poursuivi en justice par le pouvoir algérien, en vertu de l’article 87 bis du Code pénal algérien qui réprime les « crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, visant notamment les manœuvres portant atteinte à l’intégrité du territoire national ou incitant à le faire, par quelque moyen que ce soit ». Le 13 mars 2025, il comparait devant un juge du tribunal de Dar El Beïda. Un nouveau chef d’inculpation pèse sur lui, celui d’« intelligence avec des parties étrangères ». Le 20 mars 2025, le parquet du tribunal requiert dix ans de prison et une amende d’un million de dinars (6.887 euros). Le procès dure vingt minutes. Le 27 mars 2025, Boualem est condamné à une peine de cinq ans de prison ferme et à une amende de 500.000 dinars (3.500 euros). Ne croyez surtout pas qu'il est seuls dans ce cas.
Sénac, mon soleil, Kateb, Feraoun, Djaout, Belamri Sebti, Nacer Khodja, Dib, Jamel Eddine, Amrouche, Mammeri, Fanon, Alleg, Audin, relevez-vous ! Et toi aussi Larbi Ben M’Hidi, Le dernier souffle des héros – alimente nos forges. Boualem Sansal doit être libre !
Christophe DAUPHIN
2, rue Élisée Reclus, Alger, le 29 novembre 24
DÉNOUEMENT : Arrêté de manière arbitraire le 16 novembre 2024, à Alger, puis, condamné, au cours d'une parodie de procès, à la peine scandaleuse et inique de cinq ans de prison ferme, pour « atteinte à l’intégrité du territoire national », le 27 avril 2025, et à une amende de 500 000 dinars (3 307 euros), en pleine crise diplomatique entre l’Algérie et la France, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, a enfin été libéré, par la junte d'Alger, le 12 novembre 2025. Mais n’oublions pas les autres prisonniers politiques algériens. Ainsi, Mohamed Tadjadit, le poète du Hirak, qui, le jour même de la libération de Boualem, a, lui, été condamné, par la dictature algérienne, à cinq ans de prison, pour délit d’opinion. Et le journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis mai 2024, et condamné à sept ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou, pour une imaginaire "apologie du terrorisme".
« C’est ainsi que je veux répondre à la question de Primo Levi, Si c’est un homme. Oui, quelle que soit sa déchéance, la victime est un homme, et qu'elle que soit son ignominie, le bourreau est aussi un homme. Mais en même temps, tout le choix nous appartient, à chaque instant… »
Boualem Sansal (in Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, Gallimard, 2008).
Œuvres de Boualem Sansal
Romans
1999 : Le Serment des barbares, Gallimard, prix du premier roman 1999, prix Tropiques 1999,
2000 : L'Enfant fou de l'arbre creux, Gallimard, prix Michel-Dard,
2003 : Dis-moi le paradis, éd. Gallimard,
2005 : Harraga, Gallimard,
2008 : Le Village de l'Allemand ou Le Journal des frères Schiller, Gallimard, grand prix RTL-Lire 2008, grand prix de la francophonie 2008, prix Nessim-Habif (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique), prix Louis-Guilloux,
2011 : Rue Darwin, Gallimard – prix du Roman-News,
2015 : 2084 : la fin du monde, Gallimard – Grand prix du roman de l'Académie française 2015,
2018 : Le Train d'Erlingen, ou la Métamorphose de Dieu, Gallimard,
2020 : Abraham ou La Cinquième Alliance, Gallimard,
2024 : Vivre : le compte à rebours, Gallimard,
Essais
2006 : Poste restante : Alger : lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes, éd. Gallimard,
2007 : Petit Éloge de la mémoire : Quatre Mille et Une Années de nostalgie, éd. Gallimard,
2013 : Gouverner au nom d'Allah : Islamisation et Soif de pouvoir dans le monde arabe, éd. Gallimard,
2015 : Romans 1999-2011 , Gallimard, Collection Quarto (contient Le serment des barbares L'enfant fou de l'arbre creux Dis-moi le paradis Harraga Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller Rue Darwin)
2017 : L'Impossible Paix en Méditerranée, avec Boris Cyrulnik, éditions de l'Aube,
2020 : France-Algérie, Résilience et Réconciliation en Méditerranée, avec Boris Cyrulnik, éditions Odile Jacob,
2021 : Où va la France ?, tribune publiée dans Le Figaro
2021 : Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre, Gallimard,
2024 : Le Français, parlons-en !, éditions du Cerf.
*
LA LIBERTE AUX OUBLIETTES
Entretien de Jean-Louis Kuffer avec Boualem Sansal, en 2007.
Boualem Sansal est l’une des grandes voix de la littérature algérienne francophone, dont les romans ressaisissent la tragique et complexe réalité contemporaine avec une porosité et une faconde sans pareilles. Après Le serment des barbares (1999), L’enfant fou de l’arbre creux (2000) et Dis-moi le paradis (2003), son quatrième roman, Harraga, s’attache à deux destinées de femmes avec autant d’empathie que de lucidité révoltée.
Au printemps 2006, cet auteur qui a « mal à l’Algérie » adressait une lettre ouverte à ses compatriotes intitulée Poste restante : Alger, d’un courage civique impressionnant.
- Comment, Boualem Sansal, vivez-vous aujourd’hui en Algérie ?
- Plutôt mal, après une amnistie marquant la réhabilitation des criminels d’hier, qui se retrouvent à plastronner en ville avec une arrogance extraordinaire. La chape d’un ordre moral intolérant se fait de nouveau ressentir, parallèlement à la réintroduction de l’enseignement religieux et à l’occupation des mosquées. Or la population semble l’accepter, tant elle est respectueuse de l’islam.
- Quelle a été votre éducation personnelle ?
- Je suis né dans une famille où l’on pensait que l’instruction était essentielle. Ayant perdu mon père très tôt, j’ai été soumis, avec mes trois frères, à la discipline rigoureuse d’un grand-père chef de gare qui avait fait la guerre de 14-18, laïc et profondément attaché à la France et à sa culture. Après un début d’études classiques en latin-grec, j’ai cependant bifurqué sur une formation d’ingénieur, l’Algérie de l’indépendance ayant besoin de bâtisseurs et de techniciens plus que de « beaux parleurs », comme on disait alors. C’est pourquoi je me suis retrouvé, en 1992, au poste de Directeur de l’industrie, où m’avait appelé un condisciple devenu ministre.
- Qu’avez-vous appris dans les allées du pouvoir ?
- Ce qui m’a le plus frappé, c’est la morgue, la corruption, les luttes entre clans et, d’une manière générale, le mépris de la population, ainsi qu’une formidable incompétence des apparatchiks du parti unique.
- En avez-vous un exemple ?
- Le plus éloquent est ce rapport qu’un ministre m’a chargé d’établir, sur les relations entre l’endettement des pays du Sud méditerranéen et leur niveau de développement. Me fiant aux chiffres de la Banque mondiale et du FMI, j’ai constaté que les pays les plus endettés à régimes autoritaires, à commencer par l’Egypte, étaient aussi les plus déficients en matière de développement, alors qu’Israël, super-endetté, affichait un développement constant. Ce constat a mis le ministre en fureur, qui m’a prié de supprimer la mention d’Israël, ce que l’honnêteté m’interdisait. Je lui ai donc proposé ma démission immédiate, qui a été refusée en même temps qu’on enterrait le rapport. Par la suite, mes positions et mes livres m’ont valu d’être limogé.
- Comment en êtes-vous venu au roman ?
- Cela s’est fait comme ça, pendant la terreur islamiste qui nous cloîtrait. Or que fait-on dans ces conditions ? On tourne en rond, on remâche les dernières horreurs du jour, on prend des notes sur ce qu’on observe, et tout à coup le « roman » est là, dicté par la vie. C’est ainsi qu’est né Le serment des barbares.
- Décrire la réalité si fidèlement, comme l’a fait aussi votre ami Rachid Mimouni, ne représentait-il pas un risque ?
- Bien entendu, mais sortir dans la rue était déjà risqué. A propos de mon ami Rachid, la nuit suivant son enterrement en Algérie, des fanatiques ont exhumé son cadavre pour le livrer aux chiens. Ce n’est pas du roman : c’est la réalité, comme Harraga relève d’une réalité vécue.
- Dans votre lettre ouverte aux Algériens, vous vous en prenez violemment à l’amnistie…
- Pour aboutir à une vraie réconciliation, il fallait enquêter et rendre la justice. Je ne suis pas contre le pardon, au contraire, mais cette amnistie était une insulte aux victimes et un déni de justice.
- Pensez-vous être entendu ? Et menacé ?
- On m’a appris récemment que le livre faisait l’objet d’une mesure de censure, mais de nombreux compatriotes partagent mon point de vue, même si mes adversaires me font passer pour un « agent de la France » Menacé ? L’Algérie est un grand pays, dans lequel je reste à peu près invisible. Par ailleurs, comme Mimouni, je suis protégé par ma notoriété. Mais vous savez : un voyou payé peut me descendre demain de façon anonyme, surtout dans le contexte actuel où, comme je vous le disais, l’islamisme radical repique de plus belle…
Le serment des Barbares, L’enfant fou de l’arbre creux et Dis-moi le paradis, parus chez Gallimard, sont disponibles en poche Folio.
Du coté des femmes
« Il faut en finir avec ces bêtes immondes, avec ces barbares des temps obscurs, ces porteurs de ténèbres, oublier les serments pleins d’orgueil et de morgue qu’ils ont réussi à nous extorquer au sortir de ces longues années de guerre. La lumière n’est pas avec eux et les lendemains ne chantent jamais que pour les hommes libres ». Ainsi Boualem Sansal s’exprimait-il dans Le serment des barbares, dont Harraga prolonge les constats du côté des femmes. Chérifa, enfant de la perdition enceinte de plusieurs mois, débarque un jour chez Lamia la pédiatre solitaire, sur l’indication de Sofiane le frère aimé et fuyant de celle-ci. Lasse « de la violence ambiante, des foutaises algériennes, du nombrilisme national, du machisme dégénéré qui norme la société », Lamia recueille l’adolescente en espérant l’aider à s’en sortir, jusqu’au moment où la sauvageonne s’esquive et disparaît. Malgré l’âpreté du tableau, ce roman magnifique vibre d’émotion, avec une ultime touche d’espoir.
Boualem Sansal, Harraga. Gallimard, 271p.
Par amour de l’Algérie
Boualem Sansal est un écrivain, au verbe justement dit « rabelaisien » tant il brasse la vie à pleins mots, bien plus qu’un imprécateur. Il y a pourtant de l’exhortation dans cette Lettre de colère et d’espoir qu’il adresse à ses compatriotes, les enjoignant d’abord à se (re)parler. « Le nom même de notre pays, Algérie, est devenu, par le fait de notre silence, synonyme de terreur et de dérision et nos enfants le fuient comme on quitte un bateau en détresse ». Or revenant sur les dernières décennies, de « règne de fer » en embellie et de guerre civile en paix de cimetières, l’auteur s’en prend à une série de « constantes nationales » qui ne visent selon lui qu’à mieux asservir le peuple algérien. Ainsi celui-ci est-il notamment décrété massivement arabe (alors qu’il ne l’est qu’à 16-18%) et massivement musulman, dans un glissement qui aboutit à un fatal « qui n’est pas musulman n’est pas de nôtres ». D’inspiration démocratique, l’appel de Boualem Sansal est une incitation au débat. Puisse celui-ci s’ouvrir un jour…
Boualem Sansal, Poste restante : Alger. Gallimard, 57p.
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
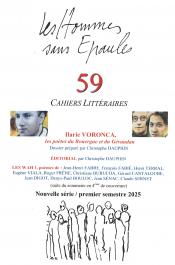
|

|
|
| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | Dossiers : Alain SIMON poète insulaire / La poésie palestinienne à Paris n° 61 |
