Christian VIGUIE

« Le souci de son propre statut, la mesure de son degré, voire de son absence de légitimité, sont des exigences auxquelles, en poésie, la parole contemporaine échappe, comme on sait, difficilement. Lisant ou écrivant, nous rencontrons mille témoignages, les plus explicites comme les plus souterrains, de l’astreinte à cette vérification permanente. Christian Viguié est de ces poètes, soigneux visiteurs des choses, des heures, des silences, à quoi, comme à des pierres de touche, il vient frotter sa parole pour des effritements d’éternités, pour une brièveté étonnée. Aucune sécheresse académique, aucun dogmatisme pour cette recherche, mais, dans la lumière du paysage (Le matin s’accroche à un châtaignier/ Un volet pousse un nuage), le simple accomplissement d’un exister conscient par lequel se jauge l’exigence/ du néant.
Si le poème de Christian Viguié consent à ne se penser qu’en limite (S’approcher/ sachant que rien ne fut pris/ mais juste effleuré/ ajoutant une ombre à une ombre), il revendique aussi quelque non-violente insoumission dont il se veut redevable à la pierre légère d’un parfum, à une branche que tu casses et qui retentit à peine, dans l’éternité surprise. Ainsi se décante et s’épuise le destin d’homme. Le poète n’entend pas échapper à l’éphémère. Il reste au contraire, résolument mais sans effort, dans un immanent dont il montre le chemin, échangeant ce qui passe et ne passe pas, un dieu contre une brindille. Une belle et profonde œuvre. De précieuses pages pour écouter une voix qui soulève le temps », écrit Paul Farellier (in Les Hommes sans Épaules n°50, 2020).
La poésie de Christian Viguié, exigeante, sonne juste, parce qu’elle est vraie et personnelle, forgée au contact de la vie et pas la plus aisée : « La poésie est une émotion têtue. La poésie nous permet de perdurer avec cette émotion-là. Et l’émotion est toujours intelligente. »
Christian Viguié est né le 13 juillet 1960, à Decazeville, dans une famille ouvrière. Son parcours est chaotique, à l’instar de sa jeunesse et de ses études. Il découvre tôt la poésie, à travers Baudelaire et le surréalisme, et cela le rattrape, lui permet de prendre son envol.
De 1982 à 1984, Christian Viguié vit à Agar, un village abandonné, proche d’Aubin, dans l’Aveyron : « À cette époque, je n’ai tellement pas d’argent et je récupère des papiers à la poubelle pour pouvoir écrire, du papier kraft. » Son Livre des transparences et des petites insoumissions et son roman, Des rois dans les arbres, évoquent cette période de sa vie. Il fait ensuite de multiples métiers saisonniers avant de devenir veilleur de nuit dans la région parisienne, puis éducateur et instituteur. Il vit aujourd’hui près de Limoges.
Son œuvre comprend des livres de poèmes, des romans, des nouvelles, des récits, des pièces de théâtre et des essais. La poésie prédomine. Viguié est un poète de la poésie vécue et non pas de laboratoire : Maintenant, tu vis avec le monde du dehors, Avec le vent, avec les pommes accrochées à l’arbre, Avec ce chemin qui monte et descend, sans la leçon que donnent les mots.
Cela découle pour une bonne part de ses « humanités » prolétariennes, auxquelles il est demeuré fidèle. Je partage cela avec lui. Nous sommes peu, dans le milieu littéraire et même de la poésie, pour réduire encore ce microcosme. Nous nous reconnaissons. Je cite en vrac : Gérard Mordillat, Paul Sanda, Jacques Simonomis, Jean L’Anselme, Roland Nadaus, Charles Plisnier, Albert Ayguesparse, Jean Rousselot, Luc Decaunes, Patrice Cauda, Robert Piccamiglio, Christian Da Silva, Jean-Pierre Eloire, Thierry Maricourt, Serge Basso de March, Jean-Michel Bongiraud (qui écrit dans Les mots du manœuvre, l’épi de seigle, 1999 : « Je suis un corps à courant d’air, toujours exposé au vent… »), naturellement Christian Viguié, sans oublier Thierry Metz, qui est le seul dont les origines ont été mises en avant et de manière positive.
Disons, que nous avons l’impression d’évoluer en « cancres » dans ce milieu de la poésie contemporaine, avec une majorité de professeurs qui n’ont jamais quitté l’école. Notre « école de la vie » contre leur « école à diplômes » ? Ce serait réducteur et caricatural d’en rester là, mais la poésie vécue de Viguié n’appartient, il me semble qu’à Viguié, alors que tant de noms sont interchangeables chez nombre de fabricants de poèmes. C’est un constat et non une règle.
En tant que membre de l’Académie Mallarmé, j’ai participé en 2021 au vote et à l’attribution du Prix Mallarmé à Christian Viguié pour son livre Damages (Rougerie). Un poète issu du prolétariat, qui vote pour un autre sous l’égide de Mallarmé, ce n’est pas piqué des vers, rimés ou non !... J’en ai été heureux, non pour une « victoire de classe », mais bien parce son livre le méritait. Christian Viguié est Aveyronnais, mais il ne sort pas d’une carte postale de Belcastel ou de Conques, mais du bassin houiller de Decazeville, comme Christian Da Silva.
Decazeville, ville ouvrière et bassin houiller, ignorée des parcours touristiques, a une histoire qui n’a rien de bucolique. Dès la fin du XIXe siècle, les conditions de travail des ouvriers y sont désastreuses avec une insécurité permanente. Lors de l’extraction du charbon, les mineurs abattent la houille dans l’obscurité et en l’absence de ventilation. Leur environnement de vie est misérable.
Le 26 janvier 1886, les ouvriers tentent de négocier le paiement des salaires tous les 15 jours et finissent par défenestrer l’ingénieur Watrin, le symbole de la violence sociale à Decazeville. Au lendemain de sa mort, 1.500 soldats sont mobilisés pour maintenir l’ordre et le Conseil d’Administration réduit encore les salaires. Les autorités et le patronat multiplient les arrestations, la réclusion, les travaux forcés, les licenciements abusifs.
Bien plus tard, en 2022, David Gistau assiste, impuissant à la fermeture de son usine du bassin sinistré de Decazeville : « Ce bassin représente une terre de résistance, qui a beaucoup souffert et beaucoup donné au pays : l’exploitation charbonnière et la fabrication d’acier et de fonte ont permis d’alimenter des milliers de kilomètres de rails en France. » Le bassin comptait plus de 30.000 habitants en 1968, contre à peine 18.000 en 2018, selon les derniers chiffres de l’Insee. En décembre 2019, la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM), est placée en redressement judiciaire avant que, le 26 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse acte la cessation d’activité et la liquidation.
Paulin Marty (1825-1898), le poète de Villefranche-de-Rouergue écrit (in son poème « N’insultez pas les ouvriers) : Allons, cessez de nous jeter l’outrage, - gardez votre or, nous ne l’envions pas ; - Votre bonheur est notre propre ouvrage : - Que seraient-ils ?, vos écus, sans nos bras ? – Pendant que vous courez de fête en fête, - Nous, relégués dans de froids ateliers, - Sous le travail nous fléchissons la tête. – N’insultez pas les ouvriers. – Dans vos hôtels blasonnés d’injustices, - Où tout se courbe au gré de vos désirs… - Nous, travailleurs, plongés dans l’indigence, - Sans pain, sans feu, dans d’humbles greniers, - Déshérités, nous souffrons en silence. – N’insultez pas les ouvriers.
Le poète et ouvrier gantier de Millau Henri Terral écrit pour sa part, en 1873 : Ouvriers, mes amis, pauvre peuple d’esclaves, - Le moment est venu de briser vos entraves.
À Aubin, la ville natale de notre amie poète Marie-Claire Bancquart, une fusillade a lieu le 8 octobre 1869 sur « le Plateau des Forges » du Gua. Ce jour-là, l’armée tire sur des ouvriers de la Compagnie de Paris-Orléans en grève, faisant 14 morts et 22 blessés, dont trois ne survivront pas. Cet événement, qui a un retentissement important au-delà des frontières françaises, inspire à Émile Zola l’épisode de la fusillade relatée dans Germinal (1885). Victor Hugo écrit son « Ode à la misère » : « - Quel âge as-tu ? - Seize ans. - De quel pays es-tu ? - D'Aubin. – N’est-ce pas là, dis-moi, qu’on s’est battu ? - On ne s’est pas battu, l’on a tué… - Mon père est mort frappé d'une balle. - Et ta mère ? - Folle. - Et tu n’as plus rien ? - Si. J'ai mon petit frère. - Il est infirme... »
Christian Viguié a lui, brisé ses entraves, avec le feu de la poésie et on comprend pourquoi il considère cette dernière comme « l’histoire profonde du réel », comme il en témoigne dans un entretien (in La Dépêche, mars 2024) : « Je suis, je me sens avant tout fils de prolo. Je n’ai jamais su retaper une maison ou réparer une bagnole, mais les livres, ce truc-là, j’y arrive. Quand j’interviens, c’est toujours le fils d’ouvrier qui parle. Je ne suis pas celui qui va jouer au poète…. Je travaille parfois huit heures par jour et c’est devenu une vraie nécessité à 19 ans. J’en ai 63 et je peux dire que cela m’a aidé à vivre. Quand j’étais en voie de clochardisation, les bouquins de poésie que j’avais dans mes poches m’ont beaucoup aidé. Mon père, un être adorable, était un peu soucieux de ma vie sociale à une époque, d’où son bonheur quand je lui ai offert le premier livre pour lequel j’avais reçu un prix. Un jour, mon beau-frère, qui sait faire beaucoup de choses, m’a demandé : « Tu as mis combien de temps pour faire ce livre ? » Deux ans, j’ai répondu. « Comme mon mur », a-t-il ajouté. Voilà, j’étais validé. Et c’était la plus grosse validation du monde. En tant que fils d’ouvrier, j’avais un corpus langagier qui était celui de notre classe sociale. Quand j’étais en sixième, je ne comprenais pas les livres qu’il fallait lire, les Balzac, les Flaubert, etc. Je trouvais, à l’époque, que ces auteurs parlaient bien, mais je ne savais pas s’ils parlaient vrai. C’était une question très naïve. Je trouvais qu’en lisant ces romans-là, on pouvait trouver des pépites d’or, mais je n’y retrouvais pas ma classe sociale et justement, le poète Guillevic a été un grand passeur pour moi. Son écriture est simple, mais faussement simple. Ça m’a réconcilié avec l’adolescent que j’étais et mon écriture est devenue originale, quand j’ai accepté que ce langage, c’était le mien et non pas un langage d’emprunt pour montrer « Regardez comme j’écris bien ! » La première reconnaissance est venue de moi, puisque j’étais tout seul. Je n’avais pas du tout l’idée d’un livre. J’étais assez naïf. Quand j’écrivais un poème et si 2-3 jours après, je voyais du Christian Viguié quand je le relisais, je le déchirais. Si je voyais un objet étranger qui me regardait, c’est qu’il était réussi. C’est un critère de véracité du poème et ça marche encore comme ça. Le premier censeur c’est moi. Je n’aime pas me voir. Il y a deux phrases que j’adore et qui parlent d’esthétique. La première est de Pascal, qui dit : « Le moi est haïssable. » Et la deuxième, de Montaigne, dit : « Je ne peins pas l’être, je peins son passage. » C’est ce qui m’émeut le plus. Je n’ai pas de problème d’identité. Je trouve que les personnes sont belles parce qu’elles sont mortelles. La beauté est là, pas dans une plastique prédéfinie. Je suis un incroyant au niveau des représentations de la beauté qu’on peut me faire. Le livre, c’est vérifier autrement… »
Christian Viguié écrit encore : « S’il demeure urgent d’analyser à tous les niveaux les contradictions frontales entre un projet d’émancipation collectif et la nature des partis politiques censés le promulguer, cela indique qu’il y a un combat dans le combat. L’oublier, c’est subordonner le résultat à son bornage minimaliste. » Christian Viguié, on le voit, assume ses « quartiers de noblesse » prolétariens, comme les appelle mon ami Gérard Mordillat, qui écrit : « Je n’ai aucun engagement partisan, mais je reste fidèle à la sensibilité ouvrière de mes origines. J’ai été ouvrier imprimeur, et je ne peux pas être indifférent à ce qui se passe en France aujourd’hui. On ne se sent jamais assez révolté devant les injustices et les crimes commis, ici ou ailleurs. Dans cette immense douleur qui habite le monde, je veux m’associer à ces combats, surtout auprès de ceux qui sont le moins soutenus. De la violence du harcèlement à l’inégalité salariale, la condescendance vis-à-vis des plus faibles m’insupporte ».
Je pense que Christian Viguié peut se reconnaître dans ces propos, davantage qu’en ce concept de « transfuge », que je désapprouve, tout comme Mordillat. Le prolétaire ne disparait pas comme par enchantement du fait d’un meilleur bulletin de paie, d’écrire des livres et avoir une certaine reconnaissance pour cela. Viguié n’écrit pas ses poèmes sur les bancs de Normale Sup ou de Science Po, mais dans les champs de la vie. La voix du poème des Causses, du Rouergue et des déserts industriels, depuis la disparition de Jean Digot, c’est lui ! « La langue, pour moi, n’a existé qu’à partir du moment où elle a été un instrument de combat. Moi, j’étais fils d’immigré italien. J’arrivais dans un milieu où mon nom disparaissait : on m’appelait « salami » ou « macaroni », écrit le dramaturge Armand Gatti.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
À lire :
Poésie : L’Âge est de rompre (Messidor, 1987), Prix Europe/Poésie 1986, Fables (L’Arrière-Pays, 1996), Petites écritures (Rougerie, 1996), Paysages dans la neige (L’Arbre à Paroles, 1996), Biographies (Tarabuste, 1997), prix Émile Snyder 1993, Le Livre des transparences et des petites insoumissions (Le Dé bleu, 1997), Prix Max-Pol-Fouchet 1997, Économie d’un paysage (Rougerie, 1999), La Dure Lumière (Rougerie, 2001), Prix Antonin-Artaud 2003, Contre-chant (Propos 2 Éditions, 2003), Juste le provisoire (Rougerie, 2004), Cheminements (Rougerie, 2007), Des oiseaux (Le cadran ligne, 2009), Autres choses (Rougerie, 2010), Outre mesure (Dernier Télégramme, 2013), Limites (Rougerie, 2016), Damages (Rougerie, 2020), Prix Mallarmé 2021, Fusain (Le Cadran ligné, 2021), Ballade du vent et du roseau (La Table ronde, 2022), Nature morte avec page blanche, ombre et corbeaux (L'Ail des ours , 2023), Comme une lune noire sur ma table (La Table ronde, 2024).
Romans, nouvelles, récits : Le Carnet de la roue (Le bruit des autres, 1999), Le Jardin (Le bruit des autres, 2001), Un homme inutile (Le bruit des autres, 2002), Le vieux Maître (Le bruit des autres, 2003), Comme un chemin (Circa 1924), Guerres sur fond bleu, (Le bruit des autres, 2006), Des rois dans les arbres (Le Mot fou, 2010), Baptiste l’idiot (Le Mot fou, 2014), Prix Murat 2015, Passé décomposé (Le geste noir, 2015), La Naissance des anges (Les Monédières, 2020), Le coureur de serpent roman (Les Monédières, 2024).
Théâtre : Pour les oiseaux ou les fous ou Les derniers jours du Caravage (Le bruit des autres, 2001), Nuits d’été (Le bruit des autres, 2012).
Essais : Partis pris 1, Lettres à René Pons (Le bruit des autres, 2009), Partis pris 2, Poésie et politique (Le bruit des autres, 2009), René Rougerie, une résistance souveraine, entretien, livre accompagné d’un DVD (Le bruit des autres, 2010), Partis pris 3, Esthétiques (Le Bruit des autres, 2010), Conjonction d’insubordination, entretiens avec Laurent Albarracin et Laurent Doucet (La passe du vent, 2018).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
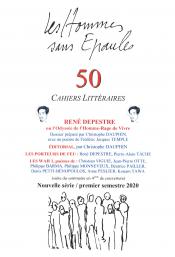
|
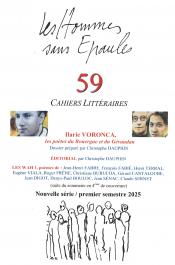
|
|
| Dossier : René DEPESTRE ou l’Odyssée de l’Homme-Rage de vivre n° 50 | Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 |
