Claude SERNET

Les pas comptés et recomptés de Claude Sernet sont ceux de sa vie qui le mène de la moldave Targu Ocna à Paris, avec, dans ses sillons, des milliers de vers gorgés d’émotions, de joie et de terreurs, avec une obsession sur le mot et sa véracité.
Sernet s’interroge toute sa vie sur les mots qui sont langage et sève à la fois (Des mots qui m’ont appris à vivre - Des mots qui sont déjà la vie - Des mots qui m’ont vanté la mort… - Des mots d’ivresse et de ferveur…) et surtout sur les siens : Ces mots – sont-ils pourtant plus vrais que d’autres ? – Sont-ils hasard, réponse, étude ou découverte ? – Sont-ils comme un désert ? Comme un sillon fertile ?
Cette œuvre se déroule entre Danube et Seine avec une thématique qui évolue au gré des courants du fleuve, mais dont le limon est stable : le dialogue avec la femme, la joie entraperçue, la route, l’exil, le doute, l’angoisse, la traque, le poids et la signification du mot, la précarité, la résistance, la vie du paria, la chambre. Benjamin Fondane a été assassiné par les nazis en 1944 dans une chambre à gaz du camp d’extermination d’Auschwitz, Ilarie Voronca s’est suicidé en 1946.
Victor Brauner est mort en 1966, mais, surréaliste, il avait depuis longtemps rompu avec cette histoire qui demeure chevillée au corps et au cœur de Sernet, qui est très vite, avec Colomba, le survivant des mousquetaires de l’avant-garde roumaine des années 30. Il survit à tous, sauf à Colomba, qui meurt en 1994.
Claude Sernet dialogue en poésie avec ses sœurs et frères humains à la poursuite de ce frais bonheur de vivre où tout devient facile et, en survivant, avec tous les fantômes qui peuplent sa route sinueuse, tout en s’adressant aux vivants : Ils rediront peut-être au monde encore aveugle – Nos pas dans la lumière et le chemin battu – Ces mots… Sernet l’angoissé trouve rarement le repos, la quiétude. Comment le pourrait-il ? Il a grandi dans un pays aux nuages antisémites : Ici je montre les combats, les gouffres, les révoltes – Le froid pays d’enfance où je reviens m’attendre. Il a été témoin de la Shoah, qui emporte nombre de ses proches : Ces longs convois de la douleur et ces visages… - Vois saigner l’oubli qui nous assemble. Il vit chichement, l’exil à la boutonnière (Étranger dans la vie, étranger sur la terre – Le pays de ma vie est en terre étrangère), prêt à reprendre la route, une route pavée de morts, de douleurs, avec quelques éclaircies que le poète sait saisir au vol : Je demeure où l’amour et l’attente ont bâti leur maison.
Sernet est un poète de la transmission et du partage : J’apprends avec les arbres… - J’apprends avec les routes – La mer et les étoiles – J’apprends avec ma fille – Ses pas, ses jeux, ses rires – J’apprends avec les hommes – Leurs chants d’ici, leurs rêves – Et pour m’accroître encore – Je dis ce que j’apprends. Attention, donc, de ne pas trop noircir le trait et de réduire Sernet à cette angoisse, certes, bien présente en lui, mais il n’est pas que cela.
De même, on dit trop souvent que le style de Sernet est devenu en France, un style « classique ». Certes, il lui arrive parfois d’avoir recours au poème à forme fixe, d’utiliser un mètre classique et la rime, mais pas dans la majorité des cas où le vers libre prédomine. Sernet n’a pas tué en lui le jeune poète avant-gardiste et intégraliste : Un Arbre qui rugit dans l’œil d’une hirondelle – une hirondelle aveugle avec un cierge en laisse – Un arbre à barbe, une ancre veuve, un puits de lèvres – Une autre clé de mousse, un escalier de plumes – Un œuf carré d’étoile, une araignée en larmes – Un merle comme un trèfle, un trèfle comme un rire – Un cri jamais poussé de chevelure en cage – Et même un simple toit de sucre à dents de pluie – Puisque tu m’aimes – Cela peut être vrai…
Sernet retrouve la verve, la fraîcheur, la fantaisie provocatrice de sa jeunesse, avec de images qui n’ont rien de factices : Je vois, j’entends, je parle - Je vois pour les muets - J’entends pour les aveugles - Je parle pour les sourds - Le monde étant le monde - Aveugle, sourd, muet - Je vais où je demeure - Mais je ne tremble plus.
Ernest Spirt est né le 24 mai 1902, à Targu Ocna, un village de Moldavie, situé dans le nord-est de la Roumanie, dans une famille juive (non pratiquante) de la petite bourgeoisie. Son père est médecin, Eugen Spirt. Les Spirt résident à Bucarest, Strada Parfumului n°20. Ernest Spirt est un poète, un homme exalté, mais aussi un grand ténébreux, comme le furent tous ces amis, vivant au temps des assassins. Sous le pseudonyme de Mihail Cosma, il est avec Benjamin Fondane, Ilarie Voronca, Victor Brauner et bien d’autres, l’un des animateurs de l’avant-garde roumaine. Tout commence à Bucarest, au début du mois d’octobre 1924, lorsque paraît, tel un coup de tonnerre, la revue 75 HP.
Mihail Cosma décrète que la littérature est le meilleur papier hygiénique du siècle. Fervent défenseur de l’Intégralisme, il ajoute : « Nous envisageons l’accomplissement intégral… Nous labourons une terre vierge. Une terre dure Échapper à la tyrannie logique et syntaxique a donné naissance à une logique et une syntaxe, nouvelles… La matière de nos réalisations ? Le Tout. Le bois, la parole, le son, le fer, la couleur, la sensation, l’idée. Le domaine de nos réalisations ? Partout. L’usine, la rue, le bordel, l’homme, la société. Le cœur en frome d’alpenstock, nous gravîmes les montagnes. Notre poète compose devant une machine à écrire. Notre peintre travaille à l’aide du compas et de l’idée… De l’esprit unilatéral et étroit de nos essais solitaires, de l’exploitation fragmentaire de notre sensibilité, nous sommes arrivés à la synthèse contemporaine : L’INTÉGRALISME ; Esprit constructif, infiniment applicable dans tous les domaines. Effort intégral vers l’achèvement synthétique de l’existence. Nous avons réussi à conquérir la technique après des années de combat. »
En 1925, Ernest séjourne à Pavie, en Italie, où, correspondant de la revue Integral, il achève ses études de droit. Il se rapproche des futuristes, puis s’en éloigne en raison de leur ralliement au fascisme.
Comme ses amis poètes et peintres roumains, Ernest s’exile, fuit l’antisémitisme ambiant qui gangrène la Roumanie et gagne la ville lumière Paris et la France, en 1928, où il s’installe définitivement l’année suivante.
La chambre fait son apparition dans la poésie de Sernet. Elle symbolise la solitude et le dénuement. La chambre est un endroit, souvent celle d’un hôtel « miteux », et un thème récurrent, dès l’arrivée en France. Lieu de vie du poète rappelé à sa misérable condition. Sernet en dresse en dresse le modeste inventaire, comme Van Gogh a pu peindre la sienne, à trois reprises, à Arles, en 1888. La chambre de passage nous renvoie à la fêlure du poète errant qu’est également Ilarie-Ulysse (« Nous sommes tous passés de chambre en chambre » écrit Voronca dans un poème inédit de 1943), tout comme Fondane et Sernet, qui écrit (« La chambre du poète » in Les Pas recomptés,1962) : J’oublie en m’oubliant la faim, la soif méchante – Je mange un pain de feu, je bois une eau solaire – Je suis mon maître et je retrace enfin mes routes – L’espoir est un sentier, ma joie est un chemin – Je marche et je suis libre et mon plaisir ajoute – Aux astres d’aujourd’hui l’éclat des lendemains.
En France, Ernest Spirt alias Mihail Cosma, devient définitivement le poète Claude Sernet. En marge du surréalisme, il fréquente la bohême de Montparnasse, se rapproche des poètes du Grand Jeu et fonde avec le poète et dramaturge d’origine russo-arménienne Arthur Adamov, la revue (un numéro unique sortira en juin 1928) et le groupe Discontinuité. La discontinuité représente l’abandon du principe d’éternité, elle porte la marque de la rupture, de la déchirure ontologique de l’homme : « Je sais que détruire les horloges, ces visages solennels du sommeil, n’emmène pas, comme nécessaire et immanente conséquence, à la suppression du temps ; je sais qu’aucun glaive, si céleste fût-il ne peut fendre les rideaux passionnés de l’aube » écrit Sernet pour qui, le vrai poète est celui qui pratique « la fidélité envers soi-même ».
Ernest (comme l’ignorer ?), a une sœur, Colomba, avec laquelle il entretient une relation fusionnelle. Colomba est l’égérie des peintres et des poètes de Bucarest. Elle a épousé en 1927 le poète Ilarie Voronca. Mais les relations entre Nesty (Sernet) et Edy (Voronca) se tendent considérablement lorsque Voronca quitte Colomba en 1938, pour une autre femme. Voronca fait souffrir Colomba et ce n’est pas acceptable aux yeux de Sernet, qui ne voit pas d’un meilleur œil la relation qu’entretient sa sœur avec le poète Eugène Guillevic, par la suite. Il y a, comme il y eut avec Voronca, rivalité entre Sernet et Guillevic, à propos de Colomba, mais aussi de leur audience respective, tant sur le plan littéraire, qu’au sein du Parti communiste auquel ils appartiennent tous les deux.
La relation fusionnelle entre Sernet et Colomba ne se démentira jamais et compliquera plus tard, la propre relation de couple de Claude avec Helen Todd, rencontrée dans une réunion du PCF, qu’il épouse en 1945, un an avant la naissance de leur fille Catherine, qui a reçu en héritage une histoire bien lourde à porter, mais, pour le meilleur, de ses parents : la droiture la combattivité, la bonté, la simplicité et le refus de l’injustice.
Le testament de Sernet à Catherine, ne figure-t-il pas dans cette très émouvante « Chanson » : L’espoir est dans tes yeux – La force est dans tes mains – L’amour est dans ton cœur – Jamais ce monde à faire – N'eut avenir plus beau – Nous vivrons par toi – Tu le vivras pour nous – Déjà tu nous attends – Mets tes rubans, ma fille – Allons cueillir des fleurs !
Père et époux aimant, Sernet n’est toutefois pas toujours facile à vivre, drôle, il peut l’être beaucoup moins, car, il est très exigeant et peut être cassant et maladroit. Il le dit lui-même : Qui me subit selon ma rage ou ma détresse – Souvent ma joie ou ma révolte – Qui redevient selon mes cris silence ou plainte. La reconnaissance littéraire piétine (sans doute n’est-il pas assez stalinien pour le Parti, trop roumain pour les uns, pas assez pour les autres, trop ceci ou pas assez cela) : Ainsi je fonce, au bout du jour sans gloire… - Je veille et je m’attarde aux brèches.
De quoi vit Sernet en France ? De tous les travaux qui se présentent à lui : traductions, leçons de roumains et de français, corrections d’épreuves, rédaction de thèses, etc. Helen enseigne l’anglais, comme le fera par la suite, leur fille Catherine, qui apprendra aussi, bien plus tard, la langue natale de son père et se rendra dans son pays lointain. Verrou brisé, fraîcheur de porte ouverte - Je fonce — une ombre parle et la lumière écoute, a écrit Sernet.
Sur le plan de la poésie, la création de Sernet, comme celle de Voronca, évolue en France. Le poète, selon Sernet, est un visionnaire qui voit et fait voir. Le futurisme et le constructivisme de sa jeunesse sont bien loin. Sernet a pris la mesure de ce qui forge le destin des poètes quand le mythe poétique et la réalité quotidienne se confondent.
Mobilisé le 15 octobre 1939 et incorporé au vingt-deuxième régiment d’infanterie de Fontainebleau, Claude Sernet est fait prisonnier le 15 juin 1940, à Méry-sur-Seine. Détenu à Pure (Ardennes), dans un camp de prisonnier, il tente de s’enfuir à deux reprises : Nous les vomis, les mal lotis - Les rejetés, les emmerdés - Les nez crochus, les gueules noires - Les juifs, les nègres, les sidis - Les étrangers, les éloignés - Les sans patron, les sans famille.
La troisième tentative, en mai 1941, est la bonne. Au mois d’octobre, il se réfugie à Bizanet (Aude), dans les Corbières, à treize kilomètres de Narbonne, où il se remet à écrire et prend contact avec les revues de l’esprit libre, notamment la revue aveyronnaise de Denys-Paul Bouloc, Méridien, dont il devient rapidement un collaborateur précieux. Cette revue aide aussi à l’impression de nombreux journaux clandestins, dont Combat, dirigé par Albert Camus.
En terre Cathare, Sernet retrouve Joë Bousquet, l’auteur de La Tisane de sarments (Denoël, 1936), Sernet devient un familier du 53, rue de Verdun, à Carcassonne, où il rend visite à l’auteur de Traduit du silence (Gallimard, 1941), qu’il connait depuis l’avant-guerre et qui a salué chaleureusement ses poèmes (in Critique n°38, 1938) : « Celui-ci est un poète dont l’œuvre apparaît comme une façon de comprendre la vie. ».
Le 11 novembre 1942, moins d’un mois après l’arrivée de Colomba qui rejoint son frère à Bizanet, les Allemands envahissent la zone libre, mais, Bizanet n’étant plus sûr comme refuge, Sernet rejoint son ami l’écrivain Jean Carrive à la Girarde, près de Bordeaux, où Colomba le retrouve à nouveau. Ils resteront à la Girarde jusqu’à la fin novembre 1943 (ou 44 ?), date à laquelle ils regagnent Paris ensemble.
Durant toute cette période, Sernet collabore aux revues de la poésie en résistance, dont Méridien de Bouloc. Après la guerre, ce dernier sera, et pour cause, amené à fréquenter Sernet bien plus longtemps que Voronca. En 1976, un troisième prix s’ajoute au Prix Ilarie Voronca et au Prix Antonin-Artaud fondés en 1951, le Prix Claude-Sernet, doté, comme le Prix Voronca, par Colomba Voronca, à Rodez, où Claude Sernet séjournera à plusieurs reprises.
En 1952, Sernet répond à une enquête du Centre National des Écrivains : « J’ai trouvé et je trouve, une totale satisfaction à exercer mon métier d’écrivain, mais c’est uniquement dans la mesure où il m’est apparu – ou, après d’interminables confrontations et débats avec moi-même, j’acquiers la conviction que mon ouvrage peut être utile, peut servir, et qu’ainsi j’ai accompli mon devoir. Cette aspiration, ce besoin d’accomplir mon devoir (le titre d’un de mes recueils est justement : Poèmes dus) sont le corollaire naturel du sentiment permanent de ma responsabilité de « travailleur de la littérature », comme le dit Jdanov, sentiment gagné, mûri et sans cesse accru au contact des hommes, de leurs luttes et de leurs préoccupations. »
On pourra être surpris de voir un homme tel que Sernet se rallier au très totalitaire réalisme socialiste jdanovien. Cela lui ressemble si peu : sa poésie en est tant éloignée. Malgré tous les signes qu’il envoie, le communiste en liberté Sernet, plus que stalinien (il devrait, à ce moment-là, se souvenir de son cher Fondane et de ses amis les poètes du Grand-Jeu, Gilbert-Lecomte et Daumal), sera considéré avec suspicion (poète intimiste, loin du réalisme socialiste prôné, en définitive) et tenu à l’écart.
Sernet est très productif de 1950 jusqu’à sa mort. Jusqu’à ce que la maladie apparaisse sous la forme d’un tératome, une tumeur. Sernet subit une lourde opération et passe sa convalescence dans l’Aveyron, notamment à Conques.
L’été passe, puis avec l’hiver le mal revient. La deuxième opération est vaine. Claude Sernet décède le 15 mars 1968, à 65 ans et repose au cimetière du Montparnasse, où Helen le rejoint en 1985 : Rien n’est fini, j’avance encore et je tâtonne - La terre est ivre d’eau, le feu retourne à l’air – L’hiver se fait printemps, l’été mûrit l’automne – Au bout du jour, la nuit me dresse à voir plus clair.
À lire : Commémorations (Tschann, 1937), Un jour et une nuit (Sagesse, 1938), Une île ou peut-être un rivage (HC, 1948), Enfin ces neufs poèmes (HC, 1949), Le jour sans fin (HC, 1949), Poèmes dus (Seghers, 1950), Jour après jour (Seghers, 1951), D’une suite sans fin (Seghers, 1953), Avec les mêmes mots (Seghers, 1954), Fidèle Infidèle (Seghers, 1955), Étapes (Seghers, 1956), Aurelia (Seghers, 1958), Les Pas recomptés, anthologie (Seghers, 1962), Éléments (Seghers, 1963), L'étape suivante (Seghers, 1964), Ici Repose (Fata Morgana, 1967), À Jacques Hérold (Fata Morgana, 1969), Ces pas d’une autre étape (HC, 1970).
À consulter : Michel Gourdet, Numéro spécial Claude Sernet (éditions Oxus, 2005). Claude Sernet (revue Aldebaran n°1/4, Bucarest, 2001).
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Illustration: Portrait du poète Claude Sernet (1931). Huile sur toile 55 x 46 cm, Coll. privée, de Grégoire MICHONZE.
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
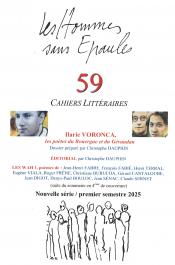
|
||
| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | ||
