François FABIE

François Fabié, né au Moulin de Roupeyrac à Durenque (Aveyron), le 3 novembre 1846, échappe à tous les mouvements littéraires de son temps, bien que publié par le Normand Lemerre, l’éditeur des Parnassiens, chante la terre, la nature et le monde paysan (mais il sait tout autant être mordant et satirique : Le vainqueur trouve doux de monter à cheval, - Escorté de bouchers galonnés qu’il appelle – Ses lieutenants, pour voir si sa victoire est belle, - Et si la mort a bien travaillé dans le val) et se décrit humblement : Tandis que dédaigneux du travail nourricier, - Loin du sol dont pourtant j’avais reçu la sève, - Je labourais le champ infertile du rêve – Avec le frêle soc d’une plume d’acier. – Il traçait des sillons dans la plaine muette, - J’alignais des mots creux en longs alexandrins ; - Et tous deux nous jetions notre cœur et nos grains – Lui, laboureur, et moi, poète.
En 1872, Fabié devient professeur de littérature au lycée de Toulon. Il s´y marie et y publie son premier livre de poésie, La Poésie des bêtes. En 1883, il est nommé professeur au lycée Charlemagne à Paris et plus tard il devient directeur de l’École primaire supérieure Colbert. En 1908, il prend sa retraite dans le village de La Valette-du-Var à côté de Toulon d’où est native sa femme. François Fabié, le poète du terroir rouergat, pique en 1887 une grosse colère et l’écrit : Non, il n’a pas vécu chez ceux qu’il injurie, - L’auteur du livre infâme où tous nos paysans – Sont des brutes creusant le sol avec furie – Afin d’y mieux cacher leurs rut avilissants… - Cynique romancier, laisse-les sous leurs chênes, - Ne trouble pas leur air des senteurs de Paris…
En Aveyron « on ne doit pas toucher » aux paysans, à Dieu et à la religion. Fabié réagit à la publication du roman d’Émile Zola, La Terre, le quinzième volume de sa série des Rougon-Macquart. L’intrigue ne se situe pas (mais elle aurait pu) dans l’Aveyron, mais dans la Beauce. Ce roman est l’un des plus coriaces de l’auteur, qui y dresse un portrait féroce (rejoignant des réflexions de Jean Mazenq comme d’Ilarie Voronca) et sans concession du monde paysan de la fin du XIXe siècle, âpre au gain, dévoré d’une passion pour la terre qui peut aller jusqu’au crime. Dans son ébauche, Zola écrit : « La terre. C’est l’héroïne de mon livre. La terre nourricière, la terre qui donne vie et qui la reprend, impassible. Un personnage énorme, toujours présent, emplissant le livre. L’homme, le paysan, n’est qu’un insecte s’agitant sur elle, peinant pour lui arracher sa vie ; il est courbé, il ne voit que le gain à en tirer, il ne voit pas le paysage. Il faut que mes personnages soient tous emplis de la passion de la terre… »
Zola écrit encore dans une lettre adressée à Van Kolff, le 27 mai 1886 : « Je veux faire tenir tous mes paysans, avec leur histoire, leurs mœurs, leur rôle, j’y veux poser la question sociale de la propriété, j’y veux montrer où nous allons, dans cette crise de l’agriculture, si grave en ce moment. Toutes les fois maintenant que j’entreprends une étude, je me heurte au socialisme. Je voudrais faire pour le paysan avec la Terre, ce que j’ai fait pour l’ouvrier avec Germinal. Ajoutez que j’entends rester artiste, écrivain, écrire le poème vivant de la terre, les saisons, les travaux des champs, les gens, les bêtes, la campagne entière. »
De quelle crise parle Zola ? De celle de deux conceptions de la paysannerie française qui s’affrontent au travers de la petite et de la grande propriété. Le cœur du roman est là, dans la question sociale de la propriété, dans la description intraitable de deux mondes qui coexistent sur un même territoire. Ce dont témoigne, dans le roman, cette réplique du fermier Hourdequin : « La lutte s’établit et s’aggrave entre la grande propriété et la petite… Les uns, comme moi, sont pour la grande, parce qu’elle paraît aller dans le sens du progrès, avec l’emploi de plus en plus larges machines, avec le roulement des gros capitaux… Les autres, au contraire, ne croient qu’à l’effort individuel et préconisent la petite, rêvent de je ne sais quelle culture en raccourci, chacun produisant son fumier lui-même et soignant son quart d’arpent, triant ses semences une à une, leur donnant la terre qu’elles demandent, élevant ensuite chaque plante à part sous cloche. Laquelle des deux l’emportera ? »
Zola se trompe-t-il ? Ils sont nombreux à le penser, dans la Beauce, en Aveyron et ailleurs, à l’instar de Fabié. Mais pas toutes et tous du côté des poètes aveyronnais issus et marqués par leur terre rurale, agricole. La question paysanne et celle de la nature les préoccupe et non seulement la célébration de la nature rouergate. Jean Digot écrit : D’autres disent J’ai faim J’ai soif – D’autres toujours chantent et dansent – Qui donc a décidé du choix ? Christine Burucoa ajoute : Mais l’homme n’entend plus que les bruits qu’il produit – Exilé du limon où germa sa semence – L’homme crie, entre exaltation et souffrance – L’homme n’a plus de terre où se laisser mourir.
Frédéric Jacques Temple, qui a passé son enfance entre les Grands Causses et les lagunes littorales : « Je suis né dans un milieu et un terroir paysan. Je ne veux pas dire que mes parents étaient des paysans, mais que mes arrière-grands-parents l’étaient encore. J’ai passé mon enfance près de la nature, assistant aux semailles, aux labours, aux moissons, à la tonte des moutons. J’ai pêché et chassé dans les marais du littoral, au milieu des oiseaux sauvages, familier des pêcheurs sur les étangs et la mer. Entre quinze et dix-neuf ans, j’ai même exploré les profondeurs de la terre, les grottes, les avens. J’ai, dans ces expériences, revécu en quelque sorte comme nos lointains ancêtres, attentifs aux sons, aux odeurs, aux mouvements de cette terre roulant sous le soleil et les étoiles. »
Et ce, jusqu’à notre Voronca : Vous vous résignez. Vous avez aussi la crainte du « trop tard ». Que pourra-t-il y avoir encore pour vous quand d’autres y sont déjà passés et ont rempli leurs poches ? Vous avez tort de penser de la sorte. N’est-il pas plus enviable celui qui vient dans un champ où tout a été déjà ramassé, que celui qui trouve l’abondance ? Celui-ci entasse tout, sans même se donner la peine de regarder autour de lui. Ses chariots geignent sous le faix des moissons. Mais pour celui qui vient ensuite, chaque caillou, chaque brin d’herbe reçoit de l’éclat et de la beauté. Alors que les sens du premier finissent par s’endormir, les sens du second s’affinent à tel point qu’ils savent non seulement reconnaître la valeur et le charme là où l’on s’attendait le moins, mais ils peuvent même inventer ceux-ci. Sur un fil de foin brillent les perles de l’azur. Des joyaux inestimables se montrent sur les feuilles et sur l’écorce des arbres. Il distingue peu à peu les signes magiques et les lettres qui sont écrites partout. Il s’habitue à lire le livre immense de l’univers. Chaque source, chaque cep de vigne, chaque colline, chaque montagne, est une parole que ses lèvres apprennent à prononcer. Il se remplit d’enseignements et le monde pénètre dans les oreilles et dans sa bouche comme un chant.
Car, à l’époque et bien davantage encore à la nôtre, l’humanité se grise de toutes ses accélérations, de ses prouesses prométhéennes. L’histoire planétaire en a été et en est bouleversée de fond en comble. Cette option non seulement aggrave le divorce entre les humains et la nature, mais elle se retourne contre celle-ci. Le poète Maurice Maeterlinck écrit en 1907 (in L’Intelligence des fleurs) : « Si la nature savait tout, si elle ne se trompait jamais, si en toutes ses entreprises elle se montrait d’emblée parfaite et infaillible, c’est alors qu’il y aurait lieu de craindre et de perdre courage. Nous nous sentirions la victime et la proie d’une puissance étrangère que nous n’aurions aucun espoir de connaître et de mesurer. Il est bien préférable de se convaincre que cette puissance est étroitement parente de la nôtre. Notre esprit puise au même réservoir que le sien. Nous sommes du même monde, presque entre égaux. Nous ne frayons plus avec des dieux inaccessibles mais avec des volontés voilées et fraternelles qu’il s’agit de surprendre et de diriger. » Maeterlinck écrit aussi (n’est-ce qu’une pirouette ?) : « Tout laisse présager que l’homme, le dernier venu sur cette terre, sera aussi le premier à la quitter, pour aller on ne sait pas encore où ? » Et encore : « Il est certain que si nous alignons nos bévues, nos imbécilités, nos illogismes à côté de ceux de la fourmi, la comparaison ne sera pas nécessairement à notre avantage. » François-Joseph Fabié, est mort le 18 juillet 1928 à La Valette-du-Var (Var).
Œuvres : La Poésie des bêtes (1878), Molière et Montespan, comédie en un acte, en vers (1882), Placet au roi, comédie en 1 acte, en vers (1884), Le Clocher, poèmes de Rouergue (Lemerre, 1887), La Bonne terre (Lemerre, 1889), Poésies, 3 volumes (Lemerre, 1891-1905), Voix rustiques (Lemerre, 1892), Vers la maison (1899), Ronces et lierres (Lemerre, 1912), Fleurs de genêts (Lemerre, 1920), La terre et les paysans, poèmes choisis (Lemerre, 1923), Souvenirs d’enfance et d’études (Éditions du Moulin de Roupeyrac, 1993), Choix de poèmes (Les Amis de François Fabié, 1971), Les poèmes des troènes (Édisud, 2001).
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
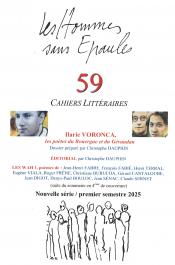
|
||
| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | ||
