Jean-Henri FABRE

L’Aveyronnais Jean-Henri Fabre est le « philosophe entomologique », l’« Homère des insectes », selon Victor Hugo. Jean-Henri Fabre, cet homme d’une envergure d’exception, est aussi un « félibre » dont le premier livre de poèmes paraît en 1909 : Oubreto Prouvençalo dóu Felibre di Tavan, rambaiado pèr J.H. Fabre. Il est surnommé Félibre di Tavan (Poète des Hannetons, en Provençal). Les Poésies françaises et provençales, de Jean-Henri Fabre, ont reparu en 1980 chez Marcel Petit. « Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s’exprime en poète » ; c’est ainsi que le biologiste Jean Rostand qualifie Jean-Henri Fabre. Son père, Edmond Rostand, le consacre « Virgile des insectes » et lui dédie en 1911 une série de huit sonnets : « Fabre des insectes ». Admiré par le poète et dramaturge belge Maurice Maeterlinck, Henri Bergson ou Stéphane Mallarmé, Fabre entretient une correspondance avec le philosophe anglais Stuart Mill et, surtout, avec Charles Darwin, lequel, en 1859, a pressenti son génie, le citant dans l’Origine des espèces et le sacrant « inimitable observer » (observateur incomparable).
Mais, Fabre n’admet toutefois pas la théorie de l’évolution, car elle va à l’encontre de la religion, très prégnante en Aveyron. Jean-Henri Fabre a fait œuvre de pédagogue en rédigeant près d’une centaine d’ouvrages, dont scolaires, dans plus de dix matières. C’est surtout en publiant ses Souvenirs entomologiques (quatre mille pages publiées en dix séries de 1879 à 1907), qu’il a sensibilisé le grand public au monde et à la vie des insectes. Traduits dans quinze langues, les Souvenirs ont été réédités en 1989 en deux volumes dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Ces souvenirs constituent une œuvre exceptionnelle, à la fois sur les plans littéraire et scientifique. Les recherches de Fabre touchent à l’entomologie (branche de la zoologie dont l’objet est l’étude des insectes), la botanique (l’étude des végétaux), la chimie organique (qui étudie les composés organiques, c’est-à-dire les composés du carbone), la mycologie (l’étude les champignons) et la biologie (la science du vivant, qui recouvre une partie des sciences de la nature et de l’histoire naturelle des êtres vivants). Fabre est enfin reconnu comme l’un des grands précurseurs de l’éthologie, qui est l’étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l’humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification des comportements animaux.
Fabre nous dit (in Botanique, 1895, chapitre « Respiration des plantes ») : « 1. Tout être organisé respire. ― Dans la plante aussi bien que dans l’animal, dans tout être organisé enfin, la vie s’entretient par une continuelle destruction, par une combustion lente au moyen du gaz vital ou oxygène. Pour être vivante, la matière doit être sans cesse consumée et sans cesse renouvelée. Pour donner lumière et chaleur, pour être en quelque sorte vivante, la lampe doit sans relâche consumer sa substance, son huile, et sans relâche la renouveler dans la flamme. Ainsi de la vie : la nutrition renouvelle la substance disparue, la respiration consume la substance acquise, et de leur perpétuel conflit résulte l’activité de l’être vivant. Vivre c’est se consumer. Pas une fibre ne fonctionne dans l’animal, pas une cellule n’accomplit son travail dans la plante sans une perte de substance cédée au gaz vivifiant. Les plantes respirent comme les animaux : l’oxygène de l’air pénètre dans leurs tissus, y entretient l’excitation de la vie en brûlant leur charbon, et devient acide carbonique qui s’exhale dans l’atmosphère. Il y a de la sorte entre les végétaux et l’atmosphère un double échange gazeux, l’un relatif à la nutrition, qui renouvelle la substance, l’autre relatif à la respiration, qui la détruit. 3. Respiration des plantes. ― Puisque respirer, c’est dépenser sa substance pour l’entretien de la combustion vitale, nous appellerons respiration des plantes le second échange gazeux entre les végétaux et l’air. Ici l’atmosphère fournit à la plante de l’oxygène, qui lentement consume les tissus et entretient ainsi leur vitalité ; la plante fournit à l’atmosphère l’acide carbonique qui résulte de cette combustion. L’échange respiratoire est donc exactement l’inverse de l’échange nutritif. Il est en outre continu et non périodique et subordonné à la présence du soleil. De nuit comme de jour, dans une profonde obscurité comme à la lumière, la plante respire : elle absorbe de l’oxygène et rejette du gaz carbonique ; elle se comporte enfin comme l’animal, dont la respiration peut s’accélérer ou se ralentir, mais ne s’arrête jamais tant que la vie est présente. Toutes les parties de la plante indistinctement, vertes ou non vertes, aériennes ou souterraines, consomment de l’oxygène. Il en faut aux feuilles, il en faut aux racines, à la graine qui germe, à la fleur qui s’épanouit, aux semences qui mûrissent, aux bourgeons qui se développent, au tubercule qui alimente ses pousses. En l’absence de ce gaz, la vie végétale s’éteint, comme s’éteint la vie animale. Une plante meurt dans une atmosphère d’acide carbonique, sa principale nourriture cependant ; elle périt dans tout milieu dépourvu d’oxygène, ou non suffisamment pourvu… Souvenons-nous d’ailleurs que la majeure partie du charbon dont les végétaux se composent, provient de l’atmosphère où il se trouvait à l’état de gaz carbonique. Par cela seul qu’il s’accroît, un arbre est donc une cause d’épuration pour l’air. Le résultat général de la végétation est ainsi de l’oxygène en plus dans l’atmosphère et de l’acide carbonique en moins. Toujours troublée par la vie de l’animal, la salubrité aérienne est toujours rétablie par la vie de la plante. »
Jean-Henri Fabre, né à Saint-Léons (Lévézou), le 21 décembre 1823, dans un milieu modeste, obtient en 1844, à Montpellier, le baccalauréat ès-lettres, en 1846 le baccalauréat en mathématiques, en 1847 la licence de sciences mathématiques, en 1848 la licence de sciences physiques et en juillet 1854, il est reçu à la licence ès-sciences naturelles. L’Aveyronnais Fabre est et demeurera toujours d’une grande simplicité. Il est nommé professeur de physique au collège impérial d’Ajaccio, le 22 janvier 1849. Fabre prépare un doctorat. Son sujet de thèse principal : Recherche sur l’anatomie des organes reproducteurs et sur le développement des myriapodes (le « mille-pattes »), et son sujet secondaire, sur la botanique : Recherche sur les tubercules de l’Himantoglossum hircinum (une espèce d’orchidées). En 1865, Louis Pasteur le consulte pour tenter de sauver l’industrie séricicole française. Les vers à soie sont décimés par une désastreuse épidémie. La rencontre est fertile puisque Pasteur parvient ensuite à enrayer l’épidémie.
Le 10 juillet 1867, la Loi Duruy pour la démocratisation de l’enseignement laïque, notamment l’accès des jeunes filles à l’instruction secondaire, déclenche une cabale des cléricaux et des conservateurs, obligeant le ministre à démissionner. Accusés par certains moralisateurs d’avoir « osé expliquer la fécondation des fleurs devant des jeunes filles jugées innocentes », les cours du soir de Fabre, à Avignon, sont supprimés après deux années d’existence. Fabre est dénoncé comme étant subversif et dangereux. Révolté, il démissionne de son poste au lycée. Malgré ses vingt-huit ans de service, il quitte l’enseignement sans obtenir de pension. Ses bailleuses, deux vieilles bigotes, convaincues de son immoralité, le mettent en demeure de quitter la rue des Teinturiers. Fabre reçoit la visite d’un huissier pour être expulsé dans le mois, avec sa femme et ses enfants.
C’est grâce à l’aide de Stuart Mill, qui lui avance la somme de trois mille francs, que Fabre et sa famille peuvent s’installer à Orange, en novembre 1870. Sa plume lui permet de sortir de la misère, notamment grâce au succès remporté de deux livres destinés à la jeunesse, Le Ciel, et Histoire de la bûche ; récits sur la vie des plantes, édités par la librairie Garnier en 1867. Son propriétaire fait élaguer l’allée de platanes qui conduit à sa maison. Fabre l’insoumis l’accuse d’acte de barbarie et quitte Orange. En mars 1879, grâce à l’argent que lui rapportent ses livres, Fabre achète une propriété, à huit kilomètres d’Orange, sur une terre non cultivée, qu’il nomme l’Harmas, à la sortie du village de Sérignan-du-Comtat. Il peut enfin se consacrer à son projet de toujours : l’observation des insectes et faire de l’Harmas de Sérignan le premier laboratoire vivant de la nature et de l’entomologie.
Alité à cause de crises d’urémie, Jean-Henri Fabre s’éteint le 11 octobre 1915, âgé de 91 ans.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
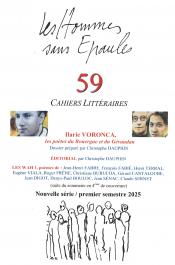
|
||
| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | ||
