Malik OUSSEKINE

Malik Oussekine, Poème (écrit en décembre 1986), suivi de "Le Mouvement de 1986, Malik Oussekine et Abdel Benyahia".
MALIK OUSSEKINE
Les dés sont jetés dans les entrailles du paysage
La révolte n’avale pas sa colère
Ni la cendre son feu
Assemblée générale
Grève
Occupation des locaux
La rage n’avale pas son fer à souder
Ni la pierre son rêve de rivière
Première manif
tracts
banderoles
et pancartes
Hiver 86
La pluie crache l’ancre d’un soleil noir
Et serre les poings au fond d’une impasse
Fleurie d’oiseaux-cicatrices
Grève reconductible
Jusqu’au retrait du projet de loi Devaquet
Dans le cortège
Tes yeux sont un bûcher public
Qui embrase les boulevards de Paris
La joie est blonde comme un couteau
Entre les doigts d’ortie de la certitude
Génération
Ma foule ma multitude
J’entends battre ton sang
Dans les oreilles sourdes du monde
Mon je mon nous
Tu n’es pas la génération bof atteinte de sida mental
Dont parle Louis Pauwels
Tu es celle que l’on n’attendait pas
Tes yeux sont décorés par l’amour
Le ciel dans la gorge comme un cri
La rue nous appartient enfin
Et déborde des trottoirs de la Seine
Pour raser la fausse barbe de la vie
Barricade en haut du boulevard Saint-Michel
Évacuation les C.R.S.
La Sorbonne
Est prise la tête dans le sac
Repli sur le Quartier latin
Avec la haute mer
Dans un bocal d’arracheurs de dents
Le sang creuse l’œil dans l’oreille
Le temps dort debout en cale sèche
Paris ignore encore
Ce que sera cette nuit du 5 au 6 décembre 1986
Matraques sur les vertèbres des étoiles
Le poumon vomit son goudron
Les chiens sont lâchés
La nuit est armée
Quarante-huit motos de trial rouge vif
Sirènes hurlantes
Vrombissements
Les motos giclent d’une rue à l’autre
Et zigzaguent sur nos vertèbres
Sur chaque moto deux flics
L’un conduit l’autre joue de la matraque
Du « bidule »
Avec la corde de ses nerfs
Matraques !
Nous courons comme des crachats
Des slogans
Des mots
Des émotions
Nous courons comme des Maghrébins
Des Juifs
Des communistes
Des jeunes de 18 ans
Le gibier du soir
Nous courons jusqu’au naufrage du souffle
Insectes du sang
Ils matraquent le ciel
Qui tombe en bas de l’escalier
Ils piétinent les yeux du désir
Nous titubons dans les caves du tympan
Qu’ils viennent de crever
Ils lacrymogènent les arbres
Ils savatent la pluie
L’air se déchire
Matraques
À marée haute
À marée basse
Une comète s’écrase
Derrière la scie des toits
Matraques du monde
Les chiens sont à nouveau lâchés
La nuit est toujours armée
Un cocktail Molotov sort d’un platane
Une moto embrasse le bitume
Deux chiens à terre
Pavés dans leurs gueules !
Matraques de Paris
de Berlin
de Rome
de Moscou
de Varsovie
de Santiago
de Soweto
et d’ailleurs
Matraques
Nous valons bien nos frères
Que vous vous avez si bien schlagués hier
Tir tendu
Énucléation de l’œil
Fracas de la face
La pluie lèche les fleurs noires de leurs plaies
Qui sont aussi les nôtres
Fracture de la base du crâne
Enfoncement orbitaire
Amputation d’un membre
Malik !
Les matraques peuplent notre nuit
Jusque dans les halls des immeubles
Matraques
Dans le hall du 20 rue Monsieur-le-Prince
Sur le jeune homme à terre
Sur Malik Oussekine
Les yeux révulsés
Le visage tuméfié
Matraques
Qui tapent avec délice
Qui écrasent avec haine
Qui cassent jusqu’à l’orgasme
Matraques sur moi
Sur nous
Sur lui
Matraques
Deux matraques
Qui cognent
Qui cognent jusqu’à la mort
La mort de Malik
De Malik Oussekine
Malik Oussekine
Vingt-deux ans
Et les yeux morts de la Méditerranée
Pour tout sourire
Malik Oussekine a été assassiné cette nuit
Au matin du 6 décembre 1986
Place Saint-Michel
La vie nous tombe des mains
Comme un pavé
Qui roule dans les faubourgs noirs de la rage
Malik Oussekine a été assassiné cette nuit
Le jour se démantèle dans les os
D’un petit matin de brouillard
Que je n’oublierai pas
Malik Oussekine est mort hier soir
Assassiné comme les yeux bleus de la Méditerranée.
Christophe DAUPHIN
Paris, décembre 1986
LE MOUVEMENT DE 1986, MALIK OUSSEKINE ET ABDEL BENYAHIA
Louis Pauwels, le directeur du Figaro Magazine, écrit dans son éditorial « Le Monome des zombies », du 6 décembre 1986 : « Ce sont les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats nourris de soupe infra idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de Touche pas à mon pote. Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. Leur rêve est un monde indifférencié où végéter tièdement. Ils sont ivres d’une générosité au degré zéro, qui ressemble à de l’amour mais se retourne contre tout exemple ou projet d’ordre... C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. Elle a perdu ses immunités naturelles ; tous les virus décomposants l’atteignent. Nous nous demandons ce qui se passe dans leurs têtes. Rien, mais ce rien les dévore… ».
La formule est restée, extrêmement violente, car notre vie sexuelle a commencé en même temps qu’apparaissaient les premiers cas de sida : nous étions des individus, une génération vivant avec le VIH. Nous étions toutes et tous affectés par le sida. En France, notre « génération sida » est entrée dans la sexualité après que les multithérapies, à partir de 1996-1997, ont reculé pour la majorité des malades l’échéance de la mort et diffracté l’expérience de la maladie.
Le Mouvement de 1986
Que s’est-il passé pour que Pauwels se déchaîne contre ma génération ? En novembre et décembre 1986, la « génération-bof » est devenue un important mouvement étudiant et lycéen (plus d’un million trois cents mille personnes) qui secoue la France en s’opposant au gouvernement de Jacques Chirac et au projet de loi dit Devaquet, du nom du ministre délégué à l’enseignement supérieur. Cette loi, adoptée le 11 juillet en Conseil des ministres et devant être étudié par le Parlement en octobre, prévoit notamment de permettre la sélection des étudiants à l’entrée à l’université, en fonction des besoins du marché, des capacités d’accueil des établissements, mais des performances scolaires des futurs étudiants. La dérégulation des frais d’inscription… Une perspective inacceptable
Le samedi 23 novembre 1986, 200.000 étudiants en grève venus de toute la France manifestent à Paris. Le mouvement de 1986 est lancé. J’y suis avec d’autres amis de la cité des Fossés-Jean. Les quartiers populaires ? Oui, ils en sont de la manif et des suivantes aussi. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : cherchez l’erreur ! Ils sont tellement repliés dans la cité où l’État aime les savoir confinés, qu’une réforme de l’université les laisse indifférents. Cela ne les concerne pas, selon eux. Ont-ils torts ?
Le 26 novembre, une trentaine de militants d’extrême droite du Groupe union défense (GUD) attaquent une assemblée générale à l’Université de Jussieu qui prépare la manifestation étudiante du lendemain, puis, à nouveau, par une centaine de militants armés de barres de fer et casqués, à coups de cocktails Molotov. Le 3 décembre, le GUD attaque la Sorbonne. Les affrontements avec l’extrême-droite sont fréquents et violents sur le plan des idées mais aussi sur le plan physique.
Jeudi 27 novembre est une nouvelle journée de mobilisation, avec les lycéens qui entrent dans la « danse ». L’affluence est estimée à 500.000 manifestants à Paris et un million dans toute la France. Le gouvernement Chirac s’inquiète et décide de renvoyer le texte en cours de discussion à l’Assemblée nationale devant la commission des Affaires culturelles.
Les cortèges tout comme l’organisation des coordinations d’étudiants et de lycéens, sont impressionnants. Le mouvement de 1986 est marqué par la volonté des lycéens et des étudiants de conserver une indépendance, conduisant à la formation d’une coordination nationale de délégués élus dans chaque université.
Chaque assemblée générale s’organise à sa manière. Nationalement, une coordination est mise en place. Elle regroupe des représentants des universités et lycées grévistes. Cette forme « d’auto-organisation » n’est pas une nouveauté, elle fait partie du répertoire d’action collectif lycéen et étudiant depuis l’après 1968.
Le 4 décembre 1986 a lieu la manifestation monstre, la plus importante du mouvement, à Paris entre Bastille et Invalides. La mobilisation est sans précédent depuis les « années 1968 ». Le slogan phare est toujours le même : « Devaquet, si tu savais, ta réforme, ta réforme, Devaquet, si tu savais, ta réforme où on se le met… » Il y a 150.000 personnes selon la police, 1 million pour nous, lycéens et étudiants poussés dans la rue par le projet de loi Devaquet.
Le mouvement, ainsi que le seront les Gilets Jaunes, entend être « apolitique », avec une volonté farouche d’indépendance vis-à-vis des partis. L’un des slogans est explicite : « Nous, on se manipule tout seuls ! » Toutefois, la répression policière politise de fait les étudiants et les lycéens confrontés à l’appareil d’État, et en quelques jours on passe de l’apolitisme revendiqué initial à des revendications antigouvernementales, de la simple opposition aux mesures sélectives à une remise en cause de l’université tel quel est.
La manifestation dégénère sur l’esplanade des Invalides, après l’annonce de l’échec de la rencontre entre la coordination et les ministres. C’est l’heure des tirs tendus et des premières grenades lacrymogènes, qui explosent avec nos yeux. On tousse, on pleure. Autour de moi, dans un nuage opaque émergent les silhouettes de ceux qui lancent des objets vers des hommes casqués, les CRS, qui vont charger. Il est temps de courir.
Nombreux sont ceux de ma génération qui découvrent à l’occasion du mouvement ce que peut être la violence policière. Nous, en banlieue, nous « nageons » dans la violence sociale que les familles de nombre d’entre nos subissent : ne pas y arriver à boucler les fins de mois et à vivre dignement. La violence policière avec ses descentes, fait naturellement partie de notre paysage. Nous subissons de fait et la violence sociale et la violence policière. Mais cette dernière est sans commune mesure avec ce que subirons en banlieue les générations suivantes, puis les Gilets Jaunes. Pour l’instant à Paris, je cours.
Le bilan est de plusieurs dizaines de blessés de part et d’autre, dont deux manifestants grièvement atteints, dont une main arrachée. Libération résume la journée : « 800.000 dans la rue et la matraque au bout. » Sous la supervision de Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur, à l’origine de lois anti-immigrés, et de son alter ego Robert Pandraud, ancien directeur de la police nationale et ministre délégué à la Sécurité, la répression est brutale, comme en témoignent les violents affrontements entre jeunes et forces de l’ordre qui émaillent quotidiennement les manifestations. Les CRS chargent une dernière fois à 22 h 30, après avoir lancé des grenades lacrymogènes. Le pire sera pour le lendemain.
Ils ont tué Malik !
Le lendemain, 5 décembre 1986, une manifestation « sauvage » part de La Sorbonne pour un défilé sur la rive droite avant d’y revenir dans l’après-midi, sans incidents. Les portes de la Sorbonne sont enfoncées et une partie des 2.500 manifestants y pénètrent. Vers 22 h, il reste moins de 400 personnes. Dans la nuit du 5 décembre au 6 décembre, les CRS reçoivent, à une heure du matin, l’ordre d’évacuer les étudiants qui occupent encore La Sorbonne. Cela est fait en vingt minutes, sans résistance.
Un autre ordre est donné à minuit au peloton des Voltigeurs motoportés : faire des rondes pour rechercher de prétendus « casseurs » au Quartier latin. Il s’agit d’une carte blanche pour une « chasse aux jeunes ». Le binôme type du peloton des Voltigeurs motoportés : deux policiers montés sur une moto tout terrain. L’un conduit. L’autre, assis derrière, est armé d’une matraque appelée « le bidule ». Ils ont pour mission de « nettoyer » les rues après les manifestations en pourchassant les « casseurs ». Le peloton a été créé en 1969 à l’initiative de Raymond Marcelin, ministre de l’Intérieur à la suite des manifestations de Mai 68.
À minuit, à l’heure ou le peloton de Voltigeurs motoportés reçoit l’ordre de faire mouvement, Malik Oussekine, vingt-deux ans, étudiant sans histoire et sans relation avec le mouvement de 86, sort d’une boîte de jazz, lorsqu’il est repéré et pris en chasse par trois policiers du peloton des Voltigeurs motoportés.
Malik parvient à se faire ouvrir la porte d’un immeuble, 20 rue Monsieur-le-Prince, pour s’y réfugier. Mais, trop tard, car deux des policiers à sa poursuite parviennent à pénétrer dans le hall. Malik est mis à terre et aussitôt roué de coups de pied et de matraque, dans le ventre et dans le dos, de toutes leurs forces, par les deux policiers, alors que le troisième monte la garde dehors. Malik est à terre, en sang, inanimé. Les policiers quittent le hall de leur boucherie.
Seul témoin du drame, Paul Bayzelon, qui a ouvert la porte à Malik, fonctionnaire au ministère des Finances, habitant de l’immeuble, témoigne : « Je rentrais chez moi. Au moment de refermer la porte après avoir composé le code, je vois le visage affolé d’un jeune homme. Je le fais passer et je veux refermer la porte… Deux policiers s’engouffrent dans le hall, se précipitent sur Malik, réfugié au fond et le frappent avec une violence incroyable. Il est tombé, ils ont continué à frapper à coups de pieds dans le ventre et de matraque dans le dos. La victime se contentait de crier : « Je n’ai rien fait, je n’ai rien fait ».
Paul Bayzelon dit avoir voulu s’interposer, mais s’être fait lui-même matraquer, jusqu’au moment où il a sorti sa carte de fonctionnaire. Dix minutes plus tard, le SAMU, arrive et apporte les premiers soins, puis transporte Malik Oussekine en réanimation aux urgences chirurgie à l’hôpital Cochin, où il est déclaré officiellement décédé à 3 h 20. Malik est en réalité décédé dans le hall de l’immeuble de son martyr.
Les manifestants blessés (150 blessés dont six graves, mutilés), les manifestations importantes à répétions et à présent la mort de Malik Oussekine... Alain Devaquet, le ministre délégué chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur, démissionne immédiatement.
Le 6 décembre, en début d’après-midi, une première marche silencieuse en hommage à Malik, part de la Sorbonne jusqu’à la place d’Italie via l’hôpital Cochin. Certains portent des pancartes : « Ils ont tué Malik ». Les messages et les bouquets de fleurs commencent à s’amonceler devant le hall du 20 rue Monsieur-le-Prince. Robert Pandraud, le 7 décembre, déclare au journal Le Monde : « La mort d’un jeune homme est toujours regrettable, mais je suis père de famille, et si j’avais un fils sous dialyse, je l’empêcherais de faire le con dans la nuit. » Ces propos insultants déclenchent une avalanche de réactions de colère.
La mort de Malik provoque une tempête au plus haut niveau de l’État, devient une affaire nationale, politique, qui cristallise notre colère, les jeunes, contre la police. Nous attendons la justice pour Malik et pour Abdel, dont nous avons appris dans un deuxième temps (après l’émotion suscitée par la mort de Malik Oussekine, la police ne veut pas ébruiter cette nouvelle « bavure »), la mort, lui aussi au cours de cette même nuit du 5 au 6 décembre 1986, à Pantin, et par un policier.
Ils ont tué Abdel Benyyahia
Le meurtre de Malik est un crime abject qui donnera lieu à un déni de justice. On peut en dire autant de celui d’Abdelwahab Benyahia, dont la mort est « reléguée » à un fait divers de banlieue et « éclipsée » par celle de Malik, qui est devenue une affaire d’État. Abdel Benyahia 20 ans, vivant à La Courneuve, venait de trouver un stage d’animateur sportif à la Villette (Paris). Une équipe TV était venue l’interviewer pendant le cours de tennis qu’il animait, quelques jours avant sa mort.
Le 5 décembre 1986, Abdel et un ami se rendent dans le bar Tout est bien aux Quatre Chemins, à Pantin, devant lequel une bagarre éclate. Abdel sort pour s’interposer. Un homme en civil sort également du bar, crie « police » et tire à bout portant. Abdel reçoit une balle dans la poitrine. La famille d’Abdel est prévenue, mais pendant 48 heures, la police, les hôpitaux et le Samu observent le silence. L’Inspection générale des services (IGS) va jusqu’à faire croire à la famille qu’Abdel est vivant.
Le meurtrier, Patrick Savrey, est un inspecteur de police judiciaire qui a fait usage de son arme et n’était pas en service. Il est remis en liberté. La famille outrée, se constitue partie civile, mais les avocats eux-mêmes n’auront accès au dossier que cinq jours plus tard. Ils découvriront que c’est sur réquisition du ministère de l’Intérieur que le juge d’instruction n’a pas délivré de mandat de dépôt à l’encontre du policier.
Patrick Savrey était ivre le soir où il a tué Abdel, avec 1.89 g d’alcool dans le sang. L’avocat de la famille d’Abdel l’apprendra tardivement, car le parquet de Bobigny délivre les informations au compte-gouttes. Grâce à la mobilisation de la famille et de proches, la requalification en homicide volontaire conduira à la condamnation de l’inspecteur à une peine de sept ans de prison avec sursis par le tribunal de Bobigny en 1988. On peut tuer et rester libre.
Le Premier ministre Jacques Chirac retire le projet de Loi Devaquet le 8 décembre 1986. Le mouvement social de 1986 a gagné, mais Malik Oussekine est mort. La version officielle veut qu’il ait succombé à une « décompensation cardiaque créée par l’état pathologique rénal antérieur du patient ». Malik souffrait des reins, et cela l’aurait tué selon l’institut médico-légal, qui « ne constate pas de traces de violences sur son corps. » La famille Oussekine a dépêché un médecin à l’hôpital le lendemain de l’annonce du décès. Le docteur Fortin n’a pu examiner le corps, mais l’apercevoir à travers une vitre. C’est suffisant pour qu’il remarque des hématomes sur le visage de Malik. L’avocat de la famille, Georges Kiejman, fait état de rapports du SAMU contradictoires avec la version officielle. Les médecins d’urgence constatent un hématome péri-auriculaire, un hématome suborbital, une fracture de la cloison nasale, une abrasion du nez et de la joue droite... Le procureur de la République rend publique l’autopsie et déclare que les « violences n’expliquent pas à elles seules le décès ». Pour Georges Kiejman, c'est pourtant suffisant : les violences, et leurs auteurs, sont responsables de la mort de Malik. La contre-expertise commandée par la famille infirme les premières conclusions, et établit un lien direct entre les coups portés et la mort de Malik, et révèle un hématome dans le dos et une plaie à la tête, passés sous silence lors de la première autopsie. Dès le 6 décembre 1986, je commence à écrire mon premier long poème « Malik Oussekine ».
Le 10 décembre à Paris, nous sommes six cent mille à manifester de Denfert-Rochereau à la Nation Plus d’un million de personnes rendent hommage à Malik Oussekine dans trente-six villes de France. Malik est enterré le 21 décembre au cimetière du Père Lachaise dans l’intimité familiale.
Le procès des Voltigeurs motoportés
Deux policiers de la brigade des voltigeurs sont inculpés. En janvier 1987 Christophe Garcia, gardien de la paix, reconnaît avoir été présent rue Monsieur-le-Prince le soir du 5 décembre. Il se souvient « avoir échangé des coups avec Malik », mais « ne parvient pas à identifier les collègues présents » à ses côtés. La même amnésie solidaire frappe Jean Schmitt, brigadier-chef voltigeur, quand il est inculpé en avril 1987. Le procès des policiers s’ouvre après trois ans d’enquête, le 22 janvier 1990.
Devant le tribunal de Paris, jeunes, étudiants et lycéens, nous sommes rassemblés pour protester contre les violences policières et réclamer justice pour Malik et sa famille. En face, les forces de l’ordre soutiennent sans aucun état d’âme leurs collègues « injustement accusés », selon leur tract. Pendant sept jours, la cour d’assises passe au crible les évènements de la rue Monsieur-le-Prince.
Le brigadier-chef Jean Schmitt (53 ans) et le gardien de la paix Christophe Garcia (23 ans), les deux voltigeurs directement impliqués dans la mort de Malik, sont jugés pour « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Le gardien de la paix Garcia admet avoir frappé de « trois coups » Malik, mais Jean Schmitt nie jusqu’à avoir pénétré dans l’immeuble.
Paul Bayzelon le seul témoin, lui aussi victime, témoigne formellement : « Ils le frappent, tous les deux, sur la tête à coups de matraque ! » Paul Bayzelon raconte comment il trouve une arme près du corps de Malik, celle du brigadier Schmitt. Et comment les policiers se mettent à le frapper à son tour après avoir récupéré l’arme en question. L’avocat général demande cinq ans de prison dont trois fermes contre les policiers, qui sont reconnus coupables de coups mortels le 28 janvier 1990. Mais la « justice » leur accorde des circonstances atténuantes.
La peine, symbolique, est un scandale et une honte : cinq et deux ans de prison avec sursis. Les deux policiers échappent à la prison, tout en étant demeurés libres durant les trois années qui avaient précédé le procès. Du côté de la famille Oussekine, c’est l’indignation. Leur avocat Georges Kiejman parle de verdict « pédagogique » pour les policiers, estimant que la responsabilité de la hiérarchie policière a été prise en compte.
Immédiatement un rassemblement des organisations étudiantes, dont l’UNEF et le MRAP, se tient sur les lieux du drame pour protester contre le verdict. Sarah, la sœur de Malik déclare : « Après la parodie de procès ..., je me suis rendu compte que, dans ce pays qui est le mien, où je suis née, je serai toujours une citoyenne de deuxième zone », déclare bien plus tard la sœur de la victime. »
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
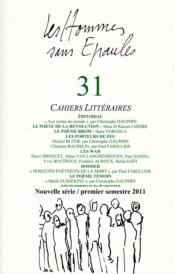
|
||
| Dossier : HORIZONS POÉTIQUES DE LA MORT n° 31 | ||
