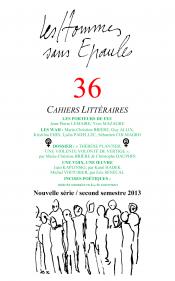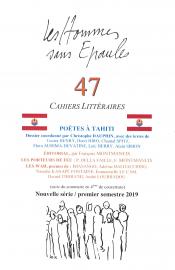Patrice CAUDA

Patrice Cauda (né à Arles en 1922) est un jeune homme de dix-sept ans lorsqu’il rencontre en 1939 Henri Rode, son aîné de cinq ans, qui témoigne (in Journal vert, 1946, inédit) : « Il tournait comme une flamme autour de la poste ou sautillait dans l’avenue pleine de moelle noire conduisant l’hôtel Dominion. Il a été singulièrement mêlé à mon essence qui l’a compris et aimé sans à proprement dire se mêler à lui. Mutuellement nous nous sommes certainement imposés dans le sens de la négation ; nos terrains étaient propices. Nous savons que nous existons l’un pour l’autre sans que cela forme une évidence pour le commun non plus qu’à l’enchaînement de de fait de nos jours. Pourtant il n’est pas un de nos actes qui n’ait été influencé par notre amitié à distance dans une espèce de fatalité jumelle. » Henri Rode entretient déjà une correspondance avec de nombreux écrivains : Jean Paulhan, François Mauriac, Julien Green, André Malraux, André Gide ou Jean Cocteau, tout en cédant pleinement à sa vocation : « Écrire une fiction romanesque est le fait de l’apprenti-sorcier. On veut créer son monde dans la création, ce monstre qui nous entoure de tentacules plus ou moins venimeux. Prétentieuse démangeaison. » Henri a en outre déjà publié un recueil de nouvelles : Le Puits des scrupules (1937).
Rode écrit furieusement (journaux, nouvelles, récits, et déjà, quelques poèmes), mais surtout il vit, fume, sort, boit, lit, et, aîné, ami, éveilleur, entraîne Cauda avec lui. Il est donc le mieux placé pour décrire l’ambiance de l’époque, son état d’esprit et celui de ses jeunes amis : « Avec Patrice Cauda et d’autres amis, nous étions particulièrement en veine de tout bruler, tout insulter, tout casser, de déchaîner nos instincts, un jour qu'Alain Borne était là. Les verres se vidaient ou volaient, avec les disques et des objets, par la fenêtre. Borne était-il effaré ? Je le revois, un verre à la main, assistant à notre happening déchaîné, son regard de miroir sombre nous comprenant – sans nous juger. Patrice Cauda délirant – il reconnaissait soudain en Borne le pouvoir d’une idole impavide – finit par se jeter contre son épaule, où il sanglota, ce qu’Alain supporta stoïquement… »
Alors qu'Henri Rode s’investit dans la littérature ; littérature de la résistance. Patrice Cauda, plus jeune est incorporé dans les Chantiers de jeunesse, qui de 1940 à 1944, sous le régime de Vichy, ont vocation à remplacer le service militaire obligatoire, désormais interdit. Le service du travail obligatoire (STO) est instauré en février 1943. Il mobilise la classe d’âge de 1942 dont une partie, vingt-quatre mille hommes, est présente dans les Chantiers de jeunesse.
Près de seize mille trois cents jeunes des Chantiers sont envoyés en Allemagne, alors que les autres, dont fait partie Patrice Cauda, restant sur le sol français, sont réquisitionnés et répartis dans des usines elles-mêmes réquisitionnées pour « l’effort de guerre allemand ».
C’est ainsi que Patrice Cauda se retrouve à Tulle, en 1944, à devoir travailler à la MAT (manufacture d'armes de Tulle), et c’est dans ce contexte qu’il fut l’un des témoins impuissants du Massacre de Tulle, et même d’après Jean Breton et Henri Rode, qu’il faillit lui-même être l’une des victimes de la barbarie nazie : « … Alain Borne cachait mal cependant l’odeur de la mort, qui rôde (notre ami, le poète Patrice Cauda, prisonnier des Allemands, devait, un peu plus tard, arriver l’avant-dernier des pendus de Tulle et échapper de peu à la pendaison, ouf !) ».
Dans la soirée du 8 juin 1944, de Montauban, la 2e division blindée SS Das Reich entre dans Tulle, après une offensive, une tentative de libération de la ville, des Francs-Tireurs et Partisans, durant laquelle quarante soldats allemands ont été tués.
Le 9 juin au matin, à l’issue d’une gigantesque rafle, près de cinq mille civils (sur une population de vingt mille habitants), des hommes de seize à soixante ans, des civils, les employés de la MAT, dont Patrice Cauda et les jeunes des Chantiers, sont arrêtés.
Une affiche est placardée à seize heures : « … Pour les maquis et ceux qui les aident, il n’y a qu’une peine : le supplice et la pendaison. Ils ne connaissent pas le combat ouvert, ils n’ont pas le sentiment de l’honneur. Quarante soldats allemands ont été assassinés par le maquis, cent vingt maquis et leurs complices seront pendus. Leurs corps seront jetés dans le fleuve… » Les Allemands s’apprêtent, à l’exception d’un seul résistant, à exécuter des civils qui n’ont pas pris part aux combats des 7 et 8 juin. Le message de leur affiche vise à justifier l’injustifiable : leurs crimes. Le but est de propager la terreur au sein de la population civile, pour éviter d’autres tentatives de libération de villes par les maquis. La sélection des cent vingt victimes se fait dans un climat arbitraire et cruel.
Les cent vingt condamnés finissent par être désignés. Patrice Cauda en fait partie : Mon dernier lit se prépare – Sous les empreintes de mes pas – Pour me reprendre ma naissance. Quatre-vingt-dix-neuf hommes de dix-sept à quarante-deux ans sont pendus aux balcons et aux réverbères de la ville sous les yeux de la population : Il ne reste qu’une pierre à leur bouche tordue. Patrice Cauda fait partie des vingt et un rescapés.
Le 10 juin, une part de la division Das Reich s’apprête à prendre le chemin d’Oradour-sur-Glane. Une nouvelle tragédie est en marche, alors qu’à Tulle, trois cent onze hommes, dont Patrice Cauda et les jeunes des Chantiers de jeunesse, sont transférés à Limoges. Après un nouveau tri, cent soixante-deux hommes, dont Patrice Cauda et tous les membres des Chantiers de jeunesse sont libérés, alors que cent quarante-neuf hommes sont transférés à Poitiers, puis à Compiègne, d’où ils sont déportés à Dachau le 2 juillet. Des cent quarante-neuf Tullistes déportés, 101 ne reviendront pas.
Patrice Cauda demeurera, n’étant pas homme à se livrer, très discret sur ces faits. Nous ne trouvons aucune allusion directe à cette tragédie dans son œuvre publiée, ou plutôt si : Je pends mon corps à la ville qui meurt. Nous ne trouvons que cela (notamment dans les poèmes de jeunesse qui sont demeurés inédits) ; car son œuvre sera placée sous le signe de l’angoisse : Détresse inutile pour une fleur déchiquetée. On dirait que Patrice Cauda, homme désormais brisé, poète de la désillusion même, écrira Jean Breton : « se sent élu par le malheur pour protester au nom de l’homme et de l’humanité entière contre son injustice. » Mais Cauda exige que l’homme fasse abandon de tous ses préjugés, ses fausses vanités, son érudition vaine pour retrouver la mesure du cri : Plus forte que le silence toujours une voix – Répète l’ordre de vivre au corps fourbu.
Les premiers poème aboutis de Patrice sont écrits après les horreurs de Seconde Guerre mondiale, sous le coup d’une nouvelle douleur insupportable ; un séisme pour Cauda : la mort de sa mère, qui n’avait jamais connu le bonheur : « la mère défigurée » (Elle faisait des ménages – d’autres faisaient l’amour – nous l’attendions harcelants – nous étions ses amants aux froides caresses) et c’est toute sa vie, son métier ingrat à venir, ses rêves mêmes, que Patrice Cauda engagera dans l’éblouissement de la page blanche, avec un beau mépris du danger et de l’opinion d’autrui : « Le sang du rêve a tous les droits – quand l’or irise les épines. » La douleur chemine sous la peau du poète, elle creuse et s’élargit, elle semble ne pas avoir de frontières.
Après la Libération, Cauda, à Avignon, est présenté par Henri Rode au groupe des Hommes sans Épaules. Il ne tarde pas à y faire figure de prodige, de « poète le plus talentueux, le plus doué du groupe », de l’aveu même de son animateur, le poète de L’Été des corps. Il en sera également « l’enfant terrible ». Cauda revient de loin (le massacre de Tulle), car il part de loin : orphelin, élevé dans la chaleur mais la pauvreté, n’ayant quasiment pas été scolarisé, misérable, dénué de formation et de culture, Patrice, poète et homme du peuple, se forgera en tant qu’autodidacte. Et c’est ce Cauda-là et la force inédite de sa poésie qui séduit d’emblée Henri Rode, comme les autres Hommes sans Épaules, mais aussi Alain Borne, Lucien Becker, René Char, Louis Aragon, Marcel Jouhandeau, André Gide et bien d’autres. Jean Breton témoigne : « On voyait souvent Cauda à Avignon, l’air fureteur. Inculte, il désirait lire, « apprendre ». Qui est Gide ? demandait-il au premier venu. Dans quelques années peut-être, d’autres adolescents demanderont à la ronde : Qui est Patrice Cauda ? »
Au sein des Hommes sans Épaules, Cauda sera tour à tour, le plus solaire et le plus noir, le plus joyeux et le plus taciturne. C’est que, de toutes ses forces, Patrice Cauda, qui ne renie ni son milieu, ni ses origines, ni même sa classe sociale, poète de la Poésie pour vivre, poète de l’émotion, émotiviste par essence, dénonce la douleur qu’il exprime, comme s’il voulait l’exorciser : Un mot un complice une présence – pour se blottir et se réchauffer – comme un cri monte et délivre.
C’est à propos de Pour une terre interdite, et particulièrement de la suite de poèmes La Mère défigurée, que Jean Breton écrit : « Ces poèmes demeurent un monument d’émotion que peu de poètes – à part Rilke ou, près de nous Renée Brock – ont pu en hauteur égaler… Il s’agit pour moi de l’un des plus beaux poèmes du demi-siècle écoulé. »
Patrice Cauda n’en a jamais fini avec la grimace du temps, l’exigence de sa chair, avec son absence claire et ses verts chagrins. Patrice Cauda est un mystère, une énigme. Orphelin de père qui a fui l’école, il est issu, nous l’avons dit, d’un milieu pauvre, prolétaire, et sera ouvrier dans une usine à douze ans, garçon de café, préposé au vestiaire dans vingt caravansérails de la Côte d’Argent ou d’Azur, d’Avignon ou de Paris, barman au « Chat qui pêche », représentant des éditions Pauvert… Il vivra toujours, aliéné, d’un métier qui « ne le concerne pas.
Recueil après recueil, Cauda, qui n’écrit jamais pour écrire, mais toujours dans l’urgence d’une vérité émotionnelle, ne baissera jamais d’intensité ; il demeurera fidèle à sa voix et à sa voie. Cauda, a écrit Serge Brindeau, ne cherche pas à pratiquer en poésie une conduite de détour. Il aborde de front la difficulté. D’autres poètes commenceraient par jouer avec les mots, remettant à plus tard de se découvrir aux yeux d’autrui et de se révéler, peu à peu, à eux-mêmes. Pourquoi habiller, déguiser la vérité ? Ce sera nettement affirmé au seuil du deuxième recueil : « La nudité est l’objet du poème ». Mais dès l’ouverture de Pour une terre interdite, le poète veut mettre son cœur à nu. Ajoutons, dès maintenant, que la forme est aussi dépouillée que la sincérité de la confession l’exigeait. La blessure du poète, c’est la malédiction qui pèse sur lui et sur le monde, un monde (il en a le pressentiment, l’expérience) où tout s’effrite.
La solitude étant sans remède, malgré l’amour, la sensualité, la fraternité ; Patrice Cauda s’y enfonça peu à peu, puis définitivement, en guettant la chute des jours. Ne maintenant guère de contacts qu’avec Les HSE, de vieux et fidèles amis tels qu’Henri Rode ou Jean Breton, il meurt en 1996, le silence des aurores au front.
Patrice Cauda est un Homme sans Épaules et sans concession ; un poète bouleversant et pur.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Homme sans Épaules).
À lire : Pour une terre interdite (Debresse, 1952), L'Épi et la nuit (Debresse, 1953), Domaine inachevé, préface Jean Breton, (Les Hommes sans Épaules, 1954), Poèmes pour R., illustration de Warb, (Le Véhicule, 1955), Un poème (PAB, 1956), L'Heure poursuit (PAB, 1957), Le Péché radieux (éd. Chambelland, 1961), Mesure du cri, Prix François-Villon, (éd. Millas-Martin, 1961), Par des chemins inventés (éd. Chambelland, 1962), Domaine vert, illustration de Boni, (P.A.B, 1962), Elle dort (PAB, 1962), Ville étrangère (éd. Chambelland, 1964), Peut-être, illustration de Kumi Sugaï, (PAB, 1964), L’Épi et la nuit, édition reprenant Pour une terre interdite, L'Épi et la nuit et Domaine inachevé, (Collection Poésie pour vivre, éd. Saint-Germain-des-Prés, 1984), Je suis un cri qui marche, poèmes choisis et inédits 1952-1967 in Christophe Dauphin, Patrice Cauda, je suis un cri qui marche (Les Hommes sans Epaules, 2018).
À consulter : Christophe Dauphin, Patrice Cauda, je suis un cri qui marche, Essai, poèmes choisis et inédits (Les Hommes sans Epaules, 2018), Serge Brindeau, Patrice Cauda (Le Pont de l’Épée n°35/36, 1967).
MON SOLEIL
Mon soleil fait la terre mauve
je suis un cri qui marche
Mains blanchies au revers d’un visage
j’accroche la nuit comme un terrain profane
Des morts dont je suis né
le rire monte comme une fleur
d’autres cris dont je fais des images
Tous les actes sur la nuit sont ouverts
un fou tourne avec sa parole sèche
il étend sur ses doigts les couches d’un rêve
La chair forme des replis fanés
les yeux ont des lueurs de verre
pourtant un feu garde sa force comme une soif.
*
Débris je vous écarte d’un rire
Je couche mes peurs sur une page nue
Décombres vos harcèlements n’ont plus de prise
J’habite un feu qui donne tout
À ne pouvoir vivre sur ces rivages
J’ai trouvé des plages de fiel
Lassé j’ai vu le blé seul grandir
Mains saignantes j’ai repris les clés
Mon cœur frappe ses veines vivantes
Ma joie colore une fleur aiguë
Tout est futur dans sa fin.
Patrice CAUDA
(Revue Les Hommes sans Epaules n°3/4, 3ème série, 1998).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|
||
| Patrice Cauda, Je suis un cri qui marche | ||