Pierre GROUIX

PIERRE GROUIX, LABOUREUR DE LARMES, DE LA SÈVE DES ARBRES AU SANG DES VEINES
Fallait-il attendre la disparition brutale, mais dans la discrétion, de Pierre Grouix, pour découvrir ou redécouvrir, c’est selon, la quintessence de son œuvre ? C’est ce à quoi nous invitent les éditions Rafael de Surtis, en faisant paraître, en juillet 2025, moins d’un mois après sa disparition, Laboureur de larmes & autres recueils. Cet important livre rassemble la quintessence de l’œuvre poétique de Pierre Grouix. On ajoute, chez le même éditeur, l’étonnant volume Triste pays d’hiver (Tollund), écrit d’après la découverte en 1950, d’un corps nu momifié de 400 avant J.-C., dans une tourbière danoise : Objet de boue meurtri, ton cou sous le garrot, c’est le mien sous le nœud ; si j’y passe le doigt, mon cœur défaille sous la corde de lin ; ce qu’on te fit, on me l’ose aussi bien.
Lorrain (Vosgien) par sa mère, Marie-Claude Lartillot, et Pied-Noir (Maroc, Fés) par son père, le médecin Camille Grouix (1941-2001), Pierre Grouix est né à Nancy, le 17 février 1965. "Neufchâteau était le centre de mon enfance, et Fez une sorte de ville au loin, mais sans représentation précise, ou même imaginée comme une cité arabe plus que comme une Ville nouvelle du Maroc de Lyautey... Ces deux espaces n'avaient pas de rapports entre eux... Une famille est, j'imagine, une mosaïque dont le grand séparateur, le temps, qui, comme la mort, ne prend pas de gants, a éloigné des pièces que je tente d'unir entre elles."
Pierre Grouix a vécu son enfance à Nancy puis à Longwy (de 1971 à 1983), où son père exerça la médecine, et au bord d’une rivière, le Mouzon, à Neufchâteau (Vosges), chez ses grands-parents maternels, là où il repose désormais pour l’éternité.
Pierre Grouix est décédé le 10 juillet 2025, à l’âge de 60 ans. « Le volcan d’or eut-il bu son magma, les branches ravalé leurs fruits, l’univers cessé, la nuit tourné sur elle-même, le monde où nous vivions était celui que nous prisions, petit amour secret de nos rêves. »
Pierre disparaît à 60 ans, c’est choquant et très triste de l’apprendre. La poète norvégienne Gunvor Hofmo (1921-1995), « la plus douée de son pays dans son siècle », nous dit Pierre, a écrit : Te plains-tu de la vie à cause des jours gris, - des ventres affamés, - des peines et des blessures ? - Le pire est de quitter des champs non semés - et des printemps non nés. Pierre nous quitte tôt, mais non sans avoir semé des champs entiers de poèmes et des printemps d’amitié fraternelle.
Pierre Grouix est né dans une famille ouvrière, dont il nous dit : "La vie des miens a été vécue au plus près de la réalité, à ras de réel, dans la vie quotidienne, loin des abstractions qu'interdisaient les soucis de tous les jours. Pas davantage, la culture, forme s'il en est de l'abstraction, ne fut leur souci. On ne la prisait ni ne la valorisait, elle n'avait pas sa place. Si les Grouix furent heureux à Fez, au Maroc, et d'un bonheur qu'ils trouvaient en grande partie dans la fré&quentation très importante et régulière de leur famille, ils ne furent jamais financièrement à l'aise ni à l'abri. L'argent était du côté du manque, des problèmes. On compta. Mon père souffrit particulièrement de cette situation économique tendue qui le complexa et, outre la vocation, expliqua en partie le choix d'un métier, la Médecine, qui le mettrait à l'abri de la précarité."
En 1962, l'étudiant en médecine Camille Grouix, arrivé du Maroc en 1958, fait la rencontre à Nancy de Marie-Claude Lartillot, 19 ans, étudiante en histoire, qu'il épouse l'année suivante. Naîtront une fille, Catherine, et des jumeaux, Pierre et son frère Georges. Camille Grouix, qui a fait partie des seulement 2% de fils d’ouvriers à parvenir à faire des études de médecine, se veut chirugien, mais il doit arrêter ses études de médecine pour travailler et pourvoir aux besoins de sa famille. Il sera médecin généraliste. Son fils Pierre, en revanche, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, deviendra agrégé de lettres, poète, essayiste, enseignant et traducteur.
Pierre Grouix est l’auteur d’une soixantaine de livres, mêlant poésie, proses, essais, mémoires et traductions. Il a en outre écrit des essais sur Hugo, Michaux, Zweig, Rimbaud, Breton, Darwich, Camus, Audiberti, Jaccottet, les littératures de Finlande et de Norvège, ainsi que deux romans sur Tolstoï, les J. O. de Lillehammer, et un essai en histoire de l’art sur son artiste préféré, le peintre danois Vilhelm Hammershøi (1864-1916), qu’il a contribué à faire redécouvrir et connaître au-delà du Danemark. « Peintre de l’intimité silencieuse, bientôt la marque distinctive de son art, Vilhelm Hammershøi aura peu fait pour faire parler de lui hors de sa peinture ». Ainsi débute l’essai de Pierre Grouix et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces propos s’adaptent également largement à lui et à sa poésie.
De son œuvre opulente et diverse (essais, traductions, mémoires et poésie), intensément vécue avant d’être écrite, on a longtemps « effacé » ou « relégué » le poète réel et authentique qu’il n’a pourtant jamais cessé d’être, au profit de l’essayiste remarquable qu’il fut, mais aussi et surtout - ce qu’il fut assurément à l’instar de son ami Régis Boyer, mort en 2017 à l’âge de 84 ans – de l’éminent traducteur des poètes et romanciers scandinaves. Il a publié des traductions du suédois de Finlande, du danois, du norvégien commun et dialectal : entre autres, Joseph Julius Wecksell, Michael Strunge, Knut Hamsun, Tor Jonsson, Knut Ødegård, Bo Carpelan, Tarjei Vesaas, Morten Nielsen, Edith Södergran ou Søren Ulrik Thomsen… Ces poètes furent toutes et tous des frères et des sœurs pour lui, la gorge tournée vers des fièvres d’automne que la pluie ne peut éteindre. Pour cela, Pierre Grouix, membre du comité éditorial de la revue francophone, Riveneuve Continents, a reçu en 2007 la bourse de traduction du Prix Européen de Littérature.
Pierre Grouix, humble, modeste et effacé, fidèle à ses origines, n’est assurément pas un premier de cordée. Il fut en revanche un « premier Cordais ». Être Cordais rattache à la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel (Tarn), qui vogue au-dessus d’une mer de nuages et dont Pierre fut un assidu avec beaucoup d’autres de nos amis, autour des éditions Rafael de Surtis et de la Maison des surréalistes, dirigés par Rafael de Surtis et Paul Sanda, également animateurs d’un mémorable Festival international de Poésie actuelle, de haute voltige, dont Pierre fut un fer de lance. C’est dans ce contexte que j’ai fait sa connaissance et que nous sommes devenus amis, à la fin des années 90. Pierre fut un fidèle de la première heure, toujours chaleureux, érudit, passionné et simple. Et quelle humanité se dégageait de lui, de ce bourreau de travail, toujours prêt à défendre les poètes qu’il jugeait méconnus à tort. Il avait un beau sourire et une présence fraternelle : celui des passeurs de poésie, c’est à dire, de Vie, masquant ses fêlures et sa dépression chronique qui le minait, en dessous des nuages. À l’intérieur où tout est profondeur, il y avait en Pierre cet accent de sens, cette brûlure. Pierre était intensément présent, avant de disparaitre sans donner d’adresse ni de nouvelles Était-il à Copenhague, à New York, à Longwy, à Paris ? Ce nomade déraciné, à l’instar de sa propre famille, n’est jamais parvenu à s’enraciner. Il était de partout et de nulle part, à la fois. Il vivait avec passion, quitte à négliger sa santé et son hygiène de vie, ce qu’il a fini par payer au prix le plus cher.
Il en fut ainsi, y compris avec le cher Alain-Pierre Pillet, poète surréaliste suisse, dont je ne peux oublier mes longues veillées cordaise et dylanesque avec lui, dans la Barbacane du peintre surréaliste Francis Meunier. Dire que ces années en juillet furent l’Or du temps, est un euphémisme. Salut l’ami, salut les amis !
Je dois à Pierre ma découverte de la poésie scandinave dont il fut un magnifique ambassadeur : les Suédois, les Finnois, les Danois, les Norvégiens. Et, surtout, celui dont la rencontre, fut un émerveillement pour lui, puis pour nous, son ami l’immense Bo Carpelan, le plus grand poète et écrivain finlandais d’expression suédoise, dont Pierre a donné l’édition complète de l’œuvre poétique en 2010 aux éditions Galaade. Carpelan est un élégiaque à l’image de son jeune ami Pierre : Ta chevelure est une constellation que j’ai vue, une fois métamorphosée. - Elle vit, saignant comme une bête sauvage blessée - sur le champ de la terre, au plus profond de mon rêve. - Elle découpe l’obscurité en pierres, en géométrie. - Aucun vent ne te touche, tu reposes toi-même - sous le sable, argentée par le sable. L’obscurité - tombe et me croise dans mon sommeil ; je me tourne - à moitié de côté, prends un mort dans mes bras. - Le vent de la mer se dresse sur son coude, pénètre - ma poitrine, fait résonner mes mains qui pendent. - Aucune rivière d’eau bénite n’unit plus, dans le cœur, - les hommes et les étoiles. Je vois comment jadis l’âme, libérée, allait toutes ailes dehors vers un espace è- limité, sans limites. Alors ton sang se répand comme une goutte qui se fige dans l’écume de l’obscurité, fut métamorphosé, - devint autour de ta mort une constellation. - Vêtue d’amiante, - semblable à une fusée, ta sœur tardive atteint son reflet mort. - Ta chevelure est une constellation que j’ai vue, une fois métamorphosée, - une nuit où le cœur inquiet tire sur ses amarres - sous les pontons disjoints du firmament, sous les murs qui s’effondrent.
Pierre a été le grand architecte du numéro 35 des Hommes sans Épaules, consacré à la poésie norvégienne, à partir de son travail de traducteur, publié par les éditions Rafael de Surtis.
Pierre nous dit : « Bien malin qui sait comment les rivières cessent. Nos lacunes, aussi, nous irriguent : ce flot de vitrail est incomplet. Des voix aussi exactes que celles de la Danoise Inger Christensen ou du Suédois Gunnar Ekelöf n’y sont pas encore présentées. Le champ n’est pas si vaste que vous le pensez. Bien sûr, la poésie nordique est une fleur inconnue et il y eut, trop longtemps, une incurie à laquelle, très modestement, je tente de remédier. Je ne comprends pas par exemple qu’il me revienne de composer la première anthologie de poésie norvégienne : le travail aurait dû être fait depuis longtemps. Je ne crois pas qu’il y ait tant de très grands poètes nordiques que cela. Parfois coupés de la tradition, confondant leur nombril et le centre du monde, bien des jeunes poètes ne me convainquent guère. Le champ semble ouvert parce que, bêtement, nous nous y intéressons peu. Tout ce qu’il y a de littéraire en moi est choqué qu’on accorde une importance absolument démesurée au roman policier, qui n’est en rien une tradition nordique, en laissant dans l’ombre la poésie, la plus belle des traditions nordiques. Il est à mon sens plus d’intrigue dans un poème, cousu de fil d’or, de lumière, d’invisible, que dans d’épais et pansus romans cousus de fil blanc. Il s’agit pour moi d’un motif de réelle tristesse. »
Un poète élégiaque de l’Amour fou
Le poète Pierre Grouix se rattache selon moi à deux autres poètes lorrains. Comme ne pas souligner qu’à la suite de ses aînés vosgiens, Yvan Goll - qui fut lié d’amitié au poète autrichien Rainer Maria Rilke - et Richard Rognet, Pierre Grouix est un lyrique et peut-être un poète élégiaque de la meilleure veine ? L’élégie occupe une place particulière dans son œuvre poétique au même titre que chez Rilke, Goll et Rognet. Des Élégies internationales (1915), l’utopie poétique de l’humanité réconciliée de Goll aux Élégies pour le temps de vivre (2012) de Rognet, en passant par les Élégies de Duino (1923) de Rilke, et Laboureurs de Larmes (2025) de Pierre Grouix, il y a l’utopie poétique de l’humanité réconciliée, la rage de vivre comme doit vivre la vie, au fin fond de notre présence et l’inexprimable dit, élevé à la présence, d’après Lou Andreas-Salomé.
Pierre Grouix écrit, à la suite de ses aînés : on ne perd pas le nord, on se perd en lui, on continue sauvage / qui vit le poids du seul connaît aussi celui des larmes / à de certaines heures plus profondes que schubert ou que brahms, même le silence pleure, la lumière / on ne pleure pas en silence, on pleure le silence / on ne pleure pas avec les yeux, on pleure avec le cœur, les larmes sont le sang invisible / parce qu'il faut que cet amour soit dit, que les mots le rencontrent et que l'encre le rende, parce que / il faut que le silence ait lieu, il faut que tout soit parce que tout vit, et le plus clair du chant et le très fin du sang / il faut que les larmes larment, que les pleurs pleurent et que saigne le sang, il faut que le pur mal ait lieu / à l'invisible nul n'est tenu mais tous se doivent…
L’amour fou de Pierre, comme celui d’André Breton, porte un nom : camilla gjørven, l’étoile du nord et le chemin perdu, préséances blondes. Dans son beau poème « Appelé à disparaître », Pierre Grouix, poète de la femme et de l’amour, écrit encore :
« nous n’aimions rien de nous que nous n’aimions d’abord en elles
nous devions aux femmes le meilleur de nous-mêmes, ce que nos mères naguère avaient aimé de nous
elles nous aimaient davantage qu’elles-mêmes, nous ne savions comment nommer l’île où elles devaient nous conduire
nous n’aimions de nous que ce que les femmes aimaient, bruissement léger des feuilles ou messe basse de l’eau des rivières
l’eau sous l’eau et comme son ombre claire, l’eau seconde, artésienne, souveraine souterraine »
« les femmes ouvraient le chant qui n’entend pas périr, ligne de feu, hymne grave, voix de beauté
à moins d’une note de la fin de leur chant, la libellule reprenait son vol, l’espace sa liberté
les femmes ne disaient nullement mille et une choses et leur contraire, leurs lèvres se ramenaient à la ligne précise, exacte et une, le chant, aimer toujours, aventure belle »
« nous n’imaginions pas de seconde vie après celle-ci, de territoire secret au-delà du taquet de la mort
nous n’opposions pas de résistance au déchiré de nos cœurs fibre à fibre, au pillage de nos sangs par les soins de la foudre
nos cœurs cesseraient et la lumière pour finir perdrait nos yeux, notre vue, le monde »
« les femmes cesseraient les dernières et le monde avant elles »
« à tout prendre nous aimions mieux laisser
nous ne dirions plus que la légende de l’amour, cette idylle ou cette fable
qu’on ne nous cherche ailleurs qu’au cœur détruit de la lumière
disparaître, disparaître surtout »
La Saga de Camille Grouix à Fès
La Saga (de l’ancien nordique saga : dit, récit, conte) est le récit mythologique et historique en prose de la littérature scandinave. La plupart, ont été rédigées entre le XIIe et le XIVe siècle en norrois. La saga est bien sûr chère à Pierre Grouix, qui a, à son tour écrit la sienne. Cette dernière que nous appellerons « Saga de Camille Grouix », se déroule loin de la Scandinavie, au Maroc, à Fès, la ville impériale dont la fondation remonte à la fin du VIIIe siècle. La « Saga de Camille Grouix » devait comporter treize volumes. Pierre eut le temps d’écrire et de publier dix livres : Une jeunesse marocaine (2008), Fez (2010), Fils de Fès (2011), Grand Hôtel des rêves (2012), Ciné Fès (2013), Depuis (2014), Partout mon père (2015), Cahiers à la ville du père perdu (2017), Vivant visage du vent (2017) et Noria des ans (2018). Pierre écrit lui-même : « Celui qui n’a pas écrit treize livres sur son père, je l’appelle dilettante, je ne l’appelle pas fils, ai-je eu le front, mais aussi la claire franchise, de poser dans Depuis. »
Pierre Grouix est âgé de 36 ans lorsqu’il perd Camille Grouix, son père adoré, en 2001. « Avec le temps, Avec le temps, va, tout s’en va - On oublie le visage, et l’on oublie la voix », chante Léo Ferré. Pour Pierre Grouix, ce fut l’inverse : plus le temps passait, plus le visage et la voix de sa père étaient présents, au point de dire à ses amis : « Je ne vivrais pas plus longtemps sur Terre que ne l’a fait mon père. » Et ce fut ainsi. Il est mort au même âge que son père, à 60 ans.
La cassure est profonde : « Mon père n’est pas revenu et je n’en reviens pas. ». Elle ne se résorbera jamais, creusant au contraire une faille entre douleur et illumination, à l’instar de la recherche de l’amour absolu et de la femme médiatrice, dans la passion totale, exclusive, excessive et souvent dévastatrice : « ce que les femmes nous disaient, les mots de leur amour, nous en avions besoin pour vivre - ce dont nous rêvions en silence, la lumière à nos yeux, là où le monde allait, les femmes nous l’offraient d’un baiser aux lèvres ». Ainsi était et vivait Pierre, dans l’Amour fou, cher à André Breton. Pierre ne cite pas en vain le poète et peintre surréaliste Yves Elléouët : « Nous nous retrouverons au rendez-vous des rivières, sur un sable qui ignore le goût du sang, à l’amitié des arbres qui ne connaissent ni la hache ni la foudre ».
La Saga de Camille Grouix, repose sur un constat, fait par le fils à la mort du père. Pierre entend trouver réponse à une question qui est autant un mystère, qu’une page blanche, un manque, un vide, pour lui : « Tu ne m’a jamais parlé du Maroc. Ce qui s’appelle jamais. De ton vivant, pas une fois le nom de ton pays de naissance n’est passé par tes lèvres en ma présence. Deux syllabes me manquent. Maroc et bouche cousue… La nuit de ta mort, ma nuit du destin, la certitude de ne pas t’avoir assez connu m’est venue avec la force d’un oued en crue. De ton temps au Maroc, dix-sept sur les soixante de ta vie brève comme un couchant africain, le peu de ta permission de vivre, j’ignorais tout… Malheur au fils qui ne connaît pas la ville de son père… Ce Maroc qui fut et ne fut pas le tien, je ne m’y suis intéressé, je ne me suis tourné vers lui qu’après ta mort, je l’ai parcouru sur tes traces, au fil – j’allais écrire au fils – de nombreux séjours. Combien ? Douze ? Dix ? Un certain nombre, je n’aime pas les chiffres… Je n’aurai pas eu l’idée de me rendre au Maroc si tu n’y avais passé presque un quart de siècle… »
L’année suivant la mort du père, voit la parution d’un premier livre qui lui est consacré, Une jeunesse marocaine. Nous ne le savons pas encore, mais ce livre est le premier d’une longue série qui va constituer la « Saga de Camille Grouix », non pas au Maroc, mais seulement à Fès : « Ton Maroc pile net après Fès, à l’endroit où stoppe aussi mon Afrique. À quoi bon parcourir des contrées où tu n’es pas allé ? C’est toi en Afrique que je cherche, pas le continent. Je refais ton parcours… Tu es mon Ulysse. Mon Ithaque aussi. »
La famille de Pierre Grouix est originaire d’Auvergne (le grand-père) et d’Alsace (la grand-mère, qui est en fait d’origine espagnole). De condition modeste (nous sommes très loin de la condition et de la mentalité des riches Pieds-Noirs), cette famille ouvrière a vécu en Algérie de 1884 à 1928, avant de s’installer au Maroc, à Fès, jusqu’en 1958.
C’est la Saga de cette famille, à partir du père, que relate Pierre Grouix, sur le ton d’un récit vivant, souvent proche de l’enquête, qui tient en haleine en faisant revivre toute une époque révolue. Il est question de la quête d’une histoire, d’une origine et d’une identité, dans laquelle chacun peut se retrouver : « Toutes les familles ont la mémoire qu’elles méritent, et certaines des centaines de clichés. Comme la nôtre en possède peu, je regarde et regarde encore ceux que les miens m’ont donnés, ou d’autres… Je suis au service de quiconque te rapproche de moi… Ce que ce parcours de mémoire m’a offert de plus beau, c’est ma famille, au plus loin que je puisse remonter son histoire. Au fil des ans, elle s’est enrichie d’éclosions, de visages, de noms. Il me semble que celui qui connaît, même un rien, l’histoire de sa famille, n’est pas aussi pauvre que cela ; il n’est en tout cas plus seul. La fin de mon père, à l’âge de soixante ans, m’a dépossédé de tout mais m’a, la gueuse, enrichi de ma famille. »
À la différence que chez Pierre, retrouver cette histoire, cette origine et cette identité en faisant revivre le père pour vivre dans ses pas, va l’occuper, l’absorber et le dévorer totalement de 2007 à sa mort, en 2025 : « Plus de temps, plus de temps libre, il me faudrait plus de tout pour lancer véritablement le travail, le préciser, le peaufiner… Je garde espoir que, un jour, ma mère, ma sœur, mon frère et sa famille surtout, s’intéressent enfin à cette part secrète de ta vie, peut-être grâce aux livres que je crois écrire, aux images que j’extrais à mains nues de l’ombre. Qui sait ? Comment savoir ? (..) Je ne souhaite pas oublier, je tiens le fil des choses dans ma main, c’est un fil qui s’enfuit. » Bien sûr, cette Fresque-Saga dépasse largement le cadre de la reconstitution méthodique d’un arbre généalogique, puisqu’il y est avant tout question de la recherche d’une identité autant que d’une histoire, d’un déracinement qui cherche en vain à s’enraciner, le tout sur un ton personnel, sans rien cacher de ses failles et de ses doutes : « Partout mon père, quatre syllabes, pas les deux de Maroc, celles du silence, non, quatre pour forer un peu plus la nuit, l’oubli, ces choses qui ne vont pas, ne sont pas dans l’ordre et malgré tout hantent ma vie, ma vie d’aujourd’hui, la seule possible, celle d’où j’écris ces phrases, ces simples mots tracés à l’encre ordinaire par un fils qui l’est autant. Partout mon père. J’ignore où je me rends, j’y vais pour te retrouver. »
L’historien Pierre Vermeren écrit : « Cette incroyable saga familiale et imaginaire, toute de reconstitution et d’indices explorés jusque dans les moindres détails, est un bel exercice de style pour l’historien du Maghreb. Elle rappelle les récits expérimentaux de la microstoria italienne des années 1970 et 1980 (comme « Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier frioulan du XVIe siècle, de Carlo Guinzburg), ou plus récemment la tentative de reconstitution de la vie de ses grands-parents morts en déportation par l’historien français Yvan Jablonka (« Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus »), qui constituent des précédents, dans le champ du récit historique, quant à la reconstitution et à l’écriture de vies inconnues, faute de témoignages, d’acteurs, de trace et de sources. Dans son récit, Pierre Grouix fait (aussi) incontestablement œuvre d’historien : accumulation des témoignages matériels, recoupement des sources, recueils de récits de vie, recours à toutes les sources disponibles, reconstitution d’une solide chronologie, mise en situation contextuelle, bannissement des anachronismes, extrême soi apporté aux mots, vocables, traductions, etc. Etude des lieux et des configurations. L’enquête, comme dans les bons romans ou récits d’histoire, est à la fois intellectuelle et factuelle, policière et judiciaire, scientifique et matérielle, et aussi inductive que déductive… La saga du père est ainsi devenue celle de toute une famille dans sa traversée du Maghreb sur deux siècles."
Chaque année, en dehors d’autres écrits et travaux, à la question que prépares-tu ? Pierre répond : « Un livre sur mon père. » Puis, deux, trois, quatre, etc. Cela en devenait, et cela l’était, pour nombre de ses amis, « délirant », comme il le relate lui-même : « Certains de mes amis sont pressés de me voir quitter ces écrits sur Fès, de me voir écrire ailleurs, comme si la chose dépendait de moi, alors qu’il reste tant et tant à faire. Rien que de reprendre et de relire mes dizaines de lourds cahiers de notes me volerait ma vie pour des mois et des mois, représenterait au moins un an de travail à temps plein. Ce temps, ce sang, je ne l’ai pas… Je ne sais combien d’années ces écrits me prendront. Cinq ans ? Dix ? Le temps de vie qu’il me reste ? (..) Le jour où, je m’en souviens clairement et je ne me le rappelle pas du tout, j’ai décidé de dire ton enfance, ton enfance avant la mienne, de laisser de côté ce que j’avais vécu de plus précieux pour partir vers de grandes plaques d’inconnu, ce jour-là, j’ai peut-être commis une erreur dans ma vie. Au moins te concerne-t-elle, au moins s’agit-il d’une erreur merveilleuse. Va savoir, va savoir, je ne sais jamais. À ce moment-là, j’ignorais combien cette évidence de te préférer, de t’aimer plus que moi, engageait de moi-même. Et j’étais loin de soupçonner qu’elle me mènerait aussi loin… »
Pierre écrit en 2015 (in revue Rive poétique n°29) : « J’écris une contrée, le Maroc, dans laquelle mon père Camille Grouix, né à Fès en 1941, n’est jamais retourné. Pas plus, il n’a tenu à la revoir. Alors qu’il en aurait eu dix fois l’occasion, revenir ne lui disait rien. Dix-sept ans de sa vie, jusqu’à son départ – et non son retour – en métropole, que sa famille française paternelle, auvergnate et alsacienne, avait, à quatre générations de là, laissée vers 1880 – une décennie avant sa famille maternelle espagnole – sculptent, tissent, composent un silence que j’interroge comme je peux, tant mal que mal. Que je fore ou peut-être force. Maroc et bouche cousue. Rien sur ce pays. C’est cet assourdissant, ce retentissant mutisme que je creuse en menant ou malmenant l’enquête depuis sept ans et autant de livres.
Pas une ombre d’instant, l’idée de revenir à Fès, de faire Fès-arrière, n’a traversé l’esprit brillant de mon père. Le retour au Maroc, sans doute assimilé par lui au mieux à un surplace, au pire à un échec, n’avait aucun sens. On ne part pas d’un endroit pour y revenir, on le laisse pour ne plus le retrouver, en découvrir un neuf, et se découvrir chemin faisant. Pas davantage il n’a tenu à mentionner son enfance de l’autre bord de la mer, à la partager avec sa femme, ses enfants. Je suis le fils d’un père taciturne à l’enfance secrète. De ce que j’ai appris sur son Maroc d’alors, ce peu de chose, rien ne m’est venu par ses lèvres.
Ce silence paternel, obstiné, têtu, douloureux selon moi et pour moi, est le cœur de ma recherche, le soleil de ce système solaire. Son battement, son sang d’astre. Malheur au fils qui ne connaît pas la ville de son père. Y débarquant, je n’avais pas une once d’information, ne connaissais personne. Pour toute richesse, j’avais de l’encre et du papier, et pas le premier élément du puzzle, la tesselle initiale. Je partais de zéro avant de me mettre en route. J’ai cherché. « Tu ne trouveras rien » : les paroles si peu optimistes, si courtes, si fatales d’un Berbère nonagénaire m’ont hanté. J’ai tenu à les faire mentir. D’un indice l’autre, j’ai peu à peu levé les pans du voile, je suis entré le cœur tremblant dans le naos, l’intimité de mon père.
Trop de plaques d’ombre après une douzaine de séjours à Fès Ville nouvelle. Trop d’étapes de la vie de mon père me restent trop lointaines. Si j’ai retrouvé des dizaines de clichés, il m’en manque encore trop. Le portrait est incomplet. J’ai pensé aux mosaïstes de Volubilis, la cité antique voisine. Longtemps je n’avais même pas situé les trois lettres grisantes de la ville sur un atlas, au pays de l’Atlas. Tout m’y était étranger. Partant à Fès, je n’avais pas l’impression de revenir quelque part, mais d’arpenter le parfait inconnu. Ce n’est qu’en y retournant – à mesure aussi que le peu que j’y découvrais d’un voyage l’autre s’amenuisait – que j’ai pu me faire à la ville, bientôt y compter des amis (j’appelle ami quiconque m’aide à chercher, à devenir un fils).
Ai-je enfreint, tel Télémaque, une loi secrète, noire, qui dirait qu’un fils ne doit pas revenir sur les traces de son père ? Il reste que je suis allé, et retourné, dans une ville dans laquelle mon père n’aurait jamais souhaité revenir. Ce rêve auquel je tenais avant son décès, me rendre à Fès en sa compagnie, lui aurait paru absurde. Marcher avec mon père dans la ville de son enfance : aurait-il vécu plus longtemps, il n’aurait sans doute pas accédé à une demande que je n’aurais peut-être pas maintenue. Davantage même, notre marche commune sur le boulevard Poeymirau ou l’Avenue de France, qu’il aurait à peine reconnus, et sur lesquels personne ne l’aurait, lui, reconnu, aurait été rien moins que ridicule, pis même artificielle. Ce n’est pas parce qu’il serait retourné à Fès avec moi, scénario hautement improbable, que mon père, qui a enterré en lui le moindre souvenir d’un pays dont il s’est amputé, le Maroc, m’en aurait dit davantage.
C’est sur ce que j’ai de plus précieux au monde, l’enfance, que je diffère finalement le plus de mon père. Là où je me retourne sur elle, et la sienne, qui compte plus à mes yeux que la mienne, lui ne souhaitait pas la retrouver. Ma naïveté aura consisté à croire que tous les hommes, et le premier homme qu’est pour tout homme son père, tiennent à leur enfance comme j’ai pu chérir la mienne. Obstinément, fidèlement, inconditionnellement. Aveuglément. Les écailles me tombent du cœur : mon père n’est pas revenu et je n’en reviens pas. »
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
« Une pensée émue pour l'ami Pierre Grouix croisé il y a un mois au Marché de la poésie, disparu bien trop vite. Rencontré en 90 à Normale sup. Fontenay St Cloud. Avec lui, j'ai rencontré la poésie. Je l'ai immédiatement publié dans la revue que je venais de créer, « La Révolte des chutes ». Ses poèmes étaient pleins de fougue et de pureté. Il « souquait dans le cristal ». Passionné par Rimbaud à Madrid ah la revue « Plein cœur », son idée, avec Alain Borer et quelques autres. Grand animateur de la poésie à l'ENS avec J.M. Maulpoix ou J.M. Gleize, il a connu presque tous les poètes de renom de son époque et écrit inlassablement sur eux. Né à Charleville dans les Ardennes, une vocation : poète agile, un peu voyou, érudit et potache, pince sans rire, ami débordant de passion, séducteur peu scrupuleux, comédien, fidèle et infidèle, homme généreux, il n'a pas cessé d'écrire, dans des directions parfois inattendues, de la poésie d'amour mystique et charnel - Le laboureur des larmes ou le sentiment du chèvrefeuille, Neufchâteau..., traductions de poètes de langues scandinaves, monographie de boxeur, tour de France, Russes de Paris, et son père, son père, son père... il voulut écrire 13 livres sur son père!! et vénérait la poésie du mien. Il y a deux ans encore il montait un volume d'hommage à « Rue des fleurs » de Maulpoix. Sa disparition nous laisse un vide immense dans le cœur. »
Marc KOBER, juillet 2025.
En guise de Préface : Tombeau de Pierre...
Notre ami Pierre Grouix (1965-2025) était sans doute essentiellement poète, même s’il fut tour à tour biographe, traducteur, critique et, comme grand voyageur, chercheur de racines profondes... Alors que nous nous sommes connus à l’orée des années 90, grâce à l’aventure voulue par notre ami commun Marc Kober – qui dirigeait alors, dans l’orbe surréaliste, une revue, La Révolte des Chutes, qui, pour être modeste, n’en permis pas moins des rencontres et des découvertes inoubliables – je commençai de l’éditer en 1999 par le recueil inaugural du présent ouvrage (qui sera le premier pilier de son "Taj Mahal" élevé pour son grand amour, Camilla) : Laboureur de Larmes. Je l’éditerai donc 18 fois – en tant qu’auteur, et en comptant l’œuvre posthume ici offerte –, tentant d’accompagner au mieux son parcours aussi fantasque que créatif, aussi divers qu’élaboré, aussi surprenant qu’élevé dans une finesse rare. Et je ne parlerai pas ici longuement des nombreuses traductions de poètes scandinaves qu’il a pu offrir à nos éditions (un dossier remarquable ayant été établi par les soins de Christophe Dauphin dans le numéro 35 de la revue Les Hommes sans Épaules, en 2013).
Quelles que furent ses occupations littéraires diverses variées, ses brillants essais et ses belles conférences, je voudrais dire ici que l’œuvre la plus poignante de Pierre Grouix, et peut-être la plus subtile, fut sans doute cette saga poétique si profonde qui le dévoilait un peu plus justement à chaque opus. Et sûrement autant que les ouvrages complémentaires qui balisèrent longtemps sa recherche du père disparu, en cette quête assoiffée de ce qu’avait vécu ce père, et en ce à quoi il avait été confronté sans jamais le révéler vraiment. C’est peut-être une admiration aussi intense, sous des aspects en conjonction de l’amour projeté, que l’on retrouve sous les deux allures essentielles de son écriture : le dialogue avec le père, Camille, à travers le temps, et le dialogue avec l’éternelle fiancée, Camilla, à travers l’espace, comme « un rien, très peu, trois gouttes de souffle, de l’encre et une ombre de sang, la lumière de l’amour, un parfum, le vol d’une chevelure, une manière d’être, une approche du silence : l’anniversaire de la princesse ». Quant au père (1941-2001, mort aussi à 60 ans exactement !) ce pourrait être avec cet exergue : « Sur les cartes blanches de débarquement de la Royal Air Maroc, à la rubrique raison du voyage, j’ai entouré la réponse travail, pas tourisme, et j’ai inscrit ton adresse qui n’existe plus, ton adresse en l’air, ton adresse pour rien. 25, place Moinier, Fès Ville Nouvelle. Pour la première fois, la seule, à la rubrique métier, j’ai porté écrivain. J’aurais dû poser fils mais j’étais déjà dans le hall quand j’ai réalisé ma méprise. Trop tard pour changer. La honte m’a pris quand j’ai passé la douane. Rien à déclarer ? Si, quelqu’un. Mon père ».
Pierre m’engagea, en 2001, à découvrir un peu de la Finlande – que je visitai alors en délégation d’éditeurs français – et puis, plus avant, à explorer un grand pan de toute cette littérature scandinave qui nous portera longtemps, de découvertes en découvertes, d’auteurs en auteurs et de poètes en poètes... Mes meilleurs souvenirs d’éditeur et de lecteur abreuvé par ses soins ? Pour la Finlande, sûrement Bo Carpelan (que je rencontrai alors lors de ce séjour), et puis toute la poésie d’Edith Södergran (offerte par feu notre ami Régis Boyer)... Pour la Norvège, au-delà du Knut Hamsun encore très jeune de L’homme secret, Tarjei Vesaas, Tor Jonsson, Stein Mehren, Gunvor Hofmo, Olav H. Hauge, etc. Pour le Danemark, Jørgen Leth, Søren Ulrik Thomsen, et bien sûr, à travers l’essai de Pierre lui-même, l’excellent peintre Vilhelm Hammershøi. Ce ne sont que quelques exemples de ces merveilleux voyages qui balisèrent notre compagnonnage, augmenté d’échanges éminents avec des traducteurs, des préfaciers, des auteurs critiques, d’autres éditeurs... Plus d’une décennie de travaux communs ainsi, pour faire se rencontrer la poésie d’ici avec celle d’ailleurs, de permettre l’intégration de livres magnifiques dans les bibliothèques des amateurs de haute littérature. Pour généreuse qu’elle soit, cette altruiste démarche de Pierre Grouix comme traducteur et préfacier, comme véritable passeur, n’a jamais repoussé trop loin dans l’ombre la subtilité de sa propre voix poétique, tout à fait originale. Et cette poésie a pu largement s’exprimer dans le foyer bienveillant, et pertinemment réceptif, d’un Festival étonnant qui eut lieu neuf fois à Cordes-sur-Ciel (Tarn), entre 2008 et 2018 (en l’impasse de 2014 et de 2017). Là, Pierre put déployer sonorités et récits, sa libre poésie et ses descriptions aiguës. Demeure et vibre encore aux murs de la Médiathèque, cette puissante fantaisie et cette vertu du poète que de savoir faire vibrer la langue à sa manière, d’inscrire un style dans la langue elle-même, de vouloir un maintien élégant comme écrin à son éternel poème, jusqu’à l’évaporation du du désir lui-même inscrit pourtant à jamais en un souvenir vivant. Ainsi l’écriture poétique de Pierre ne se résume-t-elle pas au recueil subtil, c’est aussi un torrent jaillissant, rejaillissant, une source à alimentation perpétuelle. Sonorité vivante, aussi récurrente qu’inoubliable : effort sensible, tant il est vrai que le corps parle toujours profond en lui, qu’il n’est jamais abstrait, établissant une sorte d’allégorie répétitive, de psaume qui envoûte et qui fascine en une rivière sans rivale, à l’infini.
Le Festival International de Poésie Actuelle (FIPA), qui avait lieu traditionnellement en début de juillet, permettait, dans une joyeuse ambiance largement inorganisée, autant de conférences élevées que de performances improvisées, exclamations et vociférations, dans tous les cas nombres de découvertes remarquables. Pierre affectionnait l’arrivée au lever du jour, en la gare déserte de Vindrac-Cordes, depuis le train de nuit en provenance de Paris-Austerlitz. C’était encore pour un temps le train de Jaurès, un direct qui prenait son temps. Invariablement le Festival commençait par le petit déjeuner dans les brumes matinales de la terrasse de la Maison des Surréalistes, quand la Cité de Cordes est vraiment dans le ciel, s’émancipant loin au-dessus des nuages. C’était l’ambiance du Tour de France, souvent, dont Pierre était grand supporter. Souvenir d’enfance, des histoires légendaires de Coppi, de Bahamontes, d’Eddy Merckx aussi, derrière les persiennes chaleureuses d’un temps effacé. Jamais Pierre n’aurait manqué une seule édition cordaise : toujours là, toujours présent, avec générosité, énergie, liberté, simplicité, profondeur et large rire. Chaque intervention de Pierre avait son parfum propre, sa trajectoire particulière, mais d’année en année s’apercevait-on d’un certain écho entre les causeries, les lectures, fondues l’une en l’autre en une même transmission essentielle. Neuf passages marquants, marqués par la fascination pour le Grand Nord, pour le Maroc aussi, pour le féminin en poésie, particulièrement, dans un même élan admirable dont le modèle lointain, probablement, aura été quelque maître du symbolisme et de la métaphysique.
2015. Ce sera la première année de fissure (après l’impasse de 2014 à Cordes, pour cause de fatigue pour nous, et donc de silence), avec, en poésie Triste pays d’hiver (Tollund) et, dans la quête paternelle, Partout mon père. Signe d’une fragilité irruptive, de sentiments précaires, vers étranges dont la mort n’est déjà plus absente : « Une vie, rien de plus, pas de monde de rechange. À quoi bon s’avancer ? Qui aime le sait. Ces nuages ! Si tu les avais vus, une plaine dans le ciel, leur peau noire, une armada de songes, leur teinte mon émoi, camp d’ombre qui s’avance dans le soir. Nul doute, ceux qui moururent forment un songe dans le ciel, chapelet sombre, nuage en file indienne ». Et plus loin encore, dans le même recueil de cette prose poétique que Pierre développait enfin plus loin : « Je suis cet homme, cette mort apeurée, ce peu de sang versé (rivière fragile, mes berges m’oublient), un regard clair, heureux puis terne peut-être, un souffle seul, une mort qui s’avance et pour autant le songe, t’aimer moins que très peu, le verbe vivre ». Quelque chose qui s’épuise, comme en un film de Bergman... Quant au père, peut-être tout au fond c’est alors que la béance a pu lui sembler s’engager dans l’irrémédiable : « Tu ne m’as jamais parlé du Maroc. Ce qui s’appelle jamais. De ton vivant, pas une fois le nom de ton pays de naissance n’est passé par tes lèvres en ma présence. Deux syllabes me manquent. Maroc et bouche cousue ». Parole donnée au manque, à la fêlure dont le corps, dans sa chair et dans son sang, ne peut s’affranchir sans un douleur sourde, insondable, radicale.
2018. Notre dernier lien vivant : après, ce ne sera plus qu’échanges téléphoniques, de proche en loin, de plus en plus effacés, au degré d’un effondrement intérieur que la mort de sa mère, et que le confinement imposé dans un petit appartement de bonne achèvera. Maladie, dépression, dégradation, un destin presque tendu au mystère d’un poète maudit, déjà effacé, déjà parti ailleurs. À peine le confort effleurant d’une croyance, d’un idéal renvoyé dans les méandres du passé. Pierre Grouix, évanescent, autant pour ses amis que pour le monde entier : un rire qui ne se peut dire, un humour entier, aussi décapant que beau. Lui arracher quelques mots encore, dans le lever du jour, les seuls mots possibles, comme si aucune image par lui reconnue ne pouvait rester engoncée dans l’habitude de vivre... Ici ne demeurent alors que les signes du grand et fort poème, réinventé au fil du cœur, d’un cœur qui restera toujours en demande d’une pureté singulière, indéfiniment inassouvie. L’homme qui a écrit les pages qui suivent cette préface a quelque chose de formidablement impérieux depuis son creuset le plus secret – quelque chose de fondamentalement éternel – à transmettre. On ne saurait s’y dérober, sans quelque grain de peur – et le dialogue que Pierre entama avec le corps momifié retrouvé à Tollund (Danemark) est là pour nous en témoigner : « Sur ma vie ces mots, lueur d’une lampe (est-ce le soir ?), ce que j’ai dit, très peu, une misère mes songes. Les uns apprennent à vivre, moi j’ai de l’encre sur les doigts, je prétends moins parler que dire quelques mots quand au sort, un alphabet du pire. À moins d’un rien de toi, je pars d’ici, nous sommes deux dans ta mort. Ce cordon qui te prend mais me mord, un seul et même objet transi. À moi, questions sans fin, qui suis-je ? Comment aimer ? Que vivre ? Invisible lasso, corde passée autour du corps couché, le temps nous enveloppe et c’est d’un paletot froid. Tollund, d’un jour sa nuit, le monde t’ouvre, t’entoure, des mains te trouvent, te trouent, un chant s’élève, te loue. Mon cri, tu en sais le chemin, je te parle de moi, ce rien dans le matin, ces mots titubés à deux pas, qui sommes-nous et si soudain le monde ? ».
C’était un petit matin d’été où toi, Pierre, tu citais Musset en riant, et comme Alain-Pierre Pillet nous en défendait l’objet trop romantique – y préférant Novalis – j’abondai dans ton sens pour faire enrager notre ami. Alors je clamerai encore ici un vers du grand Alfred, mais en vous pensant maintenant réunis autour d’une autre table : « On ne sait pas dire adieu à ceux qu’on aime. On les porte en soi ».
Paul Sanda,
en la résonance d’une célébration lointaine,
22 juillet 2025.
(Préface à Laboureur de larmes & autres recueils, Rafael de Surtis, 2025).
Œuvres de Pierre Grouix :
Michaux : corps et savoir. E.N.S. éd., 1998.
Laboureur de larmes (Taj Mahal). Rafael de Surtis, 1999.
Étude sur Rimbaud. Ellipses, 2001.
Le joueur d’échecs, de Stefan Zweig : Premières leçons. PUF, 2001.
Le Surréalisme. Ellipses, 2002.
Le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux, Victor Hugo. Larousse, 2002.
Sentiment du chèvrefeuille (Camilla Gjørven). Rafael de Surtis, 2003.
Russes de France, d’hier à aujourd’hui. Éditions du Rocher, 2007.
Romantisme de l’Amour (Notes danoises). Rafael de Surtis, 2007.
Une jeunesse marocaine (Français du Maroc). Éditions du Rocher, 2008.
Fèz (des hommes passent dans la ville). Rafael de Surtis, 2010.
Fils de Fès (Camille Grouix, Fez-Ville Nouvelle, 1941-1958). Rafael de Surtis, 2011.
Grand hôtel des rêves, Fez. Rafael de Surtis, 2012.
Ciné Fès. Avec Rachid Haloui. Rafael de Surtis, 2013.
François. Rafael de Surtis, 2013.
Appelé à disparaître. Les éditions du Littéraire, 2014.
Depuis (Camille Grouix, Fez-Ville Nouvelle, 1941-1958, II). Rafael de Surtis, 2014.
Triste pays d’hiver (Tollund). Rafael de Surtis, 2015.
Partout mon père. Rafael de Surtis, 2015.
Vilhelm (Hammershøi, peintre du spirituel). Rafael de Surtis, 2016.
Cahiers à la ville du père perdu. Rafael de Surtis, 2017.
Vivant visage du vent (1884-1950), Nom profond I. Rafael de Surtis, 2017.
Jacques. Rafael de Surtis, 2017.
Longwy, le feu, la roue et l’eau. Éditions Paroles de Lorrains, 2017.
Coin neutre : Camus, Cerdan, vies croisées. Éditions du Bourg, 2018.
Noria des Ans (1950-1981), Nom profond II. Rafael de Surtis, 2018.
Ferme du bois clair. Céline, Danemark (1948-1951). Éditions du Bourg, 2019.
Philippe. Rafael de Surtis, 2019.
La femme dans l’image, Journal danois. Éditions du Bourg, 2020.
L’Orchidée Tigre : Georges Carpentier, Jack Dempsey, le match du siècle. Éditions Infimes, 2021.
Coubertin olympique : Plus vite, plus haut, plus fort. Éditions Infimes, 2024.
Laboureur de larmes & autres recueils. Rafael de Surtis, 2025.
RIVIERE SANS RIVALE (extraits),
Poème de Pierre GROUIX
à la seconde de son apparition, l'orée des années blondes et des instants très vrais, un voile d'eau sur les yeux du rêveur et la beauté de plus belle
•
les feux sauvages couvant des siècles avant que l'homme sur terre, les alezans du vent et la veine ouverte du volcan, l'aurore boréale ou la lumière nordique (justice à ses cheveux)
•
elle dans des yeux nés pour la voir, les mondes où vivre exact, la terre aimée et les silences, un espace de confiance
•
la menait-il sans mot à l'eau de la rivière (l'enfance), méandres invisibles et poids du soleil, le temps se recousait et les mondes avaient lieu
•
et s'il penchait ses traits sur ceux de l'eau, le visage blond en sourdait, traits de l'amour précis et musique invisible
•
quant à savoir qui d'elle ou de lui, elle toujours, par la force des choses et pour que le temps soit
•
il n'aimait rien de lui qu'il ne préfère en elle
•
ce qu'il était peut-être en son silence abrupt, il s'en souciait comme du dernier flocon, d'une guigne ou bien de choses sans importance
•
ce que ses larmes lui apprenaient de lui, il s'en serait passé, l'aurait laissé brûler près de l'eau en silence
•
il aimait moins ses paumes indignes d'elle que le vent du soir à l'encontre des épaules blondes
•
auprès d'elle et près de la rivière, en un jardin de roses ouvertes vraies, brassée de clair sous le ciel et par l'eau douce des choses
•
hauteur, beauté, intensité, tous les accents étaient sur elle et le silence du monde
•
ce qu'il pouvait bien dire de lui par égarement ou par faiblesse ne comptait pas, les accents étaient blonds et bleu le ciel où vivre
•
il y a plus beau que l'or puisqu'il y a elle
•
il chérissait surtout les moments non loin d'elle, légers carats de temps, pas d'autre musique que le silence, rêve et chanson précise
•
les images sur elle plus qu'aux lèvres qui l'aimaient, des mondes plus blonds que le noir d'encre de ses cheveux à lui, l'incendie et la grâce plus que la cendre ou que la nuit
•
quant au silence sous le silence, la paix profonde dont il était le lieu, il n'y atteignait que par elle, intercession en blond, entremise claire
•
pour rendre ses pas en chemise blanche vers le bois clair du fjord sous la lune dès le soir, le rêve d'une encre blonde, de mots qui disent enfin
•
la baie au loin sous le bleu (tout ce pouvoir aux mains de la lumière), il la regardait sans la lire ni même chercher à la connaître jamais
•
pour un matin à ses côtés, un seul, pour la lumière ès-ses mains, noces de l'or et du lait, mille fois le pire des nuits, l'encre noirée et volontiers le vacarme du temps (ses battements)
•
principe des crépuscules, elle se couchait dans les draps souples de la brume et se réveillait nue dans le lit d'or des rivières
•
les moments sans rien et les très pauvres heures, il les passait aux environs de son visage à simplement se taire, une bougie sur la table
•
à ces heures dénuées, temps de grand silence bleu, le bel amour qui est aussi la transparence du jour
•
jamais un mot plus haut que l'autre, une ligne de musique et l'équilibre des choses, le feu de la flamme d'une bougie qui soit aussi le vol d'une chevelure, l'anniversaire de la princesse
•
elle et lui aux heures romantiques, le soir éteint et le monde en allé, la table de bois clair et la bougie nécessaire
•
à la dernière bougie mouchée par le premier vent d'aube, sur les lattes de la table sans vernis, des stalactites en blanc, comme les larmes de la neige
•
elle s'adonnait au plus aux seules notes très petites, toute fin de la musique et début du grand chant
•
cette route à l'intérieur qui allait vers nulle part, il la longeait surtout pour la traduire vers elle, tendresse à jamais et rivière de silence
•
l'entrée dans le pays profond et l'accès blond, il les demandait sans rien dire à ses yeux de beauté, parfum vrai du jour et langage bleu des fleurs
(..)
à de certaines heures plus profondes que schubert ou que brahms, même le silence pleure, la lumière
•
on ne pleure pas en silence, on pleure le silence
•
on ne pleure pas avec les yeux, on pleure avec le cœur, les larmes sont le sang invisible
•
parce qu'il faut que cet amour soit dit, que les mots le rencontrent et que l'encre le rende, parce que
•
il faut que le silence ait lieu, il faut que tout soit parce que tout vit, et le plus clair du chant et le très fin du sang
•
il faut que les larmes larment, que les pleurs pleurent et que saigne le sang, il faut que le pur mal ait lieu
•
à l'invisible nul n'est tenu mais tous se doivent…
Pierre GROUIX (Extraits de Laboureur de larmes & autres recueils, éditions Rafael de Surtis, 2025).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
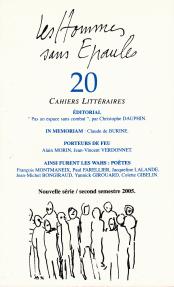
|
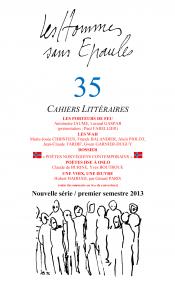
|
|
| Dossier : Léo MALET & Yves MARTIN, la rue, Paris, la poésie et le Merveilleux, n° 20 | Dossier : POÈTES NORVÉGIENS CONTEMPORAINS n° 35 |
