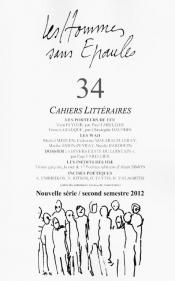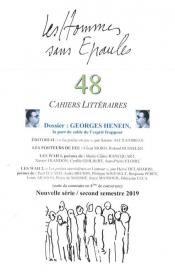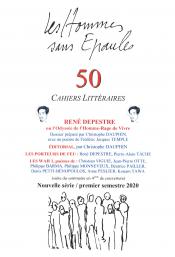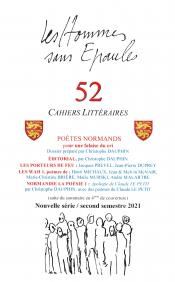Henri MICHAUX

HENRI MICHAUX A HONFLEUR
De quoi a souffert Henri Michaux (1899-1984), cet « athlète de la souffrance ? interroge Françoise Neau (cf. La souffrance dans les plis d'Henri Michaux in Cahiers de psychologie clinique, 2004). D’être « né troué » ou d’« avoir à mourir » ?, interroge Françoise Neau (cf. La souffrance dans les plis d’Henri Michaux in Cahiers de psychologie clinique, 2004). La souffrance, Henri Michaux l’a beaucoup arpentée, et l’écriture apparaît comme un recours privilégié pour « se remparer ». Des douleurs physiques, Michaux en a connu, plus banales que celles suscitées par une insuffisance cardiaque congénitale, qui l’emporte le 19 octobre 1984 : Michaux meurt à l’hôpital des suites d’un infarctus. Les douleurs physiques, elles furent souvent chez lui l’occasion de déployer une fantaisie débridée, des « créations mentales - le meilleur remède contre la douleur.
Ainsi ce panaris, qui le saisit à Honfleur une nuit de 1929, dans une chambre d’hôtel où crier était impossible, à cause des voisins. Il en fit deux courts textes, réunis dans Mes propriétés : « Crier » et « Conseils aux malades » : Contraint au silence, je me mis à sortir de mon crâne des grosses caisses, des cuivres, et un instrument qui résonnait plus que des orgues. Et profitant de la force prodigieuse que me donnait la fièvre, j’en fis un orchestre assourdissant. Tout tremblait de vibrations. / Alors, enfin assuré que dans ce tumulte ma voix ne serait pas entendue, je me mis à hurler, à hurler pendant des heures, et parvins à me soulager petit à petit. Pas besoin de panaris, d’ailleurs, pour intervenir, pour faire son cinéma – un poème voisin s’appelle « Projection ».
La scène se passe toujours à Honfleur : et je m’y ennuyais. Alors résolument j’y mis du chameau... L’odeur gagna le port et se mit à terrasser celle de la crevette. On sortait de la foule plein de poussières et de poils d’on ne savait quoi. Cette légèreté de la fantaisie toute-puissante n’est plus de mise en 1946 : « les chameaux de Honfleur », qui réapparaissent dans le fragment intitulé « Le convoi », ne sont plus que « l’accompagnement de notre malaise », une Distraction fâcheuse.
Dans ces Apparitions, la maladie de cœur ne suscite plus le détachement et le sentiment d’abandon quasi océanique que Michaux lui imputait en 1942 : Tout à coup, dans la nuit, comme un brusque coup de pompe dans la poitrine, au cœur, mais ce n’est pas le coup de pompe qui donne, c’est celui qui retire, qui retire, vous laissant au bord de l’évanouissement, au bord de l’horreur sans sujet, au bord du « plus rien ». / Les genoux en un instant, en un dixième d’instant se sont mis à trembler, comme sous une fièvre de quarante-trois degrés et demi. / Mais pas de fièvre (on la souhaiterait plutôt, sorte de compagnie), pas de fièvre. Rien. Et ce « rien » est pour faire place à l’événement terrible qui vient, je l’attends, qui appelle dans le silence, qui ne va pas reculer indéfiniment... « Ma guerre commença », disait le narrateur en circulant dans toutes les zones de son corps. C’est une vraie guerre, non plus entre « je » et « il » comme dans Le Grand Combat, mais entre « je » et « mon corps », entre « la peur » et « moi », entre « je » et des machines imaginaires, entre « je » et « quelqu’un », etc...
Parmi ces instruments à parcourir le corps humain, le thermocautère : Son style est simple : je te vois, je te détruis. / Quel admirable sillon il va pouvoir tracer dans les chairs indéfendables qu’il va rencontrer ! En pleine sculpture et cette sculpture est ciselure. Avec ardeur vous vous jetez au travail. N’y a de gênant qu’une odeur de roussi. Mais qu’importe ! Ce n’est pas le nez qui est à son affaire ici. Qui a le nez créateur ? Pas moi. On ne saurait donc pas sous ce prétexte refuser cet admirable instrument à qui veut parcourir de façon intéressante le corps humain. Mais attention, tenez-le bien, dirigé sur le corps recherché. Si exaltant dans le « Je-tu », il est terrible dans le « Tu-moi », ou même dans le « Je-moi », si vous êtes assez faible pour vous laisser aborder et cela peut arriver. Oh ! comme cela arrive aisément ! Attention, c’est fait ! lâchez ! lâchez donc ! Trop tard, le voilà qui s’attache à votre chair, qui entre dans votre cuisse où pourtant vous ne trouviez rien de trop, le voilà qui vient brûler votre propre genou, et la chaleur terrible de l’infiniment petit haut fourneau vous entre dans l’os qu’elle parcourt en un instant, le remontant d’un bond jusqu’au sommet, comme un rat affolé. / Pantin disloqué, tu t’agites, maintenant, tu t’agites dans le lit du malheur, imbécile imprudent.
Eté 1933, Michaux confie une poignée de textes, qu’il qualifie de « cauchemars », à Jean Ballard, directeur de la revue Les Cahiers du Sud. Ce dernier lui répond, dans une lettre datée du 6 juin 1933 : « Ces rêves ou cauchemars dont le récit exact n’exclut pas l’humour qui vous est propre… sont comme des lambeaux tout frais arrachés à vos fresques nocturnes… J’ai, après de subtils gommages, exhumé un titre qui me paraît parfait et que j’adopte : La nuit remue. » Les poèmes paraissent sous ce titre en 1935.
En 1941, dans une conférence devenue célèbre, André Gide fait partager son enthousiasme pour Henri Michaux, jusque-là assez peu connu. Après avoir lu quelques lignes d’un des premiers livres, Ecuador, il déclare « Déjà ces phrases vous donnent quelque idée du très singulier tour d'esprit qui, par sincérité, précipite sans cesse Michaux hors de l'ornière des conventions, de l’appris par cœur. Sensation ou pensée, il la suit, sans souci qu'elle paraisse étrange, bizarre, ou même saugrenue. Il la prolonge et, comme l'araignée, s’y suspend à un fil de soie, laissant le souffle poétique l’emporter, il ne sait lui-même où, avec un abandon de tout son être. » Intervention, relatant l’invasion imaginaire de Honfleur par les chameaux, dit avec humour le refus de la réalité quotidienne. Comment « une petite ville de pêcheurs de crevettes et de moules «, véritable univers de carte postale, se trouve-t-elle bouleversée par la fantaisie d’un poète ? Ce poète, un moment tout-puissant n’est-il pas, en fait, un apprenti sorcier ? L’humour de ce texte n’a-t-il pas pour fonction de souligner l'écart entre l'idéal et la réalité et de révéler cette réalité ? Quel rôle pouvons-nous donc assigner à cette fantaisie ?
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
«Lointain intérieur», ce titre d’un livre d’Henri Michaux recèle une ambivalence qu’il faut souligner d’emblée. On note qu’il se compose de deux adjectifs accolés. L’un de ces adjectifs est substantivé, mais ce rôle de substantif peut être tenu alternativement par l’un ou l’autre : il peut donc s’agir soit d’un lointain qui serait intérieur, soit d’un intérieur que l’on jugerait lointain. On voit tout de suite l’écart d’entendement qui sépare ces deux « versions ». Dans l’une, je me dis porter un lointain à l’intérieur de moi-même, c’est-à-dire que ce lointain fait corps avec ma part la plus profonde certes, mais aussi la plus intime, donc en fin de compte la plus proche. Dans l’autre, je procède à une introspection, je scrute mon intérieur, et voici qu’il m’apparaît lointain, qu’une distance m’empêche de le rejoindre et me sépare donc de moi-même. En quoi serait-il légitime d’ignorer l’une ou l’autre de ces deux directions ? Coexistant, elles ennoblissent le lointain de ce surcroît d’énigme où se confirme sa vraie valeur poétique.
« Je vous écris d’un pays lointain » nous dit Michaux, et aussi : « Je vous écris du bout du monde ». C’est ce loin qu’il faut ici, c’est demain qu’il faut aujourd’hui : Siècles à venir/ Mon véritable présent, toujours présent/ Obsessionnellement présent… Michaux - comment s’en étonner ? - témoigne d’une solide addiction à la drogue du lointain (« Tous les moyens lui sont bons. Pas besoin d’opium. Tout est drogue à qui choisit pour y vivre l’autre côté. ») : C’est ça qui fait rêver ! C’est ça qui fait pisser rêveusement les chiens contre le pied des arbres ! C’est ça qui nous endort à tout le reste, et toujours nous ramène, recueillis aux fenêtres, aux fenêtres, aux fenêtres aux grands horizons.
À ce penchant, « le monde », bien entendu, oppose ses obstacles insurmontables : On m’enfonçait dans des cannes creuses. Le monde se vengeait. On m’enfonçait dans des cannes creuses, dans des aiguilles de seringues. On ne voulait pas me voir arriver au soleil où j’avais pris rendez-vous.
Michaux oscille d’ailleurs entre les deux perspectives que nous indiquions. Tantôt, c’est, en leur utopie, le lointain et la cime qui pourraient être, idéalement, ses seuls intimes, « sa vraie famille », que le monde le fait quitter : […] cependant qu’il y a peu d’instants encore, il se trouvait entre les Majestés, lui-même sur un trône, parmi les souverains masqués et qu’en grande pompe le suivaient ses gens, tandis que s’élevant toujours plus haut, plus haut encore, il abordait à la plate-forme suprême, où, seul, le son des grandes trompettes de la victoire pouvait le rejoindre. […] Il lui faut en un instant, et incertain s’il la reverra jamais, quitter sa vraie famille, les célestes siens, pour revenir parmi les étrangers qui se disent ses proches et ne le connaissent pas. Tantôt, au contraire, c’est l’intérieur qui devient le lointain de tout, et qui sépare de tout : J’ai peine à croire que ce soit naturel et connu de tous. Je suis parfois si profondément engagé en moi-même en une boule unique et dense que, assis sur une chaise, à pas deux mètres de la lampe posée sur ma table de travail, c’est à grand’ peine et après un long temps que, les yeux cependant grands ouverts, j’arrive à lancer jusqu’à elle un regard. Une émotion étrange me saisit à ce témoignage du cercle qui m’isole.
Un conflit persiste donc, et l’on sent qu’il peut y avoir quelque chose de malaisé dans la « gestion » intime du lointain intérieur. Les poètes le disent, ou le suggèrent, chacun dans sa tonalité propre...
Paul FARELLIER
(Revue Les Hommes sans Épaules).
À lire : Œuvres complètes, trois volumes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1998, 2001, 2004).