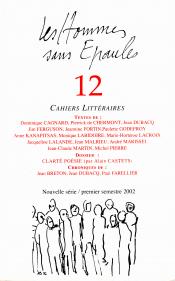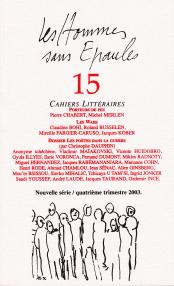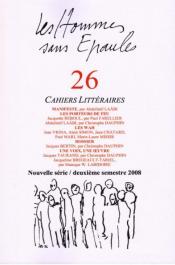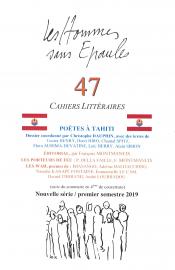Mahmoud DARWICH

Mahmoud Darwich a résidé à Paris - des séjours courts ou longs -, entre 1983 et 1995 et n’a cessé d’y revenir jusque peu de temps avant sa mort. Je crois qu’il aimait ce pays et cette ville, où il a écrit quelques-uns de ses grands livres de poèmes : Plus rares sont les roses, Une mémoire pour l’oubli, Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?, Murale, Le Lit de l’étrangère, Ne t’excuse pas, Comme des fleurs d’amandiers ou La Trace du papillon.
Darwich disait volontiers que Paris avait été une sorte de naissance ou de renaissance pour lui, en tant que poète, mais aussi lecteur. À Paris, Darwich ne recherche pas les feux de la rampe littéraire et médiatique, qui lui sont pourtant acquis. Il vit, quasi anonymement, simplement, dans l’ombre. Tout l’inverse des coureurs de coteries germanopratins. Cela me plait.
J’ai eu la chance de rencontrer Mahmoud Darwich, pour la première fois, en 1992, alors qu’il vivait à Paris. Le premier choc, fut de constater qu’il n’avait pas « grand-chose » à voir avec les étiquettes et clichés qui lui étaient associés et notamment l’image exclusive et réductrice de « poète de la résistance palestinienne ». J’avais 24 ans et lui, 51 ans. J’étais un jeune poète. Lui, un poète à la réputation internationale, dont les lectures de poèmes remplissaient des stades ou des salles entières, allant d’une centaine à des milliers de personnes.
Pour venir écouter le poète Darwich ? Ou bien le porte-parole de la cause Palestinienne ? Il souffrait dans une certaines mesure, que la part introspective, intimiste, de sa poésie, soit moins commentée et appréciée, par rapport à celle de sa période disons, plus publique, politique. Mahmoud me dit : « Je suis un poète, pas une vedette de cinéma. » Je lui rétorque, avec humour, que seule une « vedette de cinéma » peut habiter là où il réside, à Paris, en plein cœur du très huppé quartier du 16ème, Place des États-Unis. Mahmoud sourit.
Monument ? Symbole ? Héros ? Légende de la résistance palestinienne ? Darwich serait à en écouter certains (et ils sont nombreux), « la Palestine à lui tout seul ». Pour sa part, Mahmoud dit : « Quand dépasserai-je l’identité palestinienne pour être un poète avant tout, lu et reconnu comme un poète ? » Ces considérations, qui purent un temps le flatter, l’agaçaient. Cela explique en grande partie son refus des interviews dans la presse. Il savait quel genre de questions lui seraient poser, comme les réponses qu’il devrait donner ; toujours les mêmes. Et il ne serait pas question de sa poésie et de ses dernières publications. C’est pour cela qu’il évitait d’arborer tout symbole, y compris le fameux keffieh palestinien. Il en avait pourtant un. Il me l’a offert. Je l’ai conservé.
Ses poètes étrangers de prédilection ? Il me parle de René Char, Saint-John Perse, Paul Eluard, Constantin Cavafy, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, W. H. Auden, Josef Brodsky, mais surtout de Yannis Ritsos. Il apprécie aussi Yves Bonnefoy, que je connais bien. Yves est d’accord pour le rencontrer, chez lui, rue Lepic ; mais Mahmoud repousse, puis ne donne pas suite à ma proposition. Il vit à Paris comme « reclus », concentré sur son œuvre tout autant que sur ses lectures et découvertes.
Mahmoud est avenant, accessible, mais méfiant. Il soumet d’abord son interlocuteur à une habile série de questions, pour connaître la personne qui souhaite se rapprocher de lui. J’ai rarement connu d’hommes aussi élégants, humbles, que Mahmoud qui, à bien des occasions, ne manque pas de me rappeler, comme pour m’inculquer le sens de la nuance, du recul et de l’humain, de ne pas oublier que : « Dans chacun il y a l’Autre ». Il est accueillant et aussi d’un humour taquin, un esprit mordant, à l’écoute, très observateur. Il me dit encore : « La poésie requiert et offre des métaphores pour rendre la réalité plus supportable. »
Lorsque, bien plus tard, en 2002 et 2003, je lui propose de le publier dans la revue Les Hommes sans Épaules ; il accepte immédiatement. Il me parle du Proche-Orient, de littérature, de sa terre. Sa culture est encyclopédique et universelle. Pas un chef, ni la caution de quoi que ce soit. Non, un poète. Un vrai. Pas une once de haine, de racisme, de mépris, y compris à propos de l’Autre, de l’ennemi, de l’occupant, dont il maitrise parfaitement la langue (l’hébreu), la culture et aussi les textes sacrés. Il dit, d’ailleurs : « Il y a une grande poésie dans la perte. Si j’appartenais au camp des vainqueurs, je participerais aux manifestations de solidarité avec la victime. » Il a une classe qui surpasse largement, en fait, celle que lui prêtent ses apologues les plus fervents.
Mahmoud Darwich n’est pas « la Palestine à lui tout seul ». Il n’a jamais aspiré à être cela. Est-il pour autant « la poésie palestinienne à lui tout seul ? Pas davantage. Un livre le démontre d’ailleurs de manière remarquable. Il s’agit de la superbe anthologie La poésie palestinienne contemporaine, choix de textes et traduction de l’ami et grand poète marocain Abdellatif Laâbi.
Mahmoud Darwich est né le 13 mars 1941, à Al-Birwa, en Galilée, village situé à neuf kilomètres à l’Est de Saint-Jean d’Acre, en Palestine sous mandat britannique ; aujourd’hui Israël. Il est le deuxième enfant d’une famille musulmane sunnite de petits propriétaires terriens, de quatre garçons et de trois filles.
La famille Darwich est contrainte à deux reprises de quitter sa terre. En 1948, comme le poète le relate : « Une nuit d’été, alors que nous dormions, selon les coutumes villageoises, sur les terrasses de nos maisons, ma mère me réveilla en panique et je me suis retrouvé courant dans la forêt, en compagnie de centaines d’habitants du village. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes et je ne comprenais pas ce qui se passait… Je sais aujourd’hui que cette nuit mit un terme violent à mon enfance ».
Puis, en 1950, lorsqu’à son retour du Liban, la famille Darwich découvre que Al-Birwa a été rasé et remplacé par un village agricole israélien, Ahihoud, et le kibboutz Yasur. Le poète n’a rien oublié : « Rayé de la carte dès notre départ forcé. On a construit deux colonies sur son site. L’une pour des immigrants juifs venus d’Europe, l’autre pour des immigrants du Yémen… Je n’ai pas retrouvé ma patrie personnelle. Ni mon lieu personnel. Mon lieu premier a été dès le départ supprimé. C’est pourquoi, lorsque je raconte mon histoire, je dis forcément une histoire collective, celle de toute la Palestine… Le destin a voulu que mon histoire individuelle se confonde avec une histoire collective, et que mon peuple se reconnaissance dans ma voix… J’étais un réfugié au Liban et je me retrouvais un réfugié dans ma propre patrie… Enfant, j’ai déclamé un poème patriotique à la fête de l’école. Un officier me convoqua, me menaça et me parla avec une extrême grossièreté. Mais parmi mes maîtres, la meilleure fut une institutrice juive, alors que le directeur de l’école et le professeur d’anglais manquaient de chaleur. Et, bien entendu, mon premier geôlier fut juif aussi… Tout cela pour vous dire que j’ai de multiples images de l’Autre israélien. »
Que s’est-il passé ? Pas besoin de remonter jusqu’à – 1330 avant notre ère, où selon la Bible hébraïque, Moïse et les Hébreux quittent l’Égypte pour la « Terre promise » ; ni même en l’an 636, qui marque la conquête de la Palestine (qui fait alors partie de l’empire Byzantin) par les Arabes. L’écrivain anglais Arthur Koestler (né dans une famille juive hongroise de langue allemande), auteur en 1945 du roman Le Zéro et l’Infini, a bien résumé la situation et avant 1948 : « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. »
Cette histoire et ces expériences traumatisantes sont à l’origine de l’engagement de Mahmoud Darwich : Point de glaive qui n’ait trouvé fourreau dans notre chair. Un engagement qui lui vaut d’être emprisonné, sans être jugé par un tribunal, à cinq reprises en Israël, en 1961, 1965, 1967 et 1969, avec une assignation à résidence, à Haïfa, de 1967 à 1970 : Et sur la crête des vagues de la mer et du désert, ils brandissaient une île pour exister
En 1970, Darwich part pour Moscou étudier l’économie politique. En 1971, il est au Caire, où il travaille pour le quotidien Al-Ahram. À Beyrouth, en 1973, il dirige le mensuel Shu'un Filistiniyya (Les affaires palestiniennes) et travaille comme rédacteur en chef au Centre de Recherche Palestinien de l’OLP. Du 21 août au 1er septembre 1982, plus de 10.000 combattants palestiniens, avec à leur tête le charismatique leader de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat, évacuent Beyrouth par la mer, sous la protection d’une force multinationale, après trois mois d’un terrible siège de l’armée israélienne. Darwich relate la résistance palestinienne au siège israélien dans Qasidat Bayrut (1982) et Madih al-xill al'ali (1983). Le livre phare, un récit, de cette période, paraît en français en 1994 sous le titre Une mémoire pour l’oubli. Le poète poursuit sa route de l’exil, à Tunis, puis à Paris.
En 1988, son poème « En traversant les mots passants », est discuté à la Knesset et accusé de souhaiter le départ des Juifs d’Israël. Mahmoud Darwich s’en défend en expliquant qu’il veut leur départ de la Bande de Gaza et de Cisjordanie. Le poète écrit : Alors quittez notre Terre - Nos rivages, notre mer - Notre blé, notre sel, notre blessure.
Un an plus tôt, en 1987, il est devenu Président de l’Union des écrivains palestiniens. La même année, de conseiller, il a été élu au comité exécutif de l’OLP. Il est alors très proche de Yasser Arafat.
Darwich, qui a fondé, en 1981, le journal littéraire Al-Karmel (qui cesse de paraître en 1993), après Tunis et surtout Paris, vit, à partir de 1995, à Ramallah et à Amman, en Jordanie (« Ramallah, la Cisjordanie, ce n’est pas ma terre. Les gens, les paysages ne me sont pas familiers. Je suis de Galilée. C’est comme si j’étais encore en exil, mais chez moi »).
Mahmoud Darwich est l’auteur d’une trentaine de livres, de poèmes, principalement, dont, traduits en français : Chronique de la tristesse ordinaire suivie de Poèmes palestiniens (1989), Rien qu’une autre année (1983), Palestine mon pays : L’affaire du poème (1988), Plus rares sont les roses (1989), Une mémoire pour l’oubli (1994), Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? (1996), Au dernier soir sur cette terre (1994), La Palestine comme métaphore (1997), ou l’anthologie, que nous devons à Elias Sanbar, La terre nous est étroite (2000).
La poésie de Darwich, éminemment autobiographique, lyrique, épique, n’est jamais repliée sur elle-même (« Poète de la terre occupée ou poète de la résistance. Je ne veux pas être étiqueté… Mes lecteurs attendraient de moi que j’écrive en réaction à la situation politique, que je commente l’Intifada. Je ne veux pas succomber à ces pressions et, pour parvenir à écrire chaque jour, je me réfugie parfois à Amman. Là, dans une chambre à moi, je continue mon œuvre poétique ») : le mouvement, l’évolution, la recherche, l’ouverture, la personnifient bien davantage que l’immobilisme ou le militantisme : « Je crois que le thème Palestine, qui est à la fois appel et promesse de liberté, risque de se transformer en un cimetière poétique s’il demeure enfermé dans sa textualité, dans les limites que sont le « soi » et « l’Autre », dans l’espace délimité et le moment historique. Autrement dit, si le projet poétique ne recèle pas son aspiration propre, son objet propre, qui, en fin de compte, n’est que l’accomplissement de la poésie…. Au poète de produire son esthétique personnelle. Si cette dernière est suffisamment ouverte, elle donnera son horizon à la patrie ; si elle est étriquée, la patrie s’y trouvera à l’étroit. Une patrie ne peut se réduire à ce qu’elle est objectivement. Car la poésie ouvre la patrie sur l’infini humain, à condition que le poète parvienne à la porter là. Pour cela, le poète doit créer ses propres mythes. Je n’entends pas par là le mythe issu d’un autre déjà connu, mais celui qui naît de la construction du poème, de sa forme et de son univers propres. Celui qui transforme le langage concret en langage poétique. »
Visionnaire par essence, la poésie de Mahmoud Darwich s’est un temps, inscrite dans le cadre de la « poésie de la résistance ». Elle se distingue toutefois des autres par sa dimension universelle, son attachement aux mythes, aux symboles orientaux, hellénistiques, son intimisme, son introspection, comme par son habileté à donner au quotidien une dimension épique : « Je m’appuie sur les mythologies grecque, assyrienne, cananéenne et sumérienne. Je les utilise, je ne me base pas sur elles. Le poème doit créer sa propre mythologie. Le terrain du poème doit être construit de manière mythologique, et pas seulement par la citation de noms…. Chaque poème porte le projet de construire une nouvelle genèse, un nouveau commencement… Le poème doit être étranger à lui-même. Il doit faire son propre voyage. Parfois tout repose sur un seul mot. Parfois un nom de fleur, parfois un nom de lieu. Chaque poème a une clé, un secret. Vous écrivez, vous allez dans une direction et vous pensez que c’est trop poétique, alors vous jetez un mot et cela se recouvre de chair et de sang. Elytis a parlé un jour du poème comme d’un équilibre entre le bleu, le sable et le sel. Si l’équilibre est rompu, le poème tombe. » Mélange harmonieux entre romantisme lyrique et prosélytisme révolutionnaire, cette poésie part de l’individuel pour rejoindre l’universel, afin de surmonter la haine dont le poète n’a été que trop le témoin direct : L’oubli est ascension vers la porte de l’abîme ; ainsi que l’aspect tragique de la solitude humaine : La vérité a deux visages et la neige est noire sur notre ville - Nous ne pouvons désespérer plus que nous ne l’avons fait, et la fin marche vers - Les remparts. Sûre de ses pas.
Mahmoud Darwich tente de libérer le langage poétique et de le faire évoluer vers un horizon épique. L’Histoire devient ainsi un vaste espace où se succèdent indéfiniment peuples, civilisations et cultures, un lieu de recherche de l’identité nationale, dans le cadre de la coexistence, de la cohabitation et du choc des identités. Relation intime avec le langage, cette œuvre l’est tout autant envers le monde et autrui. Elle se propose comme un chant de paix qui annonce une terre enfin devenue habitable, grâce au pouvoir incantatoire de la poésie : J’ai restreint mon abîme pour que mon pas s’y allonge, et j’ai assis le ciel sur les gravats - Et je dois oublier pour secouer de mes poignets les chaînes des nombreux chemins - Et je dois oublier mes dernières défaites pour voir l’horizon des commencements.
Dense, fluide et maîtrisé, le lyrisme de Darwich interroge, questionne, éveille, donne à voir et à ressentir, tout en faisant corps avec la réalité obscure, que sublime un onirisme fusionnant la tradition avec un réel débridé, qui n’hésite pas à faire appel aux mythes et symboles du Moyen-Orient, comme à la Grèce ancienne : Les eaux du Nil et de l’Euphrate effaçaient de mes côtes les traces de ma geôle. L’espoir qui habite le poète n’est pas vain, et peut parfois rejoindre le réel immédiat.
En mars 2000, après cinq heures de débat au parlement israélien, et sous l’autorité de Yosi Sarid (ministre israélien de l’éducation), la motion qui consiste à faire intégrer une partie de l’œuvre de Darwich - à titre facultatif - dans les programmes scolaires, est adoptée. « Des choses changent, mais, comme tout changement en Israël, cela se fait dans une certaine violence. Cinq heures de débat parlementaire sur la poésie ! Jamais soirée poétique ne fut si longue. Cette décision est un pas positif sur la voie de la reconnaissance de la culture de l’Autre. La paix suppose l’ouverture de la société israélienne à l’Autre, en particulier à l’Autre palestinien, qui vit sur la même terre. Les opposants à la décision de M. Sarid craignaient avant tout que l’enseignement de mes poèmes, qui sont un hymne d’amour à cette terre et l’expression d’une relation ininterrompue avec elle, ne pousse les jeunes générations à se poser des questions ; au-delà, c’est le problème de l’intégration d’Israël dans un Proche-Orient dont il fait partie géographiquement, mais auquel il s’est toujours fermé culturellement, qui est posé. Une brèche s’est ouverte dans le mur de l’ignorance et de négation de l’Autre palestinien », affirme le poète.
Le point faible du poète demeure encore et toujours son cœur. Ses examens médicaux ne sont pas bons. Mahmoud Darwich accepte le principe d’une opération à condition qu’il ne soit pas maintenu en vie en cas de paralysie. Mahmoud Darwich décède le 9 août 2008, aux États-Unis, au Memorial Hermann-Texas Medical Center, à Houston (sud), après avoir subi une intervention chirurgicale : une opération du cœur. Il en avait déjà subi deux en 1984 et 1998, voguant déjà entre la vie et la mort : Le temps est zéro. Je n’ai pas pensé à la naissance – Lorsque la mort m’emporta dans le chaos. – Je n’étais ni vivant ni mort – Et il n’y avait ni néant ni existence.
Pour Mahmoud Darwich, malgré son pessimisme, oui, le rêve peut encore rêver. Sa hantise ? Que le futur ressemble au présent ou soit pire, encore. La racine du conflit israélo-palestinien ne résulte pas du rejet arabe d’un État juif, mais de l’occupation, de l’accaparement des terres, de la colonisation des territoires palestiniens, du « droit au retour » des réfugiés. L’OLP a reconnu l’État d’Israël en 1993, et la Palestine est entrée comme État-observateur à l’ONU, sur la base des frontières de 1967. Les Palestiniens reconnaissent l’existence d’un État israélien doté des limites qui lui étaient connues entre 1948 et 1967. Mais rien n'y fait. La situation demeure bloquée et tragique. Pour Mahmoud Darwich, le rêve peut encore rêver, mais en a-t-il envie ?
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules)
Œuvres de Mahmoud Darwich (en français) :
Présente absence (Actes Sud, 2016), Je soussigné, Mahmoud Darwich, entretien avec Ivana Marchalian (Actes Sud, 2015), L'exil recommencé, chroniques (Actes Sud, 2013), Nous choisirons Sophocle et autres poèmes (Actes Sud, 2011), Le lanceur de dés (Actes Sud, 2010), Une nation en exil (Actes Sud, 2010), Récital Mahmoud Darwich - Odéon Théâtre de l’Europe, livre-cd, (Actes Sud / Odéon / France Culture, 2009), Anthologie poétique 1992-2005 (Babel/Actes Sud, 2009), Une nation en exil : Hymnes gravés suivi de La Qasida de Beyrouth, avec Rachid Koraichi, (Actes Sud, 2010), La Trace du papillon - Journal poétique, été 2006 - été 2007, (Actes Sud, 2009), Comme des fleurs d’amandier ou plus loin (Sindbad/Actes Sud, 2007), Entretiens sur la poésie (Sindbad/Actes Sud, 2006), Ne t’excuse pas (Sindbad/Actes Sud, 2006), État de siège (Sindbad/Actes Sud, 2004), Murale (Actes Sud, 2003), Le lit de l’étrangère (Actes Sud, 2000), La terre nous est étroite et autres poèmes, anthologie (Poésie/Gallimard, 2000), La Palestine comme métaphore (Sindbad/Actes Sud, 1997), Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? (Actes Sud, 1996), Au dernier soir sur cette terre (Actes Sud, 1994), Une mémoire pour l’oubli (Actes Sud, 1994), Chronique de la tristesse ordinaire, suivi de Poèmes palestiniens, (éd. du Cerf, 1989), Plus rares sont les roses (éd. de Minuit, 1989), Palestine, mon pays : l’affaire du poème (éd. de Minuit, 1988), Rien qu’une autre année, anthologie 1966-1982, (éd. de Minuit, 1988).