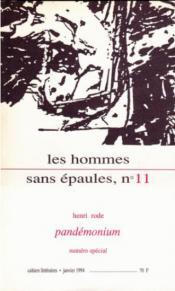Collection Les HSE
- Présentation
- Presse
- Du même auteur
Dans ce Pandémonium, où il ouvre des portes de plus en plus secrètes, il s’agit pour Henri Rode, non de frôler ses abîmes, mais de les explorer avec une exigence qui tient du défi. Sans sombrer ? Sans « sauter sur la poudrière ? » Pas si sûr : Mais, après tout, écouter l’Arbre prédateur que nous contenons, comme il est dit ici, nous sauve peut-être des faux-semblants de l’imbécillité – et la pire. Un lieu parfois, tel que Vigo, Prague, San Francisco déchaîne les obsessions de celui qui écrit cette autopsie – ou échographie – intime. Il se trouve alors, de plein fouet, sous la menace du destin et de l’humain le plus interrogeant, le plus cru, le plus fatidique, alors que son œil s’égare et fouille, selon John Milton, dans la profondeur de sa propre enceinte, là où sexe et mort se rencontrent, se conjuguent et s’hypnotisent pour la fulguration d’un rituel.
L’ARBRE PREDATEUR
à Hervé Loyez
ça commence par une fenêtre en rond, tel un œil, ouverte sur le spectacle. Face à la place, de nuit. Sur l’estrade aussi sensible qu’un ventre géant, les pieds rebondissent, des bras se tendent, projetés puis arrondis, drapés de violine et d’orange, qui traversent l’éclairage plutôt sourd. Qu’est-ce qui éclate de la survie, peut-être de la mort, dans ce mouvement très répété, d’avant-arrière ? Tandis qu’un grand visage de pierre, appuyé à une borne, tout d’usure et de ruse, observe ces bras, les oripeaux, la fenêtre, mon buste projeté en avant ? Il a les yeux ouverts sur des labyrinthes de jugement, et connaît la cause de tout. Visage-conscience, ou tribunal, sachant, surtout, le pourquoi de ma torsion au-dessus du vide, de la dissymétrie de mes genoux, des échafaudages de douleur qui s’étagent autour de ma colonne vertébrale. Oui, tout est su par cette face, ce masque, au fond de la nuit de juillet, par 40 °, alors que les corps drapés virent multicolores, mus par une mécanique de giration où l’on chercherait en vain un soupçon de sexualité.
Sûr que malgré le refus que j’oppose, arc-bouté à l’appui, malgré l’intensité multipliée de ces bras dont les couleurs se déploient plus vives en vertige, le tout accompagné du tumulte assez lointain de tambours, l’arbre s’installe en moi. Il prend naissance au bas de mes reins. Mais les racines descendent jusqu’à mes orteils et poussent, par le haut, jusqu’à envahir mes épaules, ma tête, mon cerveau. Ramifications qui me martyrisent, poussées obstinées laissant seule ma bouche libre, à vif. L’arbre fait de moi un utérus, ou un anus, prolifique et envahi, saccagé à la fois. Il cogne et s’insinue.
Un vandale l’a décidé : je contiendrai l’arbre de douleur. Puissance contractile, chercheuse. En voulant, de tout son pouvoir, remplir la configuration de mon corps pour le dépasser, puis monter jusqu’au ciel afin de s’y étaler, s’y ramifier davantage, en gigantesque prédateur saisi d’un frémissement inhumain. Inhumain, qui l’affirme ? Cet arbre pétri d’arrogance, qui me force et finit par accéder au céleste, est peut-être le fruit de toute la souffrance du monde, le bilan de myriades d’assassinats, de lèpres, d’horreurs terrestres soudain condensés dans son tronc, ses branches, ses ramilles et jusque dans la finesse de la plus petite feuille. Et je suis là, piégé à la croisée béante, avec ce message installé en moi par le végétal sans merci. J’étouffe aux trois-quarts. Comment respirer, me tordre, protester. A me remplir, l’arbre éructe de liesse – et veut me prouver quoi ?
Œil fixe, de la fenêtre, je contemple sans bouger les battements de ces bras, chacun portant son lambeau de tissu orange, violet ou d’un vert aigu. Je laisse faire. Les tambours roulent. Et le visage-masque, le visage-tribunal, là, contre la borne, qui regarde tout, me passe au crible de son procès et d’un coup nous aspire, moi et l’arbre, pour nous entraîner au fil des labyrinthes de conduits qu’il contient, où s’étouffent en réduction la place, les danses, le roulement de plus en plus menu des tambours.
Henri RODE
(Texte-poème extrait de Pandémonium, Les Hommes sans Epaules éditions, 1994).
Dans la revue Les HSE
"Digne successeur de la Bouche d’orties, Pandémonium est un implacable couperet : Elle n’existe plus puisque vous respirez. Mais elle est quelque part. Elle vous apparaîtra quand vous éclairerez, cette nuit, comme un énorme cafard écrasé sur le mur. Henri Rode y poursuit son introspection singulière en enfonçant encore davantage les portes les plus reculées de l’être. Ici, les abîmes sont visités par un oeil impitoyable qui s’égare et fouille dans la profondeur de sa propre enceinte, « là où sexe et mort se rencontrent, se conjuguent, et s’hypnotisent pour la fulguration d’un rituel. » L’audace, la vision et le style de ces textes-poèmes touchent la perfection. Outre ce constat du sexe-monstre et de la vie, qui est billet pour l’abattoir, Henri Rode se révèle être un poète de l’illumination, dans la droite ligne de Baudelaire et de Rimbaud. Partant de la condition humaine, de la douleur en soi, Rode nous fait part de ses visions, qui prennent bien souvent la forme de véritables petits scénarii. Rode tutoie le merveilleux jusque dans la plaie. Composé de deux parties : L’Arbre prédateur et Pandémonium, ce recueil annonce très vite la couleur : « L’arbre prédateur est ce qui nous dévore, nous révolte et, sans doute, nous justifie. Trop de gens, qui préfèrent s’asseoir dans l’imbécillité des apparences, ne veulent pas savoir que cet arbre est en eux. » Dès le poème « Le mur », on songe à un automatisme visionnaire. Le vers rodien est une sonde qui circule dans nos artères (celles du poète, en l’occurrence). Jamais la douleur n’a été transposée avec autant de lucidité et de justesse : « La rage autodestructrice est contenue par les contradictions du corps et tient le monde en respect. » Poète de l’intériorité, Henri Rode observe et décrypte l’être sous toutes ses coutures : Ramifications qui me martyrisent, poussées obstinées laissant seules ma bouche libre, à vif. L’arbre fait de moi un utérus, prolifique et envahi, saccagé à la fois. Il cogne et s’insinue. »
Christophe DAUPHIN (Revue Les Hommes sans Epaules n°29/30, 2010).