|
Tri par numéro de revue
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >
|

|
|
Lectures
" Quand on feuillette chaque nouveau numéro des Hommes sans Epaules, on ne sait jamais par quoi inaugurer la lecture tant le sommaire est riche et consistant, la crainte étant de retenir certains dossiers et d’en négliger d’autres. Tant pis, courons le risque en retenant d’abord l’hommage à Jacques Lacarrière. Plus de 10 ans après sa disparition, ses écrits sont d’une brûlante actualité. Le souffle que l’on ressent à la lecture de Lacarrière est celui des plus grands poètes c’est-à-dire ceux qui n’ont besoin de personne pour se hisser aux sommets.
En complément, on lira l’important dossier central consacré aux poètes grecs contemporains. Coordonné par Christophe Dauphin, cet impressionnant dossier donne à lire les textes de 10 poètes parmi lesquels le merveilleux Yannis Ritsos, le minutieux Constantin Cavafy ainsi que les deux Prix Nobel que furent Georges Séféris et Odysséus Elytis.
L’Arménie est aussi présente dans ce numéro avec une étonnante suite poétique de Paul Farellier et, du même auteur, une évocation d’Armen Lubin, le poète emblématique de l’Arménie, réfugié en France et décédé en 1974.
Mais la richesse de cette livraison ne s’arrête pas là puisqu’on trouve encore des poèmes de Gisèle Prassinos, des présentations de poètes ainsi que des notes de lectures sur plus de 50 pages. Bref, comme toujours avec cette revue, on tient la preuve vivante qu’il est possible d’associer harmonieusement la qualité des contributions et la quantité d’écrits. "
Georges CATHALO (cf. "Lectures flash" in revue-texture.fr, janvier 2016).
*
" Où es-tu Grèce ? je ne sais de toi que ce mot épelé au lointain des lèvres, ce mot de sable et de sillage tout craquelé d'aurore", Jacques Lacarrière. Le quarantième numéro des Hommes sans Epaules, cette revue semestrielle, consacre ses trois cents pages à deux expressions modernes de peuples se rejoignant dans la tragédie humaine et la poésie: le grec et l'arménien. La poésie grecque en particulier, par ses voix du XXe siècle, puisant dans le fond puissant de ses racines. Lumières à travers les tragédies de multiples occupations et résistances, guerres et massacres, voix éprises de liberté, cette liberté que la Grèce antique a apportée au monde, Jacques Laccarière nous y initie, de sa réflexion mais aussi sa voix intime et poétique: "Pour nous, c'était le droit de parler à la nuit, de revendiquer ces portiques où le couchant solarisait chaque émergence de pierre."
La poésie de Claude Michel Cluny rejoint cette voie splendide et antique : "L'orage a lavé les Dieux - de ses seaux tristes - Un insecte s'écrase - odeur d'une sueur - celle de ton passage."
Parmi les textes français présentés dans la revue, on peut souligner celui d'Hervé Sixte-Bourbon, "Le fils de Pasolini", rejoignant l'humanité antique: "Et - Plus loin - Face aux statues - Devant la chute de l'orgueil face au soleil - J'ai senti la racine de tes ongles".
Au coeur du dossier, Jacques Lacarrière reprend la main et introduit : Cavafy, Sikélianos, Séféris, Embirikos, Ritsos, Elytis, Valaoritis, Alexandrou, Christodoulou, Patrikios; voix modernes, magistrales d'une Grèce universelle et résistante. Plusieurs témoignent de ce qui était, il y a un siècle encore, l'héritage d'un peuplement millénaire sur les rives asiatiques de la mer Egée, ou même de la Méditerranée, et dans l'incendie de Smyrne, dernière ville grecque d'Asie, se rejoint la détresse des Grecs et celle des Arméniens massacrés et exilés (lire l'émouvant "Ecrit à l'Ange de Smyrne" que Paul Farellier consacre à cette effroyable tragédie). comme Constantin Cavafy, né à Alexandrie, on regarde alors avec eux vers la patrie intime, celle d'Ulysse: "Ithaque t'a accordé le beau voyage. - Sans elle, tu ne serais jamais parti. - Elle n'a rien d'autre à te donner. - Et si pauvre qu'elle te paraisse, - Ithaque ne t'aura pas trompé. - Sage et riche de tant d'acquis - Tu auras compris ce que signifient les Ithaques." On aimerait citer toutes ces voix, unies par un combat souvent désespéré, éclairé par la soleil comme la poésie de Yannis Ritsos: "Dans ce pays, le soleil nous aide à soulever le poids - De pierre que nous avons toujours sur nos épaules", ou d'Angelos Sikélianos: "En couvrant de vos danses les aires de l'abîme, - A vous, combattants qui défiâtes la mort, - Je dis que près de Vous - Les ténèbres d'En bas sont comme l'ombre - D'un arbre immense sous lequel - Côte-à-côte allongés - Nous avons parlé de la Grèce - Jusqu'à l'heure où vos yeux se fermèrent à ce monde - Ce monde qui croulait sous la lumière - Que vos âmes ont fait moindre".
Des auteurs français qui suivent, on peut retenir le poème de Christophe Dauphin, "Les oracles de l'ouzo", marchant sur le chemin tracé, reprenant actualité et poème de Cavafy avec humour et tristesse mêlés : "Le délire peut alors lancer son cri - les nuques se renversent comme des montagnes - avance Dionysos mes vertèbres mes vocables -... les barbares sont venus aujourd'hui - quelque chose tremble meurt en moi en nous - Quelles lois pouvaient faire les Sénateurs? - Les barbares s'en sont chargés une fois venus - ... Ils ont vendu le Pirée à la criée - Entre deux Metaxas et trois schnaps - avec la banque des Cyclades - Faux-monnayeurs ils ont joué les yeux d'Homère - et le paquebot des Argonautes aux osselets".
Pour conclure un si riche et profond numéro, laissons comme lui la parole à Jacques Lacarrière : " C’est cela qui persiste pour moi dans le mot Grèce : ce premier regard, cette première fissure découverte et maîtrisée (cette porte entrebâillée dans la psyché par où Oedipe aperçoit dans la chambre nuptiale le cadavre pendu de sa mère), cette première lumière insoutenable mais regardée en face, et parfois aveuglante au sens propre du terme."
Olivier MASSE (in revue Diérèse n°67, avril 2016).
*
"Les Cahiers Littéraires Les Hommes sans Epaules consacrent leur numéro 40 à "Jacques Lacarrière et les poètes grecs". Christophe Dauphin y signe une préface engagée où les difficultés du présent invitent tout autant à la sympathie qu’à l’empathie, le poète étant en ces occasions leur meilleur interprète. César Birène signe, pour sa part, un portrait de l’auteur de L’Eté grec et de celui qui écrivait pour « dériver de l’homme ancien ». L’errance et l’écriture se rejoignent en un chemin peuplé d’ailleurs, éternel retour à Ithaque. Un choix de poésies de Jacques Lacarrière tirées d’A l’orée du pays fertile permet d’entendre à nouveau cette voix qui ne s’est jamais tue. Ce riche dossier propose également de retrouver celui qui fit tant pour les poètes grecs contemporains en les traduisant, en diffusant leurs écrits engagés à une époque difficile de l’exil et de la répression pour un grand nombre d’entre eux. Cavafy, Sikélianos, Séféris, Elytis et bien d’autres encore ont prêté leur voix à l’un de leur plus grand interprète dans notre langue, et que nous entendons dans cette belle et riche livraison.
Philippe-Emmanuel KRAUTTER (in lexnews.fr, janvier 2016).
*
"Dirigés par Christophe Dauphin, ces « cahiers littéraires » paraissent deux fois par an. Le présent numéro offre quatre-vingts pages de poètes grecs, parmi lesquels Cavafy, Séferis, Ritsos, Élytis, avec leurs meilleurs poèmes. Il offre vingt pages de Jacques Lacarrière. On aime relire : « S’alléger de ce qui est trop lourd en soi, s’affranchir de l’excès d’attraction, accéder aux délices, aux délires d’une pure évanescence. » Il offre encore trente pages de et pour Claude Michel Cluny, quinze belles pages de Paul Farellier, dernier grand prix de poésie de la SGDL pour L’Entretien devant la nuit, sur ses ancêtres arméniens, dix pages d’Armen Lubin. En bref, une somme.
La structure est sans défaut, à l’image de la régularité de cette revue papier. Passé l’éditorial, en effet, qui inscrit la générosité foncière de son directeur dans la réalité du monde tel qu’il cahote, on trouve un salut à des disparus, salut toujours éclairé par un choix opéré dans leur œuvre propre. Ce choix est nourri pour une éventuelle découverte (tout le monde est jeune, un jour, avide à tout connaître). Ensuite vient le dossier, ici des poètes grecs, tous et chacun successivement présentés par Lacarrière, un régal. D’autres poètes contemporains de toutes les générations sont ensuite présentés. Frédéric Tison, né en 1972, écrit par exemple : « La flamme dévorait. Je dus la souffler. La nuit vint remercier ma bouche : lorsque son chant entra en moi, ma voix trembla. — Je suis encore ta naissance, me dit l’ombre. » Une telle concision ne tient-elle pas de l’accomplissement ? Le numéro, pour aller vite, s’achève par une cinquantaine de pages de notes de lecture. On pourrait là peut-être émettre une réserve, mais que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre !
Un hommage de Jean Pérol à Cluny, décédé le 11 janvier, trouve place dans ce beau numéro. C’est coruscant. Ouvrir au diariste des dix volumes parus de L’Invention du temps (La Différence) la porte de la postérité est d’une grande justesse, même si la beauté chez Cluny vient de loin. Ainsi, ces lignes des années 1960 me semblent universelles : « Attendre aura été le chant de ma vie. J’ai attendu, enfant, que la vie m’appartienne. Ensuite, j’ai su que nous ne possédions rien. Que rien ni personne ne préservera jamais le peu d’illusion que nous sommes de l’effacement. Ce que nous voyons, ce que nous comprenons, nos mains le mêlent à nos désirs pour l’offrir à d’autres. »
Généreuse, donc, avec un grand empan tant sur le plan éditorial, générationnel que géographique, éclectique sans jamais perdre de vue la qualité poétique, de belle facture de surcroît, la revue Les Hommes sans épaules mérite plus que de l’attention, une franche adhésion. Il est plus que temps de suivre ce qui se fait de mieux, en revue de poésie, aujourd’hui."
Pierre PERRIN (in nonfiction.fr, le quotidien des livres et des idées, 28 décembre 2015).
*
"Il arrive à l’auditeur de radio de s’impatienter en écoutant l’énumération des offices de la moindre personnalité : « ainsi donc, vous êtes diplomate, voyageur, claveciniste à ses heures, parapentiste, cuisinier, philosophe, écrivain & j’en passe… »
Mais, concernant Jacques Lacarrière, les dresseurs de liste peineraient à faire le tour de ses multiples talents ; « je suis pléthorique » aimait-il à dire. Comme l’illustre encore cet excellent dossier que Les hommes sans épaules consacrent, dix ans après sa mort, au poète « porteur de feu ».
Sujet en outre bienvenu pour redonner de la Grèce une autre image que celle de mendiant de l’Europe qui prévaut ces temps-ci. Dans l’introduction, citant Lacarrière, Christophe Dauphin rappelle que l’histoire de celle-ci n’a été « qu’une suite de combats pour sa libération, on y retrouve très souvent le poète au milieu même des combattants ».
S’ensuit une biographie économe et directe écrite par César Birène, que complète un florilège extrait du beau recueil paru en 2011 chez Seghers :
La dormeuse
D’après une gravure de Picasso
Tu cueilleras tout aussi bien des fleurs dans le soleil. Tes bras respireraient jusqu’au zénith le feuillage que les forêts soumettent à l’espace. Ne cherche pas à conquérir la pluie que supposent les toits, à chevaucher les fleuves sur des arbres géants. Reflète-toi entre deux ciels et tu connaîtras l’amitié que les astres te portent.
… entre deux ciels, cet usage fluide et tragique à la fois du présent, du futur et du conditionnel.
Mais l’originalité du dossier tient à cette somme (posthume) de Lacarrière sur ses contemporains grecs : un très beau cadeau. Bien sûr, on croise des figures connues comme Ritsos, Seferis et Cavafy, qu’il est toujours intéressant de (re)lire sous la plume du traducteur amical qu’était Lacarrière.
Je m’étendrai d’avantage sur les noms moins connus.
Par un usage tout aussi intéressant du conditionnel, Anghélos Sikélianos, mort en 1954, se tient à cheval sur le profane et le sacré, sur la terre et au sommet où les noms des dieux sont gravés :
Ou j’aurais pu soudain
Devançant le corbeau des Ténèbres
Haletant sur mes pas pour s’emparer de moi,
Rassembler toutes les forces vives
Et m’élancer au-delà des cercles étroits de l’univers
Pour chercher dans la nuit
Mon dur destin de créateur.
Mais aujourd’hui, je Vous le dis,
Je veux rester à Vos côtés,
Ne plus Vous perdre un instant
Car j’ai fait de mon cœur une aire
Pour que Vous y dansiez.
Telle parole, en ces temps de transhumanisme et d’hybris généralisé, ne peut que consoler le sage !
Voix plus intérieure saisissant des instants, des sensations et des lumières en équilibre précaire, que celle d’Andéas Embirikos, un des premiers freudiens grecs, ami de Yourcenar :
Accroissement
Parfois il nous arrive de porter à nos lèvres
La main d’une lumière aurorale
Immobiles et bouche scellée
Dans le silence du paysage
Avant que la ville bruissante de fontaines
Ne s’éveille aux cris brutaux jetés dans le soleil
Par les éboueurs matinaux.
Nos souffrances ne furent pas inutiles
Les voici soulevant leurs voiles et révélant
Leurs bras livides et tuméfiés,
Les voici s’éployant vers le cœur de la ville
Relevant un à un les doigts des endormis
Comme des mages orientaux et gagnant
Le cortège odoriférant des caïques
Traçant, tressant au cœur des rues
Des espaces aussi souverains que les yeux
D’une femme éperdue de rêve.
Les notices de Jacques Lacarrière font bien entendu partie du charme de cette publication, elles sont personnelles, tirées des rencontres et des amitiés que ce dernier a cultivées. Un passage consacré à Odysséas Elytis, « le buveur de soleil », en témoignera pour les autres : « Au cours d’un entretien que j’eus avec lui après sa parution, Elytis me confia qu’il avait écrit ce poème pour compenser l’injustice et la non-récompense dont le monde contemporain faisait preuve à l’égard des souffrances de son pays. Le titre, emprunté à un hymne byzantin très célèbre, peut se traduire par Digne ou Loué soit — sous-entendu : ce monde. C’est un hymne à toutes les Grèce, l’ancienne, la byzantine, celle des guerres de l’Indépendance et celle d’aujourd’hui — qui, elle, sortait à peine de l’Occupation et de la guerre civile — ainsi qu’à ses traditions, ses paysages et surtout sa langue ».
J’ai peine à ne pas faire entendre les autres voix : celle d’Aris Alexandrou, le désabusé et de Dimitri Christodoulou tout en « résistance et vigilance ». Terminons ce frustrant tour d’horizon par l’humour de Nanos Valaoritis :
Ainsi donc nous sommes assiégés
Et nous le sommes par qui
Par toi et par moi, par machin-chose
Nous sommes sans cesse assiégés
Par les frontières, les douanes, les contrôles de passeports, Interpol, la police militaire, les tanks, le bagout, la bétise, (…)
Drôle ? Après tout, pas tant que cela.
Il serait dommage de ne pas signaler, dans ce riche numéro, le dossier que Paul Farrelier consacre au regretté Claude-Michel Cluny. Jean Pérol rend hommage à leur amitié « libre, souple, vive, affectueuse ». Un remarquable florilège montre que le fondateur de la collection « Orphée » fut d’abord un poète :
… Ce matin, est-ce pour susciter quelque regain de courage ? j’ai retourné des travaux anciens, de ceux que je ne me suis pas résigné à vendre. Ce fut pénible. Ce qu’on a laissé au cours des années dormir, face au mur, et que l’on rend au jour, surgit comme d’une tombe. Le leurre des enthousiasmes s’écaille, la vie peinte à fresque sur un mur mangé par le salpêtre. Au vrai, on se déprend tôt de soi."
Eric PISTOULEY (cf. "Revue des revues" in www.recoursaupoeme.fr, novembre 2015).
*
« Ce très beau numéro est consacré à Jacques Lacarrière et à la poésie hellénique. Dans son éditorial, Christophe Dauphin nous rappelle que la Grèce et l’Arménie sont des terres de souffrance et de résistance dans lesquelles la poésie est irriguée par le sang perdu.
Jacques Lacarrière, qui nous a quittés en 2005, « aventurier de l’esprit et l’un des meilleurs connaisseurs du monde antique et de la Méditerranée », rebelle précieux qui s’est toujours efforcé de transmettre ce qui est, témoigne, dans une œuvre multiple, du rayonnement permanent de la Grèce. Les poèmes choisis pour cet hommage sont d’une grande densité, souvent charnus pour mieux souligner l’esprit qui demeure.
Cinabre
Soleil emprisonné dans les macles du soir,
blessure d’où suinte le mercure,
tu dis l’ultime cri du sang avant qu’il ne se fige
la grande paix des cicatrices et la convalescence de la terre
Nous retrouverons avec grand plaisir dans le dossier l’un des grands auteurs grecs du XXème siècle, grand ami de Nikos Kazantzakis, Anghélos Sikélianos, dont on se rappellera le merveilleux Dithyrambe de la Rose. La poésie grecque des dernières décennies du siècle passé fut particulièrement riche comme en témoigne Jacques Lacarrière : « Je crois qu’il est bon de préciser ici que la Grèce, à l’inverse de la France, n’a jamais connu d’écoles, de mouvements, de chapelles ni de cercles poétiques. Les poètes grecs n’ont jamais manifesté, à quelque génération qu’ils appartiennent, un besoin de communauté littéraire. Très vite, ces poètes nouveaux – ou du moins dont les œuvres opérèrent une évolution sans marquer pour autant de rupture avec les poètes antérieurs – vont faire poésie à part, si je puis dire. Je ne vais pas ici me mettre à dresser l’inventaire de leurs noms ni de leurs oeuvres car à partir de ces années 70, la poésie se caractérise par un foisonnement d’œuvres et de publications, une véritable explosion de revues, une multiplicité de personnalités, d’individualités pour qui la poésie se trouve désormais affranchie de toute sujétion à l’histoire. Je dis bien : à l’histoire mais sans pour autant braver ou brader aussi la mémoire… »
Le choix de poèmes rassemblés dans Les HSE démontre que les Hellènes n’ont pas quitté la Grèce depuis des siècles comme certains l’ont avancé imprudemment en Grèce même. L’essentiel est toujours de revenir en Ithaque comme l’affirme Constantin Cavafy :
Et surtout n’oublies pas Ithaque.
Y parvenir est ton unique but.
Mais ne presse pas ton voyage,
Prolonge-le le plus longtemps possible
Et n’atteins l’île qu’une fois vieux.
Riche de tous les gains de ton voyage,
Tu n’auras plus besoin qu’Ithaque t’enrichisse.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, novembre 2015).
*
« Christophe Dauphin dans son éditorial des HSE n°40 : « s’agissant de la Grèce ou de l’Arménie, qui commémore le centenaire du génocide, l’histoire de ces deux pays n’est qu’une longue lutte douloureuse contre les envahisseurs » (et Pâques 1916 à Dublin – NDLR). En exergue, « les porteurs de feu » : Jacques Lacarrière (et les poètes grecs) et Claude Michel Cluny. Donc, d’abord un portrait de Lacarrière par César Birène qui cite le poète : « Il n’est de manque véritable que le vide d’un monde privé de poésie » suivi de seize pages de textes. Dont : « Elle [la poésie] est toujours de ce monde puisqu’elle demeure vivante parce que vivace, vivace parce que rebelle ». Plus loin, un très important et passionnant dossier sur Lacarrière et dix poètes grecs contemporains, avec, en plus, un portrait du « peintre du surréel grec », Nikos Engonopoulos.
Le portrait de Claude Michel Cluny est signé Paul Farellier : « L’œuvre poétique de Claude Michel Cluny frappe tout d’abord par son intense beauté, beauté du sens poétique et de l’image, bien sûr, mais en même temps beauté française de la langue ». Suivent dix-neuf pages de textes et des inédits du poète Jean Pérol. Un détour chez « les Wah » avec six poètes : K. Dimoula, F. Y. Caroutch, D. Abel, H. Sixte-Bourbon, F. Tison, Ch. Guinard.
Paul Farellier, avec Ecrit à l’ange de Smyrne nous entraîne dans les « Inédits des HSE » avant de nous présenter l’œuvre de Chahnour Kerestedjian Armen Lubin (surtout des textes).
Avec la rubrique Dans les cheveux d’Aoûn, nous sommes entraînés dans l’univers de quatre créateurs, poètes et peintres : Alain Breton, Gwen Garnier-Deguy, Hélène Durdilly et J.-Gabriel Jonin. Les textes de quatre poètes précèdent une vingtaine de pages consacrées à des notes de lecture.
En somme, comme d’habitude, une revue dense et passionnante. »
Alain LACOUCHIE (in revue Friches n°121, juillet 2016).
|
|

|
|
Lectures
"Cette nouvelle livraison, essentiellement consacrée à la poésie, est d'une richesse exceptionnelle. Dans son éditorial, Le Passager du Transatlantique, Christophe Dauphin rend un hommage chaleureux à Benjamin Péret dont il souligne le parcours singulier, celui d'un poète qui n'a jamais songé à faire carrière dans la littérature. Il cite, pour souligner son propos, Sarane Alexandrian: "Quand on considère ce que sont devenus dans leur vieillesse tant de matamores qui entrèrent dans les lettres le défi aux lèvres, le regard hautain, on s'incline bien bas devant Péret. Il n'a pas un instant fait de concessions pour s'attirer les honneurs que méritait son génie. Pauvre, vivotant de son métier de correcteur, il a gardé jusqu'au bout la vertu réfractaire de sa jeunesse... Libre comme le rossignol, mélodieux comme lui, menacé comme lui par la cohorte bruyante des ânes, il n'a cessé de faire entendre le chant qui lui était naturel." Le travail de l'association des amis de Benjamin Péret y est salué, une fois n'est pas coutume, depuis l'édition des Oeuvres complètes jusqu'à l'apport nouveau des Cahiers Benjamin Péret.
Benjamin Péret occupe le coeur de ce numéro avec un volumineux dossier de plus de quatre-vingt pages intitulé: La Parole est toujours à Benjmain Péret. Ce dossier, parfaitement documenté et maîtrisé, par Christophe Dauphin, dit l'essentiel. Il est complété d'un article de Jean-Clarence Lambert sur les liens et affinités entre Benjamin Péret, Octavio Paz et le Mexique. Octavio Paz savait ce que fut l'exceptionnelle amitié entre Péret et Breton, une complicité intellectuelle reposant sur "la recherche d'une vie qui concilie poésie et révolution". Le choix des extraits de l'oeuvre de Péret qui a été fait dans Les HSE en est l'illustration.
on trouverea également dans ce numéro plusieurs dossiers sur Annie Le Brun par Karel Hadek et sur Jehan Mayoux avec une présentation de César Birène: "Jehan Mayoux, le poète insoumis", suivi d'un choix de poèmes par Hervé Delabarre. Parmi les "portraits éclairs" figurent également Lionel Ray et Fabrice Maze."
Gérard ROCHE (in Cahiers Benjamin Péret n°5, septembre 2016).
*
" Le dossier de ce beau numéro est consacré à Benjamin Péret. Dans son éditorial, intitulé « Le passager du Transatlantique », Christophe Dauphin explique ce choix :
« Les poètes ont toujours été et sont toujours de ce monde, mais ils sont rares, ceux qui, de la trempe de Benjamin Péret, demeurent toujours et définitivement à l’avant-garde du Feu poétique. Et pourtant, si le Passager du Transatlantique n’a jamais cessé d’être à flot, ce fut trop souvent sur un océan d’ombre, que n’emprunte qu’une minorité, certes, mais active et éclairée. Ce constat a motivé l’écriture du dossier central de ce numéro des HSE. Avec Péret, nous ne sommes jamais dans l’histoire de la littérature, tellement ce poète est actuel – et surtout en ces temps d’assassins et du médiocre dans lesquels nous vivons -, mais dans la vie. Comment alors expliquer l’audience confidentielle de son œuvre ? »
Si la France a, depuis des décennies, du mal avec la poésie en général et les poètes en particulier qui, souvent, obligent à penser dans un monde qui a vu, avec les soi-disant nouveaux philosophes des années 60-70, l’opinion remplacer la pensée et le savoir. Benjamin Péret, un anticonformiste cher à Sarane Alexandrian, n’a jamais fait la moindre concession à la mondanité.
L’œuvre, toujours injustement méconnue de Benjamin Péret, est immense, aux poèmes s’ajoutent des contes, des écrits politiques, des écrits ethnologiques, des écrits critiques sur le cinématographe et les arts plastiques, sur le surréalisme, la littérature, sans compter les entretiens. Une œuvre éditée aujourd’hui en sept volumes sous le titre Œuvres complètes grâce à l’association des amis de Benjamin Péret.
Son œuvre, toujours aussi actuelle, dérange et secoue. Elle réveille. Benjamin Péret qui poussera de manière exemplaire la pratique de l’écriture automatique dans ses retranchements soulève l’hostilité et l’incompréhension dès la fin des années 1920, notamment de la N.R.F., incompréhension qui demeure.
Voici pourtant ce qu’en dit André Rolland de Renéville en 1939 :
« L’écriture automatique apparaît en harmonie avec le tempérament de Péret, au point qu’il semble que notre poète n’eût pas écrit si le surréalisme n’avait pas été découvert. Benjamin Péret ne conserve de notre langage que la construction syntaxique, l’allure et le ton. Les mots lui deviennent des signes. Il leur redonne un sens absolument libre, dégagé des objets qu’il désigne. De nouveaux objets semblent naître de ces moules dont le contenu nous était imposé par l’usage. Et le miracle est que ces réalités nous les comprenons, tandis que nous traverse l’immense éclat de rire d’un être que nulle contrainte ne retient plus de se lancer à travers notre flore et notre faune urbaines, comme s’il s’agissait pour lui de celles d’une contrée primordiale, ouverte à ses instincts. Il suffit de lire au hasard l’un de ses plus beaux poèmes pour y trouver l’exemple d’une conscience qui décide d’accepter sans y introduire de contrôle, la succession des idées qui se présentent à elle par le mécanisme de leur libre association. Péret annihile la distance entre l’homme et l’objet, entre l’espace et le temps, entre le réel et le rêve : Sois la vague et le bourreau la lance et l’orée – et que l’orée soit l’étincelle qui va du cou de l’amante à – celui de l’amant – et que se perde la lance dans la cervelle du temps – et que la vague porte la poutre – et que la poutre soit une hirondelle – blanche et rouge comme mon CŒUR et ma peur. »
Christophe Dauphin note que si Benjamin Péret, ce « surréaliste par excellence », « est presque toujours qualifié d’opposant-né », il convient aussi de parler de lui comme d’ « un homme du oui et de l’adhésion à la liberté, à l’amour sublime, au merveilleux, à l’amitié ». Péret, nous dit-il, a aussi « magistralement établit l’analogie entre la démarche poétique et la pensée mythique ». Christophe Dauphin rappelle que Benjamin Péret est définitivement vivant quand bien des prétendus poètes d’aujourd’hui sont déjà morts. En 1945, il tenait ces propos, à la fois réalistes et visionnaires, dans Le déshonneur des poètes.
« Les ennemis de la poésie ont eu de tout temps l’obsession de la soumettre à leurs fins immédiates, de l’écraser sous leur dieu ou, maintenant, de l’enchaîner au ban de la nouvelle divinité brune ou « rouge » – rouge-brun de sang séché – plus sanglante encore que l’ancienne. Pour eux, la vie et la culture se résument en utile et inutile, étant sous-entendu que l’utile prend la forme d’une pioche maniée à leur bénéfice. Pour eux, la poésie n’est que le luxe du riche, aristocrate ou banquier, et si elle veut se rendre « utile » à la masse, elle doit se résigner au sort des arts « appliqués », « décoratifs », « ménagers », etc. »
Benjamin Péret est plus que jamais précieux dans un monde ou la compromission, la trahison et la falsification sont la norme.
A travers le temps et l’espace
Attendre sous le vent et la neige des astres
la venue d’une fleur indécente sur mon front décoloré
comme un paysage déserté par les oiseaux appelés soupirs du sage
et qui volent dans le sens de l’amour
voilà mon sort
voilà ma vie
Vie que la nature a fait pleine de plumes
et de poisons d’enfants
je suis ton humble serviteur
Je suis ton humble serviteur et je mords les herbes des nuages
que tu me tends sur un coussin qui
comme une cuisse immortelle
conserve sa chaleur première et provoque le désir
que n’apaiseront jamais
ni la flamme issue d’un monstre inconsistant
ni le sang de la déesse
voluptueuse malgré la stérilité d’oiseau des marécages intérieurs"
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress. com, 1er mai 2016).
*
"Je me demande toujours si je dois considére Les Hommes sans Epaules (ici, le numéro 41), comme un livre ou une revue. presque 200 pages pour Benjamin Péret et 30 pour Annie Le Brun, me font hésiter, mais tout de même et comme d'habitude, Christophe Dauphin me fait pencher vers le livre. En particulier pour Péret, si curieusement discret et souvent mal défini, même si son surréalisme est sans doute aucun, un des plus complets et plus authentiques de tous les membres et souvent tellement plus connus des groupes internationaux. Par ses voyages et ses étonnantes originalités, il se démarque fortement des autres tentations explicatives, si nombreuses et si souvent contradictoires sous le même nom de surréalistes, comme de Dada et tant de noms d'avant-gardes, valables ou non, Péret reste un modèle par l'abondance de sa production et sa qualité d'écriture et de pensée (au grand pluriel), mais plus encore de son inventivité. Dauphin ne s'y trompent à aucun moment et le lecteur a intérêt à parcourir avec lui cette oeuvre que je commence à préférer parfois aux autres icones groupées autour de l'éternel André Breton. J'ai découvert Annie Le Brun, que je ne connaissais pas encore, et admire sans réserve tout ce qu'elle rend magique dans ce portrait en apparence si simple. même après cet Homme sans Epaules, j'ai le sentiment de n'avoir pas encore lu Péret."
Paul VAN MELLE (in revue Inédit Nouveau n°279, avril 2016).
*
" Le dossier majeur de la revue de Christophe Dauphin (une centaine de pages sur les plus de 300 de l’ensemble) est consacré à Benjamin Péret (1899-1959). Opposant-né, anticlérical, antimilitariste, adversaire du nationalisme, Péret ne s’est jamais départi de ses opinions profondes tout au long de sa vie. C’est en 1920 qu’il rencontre Breton et les dadaïstes ; il demeurera un fervent adepte de l’écriture automatique et plus largement défendra la liberté sous toutes ses formes. Certains de ses articles assez virulents et prises de position lui vaudront pas mal d’inimitiés durables. Il passera en trois périodes une dizaine d’années soit au Brésil, soit aux Mexique. Où son penchant pour le trotskysme prendra racine ainsi que son intérêt pour les religions africaines. Il sera correcteur pour les Journaux Officiels, rejoindra les anarchistes de la « colonne Durutti » en Espagne, en 36, et sera emprisonné trois semaines à Rennes, en mai 1940. Durant la guerre, il passe par Marseille, avant de rejoindre le Mexique, est fasciné par la civilisation maya. Il travaille vingt ans sur l’Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique. 1945, c’est le scandale du Déshonneur des poètes qui répond à Honneur des poètes (Aragon, Éluard, Seghers, Tardieu, Frénaud, Ponge…). Où Péret fustige cette poésie proche de la propagande, en dénonçant « la récupération du poétique par le politique ». Cette polémique violente va l’isoler. Il aura du mal à éditer Le Gigot, sa vie, son œuvre que Losfeld accepta où il fait montre de ses dons de conteur. Octavio Paz parle en résumé d’une des œuvres les plus originales et sauvages de notre époque. Suit un texte de Jean-Clarence Lambert, un voisin, qui met en perspective Péret, Paz et le Mexique, et je retiens dans son préambule cette comparaison assez juste entre Péret et Breton entre le naturel de l’un et le côté plus emprunté et cérémonieux de l’autre. Une anthologie d’une vingtaine de pages pour clore.
Je voudrais te parler cristal fêlé hurlant comme un chien dans une nuit de draps battants… "
Jacques MORIN ( cf. "Repérage" in dechargelarevue.com, 17 août 2016.)
|
|
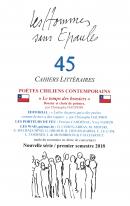
|
|
Lectures :
LES HSE ET LA VALEUR DE LA POÉSIE CHILIENNE
Les Hommes sans Épaules consacre son 45e numéro à la poésie chilienne. C’est l’aventure intellectuelle et poétique d’un peu plus d’un siècle qui s’y lit, passionnément.
La poésie chilienne s’attache, semble nous dire Christophe Dauphin, à ses contingences propres. À son histoire coloniale tout d’abord, à la conquête espagnole et à l’asservissement des peuples autochtones, au basculement violent dans un autre ordre. Mais elle s’inscrit également dans une spatialité, une réalité physique, des contrastes évidents. Dans sa préface du dossier du 45enuméro des Hommes sans Épaules, il nous rappelle la formulation qu’emprunta Pablo Neruda pour dire la naissance d’une poésie nationale : « La poésie du Chili émergea comme une fleur rouge du combat livré par une race qui fut décimée mais ne se rendit pas au formidable ennemi. C’est alors que ce petit pays acquit sa voix propre. Et cette voix se répercute sur les neiges andines et les écumes infinies du grand océan. » Et qu’elle est mal-connue, comme sa pluralité s’éclipse derrière quelques astres tonitruants, imposants, quasi monstrueux.
Il y a d’abord le grand Neruda, presque trop grand, débordant, un peu mégalomane, aux formules habiles et lyriques qui prend toute la place, ou qui voudrait la prendre. Celui qui affirme, se voulant « barde d’utilité publique », qu’il veut « faire office de garde-frein, de maître berger, de maître d’œuvre, de laboureur, de gazier, ou de simple bagarreur de régiment capable d’en découdre à coups de poing ou de cracher du feu par les narines », se rêve en étendard ou en héraut d’un peuple entier. On oublie que tous ne furent pas dans sa ligne, au premier rang desquels le truculent et tonitruant Pablo de Rokha ou le très altier Vicente Huidobro qui se fâchèrent souvent avec lui. Ils sont les poètes majeurs du premier quart du XXe siècle ceux qui structurent, avec Gabriela Mistral, la poésie chilienne, sans aucun doute l’une des plus fortes et des plus cosmopolites de son époque en Amérique du Sud et que nous avons en grande partie oubliée.
Car derrières les quelques astres qui éblouissent, tout un fourmillement de poètes mérite d’être redécouverts, relus, mis en avant. C’est ce à quoi s’emploie le très bon dossier de ce numéro qui présente pour chaque poète un court texte de présentation et un choix d’extraits exemplaires. On lira quelques vers très beaux d’Alberto Baeza Flores (1914-1998) sur Valparaiso :
Tu as été pour ma vie la fenêtre secrète, ouverte sur
l’aventure.
Je suis descendu de ma capitale aux larges épaules,
poussée par tant de cordillères.
J’ai parcouru ta couronne de collines, tes labyrinthes de
rues et de réverbères
à l’arrière du pont d’un navire fantastique de rêves,
et au bout de ta voix était l’aube.
Ou bien, assurément du grand antipoète, Nicanor Parra, à mon avis le plus grand, le plus drôle, le plus lucide peut-être, le plus modeste en tout cas.
Christophe Dauphin dans une présentation synthétique d’une trentaine de pages retrace plus d’un siècle de production poétique : de l’impact du surréalisme, des différents mouvements, des concurrences et des relations compliquées entre des personnalités très fortes. Il explique clairement comment les mouvements se frottent les uns aux autres, s’incarnent dans des revues – Mandrágora, Boletín surrealista, Leitmotiv – plus ou moins éphémères, assez clairement l’histoire des avant-gardes, des relations cosmopolites avec Breton ou l’influence de Jarry, Péret ou encore Césaire sur les travaux des poètes chiliens. On y découvrira les élans du modernisme, le groupe de Los Diez, le créationnisme ou l’imaginisme. Il resitue très bien ces mouvements, ce fourmillement dans le contexte politique et l’évolution de la société chilienne. Jusqu’à la charnière de l’élection de Salvador Allende et du coup militaire qui porte au pouvoir Augusto Pinochet.
Car, on le sent, c’est cette période qui l’émeut plus – il la relie à sa biographie personnelle, à sa jeunesse en banlieue parisienne, à ses amitiés avec les jeunes exilés chiliens qui y débarquèrent après l’instauration de la dictature –, cet enjeu central de l’exil, du retour, de la circulation des histoires et des identités, la manière dont tout ceci s’extravase. En lisant la petite anthologie qui poussera nombre de lecteurs à aller y voir de plus près, on découvre des poètes comme Waldo Rojas ou Rodrigo Verdugo Pizarro, on se rappellera que Roberto Bolaño a produit une œuvre poétique importante dont la plus grande part demeure inédite, malgré la parution il y a quelques années de son recueil Trois, chez Bourgois, en 2012.
En lisant ce dossier intitulé « Le temps des brasiers » – probablement en hommage au film documentaire de Fernando Ezequiel Solanas (El hora de los horno, 1968) –, on relira de la poésie en même temps qu’une histoire, celle de dés-exilés, de sans-terre qui sont de quelque part, « ce pays qui a des poètes comme la mer a des vagues », on en saisira la puissance d’invention, la continuité intellectuelle, la cohérence utopique, l’énergie verbale qui coïncide toujours avec la vie collective, la passion politique, le traumatisme d’une nation. Donner accès, ouvrir les yeux et les oreilles sur de pareils poètes, du passé comme d’aujourd’hui, est une entreprise louable, forte, nécessaire probablement. On espère qu’elle aura quelque écho, que des yeux attentifs se pencheront sur l’Altazor, qu’on lira Nicodemes Guzmán, Juan Godoy ou Volodia Teitelboim, qu’on se frottera à un lyrisme bien singulier, qu’on entendra la valeur d’une poésie, oui, sa valeur.
Hugo PRADELLE (in entrevues.org, le journal des revues culturelles, 31 mai 2018).
*
"Chaque nouvelle livraison de cette revue semestrielle est d’une richesse inouïe tant sur le plan des découvertes et des confirmations que sur celui des informations dans le domaine de la poésie. Christophe Dauphin dirige de main de maître cette publication en sélectionnant et coordonnant articles et poèmes.
Son long éditorial enflammé ouvre la voie et donne envie de se plonger dans ce qui constitue sur 135 pages le dossier principal intitulé « Poètes chiliens contemporains, Le temps des brasiers ». Il s’agit d’un large choix de 17 poètes chiliens contemporains parmi lesquels deux Prix Nobel : Gabriela Mistral et Pablo Neruda. Ce choix va du prolifique Luis Mizon au jeune Patricio Sanchez Rojas et du novateur Vicente Huidobro au chanteur martyr Victor Jara.
Les Porteurs de feu de ce numéro sont le poète-prêtre révolutionnaire nicaraguayen Ernesto Cardenal et le poète-médecin éditeur belge Yves Namur.
Quant aux neuf Wah sélectionnés, ils sont le miroir d’une diversité et d’une richesse qui ne se dément pas. Évoquons enfin la soixantaine de pages finales qui propose des articles, des informations et des chroniques.
Tous les numéros de la 3° série des Hommes sans Épaules constituent, au fil des années, un riche panorama des poésies mondiales. "
Georges CATHALO (cf. Lecture flash 2018 in revue-texture.fr, 27 avril 2018).
*
Encore une très belle livraison que ce numéro 45 des Hommes sans Epaules, qui nous offre ce que nous pouvons sans hésitation appeler une anthologie des poètes Chiliens contemporains. Accompagné et guidé par un paratexte important comme à l’habitude, le lecteur est invité à découvrir quelques uns des noms parmi les plus représentatifs du genre : Vicente Huidobor, Pablo de Rokha, Pablo Neruda, Alberto Beaza Flores, Gonzalo Rojas, Patricio Sanchez Rojas et bien d’autres.
Ce dossier est précédé d’une introduction signée par Christophe Dauphin, qui dans son éditorial retrace le panorama historique et social qui a présidé aux productions proposées : « Lettre du pays qui a des poètes comme la mer a des vagues ».
Les rubriques habituelles entourent ce dossier : le lecteur y découvrira tout un appareil critique, « Avec la moelle des arbres » dont les auteurs ne sont autres qu’Odile Cohen-Abbas, Henri Béhar, César Birène, Karel Hadek, Paul Farellier et Claude Argès. Des informations qui recensent aussi les événements qui ont eu lieu autour de la poésie figurent en fin de volume : un compte rendu du 27ème salon de la revue, de la rencontre avec Frédéric Tison qui a eu lieu à Saint Mandé en novembre 2017, et bien d’autres encore.
Enfin, ce numéro du premier semestre 2018 nous propose des textes d’Yves Namur, d’Emmanuelle Le Cam, de Gabriel Henry, et d’autres poètes contemporains de tous horizons.
Fidèle à sa ligne éditoriale et à sa politique qui est d’offrir au lecteur une pluralité d’outils afin de guider sa lecture sans jamais en orienter la réception, ce numéro 45 des Hommes sans Epaules est dans la lignée de ceux qui l’ont précédé. Il propose une rare épaisseur, non seulement en terme de volume, annonciateur d’un contenu riche et diversifié, mais aussi en terme d’analyses visant à enrichir l’appréhension d’une littérature toujours donnée à découvrir dans la globalité des éléments contextuels qui ont présidés à sa production. La liberté de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux horizons poétiques est ici encore soutenue par une contextualisation dont le lecteur saura s’emparer pour recevoir dans toutes leurs dimensions les pages de cette revue.
Carole MESROBIAN (cf. Revue des revues in recoursaupoeme.fr, 5 mai 2018).
*
" Les revues ouvrent un espace de réflexion politique, offrent des possibles d’engagement. On y est lucide, en colère. Ainsi, la remarquable revue XXI propose une série de dossiers passionnants qui s’inscrivent dans la longue durée, La Revue du crieur poursuit son travail original pour promouvoir une réflexion de gauche dans le monde d’aujourd’hui, alors que Les Hommes sans Épaules nous rappelle l’histoire douloureuse des exilés chiliens tout en brossant un magnifique panorama de la poésie de ce bout du continent américain.
Ceux, encore trop nombreux, qui ne connaîtraient pas Les Hommes sans Épaules, une revue poétique qui a démarré dans les années 1950 à Avignon et redémarré en 1991 en restant sous l’égide de Rosny aîné (auteur du Félin géant), peuvent et doivent commencer par le numéro en cours qui offre un aperçu substantiel de la poésie contemporaine chilienne et la contextualise, ce qui reste indispensable. L’article de fond de Christian Dauphin, par ailleurs directeur de la publication, tient sa ligne qui cherche l’homme derrière la poésie, l’étincelle derrière la forme.
Sa contribution, intitulée « L’Heure des brasiers » (comme le film de Solanas en 1968), comporte un important dossier sur les exilés de 1973. Avec le groupe des Quilapayun, alors en tournée en France et considérés comme des ambassadeurs d’Allende, ils se retrouvèrent dans le même immeuble de Colombes et cette condensation géographique, leur impact culturel adossé au support des maisons de la culture en France, ont modifié notre rapport à l’hispanité d’autant que les dictatures du Cône Sud ne cessaient d’accroître le nombre d’exilés. Plus de 10 à 15 000 personnes, qui, pour presque un tiers, sont reparties lorsque la démocratie revint. Ces figures de l’adaptation et de la mélancolie ne sont pas homogènes, même en cas de malheur commun. Le dossier de poésie contemporaine permet de suivre toutes les positions humaines, mais aussi la difficulté de la situation de dés-exilés de ceux qui ont choisi le retour. Les jeunes embarqués dans une identité duelle n’ont pas davantage vécu sur un lit de roses.
On peut être désarçonné quand de la poésie n’est pas éditée en bilingue mais la variété de tons et de couleurs, de rythmes et de registres, donne une présence et une actualité qui sortent tous ces auteurs transatlantiques d’un trop lointain Pacifique. Le Chili tout entier est bien « ce pays qui a des poètes comme la mer a des vagues », une formule qui désigne l’île de Pâques dont l’article liminaire rappelle comment disparurent sans faire de bruit, dans la déréliction totale de l’infériorisation, les derniers qui en savaient le sens.
On pourra y lire aussi un peu de Gabriela Mistral et de Pablo Neruda, de Huidobro comme de poètes contemporains tels Waldo Rojas et Rocío Durán-Barba, y découvrir bien d’autres noms trop méconnus. Bref, le volume qui comporte aussi ses rubriques habituelles, des inédits de jeunes poètes, des notes de lecture, fera référence. "
Ma. B (in en-attendant-nadeau.fr, 2018).
*
« Valparaiso, tu étais le filet où vont s’engloutir des étoiles – poissons de brume et de fumée, yeux pleins de nostalgie des voyages impossibles – Tu as été pour ma vie la fenêtre secrète, ouverture sur l’aventure… », Alberto Baeza Flores, dans Les Hommes sans Epaules, qui consacrent presque cent-cinquante pages de son numéro 45, à la poésie chilienne, présentée historiquement et géographiquement par Christophe Dauphin. Entre la première nommée, Gabriela Mistral (née en 1887) et le quarantenaire Rodrigo Verdugo Pizarro, toutes les célébrités (car s’en sont) de la poésie chilienne sont là : Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Luis Mizon, Nicanor Parra, Roberto Bolano : « il m’a été impossible de fermer les yeux et ne pas voir cet étrange spectacle, étrange et lent… - des milliers de jeunes gens comme moi, glabres – ou barbus, mais latino-américains tous – joue contre joue avec la mort. » Il y a aussi de quoi faire des découvertes : Alberto Baeza Flores, Gonzalo Rojas, Waldo Rojas… N’ont pas étét oubliés les chnateurs Victor Jara et Quilapayun… Autrement, le numéro s’ouvre sur un autre latino-américain, Ernesto Cardenal (qui n’a pas lu sa formidable « Oraison pour Marylin Monroe » ?) et par Yves Namur : « Rien - Si ce n’est peut-être la mer qu’on voit danser – Dans un poème… – Et de l’autre côté… - Une femme qui dit des je t’aime aux oiseaux – Et aux hommes qui s’envolent par hasard ou simple distraction. » La partie centrale du numéro est une anthologie d’inédits (Emmanuelle Le Cam, François H. Charvet, Adeline Baldacchino…). J’en retiens aussi l’écriture vigoureuse de Marie Murski : « des siècles qu’on te le dit ! -Mais as-tu seulement un nom – petite sœur des grandes batailles – des fers à repasser les immortelles fœtus après fœtus. Encore un numéro marquant, je trouve, des Hommes sans Epaules. »
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°174, septembre 2018).
*
"L’éditorial de Christophe Dauphin, véritable introduction au dossier « Le temps des brasiers », permet de comprendre les particularités historiques et géographiques du Chili « qui concentre une bonne partie des climats de la planète ». On comprend pourquoi la poésie y « demeure l’un des moyens d’expression les plus créatifs ». Le dossier, très complet, présente les poètes connus ici (Pablo Neruda, Victor Jara), sans oublier les autres. "
Marie-Josée Christien (rubrique "Revues d'ailleurs", in n°24 de la revue Spered Gouez, 2018).
*
"Un dossier consacré à la poésie chilienne contemporaine resituée dans son contexte historique et politique suivi d'une anthologie qui reprend entre autres des textes de Roberto Bolano, Antonio Skarmeta ou encore de Luis Sepulveda."
Electre, Livres Hebdo, 2018.
|
|

|
|
Lectures :
Le dossier ce numéro, coordonné par Christophe Dauphin, est consacré à quelques poètes à Tahiti. Il commence par une longue introduction de Christophe Dauphin qui s’attaque aux malentendus les plus tenaces concernant la Polynésie française, ses peuples, ses cultures, de la structure de la société traditionnelle à la fonction des tatouages. Il résume en quelques dates qui sont surtout des repères, une histoire complexe que nous voulons linéaire quand elle obéit à d’autres modèles du temps.
Cinq auteurs ont été retenus pour ce dossier, nés en Tahiti ou venus en Tahiti pour des raisons diverses et marqués puissamment par ce monde qui ne cherche pas à contraindre la nature : Teuira Henry, Henri Hiro, Flora Aurima-Devatine, Loïc Herry, Alain Simon.
L’ouvrage le plus célèbre de Teuira Henry (1847 – 1915) est Ancient Tahiti. Il demeure l’ouvrage de référence sur l’histoire des îles de la Société rassemblant des matériaux précieux pour la compréhension des mythes tahitiens.
Henri Hiro (1944 -1990), fondateur de la littérature, du théâtre et du cinéma polynésien contemporains fut un grand acteur de la recherche et de l’expression des racines.
Flora Aurima-Devatine, née en 1942 sur la presqu’île de Tahiti démontra l’expérience et l’intérêt d’une littérature polynésienne française. Elle milita notamment pour le droit des femmes et ce combat imprègne son œuvre littéraire.
Alain Simon (1947-2011) est né en Bretagne. Il demeura quinze années à Tahiti où il livra les plus belles parts de sa poésie.
Océan parfait au goût de câpres
Comme le vrai fâfaru
Encore faut-il déchiffrer
La souffrance au ras des vagues
Si l’écume mène le monde
Encore faut-il savoir marcher sur l’eau –
Le guerrier désire-t-il la paix
Le sage mange-t-il toujours de la terre
Avant de pénétrer la femme
Dessiner le grand cercle
Mourir encore une fois –
Toi la mémoire est prête
Tu peux tendre tes titis
Faire mousser la bière
Dans le sillage exact du grand requin
Nageuse de combat
Loïc Herry (1958-1995) est né à Cherbourg. C’est par amour qu’il gagne Tahiti en 1994. Sa poésie mêle son amour et la rencontre lucide avec l’île.
je ne suis pas venu voir la Polynésie
je n’ai pas vu Tahiti
j’ai simplement visité la Beauté
une jeune beauté brune aux
courbes dansantes aux mains longues
enfin s’est chiffonnée dans mon poing
toute cette page du Pacifique qui
nous séparait
et l’espace qui ombrait
le souvenir de ton rire
s’est enflammé
saveur de ta peau
saveur de tes mots
Cythère ô Christel
si le jus de l’ananas coule de tes lèvres
c’est le goût de la vie qui m’envahit
je ne suis pas venu voir Tahiti
je suis venu m’asseoir sur la terrasse
Avec toi
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, avril 2019).
|
|

|
|
Lectures :
« François Montmaneix déclare haut et fort : « Ce ne sont donc pas le retour consternant des guerres de religion, la déferlante technologique obsessionnelle, l’abrutissement, par le football, la banalisation du verbe par le développement des réseaux prétendument sociaux, la vulgarité médiatique, la sacralisation des gadgets, la mondialisation de l’uniformisation et le déclin de la conscience du monde qu’ils engendrent, qui viendront à bout de la vérité et de la force de la parole qu’incarne la Poésie » (p 5).
De même, dans son article, Le poète ermite de Tromba, Jacques Crickillon (p 25) note à propos de Pierre della Faille que l’amour de Belle est aux antipodes de la conception barthienne des Fragments d’un discours amoureux et assimilable aux représentations de l’amour vu sur les sculptures des parois des temples de Maliparum et de Borobudur. Il note aussi : « La différence, c’est que, la rencontre ouvre chez della Faille, une destinée commune, un chemin (avec Belle à deux, en étant non unique mais double dans l’unique. Dès lors, si la femme aimée apparaît sublimée dans l’œuvre jusqu’à en faire une figure mythologique, elle est aussi présence jour à jour et alimente ainsi perpétuellement la création… » (p 24). Si j’aime François Montmaneix pour ses poèmes en général et pour son écriture, j’aime Pierre della Faille pour l’amour fou qui donne une tonalité particulière à sa vie et à son écriture poétique…
Si François Montmaneix signe l’éditorial de cette livraison des Hommes sans épaules, les deux précédents (FM & PdF) font partie du premier article de la revue, Les porteurs de feu, par leurs poèmes. La revue est divisée en ses parties habituelles : Ainsi furent les Wah (avec Imasango, Adeline Baldacchino - dont j’ai lu jadis La ferme des énarques (et dont j’ai rendu compte dans Recours au poème) -, Natasha Kanapé-Fontaine, Emmanuelle Le Cam, Hamid Tibouchi, Franck Balandier et André Loubradou… De même avec le dossier Poètes à Tahiti avec Christophe Dauphin (introduction) : Teuira Henry, Henri Hiro, Flora Devatine, Loïc Herry et Alain Simon… Les inédits des HSE sont consacrés aux poèmes de Sonia Zin Al Abidine. Vers les terres libres sont réservées à une étude de Paul Farellier intitulée La poésie de Frédéric Tison suivie de Minuscules (un ensemble de proses poétiques) du même Frédéric Tison… Suit alors une étude d’Eve Moréno ; consacrée à la chanson, la poésie, elle présente le chanteur Allain Leprest. Suivent enfin des poèmes inédits d’Elodie Turki, de Paul Farellier, de Jacqueline Lalande, d’Alain Breton, de Christophe Dauphin et d’André Prodhomme… Viennent en final des notes de lecture de Christophe Dauphin, de Claude Luezior, d’Eric Pistouley, de Bernard Fournier, de Jean Chatard, de Thomas Demoulin, de François Folsheid, de Frédéric Tison et de Paul Farellier… Viennent ensuite les usuelles informations…
Jamais une revue n’a autant ressemblé à ce que doit être une revue de poésie. Et il y a des poèmes pour tous les goûts.
Lucien WASSELIN (in www.recoursaupoeme.fr , 6/09/2019)
*
"L'un des principaux dosseirs est consacré au poète François Montmaneix, décédé en 2018 à l'âge de 80 ans, présenté avec brio sous ses nombreuses facettes par Christophe Dauphin et par des pooèmes "beaux et graves comme autant d'éblouissements" choisis dans "une oeuvre forte, c'est-à-dire personnelle, où l'éclair survit à l'orage". L'édito est composé d'un article inédit du poète et de fragments d'un entretien publié par La Tribune en 2015, où "passagers du temps mais aussi "messagers", pour "faire entendre une voix qui est plus que la nôtre : celle de l'émotion qui est sentiments du monde."
L'autre gros dossier, consacré aux "Poètes à Tahiti", replacés par Christophe Dauphin dans leur contexte géographique, historique et culturel : Teuira Henry (1847-1915), Henri Hiro (1944-1990) et Flora Devatine (1942), mais aussi Loïc Herry (décédé en 1995) qui y vécut une parenthèse intense et Alain Simon qui y séjourna pendant quinze ans.
Paul Farellier présenté Frédéric Tison, dont on peut lire des textes inédits, composés de notes et d'aphorismes, extraits de ses carnets.
Eve Moreno évoque Allain Leprest, le "plus connu des inconnus de la chanson française".
Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°25, 2019).
*
"Le polynésien sait nourrir, mais ne sait pas gagner de l'argent": Thierry Tekuataoa, cité par Christophe Dauphin dans le dossier qu'il a coordonné (avec un historique de la colonisation des îles du Pacifique) et qui s'intitule justement Poètes à tahiti, car si ces îles produisent des poètes, elles en attirent aussi de la métropole.
Donc, dans le n°47 de Les Hommes sans Epaules, ont peut lire des natifs de Polynésié: Teuira Henry (1847-1915), "Chant sacré de la pirogue de Rû : Derrière était Te-ao-tea-roa, devant était le vaste océan - Rû était à l'arrière, Hina était à l'avant - Et Rû chanta ainsi : Je te tire, je te tire vers la terre - Te-apori, ô Te-apori..."; Henri Hiro, militant indépendentiste et culturel des années 70: "Je grimpe au sommet du Temps - s'ouvrent alors les autres bouches - du vent - Est, Ouest - Sud, Nord - l'esprit vacant et les oreilles libres - je reçois ce message - Manger le temps - Il faut manger le temps..."; Flora Aurima-Devatine (née en 1947) : "Sur la place qu'évente - la fraiche rosée des vallées - c'est l'heure du pariparifenua - espace de ressourcement - chant-poème - au ras de l'île..."
On peut lire des poètes de passage aux îles, Loïc Herry : "Polynésie paradis tu parles - vol violence c'est la chanson - de Papeete paradis frelaté"; ou Alain Simon : "Océan parfait au goût de câpres - Comme le vrai fafaru - Encore faut-il déchiffrer - La souffrance au ras des vagues..."
Dans ce même n°47 de Les Hommes sans Epaules, il y a "le parfum de calcaires mouillé des collines d'Hammamet après les premières pluies d'automne, terre brûlante dont on devine un crépitement semblable à la braise qu'on arrose", de Sonia Zin El Abidine (quinze pages de poèmes inédits), née en Tunisie (ça se sent), vivant à Paris (ça se devine) : "Ma terre chrysalide - Le temps créateur d'exil - Loin de ternir ton éclat - t'a faite paradis..." Comme un écho à Tahiti, on dirait, non ?
Dans ce numéro très exotique, Imasango (elle est de Nouvelle Calédonie) : "Tu manges encore de l'igname et le taro - Tu caresses la peau des bois - Tu traverses l'allée vibrant de cordylines - Tu sais l'araucaria - La conque et le cri des oiseaux - Tu es - de cette île - Multiple aux confluences".
Sinon, il y a des célébrités de naguère présentées et anthologisées : François Montmaneix, "Une fois que les bruits inutiles - ont fini de leurrer la parole - quand le silence baigne le lac - l'eau dans le soir d'été a ce visage - d'ombre qui vient de naître..." et Pierre Della Faille : "Soyez heureux, ô syndiqués cyclopes ! Je vous laisse la langue. Crie. Criez. Vos souterrains n'ont pas d'écho - et j'engraisse vos dieux qui me servent à table ".
Il y a Adeline Baldacchino, Emmanuelle Le Cam, Natacha Kanapé Fontaine (Québec), Hamid Tibouchi (Algérie), Allain Leprest, et d'autres et les pages de lectures-critiques; il y a, il y a... Songez au truc : comment rendre compte de 320 pages de revue sans tout mettre en miettes ?
320 pages, un semestre d electures variées: un bon plan."
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°178, 2019).
|
|
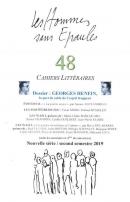
|
|
Lectures :
Les Hommes sans Épaules : des voies poétiques
Souvent, les numéros des Hommes sans Épaules attirent par leur dossier, leur thème, le territoire qu’ils proposent d’explorer à ses lecteurs. On est enthousiasmé ou déçu, c’est selon. Peu importe d’ailleurs, au fond, que la poésie chilienne nous frappe singulièrement et que l’anthologie tahitienne nous laisse un peu froid. C’est la diversité des directions, la place offerte à des textes qui comptent. La manière dont il se combine avec des essais, des présentations toujours précises et informées. Il faut bien dire que c’est une revue qui s’apparente un peu à une ogresse. On n’y lésine pas sur la matière, sur les propositions. Il faut assurément une sacrée énergie, peut-être aussi un peu d’obstination, pour publier des volumes si variés.
Le 48e numéro propose un dossier comme toujours – ici consacré à l’écrivain surréaliste égyptien Georges Heinen. Journaliste à l’Express, à Jeune Afrique, il semble avoir quelque peu disparu de l’attention des lecteurs. Raison de plus pour s’attacher à une figure atypique et discrète. On y lira un portrait touchant d’un homme retenu, modeste, sous la plume assez douce d’Yves Bonnefoy, ou bien, et peut-on espérer meilleur éloge, ces lignes d’Henri Michaux qui le désigne comme un passant magnifique qui traverse le monde : « il aura vécu en se promenant dans la nature, la nature des hommes en société, des hommes de toute espèce, qu’en curieux il parcourait – les traversant sans les salir. Au-delà d’eux, il aspirait à rencontrer d’autres aventuriers de l’esprit. » Suivent un poème de Joyce Mansour, des textes d’Heinen lui-même, ainsi qu’une assez longue étude de Sarane Alexandrian disparu en 2009 dont le manifeste La poésie en jeu ouvre cette livraison de la revue.
Et c’est ce texte qui donne une tonalité au numéro, qui lui donne une direction. Car si on trouve des textes toujours aussi riches, depuis Breton, Éluard, Aragon, Péret, Soupault, mais aussi des études et des extraits de César Moro ou Roland Busselen, ainsi que les habituelles notes de lectures, une réflexion de Christophe Dauphin sur la peinture de Madeleine Novarina, c’est bien la question de ce qu’est le poème, la poésie, le rapport du poète avec le monde qui compte ! On lira ainsi les mots inauguraux du texte d’Alexandrian : « L’essence de la création littéraire se découvre à l’horizon de cette folle question : qui, du langage ou du silence, possède une existence autonome et que le surgissement de l’un ou de l’autre vient rompre ou troubler ? »
Ce sont les mêmes interrogations, à la croisée de l’intime et du monde social, comme mises en partage qui portent les textes inédits de Marie-Claire Bancquart que publient les Hommes sans Épaules. Elle écrit : « Essayer de parler, et si possible de faire sentir, selon ce décalage essentiel avec un usage paralysant de la langue et de l’existence, un poète ne peut rien d’autre. Mais son emportement est irremplaçable/ Il (elle) crie le cri, pour susciter d’autres cris. Et aussi d’autres amours, d’autres joies devant les choses. Il change, non sans doute la vie, mais les rapports avec la vie. » Ajoutant qu’elle écrit de la poésie parce que « ces idées, ces conduites, ces mots qui figent la pensée, on ne peut y répondre que par la poésie. Elle est tout le contraire : un emploi propre du mot propre, la mise en évidence d’une relation. »
Ce que dit Marie-Claire Bancquart relève d’une sorte particulière d’étonnement. Il s’y entend un d’enthousiasme lucide, une lutte dans la langue pour conserver un rapport émerveillé au réel, pour ne pas choir dans une déréliction stérile. Elle souhaite une poésie du sujet certes mais qui ne soit pas isolée, qui demeure ouverte, généreuse, accueillante. Il se trouve une liberté dans la langue et la poésie représente « un besoin vital, une énergie, un moyen d’‘être (un peu) là’ en approchant le monde. » Il se trouve que, bien souvent, cette exigence, ce désir, cette énergie, animent les revues, ceux qui les font, les portant en quelque sorte à se dépasser.
Hugo PRADELLE (in www.entrevues.org, le 23 novembre 2019)
*
Chaque parution de cette revue dirigée par Christophe Dauphin a l’extrême mérite de faire flamber plus haut encore le mot poésie. Tout y est : qualité, fraternité, beauté. Le lecteur lit chaque rubrique avec intérêt.
On pourra les énumérer toutes : l’ouverture reprend en hommage à l’écrivain Sarane Alexandrian parti il y a dix ans son texte La Poésie en jeu. Je vous laisse découvrir, entre autres, ce qu’il définit comme les trois temps poétiques majeurs. Une citation cependant, pour laisser percevoir la force de l’ensemble : « Le silence est troublé, le langage est troublant, et de la qualité de ce trouble double dépend l’émotion poétique. Plus loin : « Mais on sera ému par la création même de l’émotion, plutôt que par sa nature propre ou par l’objet qui la motive. »
« Les Porteurs de Feu » invitent les poètes César Moro et Roland Busselen à refaire surface. A la présentation, véritable portrait, succède des choix de poèmes révélant la portée de leur œuvre : Je parle… de certaines larmes sèches – qui pullulent sur la face des hommes (Moro). Je vois un matin – deux matins – une éternité de matins – où je cherche mon sang d’enfant – au creux des artères de ma mère – Tout ce qui tourne sans l’homme – trouvera sur mes lèvres – le nord de la terre vieillie – Mon nom est imprononçable – que ma mère repose en paix (Busselen).
« Ainsi furent les Wah 1 » accueille les poèmes de Marie-Claire Bancquart (oh le bel hommage !), de Xavier Frandon, Cyrille Guilbert et Jean-Pierre Eloire : Le froid avait déjà attaqué plusieurs maisons, - picoré nos silhouettes, - basculé un piano dans le ruisseau. La mise en lumière de ces trois derniers poètes est révélatrice de cette revue. Elle offre en partage des voix plurielles et sauve de chacune d’elle l’indispensable et rare singularité. Une large part laissée à la biographie du poète confirme cette volonté de ne jamais sérier l’homme de l’œuvre.
Le « dossier central » est consacré à Georges Henein, La part de sable de l’esprit frappeur, avec des textes de Guy Chambelland, Yves Bonnefoy, Joyce Mansour, Henri Michaux et Sarane Alexandrian, qui précèdent les poèmes de Heneien. « Les poèmes de Georges Henein sont l’expression de la modernité dans ce qu’elle a de plus dramatique : Intelligence et l’impuissance », (Chambelland). « Né d’un désert, il réussissait en toutes circonstances, en tout drame, et contre tous, à garder la part de sable », (Michaux). Des poèmes de Henein présents, je citerai ce vers et lui seul comme une invite à lire ce dossier et relire ce poète : la neige est comme une lettre qu’on a négligé d’ouvrir.
« Ainsi furent les Wah 2 » présente les « poètes surréalistes et l’amour ». Ensuite, Christophe Dauphin présente (à sa belle façon), le « peintre de cœur » Madeleine Novarina, dont on découvrira aussi la poésie. « Une Voix, une œuvre » invite la poète Jasna Samic (née à Sarajevo), après les Inédits des HSE (Jeannine Modlinger). Puis, se lisent les « Pages des HSE ». pulse là le cœur poétique des membres de cette revue. « Avec la moelle des arbres » se découvrent des notes de lecture, non simples recensions, mais authentiques études. « Infos/Echos » est un rubrique originale axée sur l’hommage, la fraternité et, oui, la solidarité. Dans le paysage contemporain de la revue littéraire, Les Hommes sans Epaules est une revue incontournable. Il faut la lire, car le Feu est là porté haut et le lecteur a en retour le beau rôle de le recevoir et de le transmettre. »
Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix n°34, novembre 2020).
*
« La revue de Christophe Dauphin est, chaque fois que je la décortique, remplie d’éléments variés qui sont toujours intéressants. Poètes en particulier qui, à titres divers, se révèlent passionnants.
L’édito pour commencer est laissé à Sarane Alexandrian (mort en 2009) avec un texte inédit : « La poésie en jeu ». Il pose justement la question : Doit-on écrire parce qu’on est ému ou écrire pour émouvoir ? Il balaie ensuite en tant que philosophe de la poésie, dadaïsme, élémentarisme et poésie érotique…
Deux porteurs de feu ensuite, singuliers et étonnants : César Moro, né au Pérou en 1903, qui écrira surtout en français. Tendance surréaliste bien entendu, avec des vers sidérants comme ceux-ci : Le prix des allumettes étant vraiment trop élevé / J’ai mis du persil haché sur mes souvenirs… (mort en 1956). Et Roland Busselen, né en 31 à Bruxelles, qui a créé la revue L’VII avec Alain Bosquet, puis la revue B + B. J’ai relevé cette métaphore : …avec le dé à coudre de ma mère / je vide l’encrier de mes souffrances et cette formule digne d’un proverbe : exister c’est toujours parce que / exister ce n’est jamais pourquoi
Est évoquée la disparition de Marie-Claire Bancquart, poète majeure, qui a inventé pour parler de la poésie l’image « braille du vivant ». Elle écrit : La difficulté ne vient pas d’une expression obscure qui épaissirait encore le mystère, mais d’un improbable, que la langue traverse d’une certaine lumière. Xavier Frandon, conseiller pénitentiaire, deux recueils (Citron Gare et Cygne) : spécialiste de rien, compétent sur tout, également : Ceux dont je m’occupe, la vie leur tombe des mains. Jean-Pierre Eloire, travailleur rural toute sa vie, qui n’écrit que depuis peu, rappelant ses travaux durs et pénibles : …la vieille batteuse hivernale / vomissait ses jours sales, […] et toute la campagne se blottit / dans un seul sac de blé.
Le dossier du n°, c’est « Georges Henein, la part de sable de l’esprit frappeur ». En fait, il s’agit de la reprise en grande partie d’un n° de la revue Le Pont de l’Épée de 1981. Et l’on a grand plaisir à relire quelques anciens comme Guy Chambelland qui fait part de son scepticisme de second lecture à propos de ce surréaliste de seconde génération à l’écriture sourde, compacte, étreignante, carcérante où il perçoit à la fois densité et abscondité ; Yves Bonnefoy parle de sa touchante gaucherie entretenue par la générosité dans la maîtrise de soi… Nonchalant seigneur j’ai nommé Georges Henein écrit Joyce Mansour.
C’est Sarane Alexandrian qui dresse la vie de Georges Henein (1914-1973), fils d’un diplomate copte, il passa sa vie entre Le Caire et Paris. Il publie un manifeste en 1935 : « De l’Irréalisme ». Deux ans plus tard, il organise le groupe surréaliste égyptien « art et liberté » dans lequel se trouve aussi l’écrivain Albert Cossery. Il fonde ensuite deux revues : l’Évolution puis la Nouvelle revue. Avant La part de sable : plage où l’on aborde et piste déjà effacée. Il se trouve au secrétariat international du surréalisme. De sa poésie émane beaucoup de sensualité : ...un certain nombre de créatures / incomparablement nues / de la tête au ciel […] jetant sur les épaules des femmes / un manteau de pluie fine / pour les protéger du beau temps… et pour clore cette chute du poème « Une rose entre deux seins » : et son premier émoi en pays étranger / est pareil à l’épi d’où naîtra / le pain de l’enfer
Hervé Delabarre donne une étude sur l’amour et les Surréalistes, avec les deux références majeures que sont Freud et Sade, en se penchant sur des poèmes d’Eluard, Breton, Soupault, Péret, Aragon…
Christophe Dauphin s’intéresse à la peinture de Madeleine Novarina, avec ses trois périodes et son travail sur vitraux. Thomas Demoulin a rencontré Jasna Samic qui témoigne et milite à Sarajevo. Janine Modlinger donne de belles proses entre poésie et automne…
Enfin poésie et critiques avec Christophe Dauphin qui rappelle la vie en Algérie de Jean Sénac et son écriture spermatique, assassiné en 1973. Puis Ilarie Voronca et Jean Malrieu… Tombeau ouvert de Jehan Van Langhenhoven après la mort de Jimmy Gladiator, revuiste hors pair avec Le Mélog, Camouflage, la Crécelle noire et j’en oublie…
Encore un numéro plein comme un œuf ! »
Jacques MORIN (cf. la Revue du mois in dechargelarevue.com, 1er mai 2020).
*
Les Hommes sans épaules ne sont pas à proprement parler une revue. C’est une somme, le tour complet d’un horizon déterminé par la thématique ou l’auteur abordés à travers l’élaboration des dossiers trimestriels.
A côté il y a des rubriques récurrentes, qui structurent l’ensemble. Le tout offrent une plongée en général profonde tant elle est riche et pertinente, dans les domaines abordés, ou bien proposent des textes d’auteurs qui y côtoient les rédacteurs appartenant à des domaines disciplinaires variés.
Ces numéros 48 et 49, respectivement du dernier trimestre 2019 et du premier trimestre 2020, sont un bon exemple de la diversité de mise en œuvre de ces volumes toujours importants tant au niveau de leur épaisseur physique que de leur contenu.
Le numéro 48 annonce un dossier Georges Henein, “La part de sable de l’esprit frappeur”. Après un éditorial signé Sarane Alexandrian vient la rubrique “Les porteurs de feu” qui offre pour ce numéro son espace à deux poètes, cette fois-ci César Moro et Roland Busselen, qui sont présentés par un rédacteur, qui varie bien sûr en fonction de l’auteur publié, avant une série de poèmes à découvrir ou à redécouvrir.
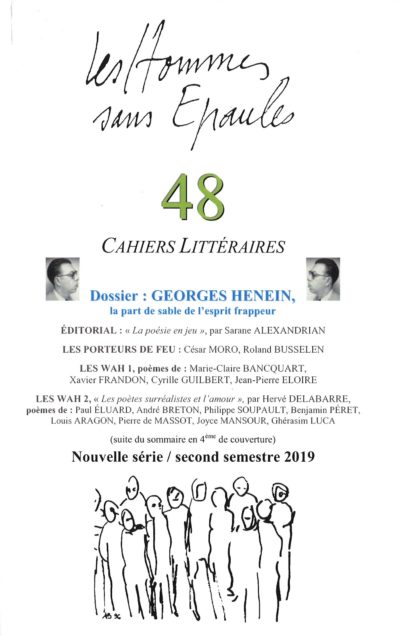
Les Hommes sans épaules, n°48, Nouvelle
série/second semestre 2019, 307 pages, 17 €.
Encore une ouverture que rien ne contraint, car ces avant-propos offrent juste des clés de lecture, et accompagnent au seuil de la découverte de ce qui est proposé ensuite. Puis les nouvelles rubriques : les “Wah 1“, où sont proposés des poèmes de divers auteurs contemporains, et les “Wah 2“, dans ce numéro une thématique, “Les poètes surréalistes et l’amour”. A côté de ces passages incontournables, d’autres rubriques viennent enrichir l’ensemble, “Les pages des HSE”, et “Avec la moelle des arbres”, où on peut trouver des notes de lecture.
Le numéro 49 obéit au même protocole éditorial, mais son dossier thématique concerne “La poésie brésilienne”. Autant dire une somme, une espace de découvertes et de réflexion, et une ouverture, comme c’est toujours le cas, à des univers bien souvent inconnus, à l’histoire de la Poésie et de la Littérature ailleurs. Les points de vue proposés par différents spécialistes qui encadrent les poèmes et les auteurs présentés, sont didactiques, objectifs et neutres, afin de guider le lecteur sans influencer sa rencontre avec le poète dont il est question.
Les Hommes sans épaules, Cahiers littéraires, sont LE Cahier littéraire, celui dont on ne se sépare que lorsque le trimestre suivant arrive, et qu’alors on peut commencer le nouveau numéro.
Carole MESROBIAN (in www.recoursaupoeme.fr, 6 mai 2020).
*
" Le dossier de ce numéro de la revue dirigée par Christophe Dauphin est consacré à Georges Henein (1914 – 1973). Les HSE fêtent aussi les dix ans, dix ans déjà, de la disparition de Sarane Alexandrian (1927 – 2009), le second grand penseur du surréalisme avec André Breton. Christophe Dauphin a puisé dans les archives de Sarane Alexandrian pour nous proposer en guise d’éditorial un inédit, La poésie en jeu, dont vous trouverez ici cet extrait significatif de l’alliance répétée entre métaphysique et réel par la poésie :
« L’instinct poétique peut ainsi se postuler et se définir comme un produit archétypique de la conscience, universel parce qu’associé à un devenir indéterminé, et phénoménal parce qu’étant de dénouement apodictique d’un recensement inconscient du réel, correspondant à l’interdépendance de l’être et de la réalité extérieure. La poésie s’exerce dans la vie quotidienne. Elle est par excellence l’aliment de la pensée, aussi doit-elle prendre pour thèmes les événements sensibles susceptibles d’émanciper l’homme, de le situer in fieri dans le concret. Ainsi, la poésie est matérialiste ou elle n’est pas. »
Il oppose ainsi la poésie au roman, seul capable de révéler par exemple l’essence de l’acte sexuel, « de créer des mythes érotiques avec le maximum de suggestion ».
Le dossier « Georges Henein » rassemble des contributions de Guy Chambelland, Yves Bonnefoy, Sarane Alexandrian, Henri Michaux, Joyce Mansour et quelques poèmes de Georges Henein ; Georges Henein, que Sarane Alexandrian désigne comme « un homme de qualité » fut l’une des figures les plus intéressantes des avant-gardes. Son œuvre, c’est-à-dire sa vie, s’inscrit dans un double exil, intérieur et extérieur, et une volonté farouche de renversement en puisant dans « un imaginaire absolu » tout en maintenant une activité politique très anti-conformisme.
A la question « Quelles sont les choses que vous souhaitez le plus ? », il répond :
« Arriver à ce point d’extrême pureté où la littérature se substitue à la vie. Car c’est alors et alors seulement, qu’il vaudrait la peine de parler et que les mots auraient un pouvoir et l’être une unité. »
Extrait du poème « Le signe le plus obscur »
« écoutez-moi
la terre est un organe malade
un cri depuis toujours
debout
dans une maison de cendre
le moment de fuir sur place
et d’achever les absents
– il faut scier la vitre
pour rejoindre les loups
entre l’esclandre et la vie partagée
et le cristal rebelle
lavé d’une seule larme
parmi les débris que l’on pousse devant soi
pour se faire précéder de son passé
parmi les êtres fidèles
qui sont la reproduction fidèle
des êtres oubliés… »
Egalement au sommaire du numéro 48 : Les Porteurs de Feu : César Moro par André Coyné, Jorge Najar, Roland Busselen par Christophe Dauphin, poèmes de César Moro et Roland Busselen – Ainsi furent les Wah 1 : Poèmes de Marie-Claire Blancquart, Xavier Frandon, Cyrille Guilbert, Jean-Pierre Eloire – Ainsi furent les Wah 2 : « Les poètes surréalistes et l’Amour », par Hervé Delabarre, Poèmes de Paul Eluard, André Breton, Philippe Soupault, Benjamin Péret, Louis Aragon, Pierre de Massot, Joyce Mansour, Ghérasim Luca – Le peintre de coeur : « Madeleine Novarina, la Fée précieuse », par Christophe Dauphin. Poèmes de Madeleine Novarina – Une voix, une Oeuvre : Jasna SAMIC ou les migrations d’Avesta, par Thomas Demoulin. Poèmes de Jasna Samic – Les inédits des HSE : Dans l’embellie du jour, avec des textes de Janine Modlinger – etc.
Un poème de Madeleine Novarina :
« Ma couleur intérieure »
« Je suis rouge
Les daltoniens me confondent avec la verdure
Plante sans racine marchante
Troène taillé en donzelle
Mur de luzerne découpé en femme
Dressée contre tout et l’ensemble
Je m’oppose verte mas au fond rouge
Très rouge je le répète incroyablement rouge. »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 20 novembre 2019).
*
« Malfaisants, les anges à peau de scaphandriers – descendent de la montagne – ayant pour seules victuailles la tristesse du soir – et le sandwich élémentaire des moissons dévastées. » Jean-Pierre Eloire dans l n°48 de Les Hommes sans Epaules. C’est sa première publication. Il s’est remis à écrire l’an dernier à 68 ans. Enfance dans une ferme isolée dans l’Aube. Vie dure de travailleur manuel : tout ça comme c’est écrit. En attendant des poèmes (d)étonnants. Ce n°48 est franchement orienté surréaliste avec Georges Henein un de ces égyptiens (Joyce Mansour, Albert Cossery, etc.) venus faire les beaux jours de notre littérature bien française (présenté par Sarane Alexandrian) : « une rose entre deux seins – un gant dans la poussière – une femme répondant tour-à-tour à plusieurs noms – dont aucun n’est le sien – il n’en faut pas davantage – pour que s’éveille le voyageur… »
Suit un dossier « Les Poètes surréalistes et l’amour » : tous célèbres et Joyce Mansour, « Je te croyais roux – bouc lippu de ma tendresse » et Gherasim Luca, « entre le nez de tes nerfs et els fées de tes fesses. »
Les Hommes sans Epaules font 300 pages ; donc sans compter celles et ceux que j’oublie, forcément y’a des trucs en plus. Par exemple, des inédits de Marie-Claire Bancquart, « je suis attirée par els choses de rien couleur de légumes tombé sous els étals du marché… odeurs d’un porte-monnaie… » ; Jasna Samic (Bosnie), Janine Modlinger, Roland Busselen (Belgique), « exister comme un croisé », César Moro (Pérou), « Toute recueil de poèmes a été fait par moi d’après un catalogue de plantes : diverses espèces de salades, fleurs douillettes, plates-bandes… » On ne saurait mieux finir cette note.
Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2019).
*
Chaque parution de cette revue fondée par Jean Breton a l’extrême mérite de faire flamber plus haut encore le mot poésie. Tout y est : qualité, fraternité, beauté. Le lecteur lit chaque rubrique avec intérêt. On pourra les énumérer toutes : l’ouverture des HSE 48 reprend en hommage au poète Sarane Alexandrian parti il y a dix ans son texte La poésie en jeu, je vous laisse découvrir, entre autres, ce qu’il définit comme les trois effets poétiques majeurs, une citation cependant pour laisser percevoir la force de l’ensemble : le silence est troublé, le langage est troublant, et de la qualité de ce trouble double dépend l’émotion poétique, plus loin : Mais on sera ému par la création même de l’ émotion, plutôt que par sa nature propre ou par l’objet qui la motive.
Les Porteurs de Feu invitent les poètes César Moro et Roland Busselen à refaire surface. À la présentation, véritable portrait, succède des choix de poèmes révélant la portée de leur œuvre : Je parle (…) de certaines larmes sèches /qui pullulent sur la face des hommes (Moro) Je vois un matin/deux matins/une éternité de matins/où je cherche mon sang d’enfant /au creux des artères de ma mère// Tout ce qui tourne sans l’homme /trouvera sur mes lèvres/le nord de la terre vieillie//Mon nom est imprononçable /que ma mère repose en paix (Busselen).
Ainsi furent les WAH-1 accueille les poèmes de Marie-Claire Bancquart (oh le bel hommage !), de Xavier Frandon, Cyrille Guibert et Jean-Pierre Eloire : Le froid avait déjà attaqué plusieurs maisons, /picoré nos silhouettes, /basculé un piano dans le ruisseau. La mise en lumière de ces trois derniers poètes est révélatrice de cette revue, elle offre en partage des voix plurielles et sauve de chacune d’elle l’indispensable et rare singularité. Une large part laissée à la biographie du poète confirme cette volonté de ne jamais sérier l’homme de l’œuvre.
Le Dossier La part de sable de l’esprit frappeur est consacré à Georges Henein, les textes de Chambelland, Bonnefoy, Mansour, Michaux, Alexandrian précèdent les poèmes de Henein Les poèmes de Georges Henein sont l’expression de la modernité dans ce qu’elle a de plus dramatique : Intelligence et l’impuissance (Chambelland) Né d’un désert, il réussissait en toutes circonstances , en tout drame , et contre tous, à garder la part du sable (Michaux). Des poèmes de Henein présents, je citerai ce vers et lui seul comme une invite à lire ce dossier et relire ce poète la neige est comme une lettre qu’on a négligé d’ouvrir.
Ainsi furent les WAH-2 présente les poètes surréalistes et l’amour, ensuite Christophe Dauphin présente (à sa belle façon)
Le peintre de cœur Madeleine Novarina (on découvrira aussi sa poésie), Une voix, une œuvre invite la poète Jasna Šanic née à Sarajevo, après les Inédits des HSE (Jeanine Modlinger), se lisent les Pages des HSE, pulse là le cœur poétique des membres de cette revue. Avec la moelle des arbres se découvrent des notes de lecture, non simples recensions mais authentiques études.
Infos Echos est une rubrique originale axée sur l’hommage, la fraternité et, oui, la solidarité. Dans le paysage contemporain de la revue littéraire, Les Hommes sans Épaules est une revue incontournable, il faut la lire, car le feu est là porté haut et le lecteur a en retour le beau rôle de le recevoir et de le transmettre.
Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix, 2020).
*
À chaque nouveau numéro des HSE, on se demande comment s’y prend Christophe Dauphin pour donner à lire tant et tant de textes originaux, de solides dossiers et d’approches apéritives. Il y a, chez ce revuiste au long cours, une soif de connaître et une volonté de découvrir hors du commun. Le dossier Georges Henein est là pour l’attester. Il met en avant l’œuvre et le parcours de ce « marginal du surréalisme » qu’avaient justement salué Henri Michaux, Yves Bonnefoy ou Joyce Mansour ici présents. On retiendra ensuite un dossier sur « Les poètes surréalistes et l’amour » ainsi que les 13 pages dérangeantes accordées à Xavier Frandon.
Georges CATHALO (cf. « Itinéraires non balisés » in www.terreaciel.net, janvier 2020).
|
|
|