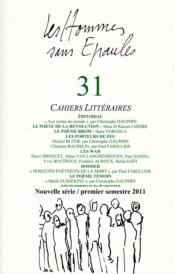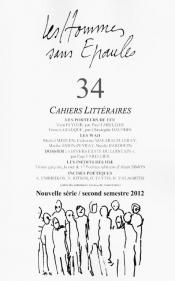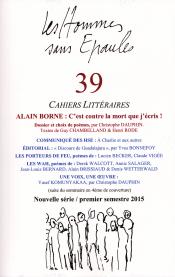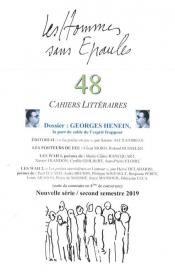Jehan VAN LANGHENHOVEN

Jehan Van Langhenhoven est né le 3 août 1952, à Paris. Enfance dans les banlieues populaires et rouges. Marques indélébiles. Possède un chien. Fidélité indéfectible par-delà la mort et les années.
À l’âge de seize ans, Jehan Van Langhenhoven intègre l’École normale d’instituteurs (Auteuil). Il y découvre le soir à l’étude la littérature : Gide, Lautréamont… Et la nuit, Paris et son errance. Coït urbain jamais démenti. Il fait la rencontre de Jimmy Gladiator. Porte ouverte sur le surréalisme. Ne sera pas enseignant. Rencontre Hélène et l’Italie. Longs séjours dans les Pouilles et à Rome.
À l’âge de dix-neuf ans, Jehan Van Langhenhoven contre Michel Fardoulis-Lagrange et la Grèce, c’est-à-dire le haut-langage. Vie professionnelle sans intérêt. Fonde Le Melog (1975-1978) avec Jimmy Gladiator, puis La Crécelle noire (1979-1981). Jehan Van Langhenhoven, alors qu'il rencontre les éditeurs Guy Chambelland (Le Pont de l’Épée) et Éric Losfeld, publie quelques-uns de ses livres emblématiques : Gabrielle (1977), Milan, minuit d’amour (1985), Le dernier tram pour Cinecittà (1985), Les Caliguliens (1988), Antipodes (1989). Suivent d'autres rencontres déterminantes : la peintre Aline Gagnaire, c’est-à-dire, pour lui, "le style !", le cinéaste Jean Rollin, le peintre Tristan Bastit...
Le poète devient animateur au micro de Radio libertaire, "la radio sans dieu, sans maître et sans publicité", pour laquelle il anime l’émission culturelle « Ondes de choc » : « Matérialiste/ Athée / Sérieuse comme le plaisir / RADIO LIBERTAIRE, c'est avant tout la voix... Et la voix sur ONDES DE CHOC / directs des lundis de 14h30 à 16h00... c'est la voix politique. La voix poétique / indissociables de la voix Théâtrale et Historique. Ainsi donc - loin de la pacotille du jour, de la poudre aux yeux aussi -, ONDES DE CHOC : le dernier comptoir où l'on cause , l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir... Neutres et pédants par avance.... s'abstenir. »
À compter de 1997, Jehan Van Langhenhoven est principalement publié par les éditions Rafael de Surtis : Chronique de la Grande Volière de l’Œil (1997), Journal d’une prétendue métamorphose et d’une défaite certaine (1999), Du chant de l’équipage (2001), Traité d’esthétisme et de perversion (2002), L’Outre-Nu (2004), Nais. Nais ! Tout ! Tout… (2007), La condition Humaine II (2008), Jehan Van Langhenhoven ou Grandeur et Décadence de l’Homme-Volu(p)tes (2010), Du surréalisme raconté à Mamadou Slang et à sa bande au rendez-vous des amis (2014), Défaite de la poésie (Rafael de Surtis, 2016), Histoire naturelle de l’ennui (Rafael de Surtis, 2017).
Odile Cohen-Abbas écrit : Je dis qu’il y a un prisme infini de niveaux de lecture dans les livres de Jehan van Langhenhoven, qu’il s’ouvre authentiquement à la plus haute fonction poétique et à la problématique de l’être, avec les masques, les téguments suprêmes, obscènes et si drolatiques de ses figures métaphoriques, mais qui provoquent aussi, comme une trémulation étrange, un tremblement au milieu du rire… … « Lorsque l’organe plus vibratile et rougeoyant que la crête d’un coq balayée par les brises du matin, chanson aux lèvres, le rhinocéros passera dans le jardin et qu’ébahis pie et corbeaux ne pourront que lui envier sa dextérité, et son élégance à, ainsi, traverser les airs… Alors seulement je saurai être enfin parvenu au terme de mon expérience, mon pari poétique. »
Jehan Van Langhenhoven "vit depuis plusieurs années à Malmaison" dans l’intimité de Madame Bonaparte, en tant que veilleur de nuit ou guide, ce qui lui inspire deux livres : Dans les jardins de madame Bonaparte (2003), et surtout : Madame Bonaparte (2004), Nulle descendance.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
À lire : Fréline (Édition Le Bosc, Tripot, 1974), Nuit dérivée (Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1974), Chanson de la grande truanderie (Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1975), La Dette et l’otage (P.J. Oswald, 1975), Le Vestiaire d’Eurydice (E. Thomas, 1975), Le Bluff de l'underground, suivi des Grimes d'un grimoire, manifeste froid comme pertuisane et non comme steack surgelé (Le Melog, 1976), Gabrielle (Melog-press, 1977), Romans d’amour fou et de mauvaise volonté littéraire (Melog-press, 1978), Voyelles (Melog-press, 1980), La Dernière nuit de Nicki Bellmoor ou le Grand prétexte (Vrac, 1981), Milan, minuit d’amour (Bordas, 1985), Le dernier tram pour Cinecittà (Le Pont de l’Épée, 1985), Les Caliguliens (Le Pont sous l’eau, 1988), Antipodes (Galerie Racine, 1989), Saveur du nectar, malice de l’ange et pâmoison infinie (Éd. de Garenne, 1992), Le Bar du dernier glamour (Pierre Bordas éditeur, 1992), Milan, minuit d’amour (Pierre Bordas éditeur, 1996), Tentative d'introduction à la personne et au texte de Michel Fardoulis-Lagrange (Atelier de l’Agneau, 1996), Chronique de la Grande Volière de l’Œil (Rafael de Surtis, 1997), Journal d’une prétendue métamorphose et d’une défaite certaine (Rafael de Surtis, 1999), Les Poésies inavouables (Alain Benoit éditeur, 2000), Poésies inavouables (AB éditions, 2001), Urbanus erectum (AB éditions, 2001), Du chant de l’équipage (Rafael de Surtis, 2001), Traité d’esthétisme et de perversion (Rafael de Surtis, 2002), Dans les jardins de madame Bonaparte (AB éditions, 2003), Madame Bonaparte (éditions Syllepse, 2004), Le champion qui va mourir (AB éditions, 2004), L’Outre-Nu (Rafael de Surtis, 2004), Le scénographe des songes, suivi des Prétendants (AB éditions, 2004), Membrer le vide (La nef des fous, 2005), Nais. Nais ! Tout ! Tout…, Mémoire d’un gardien de musée (Rafael de Surtis, 2007), La condition Humaine II suivi de Mademoiselle George (Rafael de Surtis, 2008), Jehan Van Langhenhoven ou Grandeur et Décadence de l’Homme-Volu(p)tes (Rafael de Surtis, 2010), Toto le Nomo (L’Amant nyctalope, 2011), Salon de 2012, exercices d’acrobaties picturales (Rafael de Surtis, 2012), Tristant Bastit (Éd. de l'Usine, 2013), Du surréalisme raconté à Mamadou Slang et à sa bande au rendez-vous des amis (Rafael de Surtis, 2014), Défaite de la poésie (Rafael de Surtis, 2016), Histoire naturelle de l’ennui (Rafael de Surtis, 2017), Rivolvita! (L'Harmattan, 2020), Traité d’onanirisme à usage de celles qui ont perdu la mémoire (Douros, 2022), Toto et la Métaphysique, avec Tristan Bastit (L'Amant Nyctalope, 2022).
*
JEHAN VAN LANGHENHOVEN EN DEUX LIVRES
1/ DÉFAITE DE LA POÉSIE
Défaite de la poésie (éd. Rafael de Surtis, 2016), le livre est de part en part traversé par le questionnement poétique. Mais ce testament poétique, comble de désignations burlesques et d’allégories, est-il d’une autre sorte que le questionnement érotique si l’on considère de surcroît que l’ouvrage, doublé d’une franche apparition funèbre qui a pour effet de sceller cet « à paraître », prend la question de la mort pour arbitre ? J’ai failli à mon métier - Que je ne savais pas encore de vivre. - À l’enquête : - QU’EST-CE QUI VOUS RATTACHE À LA VIE ? - Le cul des femmes ». « À travers les fenêtres le soleil redouble d’ardeur, que vois-tu, dis qu’entends-tu ? - Mais des femmes, rien que des femmes - Et surtout ne men veuillez pas encore et toujours des femmes. »
De ce dualisme entre la langue scripturaire et la langue organique (celle du lien, des sens, du contact, consacrée par la voix : la diva orgasmique), ne va-t-il pas surgir le plus fructueux, le plus talentueux des antagonismes ? Alors langue bifide comme pouvait l’être celle du serpent de l’origine et vouée à la gloire, aux célébrations en martyre ! Mais que dit la mort ? Jehan van Langhenhoven excelle en sanctions, doutes, débats, humeurs et coulures en tous genres, roulés dans les cyprines et les semences du paradis ! S’agissant des femmes encore, ne sont-elles pas la nature facétieuse, polymorphe du verbe, la structure, l’essence même de l’être ? « De brise légère ou de haute éruption elles vont, elles vont… - Points de suspension, virgules, parenthèses, consonnes, voyelles, - syntagmes et phonèmes. - Axe ! – D’un immense manège aux chevelures tournant sans répit. - Carrousel dans le jour, maelström dans la nuit. » Que dit la mort ? Comment cerne-t-elle, scinde-t-elle la question ? Création ou désir. Questionnement poétique ou questionnement érotique. La mort serait donc le tiers du dialogue entre ces deux-là ? Tantôt donnant, retirant, égalisant arbitrairement, laissant l’un et l’autre tronqués, l’un et l’autre en suspens. « Mais que ne me l’avez-vous crié, murmuré, madame, l’art et la manière pour un homme de qualité d’en toute saison vivre aux écoutes attentives de sa queue. Cette haute et très inavouable discipline qui consiste à se couper de la cervelle et du cœur, et à danser : les bourses dans le vulgaire et le gland dans les cieux. »
C’est là, assurément, dans l’infini, dans l’abyssal des femmes, c’est là que tout se passe, là que germe l’extraction, l’irruption, l’érection, les jeux de langue et de mots et les jeux fatals. C’est là que foisonne le poète, que pullule son être, in vivo, in vitro, post-éden, prénatal, post-mortem ! Vivant ! Passeur de l’une à l’autre, penseur de l’une en l’autre, retrempant le mystère de lettres et de vie dans leur ventre. Les aimant de rires et de saisissements ! Et saisi lui-même dans ses retraits et ses cheminements du fait qu’elles tiennent et soient vraiment la promesse de l’être et de l’émerveillement. Le texte se fait sexe, le texte incarne tant la sensualité qu’il est une montée du plaisir, un acte de possession, d’intromission en cours. Qui savait que Dom Juan avait ses préférences dans les rues descendantes ascendantes de Ménilmontant ?
L’ode à Hélène est la plus profonde, la plus inavouable, la plus inextricable, qui finit ainsi : « - Je me tourne vers toi et meurs. » Et que dit la mort ? Mais n’est-ce pas par elle que les mots s’allongent, que le poème se fait infinissable, que les lettres se décomposent et se recomposent à parts égales ? Quelles que soient sa langue propre, sa déshérence immémoriale, et bien que : « Mes poignets déjà baisés par les vers vite désécrivent mes mots à l’heure où les morts ne sortent plus de terre. Car pour les morts, nulle métaphore. Métamort ! Métamort ! Afflux de sang… PAROLE DE VIVANT. », tels sont notre mission et notre courage de nous conserver dans la joie, les brèches et les fulgurances visionnaires de l’extase.
2/ HISTOIRE NATURELLE DE L’ENNUI
Histoire naturelle de l’ennui (éditions Rafael de Surtis). La méthode par sauts, par bonds suprêmes, d’un registre à l’autre, d’un domaine à l’autre, d’une sphère à l’autre de plus en plus élevée, employée par Jehan van Langhenhoven, libère le texte de tous les codes et contraintes matérielles de l’écriture pour arriver au saut suprême et entièrement pur dans un imaginaire sans fin renouvelé. Pour nous faciliter les choses, j’ai choisi de suivre l’ordre du livre.
Tome I. De l’âne (us et coutumes). Puisqu’il sera souvent question de l’âne autant que le lecteur dispos et distingué en revête les attributs. Ici, en filigrane, l’autoportrait asinien qui commence le récit a les formes troubles, interlopes et parfaites d’un Caravage. Le visage éclairé interroge la dangerosité du visage tout d’absence et de science. Ce premier texte d’une luxuriante componction ruisselle des larmes de la connaissance. On sent d’emblée que le graphisme autobiographique a les membres, le sang, les abscisses et ordonnées illicites, les impacts intrigants d’une légende. Comme devant un Caravage le meilleur du visage nous renvoie, pour l’appréhender, à des sens qui restent à créer : âne qui chante l’amour et pénètre l’astre irradiant - âne qui en les radiations de l’astre irrigue son règne - âne qui dans l’orbe des rois baigne son rien - âne d’or d’Apulée, décembre 1986, mon livre de chevet. L’hybridité romanesque est un des leviers de l’action, de la pulsion/propulsion de l’imaginaire. C’est elle qui, à la fois rétrospective et visionnaire, et non moins trempée d’immédiateté, des transes séminales du poète, proclame : il est mortel, avilissant, déshonorant pour la question de l’être, de s’en tenir aux données. « Femmes de mon siècle et de ma rue qu’avez-vous fait de l’épopée et du risque… Femmes qui avez oublié que « les pays qui n’ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid… » Hybridité de l’être : sait-on jamais de quel théâtre exotique, contre-lettres, contrepieds délivrés furieusement de l’intériorité, et dans quel accoutrement du désir va surgir la pensée dramatique ? Pas une ligne, pas une image qui ne soit de l’anti-vide, du merveilleux en fusion ! Hybridité des lieux, souvent traités dans leur confusion d’une façon si judiciaire et si judicieuse (ainsi de la page et de la plage dans le récit « Le beach boy et les empuses ») que leur dissociation suffoquerait l’évidence ! « Labyrinthique à l’envie, je vous parle là, par maints détours, de celle qu’en permanence je caresse comme le poète sa page blanche pour qu’au fil de mes humeurs balnéaires s’y positionnent voyelles et consonnes, m’invitant ainsi à soudoyer les forces, jusqu’aux tempêtes d’équinoxe qui, le moment venu, n’hésiteront pas à tout balayer, ravager. La plage (outre le ventre battant des grandes villes en fête quel autre creuset accorder au langage ?) pourra alors étendre sa toile d’amnésie dont les plis seront ceux des draps après l’amour. »
Hybridité du temps enfin, car le poète cheminant, disséminant abondamment sa lave, son magma de truculences, tient dans sa poche, au plus serré, un reliquaire de poètes, un glossaire du passé. « Gabriele d’Annunzio au début du siècle venait y galoper. Blanc de pur-sang, retreint de taille, botté de cuir et chauve malgré tout, au crépuscule, toujours au crépuscule » Il relève d’une logique, d’une cohérence rigoureusement poétique de faire surgir ainsi des lettres d’entre les lettres, des songes d’entre les songes, et des poètes (à faces rebondissant, anticipatrices de royaumes du désir) du poète. Et l’ouvrage est si avancé dans cette pratique prospective qu’on dirait souvent qu’une espèce de démon, de spectre exégétique se décolle des feuilles, s’affranchit de la page et de la création pour s’en aller vivre ailleurs une nouvelle existence, une pluralité de manières d’être au monde. Si ce n’est que l’esprit de l’œuvre transmigre, visuellement, s’enhardit sous nos yeux au fil des récits dans des anamorphoses et des transmutations de plus en plus percutantes. Prodige fantastique, polysémique, eschatologique ? Les textes, de toute évidence, tissent aussi une éternité et les miracles incoercibles d’un temps d’après la mort. L’avènement de l’ennui, sa conscience irréductible à contempler une communauté d’hommes-ânes groupée autour d’un train – vecteur morbide de l’historicité de l’être et de la vie – jusqu’à confondre, en ses modes obtus et extrême, l’intérieur et l’extérieur de ce train, les autres et soi-même (ici s’insère très furtivement l’entaille spectrale du « jeune homme triste dans un train » de Duchamp), l’avènement humainement, chimiquement aliénant de l’ennui est le fondement de sa vocation poétique. « Lorsque décidé à les rejoindre j’ouvris la porte la nuit commençait à tomber, insidieuse comme l’ennui et profonde comme lui qui entre Eboli et Sybaris, quels que soient le sens emprunté et les influences marines, offre licence infinie à l’imaginaire afin d’enseigner au voyageur perdu ce point suprême du détachement qui consiste à lécher les chardons brûlés du paysage avec la certitude d’entreprendre les tétons toujours superbement érigés des maîtresses majeures. »
L’ennui si irrévocablement avéré, la créature humaine, son statut, sa crédibilité, se désagrègent. Le mal l’atteint au fondement de son être. Dès lors il ne reste plus qu’à élire parmi les représentations de l’imaginaire la plus combinatoire et la plus effective qui ne serait ni homme ni animal, mais qui hésiterait, se chercherait entre deux règnes, avec une responsabilité imputable à l’entre-deux et à l’aléatoire. Ainsi de la création-révélation de l’âne qui associée fraternellement au plus sombre jusant de la condition humaine travaille les sens et l’esprit au point qu’on se demande si nous ne sommes pas impliqués dans une expérience de transformation de nous-mêmes, un événement à haute teneur spirituelle. À ce point du dommage il fallait renouveler l’être ! Et c’est bien une philosophie du renouvellement qu’on nous propose ici à travers la dualité de l’âne, du gorille, du cochon, etc., dont nous aurons à découvrir les codes et les usages et à les appliquer aux désirs et secrets transfinis de nos vies. À ce point du dommage, il fallait le recours à un acte majeur de la volonté, un acte qui engage, qui érige en système cette décision fondamentale de l’âme poétique. Car Jehan van Langhenhoven, c’est cela aussi : une procession d’actes figurant, édifiant, entrés dans le domaine majestueux de la poésie et qui la régénère en corps et conscience. Puis, abandonnant la vision de l’âne, la glose animalière reprend sa voie intègre et singulière et de nouveau fait rage.
Tome II. Du gorille, des grandes européennes. La méthode procède par bonds, avons-nous dit (le souffle contrapontique ne perd jamais sa maîtrise), bonds dans l’agencement conceptuel et narratif aussi, comme si tous les éléments, rationnellement élus et concertés, qui composent cette trame convulsive, étaient animés de ressorts fanatiques, de mécanismes œuvrant à la fois pour leur propre compte et indivis. Le contrepoint n’a que faire des périodes et des cadres, le contrepoint s’en tient rigoureusement à sa méthode, se sépare des attaches et des articulations éphémères du réel, élève ce réel à la pointe ultime des visions et du dire. Le poète protège le réel, le transpose en lieu sûr. Ainsi le thème des gorilles englobe-t-il dans sa version polyphonique Belleville, Ménilmontant, Hannon le navigateur, les temps d’origine et les temps à venir.
« Ils ramèrent en costauds comme parfois
il est dit dans les gazettes sportives
Ils ramèrent effrayant à jamais
la boussole des géographes
et les historiens ânonnant au sortir du métro Belleville
comme à l’amorce de la rue Ménilmontant
d’aujourd’hui encore hésiter
entre colonnes d’Hercule et pylônes d’Héraclès
Ramez ! Ramez… »
Combien jubilatoire la démarche de l’auteur qui, pour passer les degrés, accéder aux confins du représentable, travaille d’une seule main, d’un seul cœur illuminé autant sur la forme des mots (leurs joints, leur poids sensuels, leur assiduité sexuelle), que sur leurs sens. Franchis les seuils et les perspectives, les sciences communes et les sciences naturelles, c’est une accession aux ciels de la poésie ! Jamais on ne l’a vu fléchir, ménager ses atouts, cet amoureux du corps textuel. Jamais on n’a surpris ce seigneur de l’amour avoir autre chose en vue que la jouissance de l’œuvre ! « Écoute, comme expert en poésie narrative, privilégiant la parfaite objectivité du souffle à l’omniprésente versatilité du sens, dans les boudoirs de l’hyperlittérature, son corps raconte. » Mais de quelle secousse violente, quel spasme primordial de l’imaginaire a surgi cette épopée de Charles et Gustave au Birunga sur les traces des maîtres simiens, héros et martyrs, ce « carnaval des animaux » dans sa superbe orchestration poétique, allégorie de la cruauté dont l’humour, les subversives injections d’humour (au regard desquelles, à géhenne égale, Virgile et Dante sont discrédités), en activent et apaisent les plaies ? « - Le Sumu, Charles ? - Oui le Sumu Gustave, cet usage ancestral consistant à massacrer les gorilles – et en particulier les grands mâles à dos argenté – afin de leur prélever : oreilles, langue, petits doigts et surtout testicules qui une fois mélangés, bouillis et agrémentés d’ingrédients fournis par le sorcier guérisseur, constitueront un aphrodisiaque infaillible. » Bien sûr, en toile de fond, il y a le récit choisi de ce navigateur et découvreur des contrées africaines au VIe siècle av. JC, Hannon, mais comme un des multiples picadors qui excitent et fécondent la chair de sa création. À chaque ligne la métaphore prend corps, emprunte à une mythologie ou mystique animale, pour révéler ces sauvageries du règne vivant et nous les rendre tolérables.
Tome III. Du cochon (et de ses truismes). « Je le sais à présent, moi que voici peu, tigres, albatros, taureaux et baleines, sans préavis, en chœur désertèrent pour, clé de la conjuration, me laisser seul, face aux… Cochons ! Aussi, pensant avoir atteint le stade ultime de l’abjection, visage défait, genoux tremblants, mains jointes, je tombai à terre en criant : Non ! Non ! Les punaises, les crapauds, les hyènes si vous voulez, mais pas les cochons. Pas les cochons ! » Dans ce long poème épique qui a trait à l’amour, où l’entité masculine, double, est d’une part le poète lui-même, d’autre part le cochon simple, mortel, sacrificiel, dans cette chanson qui abonde en évocations de la gestuelle sexuelle, le paradoxe et le paroxysme dramatique le disputent au burlesque. Nul animal dans l’ouvrage ne fera son entrée en scène sans porter l’étendard du sacrifice. Cette reconduction du thème de la bête immolée qui traverse le texte est sa dimension complexe, juridique, comme aux meilleurs moments, une strangulation par surprise, fantomatique, de l’humour et du rire. Il ne faut qu’un glissement de plus du sens pour révéler l’omniprésence de l’attention à autrui, du partage. Tous les objets qui composent le livre sont revêtus d’une plénitude, d’une gratitude maitresse qui sont le signe de la compassion du poète.
Tome IV. De l’animal tri-nodal et de son influence sur la poésie passée, présente et à venir… « Le phénomène, qui l’eut cru, est de retour ; et c’est toujours l’effroyable forçat. L’animal ! Le presque-dieu nidifiant à perdre haleine pour qui les yeux des filles, ô les yeux des filles… » « L’animal tri-nodal nidifie à tour de pine », tant et tant, à perte d’une représentation contingente de lui-même et à perte de vide, que l’on craint qu’en s’exécutant il ne s’exténue. Si ce n’est que de ses épuisements l’essence et la forme du texte se recréent. Si ce n’est, et ce crédo s’est inscrit dans sa chair, qu’au stade de l’ultime épuisement jaillira la forme accomplie du poème, de l’objet de l’écrit, sanctifié. L’homme porte dans son membre les chemins et les voies de la création. Je le crois. Je crois que pour J. v. L. la voie poétique est la voie qui s’éprouve, la voie qui s’élonge superbement, prophétiquement, faite de lettres, de sperme et de sang. « La bête du verbe » nous dit-on !
Tome V. Chroniques de la grande volière de l’œil. Le principe moteur de cette cinquième œuvre, c’est d’ôter une à une, les limites, d’un geste invisible, de prévenir les obstacles, d’ouvrir le champ (tel que seul notre auteur de cataclysmes et de traumatismes oniriques pouvait, dans sa synthèse cohérente, l’initier) à l’illimité. Plus qu’une mise en scène fantastique, c’est une démonstration, la preuve visuelle, rayonnante, que l’illimité, l’infini poétique existe. Rien ne sera épargné qui doive entraver, faire insulte à la démesure. Une femme, épouse, et le vol corrupteur-rédempteur de toutes les espèces du ciel en rut ! « Elle n’en croit pas ses yeux. - Mais combien de giratoires à l’infini lui en faudrait-il, de vifs et démesurés, pour d’un regard, un seul, pouvoir étreindre tous ces astres virevoltants, gavés de sulfureuses liqueurs et d’acides jubilatoires, qui, éléments pyrométriques d’un même chapelet, entreprennent de, couilles au corps, dévaler les pentes célestes. » Dès longtemps, J. v. L. a saisi le point de fuite, la ligne bancale de l’essentiel, à savoir que nous sommes vides, que nous naissons sans fonds, engagés dans une lutte inégale contre l’attraction de l’abîme, et que notre seul salut est l’imagination. Non ! L’imaginaire protesterait-il !
Tome VI. Journal d’une prétendue métamorphose et d’une défaite certaine… Ultime métamorphose, la plus déconcertante peut-être qui fait profession de foi « des riens » et du dénuement, celle du rhinocéros. Depuis le début de ma lecture, je me remémore par intermittence un passage du livre « Le guide des égarés » de Maïmonide qui se rapporte précisément aux configurations animales. Le voici : Il (le prophète) raconte avoir vu quatre ‘hayyoth (figures d’animaux) dont chacune avait quatre faces, quatre ailes, et deux mains ; l’ensemble de la configuration de chaque ‘hayyâ était une figure d’homme, comme il dit : « elles avaient une ressemblance humaine… Il dit donc que le côté vers lequel, selon l’intention divine, la ‘hayya devait se mouvoir, était celui vers lequel elle accomplissait ce mouvement rapide désigné par les mots « courraient et revenaient ». C’est là ce qu’il dit en parlant des ‘hayyoth : « Là où c’était l’intention (divine), ‘ha-roua’h, qu’elles aillent, elles allaient, sans se détourner de leur marche… « Elles allaient sans se détourner de leur marche », mais n’est-ce pas ce que l’on sent ici de ces métamorphoses aux prises avec un destin inéluctable où quelque chose d’innomé et de fondamental cherche à travers elles à s’accomplir, ou du moins à déposer les traces, les prémices d’un autre texte, d’une autre loi, irréfutables.
Odile COHEN-ABBAS
(Revue Les Hommes sans Épaules).