Les Hommes sans Épaules
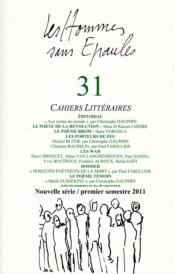
Dossier : HORIZONS POÉTIQUES DE LA MORT
Numéro 31
266 pages
Premier semestre 2011
17.00 €
Sommaire du numéro
Éditorial : "Aux tyrans du monde", par Christophe DAUPHIN
Le Poète de la Révolution : Abou El Kacem CHEBBI par Christophe DAUPHIN, Poèmes de Abou El Kacem CHEBBI
Le poème rrom : "Etranger non admis", Poèmes de Ilarie VORONCA
Les Porteurs de Feu : Poèmes de Michel BUTOR, Christian BACHELIN
Ainsi furent les Wah : Poèmes de Henri DROGUET, Jehan VAN LANGHENHOVEN, Paul SANDA, Yves BOUTROUE, Frédéric AUROUX, Hafsa SAÏFI
Dossier : Horizons poétiques de la mort, par Paul FARELLIER, Poèmes de Yves BONNEFOY, Paul ELUARD, André LAUDE, Jean-Paul HAMEURY, Marie-Claire BANCQUART, Richard ROGNET, Pierre EMMANUEL, Jean-Philippe SALABREUIL, Lionel RAY, Philippe JACCOTTET, Antoinette JAUME
Le poème témoin : "Malik Oussekine", par Christophe DAUPHIN, Malik OUSSEKINE
Une voix, une œuvre : François MONTMANEIX, par Jean-Yves DEBREUILLE, Poèmes de François MONTMANEIX
Hommage : "Pour saluer Jules SUPERVIELLE", par François MONTMANEIX, Poèmes de Jules SUPERVIELLE
Vers les terres libres : Joumana HADDAD, par Karel HADEK
Dans les cheveux d'Aoûn : proses de Jacques HÉROLD, Jean CHATARD, Alain BRETON
Les pages des Hommes sans Épaules : Poèmes de Elodia TURKI, Paul FARELLIER, Alain BRETON, Karel HADEK
Avec la moelle des arbres : notes de lecture de Jean CHATARD, Paul FARELLIER, Jean-Pierre VÉDRINES, Alain BRETON, Jacques ARAMBURU, Jean-Paul GAVARD-PERRET, Isabelle LÉVESQUE
Infos / Échos des HSE, par César BIRÈNE
Hommage du Tout-Monde des HSE : Édouard GLISSANT, par César BIRÈNE
Présentation
ELA TOGHAT AL ALAAM / AUX TYRANS DU MONDE
« La voix des Arabes libres », est le titre d’un manifeste, poignant et implacable, qui fait date, écrit par notre ami, le poète marocain Abdellatif Laâbi, et publié en ouverture des Hommes sans Epaules n°26, en 2008. « Ici La voix des Arabes libres, y écrit Laâbi, la voix de ceux, celles qui ont décidé de briser la loi du silence, combattre le mensonge, redonner la voix aux sans voix, faire entendre le cri des suppliciés, rejeter les chaînes de la soumission, dénoncer les grandes et petites chaînes de la soumission, dénoncer les grandes et petites lâchetés, démasquer les assassins et leurs commanditaires, mettre à nu les mécanismes de la corruption et du pillage, lever le voile sur les misères matérielles et morales, bref, s’insurger contre la fatalité et libérer le cours de l’espoir. » Prémonitoire, le manifeste d’Abdellatif Laâbi l’est bel et bien car il correspond aux aspirations de millions de personnes. Le poète, rappelons-le, a lui-même chèrement payé ses engagements, ayant été arrêté, torturé et condamné au Maroc, en 1972, par la « justice » du roi, à dix ans de prison. « La voix des Arabes libres » résonne aujourd’hui en Tunisie, en Égypte, en Algérie, en Libye, au Yémen, à Bahreïn, en Jordanie, et dans le pays natal de notre ami Abdellatif, soit dans tous ces lieux inconcevables « pour l’imagination courte des tyrans, de leurs sbires et des paternalistes de tout acabit. Désert primordial où la parole rebelle fut conçue, où l’arbre de la mémoire surgit, plongea ses racines dans la terre assoiffée de justice, déploya sa frondaison pour accueillir la palabre des chercheurs de vérité aux lèvres gercées d’énigmes, à la face inspirée par le message d’errance. » Oui, aujourd’hui, on peut entendre la voix des Arabes libres : « Hommes et femmes refusant l’uniforme simiesque, le garde-à-vous, l’hymne vengeur, les bruits de bottes, les marches forcées, les barbelés de la patrie. » Oui, la Tunisie, à l’ombre du soleil des touristes, était bardée de barbelés… Les révolutions tunisienne et égyptienne ont ouvert la voie à l’irruption des masses populaires et peut-être pas seulement dans le monde arabe. Il aura fallu attendre l’hiver 2010 pour que les masques et les chaînes tombent en Tunisie, et le 11 février 2011 en Égypte (avec le départ de Moubarak après dix jours de contestation populaire), comme l’avait prédit Abou El Kacem Chebbi, dans son poème « La Volonté de vivre », écrit à Tabarka (ville côtière du nord-ouest de la Tunisie), le 16 septembre 1933 : Qui n’aime pas gravir la montagne, - vivra éternellement au fond des vallées. Car la poésie porte le peuple, pour lequel nous vibrons, afin que sa « volonté de vivre » triomphe, sans que les partis politiques et religieux ne se l’approprient. Que va-t-il se passer en Tunisie et en Égypte, après la révolution et dans les pays voisins ? Personne ne le sait. Gibran Khalil Gibran (in Le Prophète, 1923) donne peut-être une piste : « Et s’il existe un despote que vous voudriez détrôner, voyez d’abord si l’image de son trône érigée en vous est détruite. Car comment le tyran peut-il régner sur les affranchis et les fiers, s’il n’existe une tyrannie dans leur propre liberté et une honte dans leur propre fierté ? » Tel est notamment le défi qu’il faudra relever. Le poème « La volonté de vivre » n’est pas sans renvoyer à une deuxième œuvre de Chebbi, « Ela Toghat Al Alaam » (Aux tyrans du monde), qui a également porté les Tunisiens (des banderoles lors des manifestations en ont témoigné), lors de leur révolution. Écrit sous le régime du protectorat français en Tunisie, le poète y dénonce la tyrannie à travers les affres du colonialisme français - sans toutefois le mentionner ouvertement -, menace les occupants et prédit une révolte contre le système : Ami de la nuit, ennemi de la vie... - Tu t’es moqué d’un peuple impuissant - Ta main est teinte de son sang - Tu abîmes la magie de l’univers - Et tu sèmes les épines du malheur dans ses éminences - Doucement ! Que ne te trompent pas le printemps, - La clarté de l’air et la lumière du jour - Dans l’horizon vaste, il y a l’horreur de la nuit - Le grondement du tonnerre et les rafales du vent - Attention ! Sous la cendre, il y a des flammes - Celui qui plante les épines récolte les blessures - Regarde là-bas où tu as moissonné - Les fleurs de l’espoir - Le torrent du sang va t’arracher - Et l’orage brûlant va te dévorer. (Abou El Kacem Chebbi).
Christophe DAUPHIN
(Extrait de l'éditorial, Aux Tyrans du monde, écrit le 20 février 2011, in Les Hommes sans Epaules n°31, 2011).
ÉTRANGER NON ADMIS
"Hier comme aujourd’hui, il y a toujours eu, le fait n’est pas nouveau, des cohortes d’anonymes, d’exilés, de persécutés, en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. Ilarie Voronca en était ainsi que ses amis, dont Benjamin Fondane. Il fut contraint de s’exiler à Paris, puis dans le Sud de la France durant l’Occupation. C’est à cette cohorte d’anonymes, d’exilés, de persécutés, fuyant les ténèbres, que Voronca s’adressait avant tout : Je vois des convois d’hommes marchant vers d’autres cités – et mon cœur reste lié à eux, comme un chien sous la charrette. Ces ténèbres, c’étaient hier, le nationalisme, l’intolérance et l’antisémitisme qui gangrenaient le monde et la Roumanie, alors sous la férule idéologique de la Garde de Fer. Aujourd’hui, près de soixante ans plus tard, l’année même qui a manqué de voir la disparition de la tombe de Voronca ; ses « restes » jetés à la fosse commune ; aujourd’hui, en 2010, près de soixante ans plus tard, l’État français, sous couvert de « sanctionner des comportements illégaux », stigmatise une communauté toute entière, qu’elle prend comme bouc-émissaire : les Rroms, Roumains pour l’essentiel. Au programme des mesures : le démantèlement des camps, les expulsions, les reconduites à la frontière, les contrôles fiscaux accrus. « Rrom » signifie « être humain » en romani, la langue des Rroms. Rrom ou plutôt Tzigane ; n’est-ce pas ainsi, Ilarie, toi qui étais tellement grand que Marc Chagall t’avait dessiné en Tour Eiffel ; n’est-ce pas ainsi que l’on te qualifiait parfois, en te regardant de travers, à cause de ton teint mat ? Rien ne change jamais et ta poésie n’est pas près de perdre de son actualité, de sa force. N’avais-tu pas publié, Permis de Séjour, en 1935, un recueil au titre extrêmement explicite ?"
Christophe DAUPHIN
Ah ! je t’ai bien connue, Misère, j’étais de ceux que tu encenses,
Tu fus pour mon esprit la première forme de la connaissance,
Et dans ce vaste pays où je m’arrête enfin,
Tu m’apprends toute chose aussi : commencement et fin.
Je foule de mes pieds ces rues semblables aux cimetières,
Mes yeux cherchent assoiffés une source de lumière,
Ici, comme là-bas, une chambre froide, un peu de pain,
La même pauvreté, la même angoisse pour le lendemain,
Et à côté le bruit de la machine à coudre d’une pauvre lingère,
Elle geint très tard dans la nuit. Elle est étrangère.
Son mari l’a abandonnée avec deux petites filles.
Ça, c’est la vie,
Ou la mort – appelle-la comme tu le voudras –
Mais ne laisse nulle trace : efface tes paroles comme des pas,
Efface ces vers où tu parles de toi et de la pauvre lingère,
Tourne ta face vers la face aveugle de la misère.
Nulle part un toit hospitalier, une mer bienheureuse
Caressant doucement les joues des rives lumineuses.
Une joie aurait pu, comme un courant chaud d’ailleurs
Venir jusqu’à mes lèvres, poser un mot meilleur,
Allumer dans mon cœur le matin comme une vaste coupole,
Et ce gravier, ces voix fraiches dans les écoles.
Des gens très doux, très polis seraient descendus vers les plages,
Et moi parmi eux tous, emmêlant nos visages,
Planant entre les vitres claires, hautes des maisons,
Frères tous, nous tenant par la main, si lumineux, si bons.
Mais non, ici comme là-bas cette rivière morne,
Ces souffles citadins, ces tristesses sans bornes,
Cette ville de boue et de brume dont le nom
Qu’importe ? Fût-il Paris, Londres ou Capetown.
Ici comme ailleurs, ces maisons qui s’écroulent
Et ces ponts sous lesquels un jour laiteux s’écoule,
Ces foules comme une meule qui broye à chaque instant
Un homme comme moi ou comme toi, lecteur, ou comme tant
D’autres encore qui se perdent, disparaissent dans l’indifférence.
Et nul ne sait ce qu’il est venu faire là, quelle souffrance
Ou quelle joie lui est due ? Doit-il rester ? S’en aller ?
Et tous sont si pressés. Pourquoi ? Nul temps pour se parler.
Non rasé, le visage triste inspire-t-il confiance ?
Mes habits sont usés, mais moins que mon âme. Pense
À quelque chose de gai – me disais-je. – Montre-toi
Plus heureux. « Bonjour, Monsieur. Je voudrais un emploi. »
Quelle fêlure dans ma voix laisse passer l’arôme
D’un pays d’au-delà ? Mes papiers sont bons. « En somme
On pourrait très bien, Monsieur, vous engager,
Mais notre maison ne prend plus d’étrangers,
Ni de poètes »… J’avais faim. Un brouillard montait vers la cité.
Loin ou près, les étoiles faisaient leur publicité.
Entre ces hommes méchants, qu’étais-je venu donc faire ?
Ici, comme partout ailleurs, ma voix est étrangère,
Partout je suis l’errant. Je ne serai nulle part
Celui qu’on attend. Il faut que je pense au départ.
« Je n’y puis rien, Monsieur, voyez vous-même,
Les temps sont durs. » Ô ! Je suis seul et cette cité blême,
Ces figures qui fondent, ces avenues, ces ponts,
Et cette foule aussi qui, telle une neige, fond,
Je veux m’en souvenir, mais déjà la mémoire
Me quitte. Le ciel montre une face noire,
N’ai-je donc pas franchi un invisible seuil ?
Ces gens sont-ils vraiment, ou seulement mon œil
A gardé leurs contours ainsi qu’une blessure
Que, seule, la cécité, couvrira d’une eau pure ?
Je serai donc ici, comme ailleurs, de passage.
Mais cette souffrance et cette misère et ces pages
Où s’inscrira un chant plus triste que le mien,
Que signifient-elles ? Il y a aussi les retours des marins,
Il y a aussi la soif de connaître. Et les sorties
Des ouvriers à six heures du soir. Et ces paroles assorties
Par lesquelles on vous montre que tout est pour le mieux.
Il y a aussi les forêts, les usines tout au fond de nos yeux,
Et ces disparitions si lentes, ces fenêtres,
Parmi les doux orages qui remplacent nos êtres,
Et ce deuil, cette angoisse d’être étranger partout,
De ne me voir accepté, hommes, fantômes, parmi vous,
Dans la vie, dans la mort, le même errant solitaire,
Et n’avoir pour compagnon que toi seule : Misère.
Ilarie VORONCA
(in Les Hommes sans Épaules n°31, 2011).
HORIZONS POÉTIQUES DE LA MORT
De quelques expériences (ca 1940 – 2000)
"... Le vingtième siècle fut non seulement « l’âge classique de la guerre » qu'avait annoncé Nietzsche, mais l'âge, en tout cas, de la terreur de masse, des camps d'extermination et de l’Armageddon nucléaire. Comment s’étonner que ce siècle-là ait réinscrit la mort dans tous les plans du paysage mental moderne, à l’image de ces « danses des morts » dont le sculpteur médiéval faisait trembler les tympans des cathédrales ? Comment ne pas voir qu’un Hadès s’est relogé au plus profond de nous et donc de notre poésie ? De nouvelles pentes même se sont creusées pour y descendre ; plus s’est assombri le siècle, plus loin fut poussée l’horreur infligée aux vivants, plus nombreux se sont comptés les voyageurs prêts à risquer l’obole. À l’aboutissement d’un long parcours, le poète finira par sonder son corps vivant pour y traquer les racines de sa propre mort. Mais auparavant, il a cherché à « vivre sa mort », estompant ainsi des limites que l’on croyait infranchissables entre les territoires de la vie et de la mort. Mourir, ce n’était plus, dès lors, accéder à une « substance » distincte du vivre. Mourir deviendrait une dimension du vivre. Irait-on jusqu’à pouvoir connaître l’inconnaissable ? Faire remonter au jour l’être de la nuit ? Aussi bien la figure d’Eurydice s’était-elle déjà insensiblement rapprochée : non plus tout à fait ce fantôme des brouillards, perdu sitôt qu’évoqué, ce rêve indécis d’un Orphée velléitaire et désemparé, mais la chair même de notre supplice, le corps ravagé, écartelé, démembré de notre absence à nous-mêmes..."
Paul FARELLIER
(Extrait de la présentation du dossier, Horizons poétiques de la mort, in Les Hommes sans Épaules n°31, 2011).
