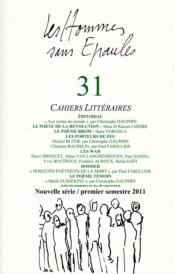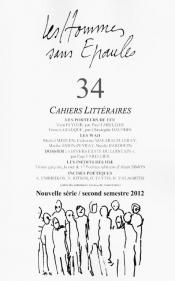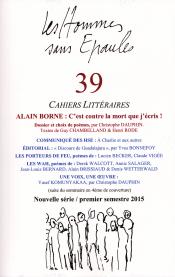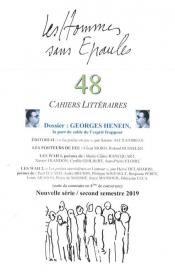Yves BONNEFOY

PORTRAIT DU POÈTE, À L’ÉCHARPE ROUGE : POUR YVES BONNEFOY,
(extraits)
par Christophe DAUPHIN
Yves Bonnefoy a été considéré de son vivant comme le plus grand poète français ; ce à quoi, l’intéressé n’accordait guère d’importance. Cela le faisait, tout au plus, sourire. « Lire un grand poète, ce n’est pas avoir à décider qu’il est grand, c’est lui demander de nous aider. C’est attendre de sa radicalité qu’elle nous guide, tant soit peu, vers le sérieux dont on est peut-être capable », a t’il écrit à propos de Rimbaud. Yves Bonnefoyn’était pas dupe de la notoriété de son œuvre (très commentée et parfois hélas de manière trop sèche, trop cérébrale), de son audience internationale (ce que bon nombre, le critiquant, lui enviait) ; mais, selon nous, il faut sans cesse revenir à l’œuvre et mettre de côté autant que possible les écrits des commentateurs à la science infuse.
Yes Bonnefoy est un intellectuel, un essayiste, un érudit de grande envergure, mais c’est aussi et avant tout un artiste, un poète, c’est-à-dire un homme du sensible ; non pas sec mais poreux aux éléments, aux émotions. « Mon grand souci, depuis mon enfance, a été la poésie. Je ressens que c’est dans l’intuition qui la fonde que peuvent prendre sens et vigueur les divers aspects de notre être au monde, privé sinon du meilleur de sa conscience de soi. C’est la poésie qui permettrait, si seulement on la prenait au sérieux, de vivre le désir à un plan où il ne soit pas simplement de l’égocentrisme, et ainsi en conflit avec la demande d’autrui dans la société dès lors malheureuse. Je crois en la valeur de la poésie, en son efficace », écrit Bonnefoy (in préface à Traité du pianiste, 2008), dont la poésie doit moins à la recherche en laboratoire, qu’à la Vie. C’est ainsi que j’ai perçu et que je perçois encore son œuvre (..)
Parlant d’Yves Bonnefoy, je veux aussi parler de l’homme, qui était simple, car fidèle à ses origines, à ses parents, qui voyageaient toujours dans son cœur ; fidèle à son milieu natal donc, et ce, malgré de brillantes études (mathématiques et philosophie ; son intérêt pour les mathématiques, la logique formelle et l’histoire des sciences perdurera), l’élévation sociale et intellectuelle, que l’on sait et qui vient de loin. Yves nous dit : « Je vivais dans un milieu de peu de livres, et à une époque où rien ou presque de la pensée ou des œuvres ne circulait dans les quartiers pauvres : d’où suit que l’école puis le lycée me furent longtemps le seul livre, ouvert aussi vers la fin quand je sus un peu de leur langue aux œuvres d’Ovide ou de Virgile. » En cela, son appartement-bureau parisien de la rue Lepic lui ressemblait, simple et chaleureux, authentique lieu de création et d’amitié, avec ses immanquables murs de livres, dont il aimait parfois desceller une « pierre » pour l’offrir à son ami visiteur.
Né le 24 juin 1923 à Tours. Yves est le fils d’Élie Bonnefoy (originaire d’une famille de paysans modestes du Lot, à Viazac), qui décède tragiquement en 1936, et de Hélène Maury (originaire d’une famille de paysans, « pas vraiment pauvre », de l’Aveyron, à Ambeyrac), et qui étaient venus, après leur mariage, s'installer à Tours, l'un comme ouvrier monteur aux ateliers des chemins de fer, l'autre comme institutrice. Un milieu simple et modeste, donc, auquel il est toujours demeuré attaché, car, « c’est vrai que j’aimé très tôt dans l’enfance », écrit le poète (in L’écharpe rouge) dans son avant-dernier livre : « ce que j’apercevais grâce au « bleu regard » maternel. Je n’y décelais pas de mensonge, comme Rimbaud se remémorant ce qu’il découvrait au même âge – sept ans, la première expérience de la pensée conceptuelle – dans les yeux sur lui de Vitalie Cuif, mais tout au contraire un surcroît de réalité. » Dans une existence, l’enfance ne finit pas, car l’enfance « est l’époque où ce sont de vraies présences qui parlent, habituant à entendre ce que, comme telles, elles disent, ce qu’on ne cessera jamais tout à fait de faire, même si l’on se laisse gagner par cette distraction que nous nommons l’inconscient. » Cette enfance, « nous avons beau nous en éloigner dans le temps, découvrir des lieux et aimer des êtres dont nos premières années n’avaient rien su ni ne pouvaient rien imaginer, tout cet après-coup se situe à l’intérieur d’un espace qui a été balisé par le petit enfant que nous fûmes. »
Je veux aussi parler de l’écoute et de l’attention d’Yves Bonnefoy, qui furent constantes ; de son amitié qui était totale lorsqu’elle était donnée, pour la vie et par-delà la mort : Vous me tendez vos mains, qui se réunissent, - Vos doigts sont à la fois l’Un et le multiple, - Vos paumes sont le ciel et ses étoiles. Si, par exemple, les œuvres complètes de ses amis Gilbert Lely, Christian Dotremont ou Georges Henein, grands poètes qui sombraient injustement dans l’oubli, purent paraître ; il faut le dire, c’est grâce à Yves Bonnefoy, lequel ne se célébrait pas et répugnait à tout culte de la personnalité. C’était un éveilleur, un être attachant ; un de ceux qui vous poussent, vous encouragent et vous forcent à donner le meilleur de vous-même.
À titre d’exemple, je peux évoquer notre première rencontre, il y a vingt-deux ans. Yves Bonnefoy a reçu en service de presse mon dernier livre de poèmes, qui lui a plu. Il a demandé à me rencontrer. Le 6 juin 1994, je me retrouve dans son bureau au Collège de France. Nous parlons à bâtons rompus et je n’en mène pas large. Non pas que mon interlocuteur cherche à m’en « mettre plein la vue » : c’est tout l’inverse. Nous ne parlons que de moi, alors jeune auteur de deux livres de poèmes. La curiosité d’Yves Bonnefoy est insatiable. Passé une bonne demi-heure, Georges Duby rentre dans le bureau, suivi, dix minutes plus tard, par Claude Lévi-Strauss. Il s’ensuit l’une des conversations les plus brillantes et admirables auxquelles il m’a été donné d’assister. Yves Bonnefoy, car je demeure silencieux, recentre la discussion en me présentant. Lévi-Strauss me parle, Yves lui ayant fait part de mon admiration pour André Breton, de sa traversée (de Marseille à destination de la Martinique) avec ce dernier, en mars 1941, à bord du Capitaine-Paul-Lemerle. Yves Bonnefoy n’embraya pas, du moins ce jour-là, sur le surréalisme, à propos duquel nous avions évidemment des dissensions. Il le fit plus tard : « Je n'ai pas rompu avec André Breton moi personnellement. J'ai simplement, à un moment donné, refusé une certaine direction ésotérique et pseudo-mystique qui me paraissait dangereuse pour la poésie. Mais ce n'était pas pour autant une façon de rompre avec André Breton pour lequel j'ai toujours gardé la plus grande sympathie. »
C’est en 1941 au lycée Descartes de Tours, lorsque son professeur de philosophie lui prêta son exemplaire de la Petite anthologie poétique du surréalisme (Jeanne Bucher, 1934) de Georges Hugnet, qu’Yves Bonnefoy, bouleversé par l’audace verbale des poèmes, comme par l’esprit de révolte qui animait les surréalistes, se rallia d’emblée au mouvement. Dès l’après-guerre, à Paris, il se lia d’amitié avec Sarane Alexandrian, Claude Tarnaud, Iaroslav Serpan (peintre et poète franco-tchèque, dont les poèmes, D'un regard oubliable pour qu'il soit, ont été publiés aux Éditions Saint-Germain-des-Prés, en 1977), Christian Dotremont, Raoul Ubac, Gilbert Lely, Georges Henein ou Victor Brauner qui le présenta à André Breton, et fonda le groupe d’action et la revue surréaliste La Révolution la nuit (deux numéros en 1946). Yves Bonnefoy y convia « toux ceux pour qui les mots de poésie et de liberté ont encore un sens à participer à ses travaux. » Le groupe La Révolution la nuit, se prononça d’emblée « contre tous les mysticismes, toutes les Églises, tous les négriers. Contre la crapuleuse morale chrétienne. Contre la réaction à visage de Sartre et d’Éluard. Contre toute falsification, aussi bien que contre toute imitation stérile des témoignages surréalistes du passé. Pour une pensée vraiment dialectique. Pour une poésie UTILE. Pour un surréalisme en mouvement. » Yves Bonnefoy conclut sa présentation en affirmant que ce n’est pas seulement dans la chronique, « c’est aussi dans une logique déchirée, dans une physique agressive de l’irrationnel, dans un nouvel état de l’esprit que s’inscriront les cris de l’époque. » La même année, Yves Bonnefoy publia, à 361 exemplaires, à l’enseigne de La Révolution la nuit, son poème Traité du pianiste et un tract de quatre pages : Dieu est-il français ? On peut y lire : « Dieu, ce porc, est du pays de ceux qui profitent, exploitent, restreignent, paralysent. (...) Il est du pays des asiles, des casernes, des bordels, des couvents, des prisons. (...) Dieu est le grand mensonge capitaliste. Dieu est le symbole, l'arme, la charpente de la classe à abattre. » Le temps est à la revendication d’un nouveau rapport au monde, au-delà des cloisonnements intellectuels que le langage instaure ; et plus encore : la poésie doit, selon le mot d’ordre de Rimbaud, « changer la vie ». Cela pour dire que le surréalisme de Bonnefoy fut authentique et même virulent ; et non pas un simple rapprochement d’ordre esthétique et/ou, de manière d’écrire.
Ajoutons (qui s’en souvient ?), que la rédaction du premier tract surréaliste publié à Paris le 22 mai 1947 après le retour en France d'André Breton, Liberté est un mot vietnamien, est due à Yves Bonnefoy, revue par André Breton et Pierre Mabille. Ce texte confirma la prise de position anticolonialiste du groupe, qui avait déjà été amorcée au moment de la guerre du Rif avec (La Révolution d'abord et toujours ! en 1925) et qui se radicalisa avec la Déclaration sur le Droit à l'Insoumission dans la Guerre d'Algérie en 1960 : « … Aux hommes qui gardent quelque lucidité et quelque sens de l’honnêteté nous disons : Il est faux que l’on puisse défendre la liberté ici en imposant la servitude ailleurs. Il est faux que l’on puisse mener au nom du peuple français un combat si odieux sans que des conséquences dramatiques en découlent rapidement. La tuerie agencée adroitement par un moine amiral ne tend qu’à défendre l’oppression féroce des capitalistes, des bureaucrates et des prêtres. Et ici, n’est-ce pas, trêve de plaisanterie : il ne saurait être question d’empêcher le Vietnam de tomber entre les mains d’un impérialisme concurrent car où voit-on que l’impérialisme français ait conservé quelque indépendance ; où voit-on qu’il ait fait autre chose depuis un quart de siècle que céder et se vendre ? Quelle protection se flatte-t-il d’assurer à tels ou tels de ses esclaves ? Les Surréalistes, pour qui la revendication principale a été et demeure la libération de l’homme, ne peuvent garder le silence devant un crime aussi stupide que révoltant. Le Surréalisme n’a de sens que contre un régime dont tous les membres solidaires n’ont trouvé comme don de joyeux avènement que cette ignominie sanglante, régime qui, à peine né, s’écroule dans la boue des compromissions, des concussions et qui n’est qu’un prélude calculé pour l’édification d’un prochain totalitarisme… »
C’est qu’avec Breton et ses amis, Yves Bonnefoy (qui écrit dans son Anti-Platon de 1946 : J’appelle SURRÉALISME l’art d’incendier cette maison, de se reconnaître à ses flammes) est indigné de l’état du monde, voire par des pans entiers de la condition humaine. Sa parole exprime bien moins les valeurs, les goûts, les jugements d’une personne particulière qu’elle ne réclame au nom de toute l’humanité et ne porte sur l’être-au-mode en ce que celui-ci a d’universel. On se doit, dit Breton, à son désir, qui n’est que l’ampleur en chacun de nous du possible que nous accorde le pouvoir d’énonciation du langage. Et là même, dans cette impatience native, dans ce vœu que soit sans entraves la liberté qu’il nous faut vouloir, là même est l’origine de la notion qui finit par laisser perplexe Bonnefoy pour qui : « l’idée de surréalité n’est que le complément en somme logique de cette revendication d’absolu, en sa fatalité d’être dédaigneuse des objections du cours ordinaire des choses, sinon même des lois de ce que nous nommons la réalité. »
La période surréaliste de Bonnefoy n’est pas « l’erreur de jeunesse » que pointent du doigt nombre de commentateurs, mais le point d’ancrage de toute sa création poétique. Le surréalisme demeure pour Yves Bonnefoy le souvenir au présent d’une expérience intérieure qui explique son attrait pour la poésie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Son désir de poésie trouva son origine dans une expérience non refoulée de l’enfance et qui procéda d’une intuition de l’être ou de l’unité, suivie d’un inévitable sentiment d’exil. La rencontre avec l’image surréaliste constitua un choc pour le jeune poète, car elle s’avéra être une entreprise de déconstruction des représentations telles qu’elles étaient envisagées dans la langue et dans la logique abstraite. Aussi, l’image surréaliste telle que l’entend Yves Bonnefoy est-elle à la fois « un surréel en puissance » qui peut rejoindre une part de néant, d’exil et un travail de déconstruction qui vise un rapport immédiat au réel. Contrairement aux mots qui jusque-là imposaient au poète de choisir entre « l’évidence de l’être et la présentation du non-être », l’image surréaliste permit l’entremêlement des deux. Néanmoins, d’après Yves Bonnefoy, cette intuition de l’image n’a pas été prise en compte par André Breton, qui, toujours pour Yves Bonnefoy, assimila à tort l’image à l’objet surréaliste pour l’orienter vers le néant de l’imaginaire, à partir du moment où il fait d’elle « un rêve de surréel. »
Son refus, en 1947, de signer le manifeste Rupture inaugurale, marqua la fin de son appartenance au groupe surréaliste. Yves Bonnefoy se détacha du mouvement à qui il reprocha le fait d’idéaliser l'objet et de tendre à substituer « la chimère poétique à la réalité même » (..)
Les poèmes et texte surréalistes d’Yves Bonnefoy ont reparu en 2001 : Le Cœur-espace, et en 2008 : Traité du pianiste et autres écrits anciens. Pour ce qui est d’André Breton, Yves Bonnefoy donna en 2001, un Breton à l’avant de soi, au sein duquel, après l’avoir quitté et délaissé trop longtemps, selon nous, il rendit hommage, sans pour autant taire ses divergences, à l’auteur de L’Amour fou : « Il a marqué tout le siècle… Je dirai moi aussi que j’ai pour Breton de l’admiration, du respect et même de l’affection… Car le dédain, le refus désinvolte ou méprisant d’autres êtres, cela n’existe que chez ceux qui ont envers soi de la complaisance, non chez les grands poètes, tournés vers bien plus qu’eux-mêmes : et il faut savoir reconnaître que le fondateur du surréalisme était du nombre de ces derniers. »
Du surréalisme, Yves Bonnefoy conservât la parole vraie, irrévérencieuse, critique. Il se tenait loin de l’image fausse que certains ont de lui : un grand poète officiel statufié. Officiel obsédé par sa propre gloire, il ne l’était pas et était ainsi capable d’encourager un jeune inconnu en poésie, de le lire, de le critiquer pour le faire avancer ; de le pousser à écrire des essais, à s’exercer à la critique et à s’investir dans le collectif poétique. Moi, qui ne jurais alors que par la peinture de Max Ernst, il m’a fait découvrir, entre autres, celle de mon lointain compatriote normand Nicolas Poussin, qu’il plaçait très haut dans son panthéon. C’est que la critique d’art occupe tout un pan de l’œuvre d’Yves Bonnefoy : L’Arrière-pays, Rome 1630 ou encore son monumental Giacometti, en sont des exemples. Il y a chez Yves, non seulement une grande fascination pour la peinture, mais également un passage de l’un à l’autre : la peinture a souvent inspirée sa poésie, de manière flagrante ou dissimulée, tout comme pour et chez Charles Baudelaire, qui est son interlocuteur privilégié (« Voici le maître-livre de notre poésie »). (..)
Nombreux sont ceux qui jouent au poète. Yves Bonnefoy lui, a vécu la poésie intensément sa vie durant. S’il n’ignorait ni les désastres, ni les beautés du monde, Yves Bonnefoy avait fait règle de se tenir à l’écart des bruits parasites du monde surmédiatisé. L’intériorité primait chez lui, aux dépens d’une extériorité qui lui paraissait surfaite, factice. (..)
L’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy est imposante (une trentaine de volumes). Elle le porte tout entier. Parallèlement, le poète avait débuté une importante œuvre d'essayiste (qui totalise près de soixante volumes), à partir de 1954, avec une monographie consacrée aux Peintures murales de la France gothique. Suivirent de nombreux livres, qui portèrent principalement sur l'histoire de la peinture, la relation des arts à la poésie, l'histoire de la poésie et son interprétation, la philosophie de l'œuvre et de l'acte poétiques : L’Improbable et autres essais ; Le Nuage rouge ; La Vérité de parole ; Entretiens sur la poésie ; Remarques sur le dessin ; Dessin, couleur et lumière ; Sous l’horizon du langage ; Giacometti ; Goya, les peintures noires ; Breton à l’avant de soi ; Notre besoin de Rimbaud… : « Je me sens à mon aise dans l'espace de mes écrits, je suis tenté de le voir comme une arborescence à partir d'une unique et nécessaire racine. Ce qui ne signifie pas que je sois en paix avec cet ensemble. Car c'est évidemment au sein même de chacune de ses parties que peut se rencontrer le désordre, désordre, cette fois bien plus dangereux, de la pensée au travail. À ce plan je ne prétends pas à l'unité, je cherche bien plutôt quand l'occasion m'est donnée, et non sans perplexité, à comprendre si tant soit peu elle existe. D'où la reprise que je fais aussi souvent que je puis de mes essais anciens dans de nouveaux livres. Non pour rien y changer, encore que je ne me prive pas d'en corriger les gaucheries de simple expression, mais pour me représenter un cheminement. Peut-être celui-ci pourra-t-il un jour se faire pour moi une ultime occasion de réflexion, avec quelques indications à offrir alors sur les lueurs mais aussi les pièges qui jalonnent le champ de la poésie. »
Ajoutons qu’après l’expérience surréaliste et revuistique de La Révolution la nuit et la disparition du Mercure de France (1890-1965), Yves Bonnefoy fondera une nouvelle revue (qui sera éditée par les éditions de la Fondation Maeght), L'Éphémère (20 numéros de 167 à 1972), avec Jacques Dupin, Gaëtan Picon, André du Bouchet, Louis-René Des Forêts, rejoints en 1968 par Michel Leiris et Paul Celan. Dès le premier numéro, Yves Bonnefoy affirma de manière radicale le caractère transitif de la poésie : « L'Éphémère a pour origine le sentiment qu’il existe une approche du réel dont l’œuvre poétique est seulement le moyen. En d’autres mots : il ne faut pas consentir à réduire l’œuvre... à la nature d’un objet, où cet au-delà se dérobe. » (..)
Chez Bonnefoy, poèmes et essais allèrent aussi de pair avec une activité de traducteur (doublée d’une réflexion sur l'acte de traduire, réflexion engagée dans les préfaces qu'il donna à ses traductions de Shakespeare ; traductions amorcées dès 1954, à la demande de Michel Leiris, pour le Club français du livre), outre l’auteur d’Hamlet, de William Butler Yeats, de Pétrarque, de Leopardi ou du poète grec Georges Séféris, à qui l'a lié une longue amitié : « Et traduire, alors ? Pourquoi ne pas traduire des poètes d'une autre langue, puisque sortir de la sienne, c'est rencontrer sous de nouveaux angles le travail de la pensée conceptuelle, ce qui relativise celui-ci et encourage donc à la poésie ? Il faut traduire, si on se veut un témoin de la poésie, traduire et, bien sûr, réfléchir à la traduction décider du champ et des lois de la traduction de la poésie... »
À partir de 1960, Yves Bonnefoy fut régulièrement invité, pour des périodes d'enseignement, par des universités françaises ou étrangères, en Suisse et aux États-Unis. Il fut professeur associé au centre universitaire de Vincennes (1969-1970), à l'université de Nice (1973-1976), et à l'université d’Aix-en-Provence (1979-1981), professeur invité à l'université de Genève (1970-1971 et 1971-1972), puis professeur au Collège de France (Chaire d’Etudes comparées de la Fonction poétique) ; sans jamais que cela ne modifie en quoi que ce soit l’intégrité de sa personne ou l’authenticité de sa démarche. C’est assez rare pour être rapporté. L’ensemble de ses résumés de cours au Collège de France fut publié en 1999 : Lieux et destins de l’image : un cours de poétique au Collège de France (1981-1993).
Après son premier grand livre de poèmes (sans négliger le Traité du pianiste de 1946, et l’Anti-Platon de 1947) qui fait date, Du mouvement et de l'immobilité de Douve (1953), les deux volumes des années suivantes, Hier régnant désert (1958) et Pierre écrite (1965) ; Yves Bonnefoy publia L’Arrière-pays, en 1972 : un récit autobiographique dont le fil directeur est la tension entre la séduction exercée par le désir d’un ailleurs, suggéré par les œuvres de la peinture et le retour à l’ici et à la finitude. Yves Bonnefoy écrit ensuite les poèmes en prose de La Rue Traversière (1977), qui inaugurent les rassemblements ultérieurs de Récits en rêve (1987). D’autres livres majeurs suivront, dont : Ce qui fut sans lumière (1987), Début et fin de la neige (1991), La Vie errante (1993) ou Les Planches courbes (2001). Signalons enfin que depuis les premiers volumes réalisés en collaboration avec des artistes et édités par Maeght, Pierre écrite avec Raoul Ubac en 1958 et Anti-Platon avec Joan Miró en 1962, Yves Bonnefoy publia régulièrement des livres, dans lesquels un dialogue s'engage entre les mots du poème et l'œuvre graphique qui l'accompagne, avec notamment Pierre Alechinsky, Eduardo Chillida, Alexandre Hollan, Antoni Tàpies, Gérard Titus-Carmel, Bram Van Velde ou, Zao Wou-Ki : « On ne peut penser à la poésie sans rencontrer la peinture, cet autre champ de la transgression des concepts, alors, comment ne pas aller voir de ce côté-là, s'assujettissant au passage à quelques travaux plus étroitement historiques pour mieux déboucher dans le lieu des peintres ? Je trouve on ne peut plus naturel, du point de vue de la poésie, d'avoir tenté l'étude de quelques-uns de ceux-ci, d'autant qu'il me semble que la Renaissance - que j'entends au sens large, de Giotto à la mort de Poussin - a lancé une dialectique qu'on peut entendre comme un déploiement cohérent des contradictions inhérentes à la visée poétique. »
Yves Bonnefoy parlait peu de ses problèmes ; davantage ces dernières années, en raison de l’abattement moral que lui causait la maladie de son épouse Lucy (elle-même artiste-peintre, qu’Yves a épousé en 1968 et dont il eut une fille, Mathilde, née en 1972, devenue monteuse image et son de talent,Oscar du meilleur film documentaire, en 2015, avec son mari, le producteur allemand Dirk Wilutzky et la réalisatrice américaine Laura Poitras, pour Citizen four, quitraite des révélations d'Edward Snowden sur le scandale d'espionnage mondial de la NSA), puis par ses propres problèmes de santé, qui devaient l’emporter.
Yves Bonnefoy ; la mort ne l’a pas cueilli par surprise. Bien qu’alité, ne pouvant plus bouger, il parvenait à parler d’une voix entrecoupée, totalement à bout de forces et de souffle. (..) J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi courageux et lucide devant la mort, à l’instar d’Henri Rode et de Sarane Alexandrian, ami de jeunesse d’Yves Bonnefoy qui nous dit : « Le ciel est beau le soir, c’est à cause de nous. ».
Yves Bonnefoy est décédé le 1erjuillet 2016 à l’âge de quatre-vingt-treize ans. Il venait de faire paraître deux de ses plus beaux livres en 2016 au Mercure de France : L’Écharpe rouge, son livre le plus autobiographique, à partir d’une centaine de vers écrits d'un seul élan, en 1964, et vers lesquels il revint souvent, à travers les années, car ils étaient pour lui une énigme ; et les poèmes fraternels et testamentaires d’Ensemble encore, suivi de Perambulans in noctem : Accepte ce que je t’offre, cette nuit – C’est mon besoin de continuer à croire – Qu’il y a sens à être… Si la publication de son œuvre poétique, dans la Bibliothèque de La Pléiade, chez Gallimard, a été décidée de son vivant. Il en ira hélas autrement de sa parution, très attendue.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules n°42, octobre 2016).
***
Présence et effacement (Sur les livres de poésie d’YVES BONNEFOY),
(extraits)
par Paul FARELLIER
(..)
Une rare unité rassemble au sommet de notre langue les poèmes d’Yves Bonnefoy ; sur plus d’un demi-siècle, une fidélité de ton, d’inspiration et de pensée. Cependant, à lire et relire ces livres de poésie, et en risquant une simplification sans doute abusive, on y discerne comme une évolution thématique avec l’exploration successive de deux versants : de l’Anti-Platon de 1947 jusqu’à Dans le leurre du seuil, publié en 1975, le versant de la présence, attesté par nombre de commentateurs ; puis, à partir de cette date, comme nous le croyons, le versant de l’effacement.
À vrai dire, plutôt que de simples thèmes, s’opposent là deux ordres qui paraissent se disputer la poésie de Bonnefoy – l’ordre de la présence, l’ordre de l’effacement. Quand ils se manifestent, c’est moins par contrariété formelle des caractères que par subtile et subite inversion des signes. La présence va se conquérir, dans l’espoir d’un règne. L’effacement, lui, ne vient qu’en soupçon, s’introduit beaucoup plus tard dans l’œuvre, pour devenir hantise par de nombreuses occurrences ; mais on ne saura même pas si son pouvoir de négativité aura pu jeter plus qu’une ombre sur la présence ; si, en définitive, à l’image d’un doute méthodique se résolvant en cogito, il ne l’aura pas confirmée. Une réponse sur ce point sera peut-être à rechercher dans le livre le plus récent : Les Planches courbes.
Ce qui contribue à rendre cruciale l’opposition de ces deux ordres, c’est que l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy est aussi l’une des plus résolument engagées dans une expérience de l’être. Celle-ci, d’ailleurs, menée dans le prolongement de l’évidence rimbaldienne et sans rien devoir aux instruments de pensée du philosophe : Yves Bonnefoy a très vite récusé le concept, y voyant le premier responsable de notre impuissance à saisir le monde dans sa plus simple et fraîche réalité ; le concept, dès qu’il apparaît, semblant donner congé irrémédiable aux évidences de l’ici et du maintenant – de ce que Bonnefoy invoque si souvent quand il en appelle à une terre.
De ceci, dès l’origine, l’Anti-Platon de 1947 a su témoigner poétiquement : […] Ce rire couvert de sang, je vous le dis, trafiquants d’éternel, visages symétriques, absence du regard, pèse plus lourd dans la tête de l’homme que les parfaites Idées, qui ne savent que déteindre sur sa bouche. […]
Sensible seulement à la modulation, au passage, au frémissement de l’équilibre, à la présence affirmée dans son éclatement déjà de toute part, il cherche la fraîcheur de la mort envahissante, il triomphe aisément d’une éternité sans jeunesse et d’une perfection sans brûlure. Dans ce dernier fragment, apparaît cette étrange expression : la fraîcheur de la mort envahissante. C’est que toute l’œuvre poétique qui va suivre, si ancrée sera-t-elle dans la vie et dans la présence, intégrera constamment la mort dans son projet de vérité. En fait foi la citation de Hegel placée en épigraphe à Douve : Mais la vie de l’esprit ne s’effraie point devant la mort et n’est pas celle qui s’en garde pure. Elle est la vie qui la supporte et se maintient en elle. En font encore foi ces quelques phrases, tirées de l’étude sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire, dans L’Improbable : Le concept cache la mort. Et le discours est menteur parce qu’il ôte du monde une chose : la mort, et qu’ainsi il annule tout. Rien n’est que par la mort. Et rien n’est vrai qui ne se prouve par la mort.
Ainsi, une fois de plus, le mythe d’Orphée se fera source de poésie. Et, dans le premier grand livre de poèmes d’Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve, paru en 1953, c’est bien la présence qu’un Orphée innommé va quérir au royaume de la mort, dans l’adoucissement tragique que lui donne le nom si troublant de Douve, quand le poète nous le prononce tout bas : "Je me réveille, il pleut. Le vent te pénètre, Douve, lande résineuse endormie près de moi. Je suis sur une terrasse, dans un trou de la mort. De grands chiens de feuillages tremblent. […]
Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, publiée sous le titre La présence et l’image, puis insérée dans les Entretiens sur la poésie, Yves Bonnefoy, se confiant à son public, a raconté lui-même sa rencontre de la présence, survenue à l’époque de sa jeune expérience surréaliste et à la faveur d’une sorte de désappointement, chez lui, à l’endroit de ces signifiants prétendument « autonomes » : […] passée la première fascination, je n’eus pas joie à ces mots qu’on me disait libres. J’avais dans mon regard une autre évidence, nourrie par d’autres poètes, celle de l’eau qui coule, du feu qui brûle sans hâte, de l’exister quotidien, du temps et du hasard qui en sont la seule substance […] la vie comme on l’assume jour après jour, sans chimères, parmi les choses du simple. Qu’est-ce, après tout, que toute la langue, même bouleversée de mille façons, auprès de la perception que l’on peut avoir, directement, mystérieusement, du remuement du feuillage sur le ciel ou du bruit du fruit qui tombe dans l’herbe ?
On entend bien là cet appel à une terre qui nourrit l’obsession de la présence. Philippe Jaccottet, dans le numéro 66 de la revue L’Arc consacré en 1976 à Yves Bonnefoy, a su très exactement caractériser cette obsession. Il évoque la mystérieuse réalité poursuivie, ce que Bonnefoy appelle la Présence. La formule est riche de sens dans ses trois vocables : réalité – la présence est celle d’un monde réel et concret, non pas celle des abstractions ; cette réalité est dite mystérieuse : le monde n’est pas celui des parfaites Idées ; pour mériter sa lumière, il faut d’abord se lier à son obscur, à la terre craquante de nuit ; enfin, et peut-être surtout, cette réalité n’est jamais entièrement saisie, elle doit sans cesse être poursuivie, selon l’heureuse expression de Jaccottet. Et, de fait, la présence chez Bonnefoy apparaît comme une conquête jamais pacifiée, toujours contestée, cent fois reperdue, livrée au doute, écrite puis désécrite, un vrai lieu certes, mais un lieu précaire.
C’est cette recherche inlassable de la présence à travers le temps, à travers la mort, cette quête d’une lumière jusque dans l’ombre même de l’absence, que nous disent tant de poèmes du livre Hier régnant désert (1958). Ainsi, comme dans une de ces fresques italiennes que le poète a tant regardées et admirées, nous voyons une orante, figure de la poésie en état de solitude essentielle, dans la salle basse très peu claire,/ Sa robe a la couleur de l’attente des morts. Et voici que le poète lui dit : Ta présence inapaisable brûle/ Comme une âme, en ces mots que je t’apporte encor. D’ailleurs, dans le poème suivant, "Une voix", n’est-ce pas la poésie elle-même qui parle, comme est présente l’ombre au cœur de l’être ? J’entretenais un feu dans la nuit la plus simple […] Je veillais […] J’avais un peu de temps pour comprendre et pour être. Et, de même que, chez Douve, la lumière profonde naît d’une terre rouée et craquante de nuit, de même ici la présence sera débusquée au fond d’un ravin d’absence, où le poète est ce chevalier prédestiné à arracher de la pierre la vieille épée de l’absence : Et tu savais qu’il te fallait saisir/ A deux mains tant d’absence, et arracher/ A sa gangue de nuit la flamme obscure. Un chant d’oiseau le précède vers la nouvelle rive (ce regard, toujours, chez Bonnefoy, d’une rive à l’autre), jusqu’à ce qu’il entende, d’une autre voix : Ecoute-moi revivre, je te conduis/ Au jardin de présence,/ L’abandonné au soir et que les ombres couvrent,/ L’habitable pour toi dans le nouvel amour.
Le jardin de présence, c’est maintenant et c’est ici : Ici l’inquiète voix consent d’aimer/ La pierre simple. Ici, où peut aller Le pas dans son vrai lieu. Ici, dans le lieu clair, où le passage du temps sur le jour – La rose d’heures/ Défleurira sans bruit – s’exprime avec la force d’un sentiment d’adhésion à l’immanence : A peine si le bruit de fruits simples qui tombent/ Enfièvre encore en toi le temps qui va guérir. Admirable ambiguïté de ce temps qui, par la présence, peut se guérir lui-même ou qui sait nous guérir. Guérison en éternité de ce temps de la présence, quand L’oiseau des ruines se dégage de la mort et ne sait plus ce qu’est demain dans l’éternel.
Le recueil Pierre écrite, publié en 1965, porte en épigraphe cette phrase tirée du Conte d’hiver : Tu as rencontré ce qui meurt, et moi ce qui vient de naître. Bonnefoy, traducteur de cette pièce de Shakespeare, ne propose-t-il pas ainsi à la lucidité d’une lecture attentive, hors de toute certitude a priori, le sentiment qu’une vérité réside dans l’alternative vie et mort ? Et de fait, sa perpétuelle recherche de la présence va, ici encore, illustrer ce jugement déjà cité : Rien n’est que par la mort. Et rien n’est vrai qui ne se prouve par la mort. Pierre écrite comporte, en tout cas, de nombreuses pages intitulées simplement Une pierre ; chaque fois, c’est d’une stèle qu’il s’agit, d’un poème pour une tombe, anonyme certes, mais d’où s’élèverait une voix, manifestant la part que prend la mort dans l’être ou, si l’on retourne le propos, la part d’être de la mort. Ainsi le poète visite-t-il l’absence des morts : il descend vers ce qu’il appelle le lieu des morts (deux poèmes portent ce titre), où l’absence devient présence interrogative, présence qui se tient sur la frontière indécidable entre vie et mort. Deux des « pierres » de Pierre écrite évoquent même cette frontière en une image violente : au mascaret de mort et le mascaret des morts ; le mascaret, comme on le sait, est cette longue vague déferlante produite dans certains estuaires par la rencontre du flux et du reflux ; comment mieux évoquer une communauté d’être entre vie et mort, que par cette vague bondissante qui en est la présence ? La même frontière d’écume reparaît dans un autre poème : Bouche, tu auras bu/ À la saveur obscure,/ À une eau ensablée,/ À l’Être sans retour.// Où vont se réunir/ L’eau amère, l’eau douce,/ Tu auras bu où brille/ L’impartageable amour. Il n’est pas jusqu’au ciel d’été, contemplé dans une nuit bien vivante, où le poète ne ressente le franchissement de cette ligne de l’être : Il me semble, ce soir,/ Que nous sommes entrés dans le jardin, dont l’ange/ A refermé les portes sans retour. Et cette présence-absence est d’une telle force que Bonnefoy, dans un élan non religieux assurément mais quasi-mystique, en appelle à un Dieu qui n’es[t] pas : Dieu qui n’es pas, pose ta main sur notre épaule […] Renonce-toi en nous comme un fruit se déchire,/ Efface-nous en toi. Tout se passe, en somme, comme si le monde devait d’autant plus gagner en présence que le Dieu se serait fait plus absent.
Publié en 1975, Dans le leurre du seuil apparut d’emblée à beaucoup comme une étape essentielle, chez Bonnefoy, dans sa recherche de la présence en un combat difficile et obscur, risqué, incertain. Le livre se compose de sept grandes séquences. Dans la première, Le fleuve, et surtout dans la deuxième, celle qui donne au livre son titre, Dans le leurre du seuil, le poème manifeste l’expérience d’un renversement soudain de la perspective suivie jusqu’alors. Le livre – tous l’ont noté – débute d’ailleurs sur une négation violente : Mais non. Et c’est D’un déploiement de l’aile de l’impossible que le poète, dans la nuit, s’éveille avec un cri/ Du lieu, qui n’est qu’un rêve. Il se lève une éternelle fois, inquiet d’un ailleurs, proche, lointain. Mais de sa fenêtre, le spectacle admirable de la nuit du monde semble avoir perdu, pour lui, l’innocence originelle (cet à jamais de silencieuse/ Respiration nocturne qui mariait/ Dans l’antique sommeil/ Les bêtes et les choses anuitées/ À l’infini sous le manteau d’étoiles.) Et, paradoxe pour ce poète chez qui nous éblouit si souvent le rayonnement d’un sens, c’est la blessure cosmique du sens dont saigne ici le poème tout entier : Le ciel brille pourtant des mêmes signes,/ Pourquoi le sens/ A-t-il coagulé au flanc de l’Ourse,/ Blessure inguérissable qui divise/ Dans le fleuve de tout à travers tout/ De son caillot, comme un chiffre de mort,/ L’afflux étincelant des vies obscures ?
Au moment où il écrivait, dans sa maison de Valsaintes, une première version de ces deux séquences initiales du livre, Yves Bonnefoy apprit la mort d’un des êtres pour lesquels il éprouvait le plus d’estime et d’affection, Boris de Schloezer, philosophe, traducteur de Chestov et musicologue éminent. Cette mort vient s’inscrire dans le fleuve du poème, et les eaux en sont brûlées d’énigme.
La deuxième séquence, Dans le leurre du seuil, fut écrite – il faut le noter – en rupture de toute forme classique, et du vers, et de la strophe, comme pour indiquer, déjà par ce signe extérieur, que là sera le moment d’une « crise ». D’emblée, elle nous frappe, au sens propre, par une syllabe de violence impérative : Heurte, aussitôt répétée et prorogée : Heurte à jamais. La mort est passée, le nautonier a fait déraper sa barque dans le cours du fleuve. On peut toujours heurter dans l’espoir d’un au-delà : on est dans le leurre du seuil. Quant à la porte, elle est scellée. Tel un Lancelot, chevalier pécheur qui, par trois fois, pourrait s’éveiller au mystère du Graal, mais reste prisonnier de son sommeil, l’homme, ici sous la figure du poète, reste sourd, immobile et ne se lève. Se récuse ainsi la quête métaphysique, se réaffirme l’irréductibilité de l’immanence. Mais cela, l’homme ne le voit même pas, si fascinant pour lui est le leurre. Ensommeillé, bien qu’il reste à veiller /À sa table, parmi les lueurs et les signes, englué du leurre, l’homme ne peut plus voir le vrai lieu, qui s’est effacé sous l’illusion d’un au-delà, dans le leurre du seuil ; la présence est de nouveau perdue. À ce stade de l’œuvre, on pourrait désespérer du langage et de la poésie. Le vers s’est fait bref et tranchant : À la phrase, vide. […] Dans le langage, noir. Le langage, qui ne peut conduire à un quelconque dépassement du monde, se découvre à présent incapable même d’approcher les vérités de l’ici et du maintenant. Dans les livres précédents, il était porteur de présence. Mais il n’est plus, lui aussi, qu’un leurre. (Un quart de siècle plus tard, Bonnefoy n’en viendra-t-il pas à parler du leurre des mots, dans son livre, Les Planches courbes ?).
Les cinq autres séquences, par lesquelles ce grand livre se poursuit et s’achève, renaissent à la présence. Et c’est au prix, cette fois, d’une descente acceptée vers les humbles réalités de la vie : le poème se retrouve comme libéré des essences ; il est descendu de son « théâtre mental », selon l’expression de Jaccottet, pour dire et redire, dans une forme d’ailleurs litanique, son immense acquiescement à l’immanence : Oui, je consens. Un consentement à la terre presque rilkéen foisonne dans un lieu, dans une saison ; et voici que, par un nouveau et brusque retournement de la perspective, Bonnefoy n’hésite pas à se situer dans la certitude du seuil. Mais s’il répète plusieurs fois : Je crie, c’est un cri d’émerveillement, non de triomphe. Il connaît trop, en lui-même, la misère du sens ; bien qu’il voie une avancée/ Dans les mots consentants, il sait la puissance nocturne, sa sourde menace sur le fleuve de notre vie : la nuit/ Nous frôle même là d’une aile insue/ Et trempe même là son bec, dans l’eau rapide. Le livre se clôt comme sur un intervalle cosmique.
Si la présence perdue a pu ainsi, à la fin de ce livre, se retrouver présence qui s’assemble, qui se disperse, cet infini […] dans la flaque brève ne sera présence que fragile – fragilisée en tout cas, pour tout le reste de l’œuvre, par la « crise » dont le poème Heurte,/ Heurte à jamais aura révélé l’évidence. Et pas moins de douze années s’écouleront avant la publication d’un autre livre de poésie : Ce qui fut sans lumière. Ces années-là seront largement occupées par ce que Bonnefoy a appelé les Récits en rêve, au premier rang desquels le très troublant Rue Traversière. Au fil de ces récits oniriques, que les limites de notre analyse ne permettent que d’effleurer, apparaissent certains signaux et, parmi eux, ceux d’une hantise particulière qu’il est tentant de rapporter à la perception d’un effacement. Cette Rue Traversière, où se brouillent tous les repères si précis de la mémoire d’enfance, on n’arrive même plus à décider s’il faut la situer à l’ouest ou à l’est de la ville. Son nom s’est effacé du plan que l’on consulte avec une sourde angoisse. Son livre est celui d’un temps qui s’efface en lumière : On attend. Rien ne deviendra plus, dans la clarté immobile […] dans le crépuscule des fleurs, des fruits, comme un reste de temps, qui s’évapore. Ou bien, c’est d’une peinture presque éteinte que renaissent des soleils : Je levai les yeux sur la vieille fresque, si ruinée, si fragmentée par les failles de l’érosion des couleurs, des formes, que la ruine, en cet instant d’avant l’effacement absolu, semblait, changée de signe, irradiante, une écriture dans l’écriture […] comme mille soleils relancés par mille miroirs. La hantise de l’effacement peut même devenir telle qu’elle atteint jusqu’aux mots du discours avec cette conclusion désespérée du récit onirique, intitulée Du signifiant : Le premier mot, c’était « la nuée », le second « la nuée » encore, le troisième, le quatrième, etc., [...] Mais déjà le septième se déchirait, s’effaçait, ne se distinguait plus du déchirement, de l’effacement d’autres plus bas, d’autres à l’infini, [...] presque une poudre, blanche, qu’on remuait, vainement, dans ce grand sac de toile grossière, ce qui restait du langage.
Dans le livre paru en 1987 sous un titre – Ce qui fut sans lumière – ne laissant aucun doute quant à l’épaississement d’ombre et d’inconnu qui entoure l’avancée du poème, plusieurs textes, parmi les plus beaux et les plus chargés de sens, disent un effacement tragique : avec le poème intitulé "Le souvenir", la présence s’éloigne qui ne fut que pressentie/ Bien que mystérieusement tant d’années si proche. Un adieu de profonde mélancolie monte vers elle, image impénétrable qui nous leurra/ D’être la vérité enfin presque dite.
Et l’obsession de l’effacement poursuit, dans le cours de ce livre, une œuvre inexorable où va, tout d’abord Se déjointer dans l’énigme du temps/ L’être de la présence et de la promesse ; où ne subsistera ensuite, parmi les ronces et le chant du grillon d’été, Que le rien qui griffe le rien dans la lumière ; où le poète enfin ne pourra que s’écrier : […] Et poésie, si ce mot est dicible, / N’est-ce pas de savoir, là où l’étoile / Parut conduire mais pour rien sinon la mort, / Aimer cette lumière encore ? Aimer ouvrir / L’amande de l’absence dans la parole ?
Viendra alors ce que Bonnefoy nomme la grande neige (dans un livre publié en 1991, Début et fin de la neige) et dont il fait le vœu qu’elle lui soit à la fois le tout, le rien. Neige de l’effacement qui recouvre et assourdit le sens, comme dans le très beau récit-poème Hopkins Forest. Bonnefoy livre d’ailleurs un aveu dans la beauté de dénuement du dernier poème de Début et fin de la neige : cette neige image ce qui n’a/ Pas de nom , pas de sens et à quoi il en est venu à attacher toute sa pensée.
Avec le livre La Vie errante, publié en 1993, les occurrences du sentiment d’effacement se font de plus en plus nombreuses. On y retrouve, d’abord, ce qu’avait annoncé Rue Traversière dans sa chute, déjà citée, Du signifiant, ce qu’avait repris aussi le poème Hopkins Forest dans Début et fin de la neige, c’est-à-dire ce rêve devenu quasi-obsessionnel d’un livre dont s’effaceraient le sens, le texte, les mots et jusqu’aux signes. On lit encore, dans le parcours d’une prose intitulée Paysage avec la fuite en Égypte : […] J’ai fait un rêve, cette nuit qui vient de finir. Quelque part, […] je fais une lecture publique. Et voici que soudain dans mon propre livre je lis un mot dont le sens m’est inconnu, puis des phrases que je sais bien que je n’ai jamais écrites, et qui d’ailleurs n’offrent pas de sens. Après quoi c’est le livre lui-même qui n’est plus devant moi, et tout se brouille. […]
Bonnefoy exprime aussi cette obsession, et de façon saisissante, par la figure allégorique des raisins du peintre Zeuxis auxquels, dans ces années, il consacre pas moins de trois suites, toutes reprises dans La Vie errante : Un sac de toile mouillée dans le caniveau, c’est le tableau de Zeuxis, les raisins, que les oiseaux furieux ont tellement désiré, ont si violemment percé de leurs becs rapaces, que les grappes ont disparu, puis la couleur, puis toute trace d’image en cette heure du crépuscule du monde où ils l’ont traîné sur les dalles. Il nous est dit encore que ce Zeuxis-Bonnefoy peignait en se protégeant du bras gauche contre les oiseaux affamés, mais c’était peine perdue ; alors, Il inventa de tenir, dans sa main gauche toujours, une torche qui crachait une fumée noire, des plus épaisses ; les oiseaux dévoraient les raisins de plus belle ; pour tenter de ruser contre le prodige de cet effacement, Il inventa de peindre dans le noir, mais c’était sans plus de résultat. Bonnefoy dévoile enfin l’issue tant redoutée pour l’art et, bien entendu, pour toute poésie de notre temps : Il inventa de ne plus peindre, de simplement regarder, à deux pas devant lui, l’absence des quelques fruits qu’il avait voulu ajouter au monde. Et plus loin, il interroge amèrement : Pourquoi en vient-il à désirer de cesser de peindre ? Et même, qu’il n’y ait plus de peinture ?
Un doute radical s’est donc emparé du poème. Le texte donne visage à son propre néant, comme dans cette prose où la grande image divine n’est plus qu’une motte de terre molle dont on refait une boule. Bonnefoy recourt encore à la fable philosophique d’une civilisation héritière d’un art classique, mais qui désormais refuse les statues : Elle n’avait que des socles vides où parfois on faisait un feu que courbait le vent de la mer. Les philosophes disaient que c’est là, ces emplacements déserts, les seules œuvres qui vaillent : assumant, parmi les foules naïves, la tâche d’inexister.
Comme ils paraissent loin de toute présence, ces socles vides, ces emplacements déserts ! La présence se serait-elle réfugiée dans l’image, offerte par le poète, de ce feu courbé sous l’air marin ? La question mérite d’être posée, car la même image va parcourir un long et admirable poème de La Vie errante, intitulé "De vent et de fumée". Lors de sa première parution, ce poème avait pour titre "Une Hélène de vent et de fumée". Car c’est la figure légendaire d’Hélène de Troie – envisagée non seulement à partir du référent homérique ou de ses traductions picturales (notre tableau du Louvre, par Le Guide, est expressément évoqué), mais dans l’origine même du désir de Pâris pour la jeune femme de chair – qui s’efface par les degrés d’une métamorphose dans le travail de l’imaginaire et devient statue de vent, puis fumée.
Comment mieux dire qu’avec la figure, ou l’Idée, ou le concept, le risque, à chaque instant, est de manquer la présence, c’est-à-dire cette révélation mystérieuse de l’être du monde – ces à-coups d’étincellement de la nuée – ces sons de plus bas que [l]es cordes ? Hélène se dissipe dans la fumée des remparts de Troie. Un enfant sur la plage est le dernier à l’avoir entrevue ; sa vision nous enseigne l’incertaine mémoire, la troublante origine, l’inachevable de toute œuvre.
Ce n’est probablement pas un hasard si l’un des plus beaux poèmes de Georges Séféris, écrit en 1938 et 1940, lui aussi dans la fascination d’une origine homérique, a inspiré à Yves Bonnefoy le texte éblouissant d’un essai, paru en 2000 dans un ouvrage collectif, Le Mythe en littérature, et intitulé Le Nom du roi d’Asiné. Ce prince, qui serait enfoui dans l’oubli le plus total si l’incertaine mention de son nom dans l’Iliade n’était venue le ranger parmi les combattants ligués autour d’Agamemnon, Séféris, en témoin de toute une tradition hellène menacée de submersion, le recherche dans le paysage désert de lumière et d’ombre du promontoire égéen qui fut son royaume. Et le roi est là, présence unitaire et regard de masque mycénien dans le rocher brûlé de soleil et de vent ; puis la roche sonne le creux d’une jarre antique, et le roi s’efface. Une chauve-souris, sortie effarée d’une grotte, se brise sur le bouclier solaire. Est-ce le roi ? Bonnefoy s’est livré à une analyse en profondeur, à laquelle nous ne pouvons que renvoyer : non seulement elle éclaire d’un jour pénétrant la démarche du grand poète grec, mais surtout, à nos yeux, elle vient confirmer tout ce que l’œuvre de Bonnefoy lui-même, notamment dans les vingt dernières années, a pu devoir à ce sentiment si fort d’une présence malgré tout maintenue sur le bord extrême où les forces de négativité du destin humain voudraient l’effacer vers le vide.
Et, au fil des nouvelles pages que nous apporte le livre le plus récent, Les Planches courbes, – l’un des plus beaux, assurément, et des plus attachants, dans la permanence d’une œuvre aussi vaste et dans cette fidélité exemplaire au vrai lieu que n’aura pas altérée, mais seulement approfondie, le passage du temps –, comment ne pas reconnaître et partager, une fois de plus, la force de désir, l’élan, que l’on dirait presque mystique, de ce poète vers cette présence-absence mystérieuse et essentielle ? Il nous la fait aujourd’hui retrouver, peut-être encore plus émouvante parce que voix lointaine plus proche que jamais, au seuil du leurre des mots, et c’est l’être même, avec le poème, et résorption du poème au sein de l’être : Écoute, dirait-elle, les mots se taisent,/ Leur son n’est plus qu’un bruit, et le bruit cesse.
Enfin, s’adressant à la poésie elle-même comme chance de salut pour ce monde, il parvient, à l’heure où doivent être relevés les défis du nihilisme contemporain, à fonder une confiance, à affirmer une certitude nouvelle :
[…]
Et si demeure
Autre chose qu’un vent, un récif, une mer,
Je sais que tu seras, même de nuit,
L’ancre jetée, les pas titubants sur le sable,
Et le bois qu’on rassemble, et l’étincelle
Sous les branches mouillées, et, dans l’inquiète
Attente de la flamme qui hésite,
La première parole après le long silence,
Le premier feu à prendre au bas du monde mort.
Paul FARELLIER
(Revue Les Hommes sans Epaules n°13, 2004).
Œuvres d’Yves Bonnefoy
Poésie, récits :
Traité du pianiste (La Révolution, la nuit, 1946)
Anti-Platon (1947)
Du mouvement et de l’immobilité de Douve, Mercure de France, 1953
Hier régnant désert, Mercure de France, 1958
Pierre écrite, Mercure de France, 1964
L’Arrière-pays, Skira, 1972
Dans le leurre du seuil, Mercure de France, 1975
Rue Traversière, Mercure de France, 1977
Poèmes 1947–1975, Mercure de France, 1978
Là où retombe la flèche, Mercure de France, 1986
Ce qui fut sans lumière, Mercure de France, 1987
Récits en rêve, Mercure de France, 1987
La Vie errante, suivi de Une autre époque de l'écriture, Mercure de France, 1993
Début et fin de la neige Mercure de France, 1995
Le théâtre des enfants, récits, William Blake et Cie, 2001
Le Cœur-espace, Farrago, 2001
Les planches courbes, Mercure de France, 2001
Remarques sur l’horizon, Raynald Mettraux, 2003
Le Désordre, Éditart, 2004
Alès Stenar, Éditart, 2005
Une variante de la sortie du jardin, William Blake, 2007
Le Traité du pianiste et autres écrits anciens, Mercure de France, 2008
Le Grand Espace, Galilée, 2008
Aller, aller encore, Éditart, 2008
La longue chaîne de l’ancre, Mercure de France, 2008
Deux scènes et notes conjointes, Galilée, 2009
Raturer outre, Galilée, 2010
L'heure présente, Le Mercure de France, 2011
Le Digamma, Galilée (2012)
L’heure présente et autres textes, Gallimard, 2014
Ensemble encore suivi de Perambulans in noctem, Mercure de France, 2016
L'écharpe rouge, Mercure de France, 2016
Essais :
Peintures murales de la France gothique, Paul Hartmann, 1954
L’Improbable, Mercure de France, 1959
Arthur Rimbaud, Le Seuil, 1961
La Seconde Simplicité (1961)
Un rêve fait à Mantoue, Mercure de France, 1967
Rome, 1630 : l'horizon du premier baroque, Flammarion, 1970
L'Ordalie, Mercure de France, 1975
Le Nuage rouge, Mercure de France, 1977
Trois remarques sur la couleur (1977)
L'Improbable, suivi de Un rêve fait à Mantoue, Mercure de France, 1980
Entretiens sur la poésie, Mercure de France, 1980
La Présence et l'Image (leçon inaugurale au Collège de France), Mercure de France, 1983
La Poésie et l'Université, Éditions universitaires, 1984
La petite phrase et la longue phrase, TILV, 1994.
La vérité de parole, Mercure de France, 1988
Sur un sculpteur et des peintres, Plon, 1989
Alberto Giacometti, biographie d'une œuvre, Flammarion, 1991
Alechinski, les traversées, Fata Morgana, 1992.
Remarques sur le dessin, Mercure de France, 1993
Palézieux (1994), avec Florian Rodari
Dessin, couleur et lumière, Mercure de France, 1995.
La Journée d’Alexandre Hollan, Le Temps qu’il fait, 1995
Théâtre et poésie: Shakespeare et Yeats, Mercure de France, 1998
Lieux et destins de l’image, Le Seuil, 1999
La communauté des traducteurs, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000
Baudelaire : la Tentation de l’oubli, BNF, 2000
Keats et Leopardi, Mercure de France, 2000.
L’enseignement et l’exemple de Leopardi, William Blake, 2001
Breton à l'avant de soi, Farrago, 2001
Poésie et architecture, William Blake, 2001
Sous l’horizon du langage, essais, Mercure de France, 2002.
Remarques sur le regard, Picasso, Giacometti, Morandi, essais, Calmann-Lévy, 2002
Le nom du roi d’Asiné, essai, Virgile, 2003.
La hantise de Ptyx, William Blake et Cie, 2003
Le poète et le « flot mouvant des multitudes », BNF, 2003
Le Nom du roi d'Asiné, Virgile, 2003
L’arbre au-delà des images, avec Alexandre Hollan, William Blake, 2003
Baudelaire, Goya et la poésie, entretien avec Jean Starobinski, La Dogana, 2004
Feuillées, avec Gérard Titus-Carmel, Le Temps qu’il fait, 2004
Le sommeil de personne, William Blake et Cie, 2004.
L’imaginaire métaphysique, Le Seuil, 2006
La Stratégie de l’énigme, Galilée, 2006
Goya, les peintures noires, Bordeaux, William Blake & Co, (2006)
Dans un débris de miroir, Galilée, (2006)
Le Secret de la Pénultième, Abstème et Bobance, 2006
L’Alliance de la poésie et de la musique, Galilée (2007)
Ce qui alarma Paul Celan, Galilée (2007)
Raymond Mason, la liberté de l’esprit, Galilée, 2007
La Poésie à voix haute, La Ligne d'ombre (2007)
L’amitié et la réflexion, Presses Universitaires François Rabelais, 2007
Notre besoin de Rimbaud, Seuil (2009)
La Communauté des critiques, Presses universitaires de Strasbourg, (2010)
Pensées d'étoffe ou d'argile, Coll. Carnets, L'Herne (2010)
Genève, 1993, Coll. Carnets, L'Herne (2010)
La Beauté dès le premier jour, Bordeaux, William Blake & Co (2010)
L'Inachevable, Entretiens sur la poésie, 1990-2010, Albin Michel (2010)
Le Lieu d'herbes, Galilée (2010)
Le Siècle où la parole a été victime, Mercure de France, (2010)
Sous le signe de Baudelaire, Gallimard, (2011)
Plusieurs raisons de peindre des arbres, avec Agnès Prévost, Éditions de Corlevour (2012)
Traduction de Pétrarque, Je vois sans yeux et sans bouche je crie, Galilée, 2012
Orlando furioso, guarito. De l'Arioste à Shakespeare, Mercure de France (2013)
L'Autre Langue à portée de voix, Le Seuil (2013)
Portraits aux trois crayons, Galilée (2013)
Le Graal sans la légende, Galilée (2013)
Shakespeare : Théâtre et poésie, Gallimard, 2014
Le siècle de Baudelaire, Le Seuil, 2014
Poésie et photographie, Galilée, 2014
L'Hésitation de Hamlet et la décision de Shakespeare, Seuil, 2015
La Poésie et la gnose, Galilée, 2016