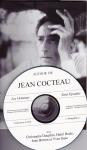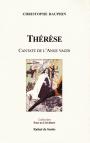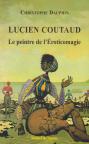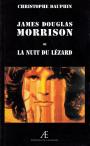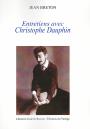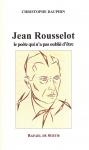Collection Les HSE
Pour un soleil de femmes 1
Chroniques d’un soleil de combats en poésie de Lucie Delarue Mardrus à Claude de Burine
Christophe DAUPHIN
Essai
ISBN : 9782912093905
522 pages -
15 x 21,5 cm
25 €
- Présentation
- Presse
- Du même auteur
Les deux volumes de Pour un soleil de femmes, forment une contre-histoire de la poésie contemporaine. Un soleil aux 42 rayons de femmes qui invitent à des rencontres et des voyages dans le temps (du tout début du XXe siècle à nos jours), dans différents pays (de la France à l’Iran, en passant par l’Espagne, l’Arménie, le Bangladesh, l’Ukraine, le Liban ou la Palestine), à partir de leurs œuvres-vies. Poètes pour la plupart, mais pas seulement, elles embrasent et embrassent autant d’époques que de contrées, de rêves que de réalités et de combats.
Ce tome 1 présente vingt-deux portraits de femmes, de la chronique à l’essai. Il s’intéresse à l’essor de la femme en littérature et en poésie, aux combats difficiles menés par celle qui, en 1901, a choisi de prendre son destin en mains, de ne plus laisser à l’homme le soin de l’écrire à sa place et qui, parallèlement à l’œuvre, et même parfois en son sein, s’engage dans la lutte contre les injustices, les inégalités.
Parmi les visages proposés, Lucie Delarue-Mardrus s’affirme comme une éclaireuse, alors que sa payse normande Thérèse Martin est, elle, écrasée par le poids de la religion.
Le chapitre suivant est consacré aux femmes du surréalisme : Jeanne Bucher, Nusch Eluard, Suzanne Césaire, Gisèle Prassinos, Madeleine Novarina, Joyce Mansour, Virginia Tentindo, Annie Le Brun. Le surréalisme a élaboré une méthode permettant de réaliser le projet de Rimbaud : changer la vie ! En premier lieu, changer l’homme, accroché médiocrement au rocher de sa logique. En lui s’étendent de vastes océans inexplorés à sillonner d’urgence, comme le rêve ou l’inconscient, les territoires de l’imaginaire. Aucun autre mouvement artistique n’a davantage mis en valeur la femme que le surréalisme. Les femmes en son sein sont nombreuses. « Si nous nous mettons encore à genoux devant la femme, c’est pour lacer son soulier », affirme André Breton, dès 1920.
Il en va de même avec les femmes de la Poésie pour vivre, Renée Brock, Thérèse Plantier, Thérèse Manoll, Cécile Miguel, Alice Colanis, Maria Breton, Jocelyne Curtil, Jacquette Reboul, Francesca Caroutch, Janine Magnan, Marie-Christine Brière & Claude de Burine. Chez elles, la poésie n’est pas considérée comme un « genre » littéraire. L’écriture de nos poètes ne triche ni avec la vie ni avec l’être. Leurs mots ne sont jamais secs, mais gorgés de poésie vécue.
Lectures :
La Contre-histoire féministe de la poésie contemporaine de Christophe Dauphin
Dans ce premier tome de Pour un soleil de femmes 1, Chroniques d’un soleil de combats en poésie de Lucie Delarue-Mardrus à Claude de Burine (Les Hommes sans Épaules, 522 p., 25 €) de Christophe Dauphin, « il est question avant tout de poésie », surtout celle « issue du surréalisme et de la Poésie pour vivre ». Il ne s’agit pas de revendiquer une poésie féminine qui s’inscrirait dans un genre mais d’évoquer, dans leur expression artistique et dans leur vie, des poètes qui sont des femmes, avec la sensibilité qui leur est propre. Son ambition : écrire « une contre-histoire féministe de la poésie contemporaine ».
Les textes ici rassemblés ne s’inscrivent pas dans une démarche linéaire. Certains tiennent du portrait ou de la chronique, d’autres relèvent de l’essai. Mais tous mettent en avant la capacité de résistance de ces femmes et leur combattivité pour s’imposer dans un monde qui fut longtemps l’apanage des hommes. Parfois mal connues, elles méritent d’être découvertes ou redécouvertes, quels que soient le pays d’où elles viennent et le métier qu’elles exercent.
On y rencontre des militantes des droits civiques, des syndicalistes, des journalistes, des peintres, des sculpteurs, des comédiennes, des cinéastes, des enseignantes, et d’autres encore. Christophe Dauphin, qui est par ailleurs poète, essayiste, critique littéraire et directeur de la revue Les Hommes sans Épaules, les a réparties par souci de cohérence en trois chapitres distincts.
Le premier, « L’odeur de mon pays était dans une femme », a pour thème Lucie Delarue-Mardrus, l’une des incarnations, avec Anna de Noailles, Renée Vivien et Marie de Régnier – décrites en quelques courts portraits –, de ce qu’on a pu appeler le « romantisme féminin », et la mystique Thérèse Martin, plus connue sous la désignation de sainte Thérèse de Lisieux dont l’auteur fait une victime de l’action cléricale et du mythe construit autour d’elle après sa mort : « Mon intention est ici de désencarméliser et de réhumaniser Thérèse, loin du Carmel où son être fut livré à un “jeu de massacre” ».
Mais si la vie de ces deux femmes nous est contée dans ses moindres détails, c’est aussi tout un regard critique et très documenté que Christophe Dauphin développe sur la place des femmes à la Belle Époque et sur leurs tentatives d’émancipation sous l’impulsion d’idées nouvelles, comme celles du saint-simonien Prosper Enfantin, de Charles Fourier, de Flora Tristan et d’autres, qui ont été des précurseurs. Relatant les amours sous toutes leurs formes de Lucie Delarue-Mardrus, il nous fait voyager, et ce n’est pas le moindre intérêt de ce livre, dans les méandres du contexte littéraire passionné et turbulent de l’époque, faisant surgir du passé des figures célèbres ou aujourd’hui oubliées, proches notamment du décadentisme, du symbolisme, de La Revue blanche.
Dans le deuxième chapitre, « Si vous aimez le surréalisme, vous aimerez la femme », l’auteur évoque quelques-unes des plus belles figures artistiques féminines de ce mouvement libérateur qui s’imposa comme le plus important courant de pensée – et comme une manière de vivre en poète – de cette première partie du XXe siècle et dont l’esprit persiste aujourd’hui plus ou moins souterrainement. Cela n’allait pas forcément de soi, en ces Années folles qui portaient encore la marque des préjugés. Chez les surréalistes de ce temps-là, la femme, à la fois charnelle et sublimée, faisait l’objet d’un véritable culte que l’on peut qualifier de magique.
N’était-elle pas la source d’inspiration de leurs plus beaux textes, d’André Breton à Paul Éluard ? Mais si l’on savait célébrer la beauté, on ne reconnaissait pas toujours le talent, nous dit en substance Christophe Dauphin, d’où une certaine frustration chez celles qui se sentaient l’âme créatrice. Si elles voulaient se faire reconnaître comme poètes, indépendamment de toute notion de genre, c’est en produisant des œuvres fortes et originales qui n’ont rien à envier à celles des hommes, à l’instar de celles de Joyce Mansour ou de Gisèle Prassinos, présentes dans ce livre, aux côtés de Jeanne Bucher, Nusch Éluard, Suzanne Césaire, Madeleine Novarina, Virginia Tentindo et Annie Le Brun, en quelques courtes biographies.
Tout en nous confiant de captivantes anecdotes qui éclairent la vie de ces femmes, l’auteur se penche d’une manière approfondie et originale sur leurs œuvres, avec des extraits et des citations, restituant la place qui leur est due dans le mouvement surréaliste et même ailleurs.
Le troisième chapitre, « Les femmes de la poésie pour vivre », se réfère à Jean Breton qui défendit naguère, dans un manifeste écrit avec Serge Brindeau, une poésie de « l’homme ordinaire », aussi éloignée « de la prétention raffinée des mandarins que d’un populisme de pacotille » : l’émotion avant tout, dégagée d’un intellectualisme étroit et cherchant à « réveiller le poète derrière sa poésie ».
Cette partie, qui est appelée à une suite dans le tome 2, relate, avec le même souci du détail biographique et d’un regard d’une grande acuité sur les œuvres, les combats de ces femmes – que la revue Les Hommes sans Épaules aura contribué à faire reconnaître – pour exister en littérature et en poésie. Elles s’appellent Renée Brock, Thérèse Plantier, Thérèse Manoll, Cécile Miguel, Alice Colanis, Maria Andueza Breton, Jocelyne Curtil, Jacquette Reboul, Francesca Yvonne Caroutch, Janine Magnan, Marie-Christine Brière et Claude de Burine. Les conjoints ne sont pas oubliés et l’on retrouvera avec intérêt, dans leurs œuvres vives, Michel Manoll, André Miguel ou Jean Breton.
Comme l’écrit Christophe Dauphin : « Les deux volumes de “Pour un soleil de femmes” forment une contre-histoire féministe de la poésie contemporaine, par le biais d’un soleil aux 41 rayons de femmes, qui invitent à des rencontres et des voyages dans le temps (du tout début du XXe siècle à nos jours), dans différents pays (de la France à l’Iran, en passant par l’Espagne, l’Arménie, le Bangladesh, l’Ukraine, le Liban ou la Palestine), à partir de leurs œuvres-vies. »
Alain ROUSSEL (in en-attendant-nadeau.fr, 3 février 2026)
*
"Les deux volumes de Pour un soleil de femmes, forment une contre-histoire de la poésie contemporaine!"
Electre, 2025
*
Avec Pour un soleil de femmes 1, Chroniques pour un soleil de combats en poésie, de Lucie Delarue-Mardrus à Claude de Burine, Christophe Dauphin rédige une véritable contre-histoire féministe de la poésie contemporaine en rétablissant les femmes, corps, âme et esprit, à leur place, autour de la grande table solaire de l’art. Elles sont 41, conviées enfin au festin souvent frugal de la création, 22 dans ce premier volume.
Elles ont pour noms :Lucie Delarue-Mardrus, Thérèse Martin, Jeanne Bucher, Nusch Eluard, Suzanne Césaire, Gisèle Prassinos, Madeleine Novarina, Joyce Mansour, Virginia Tentindo, Annie Le Brun, Renée Brock, Thérèse Plantier, Thérèse Manoll, Cécile Miguel, Alice Colanis, Maria Breton, Jocelyne Curtil, Jacquette Reboul, Francesca Caroutch, Janine Magnan, Marie-Christine Brière & Claude de Burine. Elles sont femmes du surréalisme ou d’ailleurs, de littérature ou de poésie, de lettres et de l’être.
« Les textes consacrés à nos soleils sont de longueur inégale et vont de l’essai au portrait, en passant par la chronique. Ils sont inédits mis à part certains extraits qui ont paru en revues ou dans des magazines. Ils ont été écrits séparément les uns des autres, sans le souci de constituer un livre. Cela explique les absences, que certain(e)s pourraient déplorer, d’« icônes » du féminisme ou de la création. Dresser un tel panorama n’est pas notre dessein, mais nous ne perdons pas au change, avec les femmes dont il est question ici, qui méritent d’être découvertes ou redécouvertes. »
Cet hommage, amoureux, n’exclut pas la lucidité sur le talent, le rayonnement, l’influence bienfaisante comme sur les combats que chacune, en son propre style, a dû mener, bien souvent contre les hommes qui disaient les aimer ou prétendait les protéger, d’elles-mêmes bien sûr. « Le combat fut long, constate Christophe Dauphin, pour que la femme s’écrive elle-même. »
Cette contre-histoire de la littérature, de la poésie et de l’art, si nécessaire, éclaire l’histoire tout court.
Chaque femme est absolument unique, un univers impossible à cerner mais que Christophe Dauphin cherche à révéler avec respect, éclairant des recoins inconnus où sont dissimulés des trésors. Leurs mondes croisent tous les mondes, ceux de la banalité à l’horreur, ceux de la beauté, du secret et de l’amour. Les découvrir c’est aussi nous découvrir. La poésie féminine porte la fonction philosophique de l’interrogation des évidences. Les entendre, c’est traverser les formes accoutumées pour accéder aux champs de la liberté car elles sont à la fois du centre et des marges, elles voient au plus près, la peau, et au plus loin. Elles ne sont pas seulement poètes par leurs textes, elles le sont par leurs vies dont elles font tantôt un champ de bataille, tantôt un laboratoire alchimique, tantôt une œuvre d’art.
Christophe Dauphin n’écrit jamais sans faire coïncider l’intention et l’accomplissement. Ce livre est important, il ne fait pas seulement œuvre de réparation ou de réhabilitation, il découvre, dévoile, laisse le temps et l’espace au féminin, aux féminins, car ils sont innombrables. Il invite au retournement.
Rémi BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, 4 novembre 2025).
*
Voici un moment que je m’étais promis de parler de ces deux livres. Le livre d’Odile Cohen-Abbas, « Christophe Dauphin les yeux grands ouverts » (éditions unicité, 2025), qui est un essai sur l’œuvre poétique de Christophe Dauphin, et le dernier essai de ce dernier : « Pour un soleil de femmes 1, Chroniques d'un soleil de combats en poésie de Lucie Delarue-Mardrus à Claude de Burine ».
Encore fallait-il le temps de les lire pour leur rendre justice. Je ne saurais trop vous encourager à découvrir l’inépuisable générosité de Christophe Dauphin, poète, essayiste, éditeur, revuiste, passeur ; son ardeur et sa colère, son exigence et sa formidable capacité à tirer de l’ombre toutes les ressources les plus hétérodoxes, c’est à dire essentielles, du poème. Le volume consacré au « soleil de femmes » est une mine absolue, « contre-histoire féministe de la poésie contemporaine » plein de figures rares animées par les mêmes élans qui sont ceux de Christophe - et les miens : la poésie pour vivre et le surréalisme, unis dans l’émotivisme. Pour en savoir plus, commandez, lisez, découvrez, des mondes s’ouvriront.
Adeleine BALDACCHINO (Le printemps des poètes, décembre 2025).
*
Pour un soleil de femmes 1, Chroniques d’un soleil de combats en poésie de Lucie Delarue-Mardrus à Claude de Burine.
Elles semblaient déjà prêtes à entrer dans ces pages, à y inscrire leur philosophie sensitive, sensuelle, combative et morale. On dirait, de fait, qu’un accord subtil, antérieur, implicite, prédestinait ces femmes du pays normand, ces femmes du surréalisme et ces femmes de la poésie pour vivre, à trouver leur temps de justice, leur reconnaissance, leur blason intellectuel et poétique et leur consécration définitive, entre ces lignes faites d’appels de part et d’autre, des leurs d’abord, vivants, superbement, au-delà de la mort, de l’histoire, des échecs et des réussites, et de celui de Christophe Dauphin qui aspirait profondément, à sa manière intègre et rebondissante, à leur rendre hommage.
Il semble véritablement qu’en amont des travaux de recherche positive, des strates d’échange, de rencontre, de partage, mystérieuses, et une intuition supérieure, aient guidé et prédéterminé la volonté de l’ouvrage. Étranges entrelacements de conjonctions passées et présentes, d’un homme, remué intérieurement, assidument, amoureusement, attelé à sa table d’étude, et d’un flux et reflux de souvenirs historiques. Quel est le lien intime personnel qui relie le poète à cette douce et forte gent féminine ? Quelles rumeurs de l’inconscient, de l’onirique s’insinuent dans ses marges ? Quoiqu’il en soit, Christophe Dauphin marque son œuvre de cette porte authentiquement sculptée de la mémoire.
Elles sont nombreuses, diverses, ces femmes, reliées entre elles par l’époque où les thèmes, mais chacune apparaissant dans sa découpe de lumière et auréolée de son génie individuel.
Le style est frappé d’un sceau d’empathie si véridique, si violent, qu’il semble que l’on ne puisse plus détacher l’empathie de l’écrit, l’amour de l’écriture de l’écriture de l’amour, des formes les plus extrêmes, les plus engagées de la sympathie, dans un livre dont le projet de redonner prophétiquement parole et sens au désir des femmes, est l’épicentre.
Or précisément parce que le sujet traite de cette femme proche et lointaine, il s’agit avant tout de lever quelques résistances ou malentendus, et d’appréhender le présent ouvrage avec une pensée et une sensibilité à neuf. Œuvre d’érudition, assurément, quant à ses qualités d’exigence, de concision, d’abondance de thèses et de documents, mais d’une érudition qui ne se borne aucunement à une forme abstraite, spéculative – donnant lieu à une nébuleuse de faits à la fois existants et inexistants, objectifs, subjectifs, opérants et inopérants –, mais agissant dans le sens de dégrossir tous les matériaux humains, sociaux, psychologiques, historiques, et de tendre vers une analytique profonde de l’être et de la vie.
Il faut attendre le tout début du XXe siècle, pour assister à l’essor créateur des femmes en littérature comme en poésie.
Voici donc ces femmes qui invitent à des rencontres et des voyages dans le temps (du tout début du XXe siècle à nos jours), dans différents pays (de la France à l’Iran, en passant par l’Espagne, l’Arménie, le Bangladesh, l’Ukraine, le Liban ou la Palestine), à partir de leurs œuvres-vies, en phase d’être délivrées de la forteresse inexpugnable de préjugés où elles étaient enfermées. Ou plutôt voici que Christophe met l’accent, rassemble tous les faisceaux de l’œuvre sur les moyens, les étapes forcenées, héroïques de leur fuite.
Et nous sentons s’inscrire maints stigmates d’indicible amour en nous, maintes blessures et cicatrices miraculeuses au fil des siècles et des situations, comme plongés au sein même de leur évasion. Cette symbiose, cette compassion motrice, identificatrice, allie aux thèmes, aux circonstances factuelles, le substrat si cher au cœur de l’auteur du principe d’« émotivisme » : un serment de foi esthétique, plénière, aboutissant à une transmutation / transfiguration / révélation sensible et émotionnelle du réel.
Et comment parler autrement de ces femmes qui établissent proprement, à travers leurs sens et leur corps et des circonstances si contraires, une métaphysique du courage et de l’héroïsme !
Ces poètes ont ouvert la route à plusieurs générations de femmes. Ne sont-elles pas les grandes aînées des voix féminines majeures de notre temps ? Leur apparition marque indéniablement une évolution dans le rapport des femmes à la carrière littéraire. Leurs textes expriment une perception toute personnelle de la réalité autour du thème central de l’amour et de son rapport avec différents aspects de la vie féminine : l’homosexualité, la maternité, la filiation, la vie professionnelle, le mariage et la sensualité.
De Lucie Delarue-Mardrus à Thérèse Martin, de Jeanne Bucher à Nusch Éluard, Suzanne Césaire, Gisèle Prassinos, Madeleine Novarina, Joyce Mansour, Virginia Tentindo, Annie Le Brun, de Renée Brock à Thérèse Plantier, Thérèse Manoll, Cécile Miguel, Alice Colanis, Maria Andueza Breton, Jocelyne Curtil, Jacquette Reboul, Francesca Yvonne Caroutch, Janine Magnan, Marie-Christine Brière, Claude de Burine - la liste est longue mais il serait offensant d’en oublier une tant leurs beautés, leur force, leur bravoure a dû contenter le Créateur du sixième jour, et c’est pourquoi il faut non seulement lire la liste, mais prononcer chaque nom distinctement – de toutes ces égéries donc, s’érige tout le spectre des possibles féminin.
Qu’il y ait ou non entre elles une communauté de destin, elles semblent toutes sous l’influence d’une injonction intérieure – peut-être eu égard à cette première Eve subversive, à ce féminin originel libre antérieur à toutes conditions – qui les pousse d’une part à accomplir chimiquement, intellectuellement leur individuation, mais aussi sur le plan social et collectif à réaliser ce qu’impliquait d’appartenir à leur genre : un combat pour révéler cette femme millénaire, pour aider cette part la plus douée et la plus rétractile d’elles-mêmes que les instances familiales et institutionnelles avaient laissé délibérément s’étioler, s’atrophier, pour l’aider à naître, à s’extraire et légitimer totalement, honorifiquement, cette naissance et cette haute extraction.
De la nature de cet honneur, Christophe Dauphin a pleinement conscience. La tâche immense dont il s’est investi – le cœur y est tant que tout nous semble de bon aloi – corroborant ses propres valeurs, et sa profonde considération d’autrui, sa tâche va dans ce sens de restaurer ou d’établir cette dignité et cette unité féminines dont l’absence entrainerait, n’a pu entrainer jusque là que douleur, trouble et dissociation. Car c’est sans doute sous la menace d’une mort psychique évidente, d’une implacable mort aux trousses psychologique que ces femmes ont dû accomplir tenacement, témérairement, la particularité de leur destin. Cette convergence de causes, comme s’il n’existait en vérité qu’une seule estime glorieuse dans son rapport à soi et au monde, une seule tacite et nécessaire dignité, fait de ces pages un grand livre qui rehausse, redore dans un enchantement inaugural, éthique et poétique, notre confiance éprouvée en notre humanité.
Nous attendons le second tome.
Ode à l’espagnole : Maria Andueza Breton !
Lavons les mots dans la rivière de notre vécu,
nous n’avons pas d’autre voie navigable à
notre disposition.
Jean Breton
Premier souvenir : juin 1990. Je traverse l’arrière-cour du 17, rue des Grands-Augustins, à Paris. J’accède au « sanctuaire » du Milieu du Jour éditeur par un petit couloir dont les murs sont des livres de poèmes du sol au plafond. Les livres, une femme est occupée à les ranger, à les classer, avec respect et délicatesse. Elle flotte dans sa blouse bleue trop grande pour elle et ses mains volettent, papillons au-dessus des piles de manuscrits. Elle trie aussi le courrier, en silence, alors que le saxophone de Coltrane s’envole sur plusieurs octaves et réaligne l’horizon sur la corde du Merveilleux. Cette femme qui vient m’accueillir, c’est Maria.
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Épaules, 2025).
*
L’essai de Christophe Dauphin, Pour un soleil de femmes 1, Chroniques d’un soleil de combats en poésie de Lucie Delarue-Mardrus à Claude de Burine, forme une contre-histoire de la poésie contemporaine de presque cinq cents pages. Il ne paraît pas assez long à son lecteur tant il est plongé dans cette fresque littéraire faisant rayonner, pour le tome 1, vingt-deux femmes ayant marqué de façon pérenne le paysage littéraire, artistique voire politique du tout début du XXe siècle à nos jours.
La poésie féminine existe-telle ? Je réponds non. Seule la poésie existe affirme avec ferveur Christophe Dauphin dans son avant-dire à l’œuvre. Si en 1900 l’écriture féminine serait donc une sorte de maladie, un débordement incontrôlable, Dauphin balaie d’un trait de plume ces inepties invalidant la puissance de ces femmes. Il définit et restitue leur juste place dans le champ littéraire, artistique et sociétal commun. Le livre se partage en essais, études fouillées, chroniques, portraits (le lecteur savoure son plaisir), le tout de façon harmonieuse ; chaque rayon de ce soleil, s’il fait partie d’un ensemble auquel il ajoute sa lumière, brille par sa singularité.
Le premier essai est consacré à Lucie Delarue-Mardrus, poète normande née en 1874 L’odeur de mon pays était dans une pomme. Quelle femme ! Quelle énergie ! Conteuse, nouvelliste, poète, romancière, dramaturge, essayiste, Lucie D-M n’a cessé d’écrire. Dauphin émet un parallèle entre son parcours et celui de Françoise Sagan les origines et l’éducation bourgeoise, l’attrait pour le saphisme, passion pour la littérature, la même solitude intérieure, le même parcours en dents de scie pour que chez l’une comme chez l’autre le personnel prenne le pas sur l’œuvre. Mariée (un assez long temps) à Joseph-Charles Mardrus dont le parcours est lié à la vague d’orientalisme, sa princesse amande parcourt et vit en Tunisie (principalement en Krouminie), Egypte…J.C Mardrus est le traducteur réputé des Mille et une nuits, il écrit que pour la traduction une seule méthode existe : la littérarité. Le couple vivra entre autres dans le Pavillon de la Reine à Honfleur.
Lucie D-M rayonne dans son monde, ses rencontres seront multiples et déterminantes, Renée Vivien, Natalie Barney, Germaine de Castro (Chattie), Sarah Bernhardt dont elle porte la bague sertie d’une pierre rouge…Personnage captivant, cette acharnée du travail à l’écriture au naturalisme épuré, a vécu une fin de vie difficile (narrée avec sensibilité), quelque chose de mon âme (à tout jamais perplexe) A fini d’être fleuve et n’est pas encore mer.
Une autre femme, Thérèse Martin, hante Lucie. Le mythe thérésien se fait obsédant, elle écrit en 1926 Sainte Thérèse de Lisieux. Lucie D-M veut retrouver la femme dans la carmélite et donner à son visage une densité perdue. Ainsi le fait Dauphin dans l’essai suivant Les épines des roses tuberculeuses de Thérèse Martin. Son intention est de désencarméliser et réhumaniser Thérèse. Je n’ai rien qu’aujourd’hui écrivait Thérèse, Dauphin dénonce les souffrances subies : écrasement de l’humain, négation de la vie et du monde ponctuée par la maladie (anorexie, crise de délire) l’isolement total. Née pour être un génie, elle est devenue une virtuose du renoncement et de la maîtrise de soi. Son livre Histoire d’une âme (1898) a subi censure et réécriture, pas moins de 7000 retouches dit Six. Celle qui affirmait la foi est toujours celle d’un incroyant qui croit, le long douloureux de sa petite voie, est restée poète.
La deuxième partie Si vous aimez le surréalisme, vous aimerez la femme, est consacré à Jeanne Bucher, Nusch Eluard, Suzanne Cézaire, Gisèle Prassinos, Madeleine Novarina, Joyce Mansour, Virginia Tentindo, et Annie Le Brun. Le portrait de Jeanne Buscher est lié à celui du poète Charles Guérin, il a écrit à son aimée pas moins de 2000 lettres et poèmes. Galeriste, elle expose Picasso, Masson, Max Ernst, de Chirico, Kandinsky, Man Ray et bien d’autres tout en promouvant leurs œuvres à l’international.
Le peintre chilien Roberto Matta dit des femmes qu’elles étaient pour les surréalistes des objets magiques. Ce mouvement littéraire, même si elles étaient davantage considérées comme inspiratrices plus que créatrices, aura mis en avant les femmes et leur extraordinaire pouvoir. Nusch Eluard a été l’inspiratrice du chant éluardien durant dix-sept années écrit Dauphin. Elles étaient nombreuses, bouillonnantes de créativité, flamboyantes, intrépides, à l’érotisme parfois débridé, bouleversantes. Thérèse Plantier reproche cependant à Breton d’avoir traité la femme en objet, Joana Masso, quant à elle, pose cette question terrible : « Elle en pensait quoi de tout cela Nusch de la dépossession de son corps ? ». Suzanne Cézaire était poète et essayiste. Elle a collaboré à la revue Tropiques, au sein de cette revue, elle n’est pas la femme de…, mais un pilier théorique, un mur porteur, une contributrice de premier plan. Poète, elle se bat pour une « poésie cannibale » et surréaliste en rupture avec la tradition doudouiste des écrits coloniaux.
Dans le portrait suivant, de l’écriture de Gisèle Prassinos, Dauphin écrit Les alliances de mots sont la matrice d’une écriture toujours prête à bifurquer, se laissant aller à la puissance suprême des surréalistes : le hasard. Après cette chronique, l’auteur met à l’honneur la fée précieuse du peintre Saran Alexandrian, Madeleine Novarina.
Suit une étude sur Joyce Mansour, quelle femme, quelle combattante ! Collectionneuse, peintre, poète, Mansour est cela et plus encore, Hubert Nyssen rappelle qu’il est tout à fait sommaire de réduire Joyce Mansour à une érotomane du surréalisme ou même à un ange du bizarre. Pour Dauphin, elle est le soleil du poème.
Sculptrice surréaliste, Virginia Tentindo (qui aura été aussi secrétaire de Philippe Soupault) crée de l’or émotionnel en terre cuite, la juste fascination qu’elle opère sur Dauphin, poète émotiviste, n’en est que plus palpable.
Suit une étude sur Annie Le Brun, femme oh combien singulière, elle clamait la poésie sera subversive ou ne sera pas, elle écrivait avec une belle acuité le surréalisme n’est nullement une avant-garde, il s’agit d’une attitude devant la vie, dont la véritable radicalité aura autant à en refuser la misère qu’à y chercher l’émerveillement. Elle a défendu le lyrisme comme une louve le lyrisme est une façon de voir la beauté en transparence sur ce qui la menace, ou encore stupéfiant rempart passionnel qui protège ce qui vit en l’exaltant. Si elle adhérait au combat pour l’émancipation des femmes, Annie Le Brun n’en était pas moins lucide sur les méfaits d’un collectif oublieux des singularités Etrange libération, qui prive une nouvelle fois les femmes de devenir ce qu’on leur a toujours refusé d’être : des individus.
La partie trois du livre Les femmes de la Poésie pour vivre 1, est consacrée à Renée Brock, Thérèse Plantier, Thérèse Manoll, Cécile Miguel, Alice Colanis, Maria Andueza Breton, Jocelyne Curtil, Jacquelle Reboul, Francesca Yvonne Caroutch, Janine Magnan, Marie-Christine Brière et Claude de Burine.
Régine Deforge écrit à propos de Thérèse Plantier qu’elle est Femme forte au génie baroque et libertaire, elle a combattu avec hargne et beauté Le temps n’est plus aux femmes qui se plaignent. C’est celui du féminisme. Ardente, Thérèse Plantier n’en était pas moins sensible : Celui ou celle qui n’a pas eu la chance de rencontrer la pensée peut devenir, encore que ce soit rare, un artiste, il ne sera jamais délivré.
Dans son Ode à l’espagnole : Maria Andueza Breton, je citerai ces vers de Dauphin disant toute sa tendresse pour la femme qu’elle fut, toute la prépondérance de sa présence C’est aussi Maria en blouse bleue/dépoussiérant l’ombre des poètes. Tous ces portraits (il serait difficile de les évoquer tous) sont captivants, on ne lâche pas le livre.
Oh lire celui de Claude de Burine, il s’apparente à un roman tant sa vie fut tumultueuse et je n’en raconterai pas la fin. Cette femme-personnage est bouleversante. Ce livre vibre de l’amitié de l’auteur pour ces femmes. Non seulement un hommage singulier et appuyé leur est rendu, mais une parfaite connaissance de leur parcours, de leur œuvre, de leur rayonnement enrichit le propos et le rend passionnant à lire. Chaque étude est fouillée. Les rencontres déterminantes ayant jalonné l’existence de ces femmes sont toutes détaillées (même le nom, belle surprise, de Paul Vincensini a éclairé le texte).
Les notes bas de page sont multiples et variées, elles renvoient à des approfondissements historiques, politiques, sociétaux, littéraires. C’est captivant !
Le lecteur comprend d’autant plus la précieuse implication de ces femmes dans et pour leur monde et le nôtre. Le talent de Christophe Dauphin, poète émotiviste, essayiste, membre de l’Académie Mallarmé (siège du poète Robert Sabatier) est ici voué à ces soleils de femmes, la qualité littéraire de l’ensemble est telle que la lecture en est illuminée.
Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix, 2026).