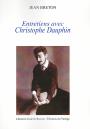Hors Collection
Lucie Delarue-Mardrus, la princesse Amande
Livre numérique
Christophe DAUPHIN
Lucie DELARUE-MARDRUS
Essai
ISBN : 9782372260428
Recours au poème éditeurs
215 pages -
13,5 x 19 cm
- Présentation
- Presse
- Du même auteur
Achat du livre en ligne chez Recours au poème éditeurs:
Christophe Dauphin, Lucie Delarue-Mardrus, la princesse Amande, 215 pages, 8 €.
Les livres numériques Recours au Poème éditeurs peuvent être lus par tout le monde, avec et sans liseuse ou tablette. Un simple ordinateur suffit.
Formats disponibles : epub, mobi, pdf.
Cet essai retrace la vie mouvementée de la poète et écrivain Lucie Delarue-Mardrus, égérie du tout Paris, écrivain monstrueusement célèbre en son temps, femme amoureuse de femmes, féministe originale, épouse du traducteur des Mille et une nuits, en une époque où tout cela n'était guère... bien vu. Lucie Delarue-Mardrus est une très haute figure de la fin du 19e et du début du 20e siècles. Plus de cent pages de poèmes permettent en outre de mesurer la poète que fut Lucie Delarue-Mardrus.
LUCIE DELARUE-MARDRUS, LA PRINCESSE AMANDE
(Extrait)
à mon ami André Albert-Sorel, I. M.
(..) Poète, Lucie Delarue-Mardrus laisse une douzaine de livres et de nombreux inédits. Romancière, elle est l’auteure de plus de quarante romans, recueils de nouvelles et de mémoires. Essayiste et biographe, elle donne une quinzaine de volumes. Lucie Delarue-Mardrus est également l’auteure de pièces de théâtre. Chroniqueuse, traductrice (Edgar Poe, Shelley, Emily Brontë), critique littéraire et musical, conférencière, peintre, auteur de contes, de récits de voyages et de chansons, elle était bien cette « vaillante à entreprendre », qu’évoqua son amie Colette : « Elle avait ce bonheur d’aller à tous travaux avec une fougue conquérante. » Lucie, la « vaillante à entreprendre », sera également sculpteur, musicienne (elle joue du piano et du violon) et compositrice, jurée du Prix Femina, dés sa fondation : elle y défendra Proust, Giraudoux, Bernanos ou Saint-Exupéry. « Il faut l’avoir vue défendre du bec et des ongles un livre qui n’est pas le sien, qui ne procède ni de ses idées, ni de sa manière littéraire, ni de ses convictions morales, ni de ses opinions intimes, mais qui fut seulement écrit par une consœur sympathique et âprement combattue ! C’est parce que je fus témoin d’un de ces ardents plaidoyers, parce que je l’ai entendue bien que lasse, et presque sans voix, puiser dans sa générosité fraternelle des arguments pathétiques dont toute le monde fut ému, que je sais ce que vaut la loyale camaraderie de cette femme », témoigne la romancière Colette Yver (in revue Corymbe n°42, 1938).
Dans l’entourage de Lucie Delarue-Mardrus, gravitent les personnalités de l’époque : Sarah Bernhardt, Auguste Rodin, Claude Debussy, Edmond Rostand, Octave Mirbeau, Marcel Schwob, Maurice Maeterlinck, Laurent Tailhade, Marcel Proust, Sacha Guitry, Paul Valéry, Félix Vallotton, Isadora Duncan, Paul Léautaud, Alfred Jarry, Pierre Louÿs, André Gide, Jean Lorrain, Panaït Istrati, Colette et bien d’autres. Éprise d’absolu, en butte aux déboires sentimentaux, Lucie Delarue-Mardrus fut toujours prête à vivre ses passions avec ferveur, comme l’a rapporté Liane de Pougy dans ses Cahiers bleus : « Elle a de grands regards bien ouverts qu’elle pose sur vous avec ardeur et étonnement… Elle est humaine dans le joli sens du mot, a su réunir autour d’elle quelques dévouements et les êtres qui lui sont voués et dévoués ; elle sait les rendre parfaitement heureux. Elle publie trois romans par an, en feuilletons d’abord puis en volumes. Vous la croyez en train de donner des conférences en Europe centrale et vous apprenez qu’on l’a applaudie à Barcelone. Elle sculpte, monte à cheval, aime une femme puis une autre, et encore une autre. Elle a — heureusement — pu se libérer de son mari et depuis cette expérience n’a jamais entrepris un second mariage ni la conquête d’un autre homme. » Incapable de haïr (« Je ne hais que la haine »), Lucie Delarue-Mardrus méprisait plus que tout le mensonge, l’hypocrisie, les bassesses et la banalité. Lucie Delarue-Mardrus, qui « rayonne la simplicité, en dépit d’un brin de jeune affèterie, et que l’on sent droite, directe, sincère, parce que les années n’ont pas de prise sur elle et qu’elle sera toujours sans âge… Âme sans duplicité, sans calcul, sans fiel, sans détour, sans soupçon, sans mensonge », dira encore Colette Yver, ne pouvait que donner une œuvre mue par la passion ; car, tout est objet de passion, d’émerveillement, chez ce poète, qui se fait une idée toute romantique de sa vocation et éprouve l’impression secrète d’écrire sous la dictée de l’inconnu : J’aimais la nuit comme je l’aime – Comme je l’aimerai toujours – Et tous les jours, l’attendais – Pour être moi-même. Le contrecoup, car il y en a un, se traduit par d’intenses périodes de pessimisme et de mélancolie. Le poète a, en effet, toujours mêlé au fil de ses jours la pensée de sa fin. La mort, qui guette la proie qui ne lui échappera pas, ne pouvait donc pas la surprendre.
L’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus comprend près de quatre-vingts volumes qui, publiés entre 1901 et 1946, rencontrèrent presque tous, du moins les romans, un franc succès, qui devait s’interrompre avec la mort de l’auteur en 1945. Par la suite, on entendit beaucoup moins parler du poète et de ses œuvres, à l’exception de quelques rééditions. L’écrivain d’avant-garde Sarane Alexandrian — qui pourrait paraître éloigné, tout comme moi, de Lucie Delarue-Mardrus, étant donné notre attachement au Surréalisme —, fut pourtant l’un de ceux qui dénoncèrent cette mise au purgatoire : « Depuis sa mort en 1945 à Château-Gontier, on ne parle plus de Lucie Delarue-Mardrus : c’est scandaleux, car elle a autant de valeur que Colette ». Il faut attendre 1994 et la parution d’Une femme de lettres des années folles, d’Hélène Plat, chez Grasset, pour que l’on reparle enfin de Lucie Delarue-Mardrus. Cette biographie, la première consacrée à l’auteure, depuis l’émouvant livre de souvenirs donné par Myriam Harry en 1946, brisa le silence et attira de nouveau l’attention sur ce personnage peu commun. Suivirent la réédition de quelques-unes de ses œuvres, ainsi que des études, des articles, des travaux universitaires, et la création d’une association en 2007 : l’association des amis de Lucie Delarue-Mardrus.
A-t-on redécouvert un grand écrivain ? Pas seulement ; car ce regain d’intérêt repose autant si ce n’est davantage sur la lecture du personnage, que sur celle de son œuvre. L’intérêt que l’on porte aujourd’hui à Lucie Delarue-Mardrus repose sur deux aspects, qui ne sont pourtant que des composantes de sa personne et de son œuvre. Alors que les uns retiennent avant tout le chantre de la Normandie et de Honfleur, c’est-à-dire l’aspect « régionaliste » de sa création, les autres cristallisent le personnage dans le Paris-Lesbos de la Belle Époque, entre Natalie Barney et Renée Vivien, auxquelles elle fut intimement liée. Ces deux visions de Lucie Delarue-Mardrus, pour n’être pas fausses, n’en sont pas moins réductrices. Le personnage et l’œuvre sont bien plus complexes. Lucie Delarue-Mardrus est certes une témoin important de son temps, mais également une auteure prolixe qui s’est exprimée dans diverses formes de création. L’œuvre est abondante et irrégulière, nous l’avons dit. Lucie Delarue-Mardrus était la première à en être consciente, en écrivant : Il faut bien que je vive en prose — Puisque je dois gagner mon pain. — Je n’aurai pas toujours dépeint — Ce que j’avais vu de la rose.
Il n’empêche que sa création recèle des œuvres tout à fait présentes, proches de nous, par une peinture de mœurs sans tricherie, et par une sincérité éclatante. Citons notamment Mémoires (1938) et El Arab (1945), qui rassemblent ses souvenirs de voyages en Orient ; soit deux volumes extrêmement denses, qui constituent aussi ses deux meilleurs récits. Côté fictions, citons entre autres : Le Roman de six petites filles, Comme tout le monde, La Monnaie de singe, L’Ex-Voto (sa plus belle réussite romanesque), L’Acharnée, Hortensia dégénéré, son roman préféré, ou L’Ange et les Pervers. Sur le plan de la prose, une seule femme peut lui être comparée, du moins aux yeux de Jean de la Varende, romancier normand et chantre du Pays d’Ouche (in revue Corymbe n°42, 1938) : « c’est « Katherine Mansfield, car, comme Lucie, Katherine a connu cette glorieuse chance d’avoir à dire, avant de savoir dire ; un maître n’est pas venu lui mettre dans les mains des instruments si perfectionnés que le disciple ne peut réaliser, avec, autre chose que son maître ; nos pédants contribuent à dégoûter du livre : ils font des meubles Henri II, comme les bahuts de salle à manger. Une même enfance de liberté a nourri ces deux jolies filles, que des hommes fins ont à peine corrigée. Mais Lucie est supérieure, heureusement moins artiste, moins décidée à enclore son œuvre. Katherine restreint et Lucie distend. L’une s’anémie et l’autre se colore. Un seul regret : de ne pas avoir senti, au moins une fois Madame Delarue-Mardrus se contraindre : à quoi, comprimant sa force profonde, n’eût-elle pas atteint ? À quelle tension expressive ? De son œuvre, il ne restera pas de grandes machines ; elle échappera au respect des cuistres. Tableautins, qu’on désire pour soi, pour sa maison, passionnément — qu’on achète — et qu’on emporte contre son cœur : des pastels de l’instant ineffable. »
À l’instar des proses, les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus nécessitent un tri, si l’on veut en appréhender le suc. Une fois débarrassée de l’excès de préciosités, de verbalisme et autres scories qui affectent une part de ses poèmes, son œuvre propose le meilleur. Il a suffi de quatre recueils de poèmes et de sept romans pour que la thématique de cette œuvre soit fixée : Le royaume de l’enfance, la terre normande, Honfleur et son estuaire aux couleurs changeantes, l’univers marin, mais aussi l’union de la nature et de l’être, la célébration de la beauté, les mythes orientaux, le désir, le voyage vers les lointains (autant extérieurs qu’intérieurs), la fuite du temps, la mort, l’amour, l’amitié, la condition féminine et l’injustice, abhorrée entre toutes. Bien loin d’être des chimères, les êtres de Lucie Delarue-Mardrus sont des êtres réels, des êtres de chair, qui rencontrèrent un large lectorat populaire, à défaut de réunir l’approbation unanime de la critique. Colette ne lui a pas écrit en vain, en 1922 : « Trouvez-moi deux créatures, acquises au même métier, qui pourront se ressembler jamais autant que nous devons nous ressembler, vous et moi » ; puis plus tard : « Mon Dieu que tu es riche, et abondante et variée ! Moi qui sue sang et encre pour bâtir des personnages. »
C’est assurément par le biais de la poésie, que l’auteure des Sept douleurs d’octobre, appréhende le monde avec le plus de force (« Ceux qui disent que j’écris facilement me font bien rire… Il n’y a que les vers que j’écrive sans ratures. Je l’ai déjà dit, le vers fait partie de ma respiration »), sans cesse écartelée entre les contraintes du quotidien et ses désirs, le réel et l’imaginaire, depuis son enfance : Mon enfance a jeté la bouteille à la mer, — Le temps enfin me la ramène… — On voit les continents désirés sur la carte, — Les océans, tout ce qu’on veut. – Pour que l’esprit s’embarque à toute voile et parte, — Il suffit de ce peu de bleu. Ce n’est pas la nostalgie de son pays qui l’inspire, mais la curiosité des horizons nouveaux, devinés du seuil de sa demeure qui regarde la mer. « Partir, fuir... toute sa poésie sera l’expression de ce désir de fuite et de conquête, de cette recherche d'une terre d’élection où ses rêves ancestraux puissent se fixer et fleurir… Après avoir, dans ses premiers recueils, pris contact avec sa terre natale : Occident, Ferveur, elle exprimera dans Horizons les premières inquiétudes des pays inconnus. Enfin, la Figure de Proue exprime le rêve réalisé, la révélation de la vraie vie : J’ai pris la grande route et ne puis m'arrêter. — Ayant connu la joie et le mal du voyage, — Je ne puis jamais plus être que de passage... », a écrit Jean de Gourmont (in Muses d’aujourd’hui, Essai de physiologie poétique, Mercure de France, 1910).
Pour René Fauchois (in revue Corymbe n°42, 1938), qui évoque une parenté baudelairienne ; le fondement de l’inspiration lyrique de Lucie Delarue-Mardrus, est « ce tourment de vivre pour quiconque aspire à comprendre ce qu’il sent, cette recherche passionnée des causes, ce désespoir devant tout ce qui borne l’horizon humain et contrarie notre soif d’absolu, cette tristesse qu’engendre l’ignorance des raisons qui orientent nos destinées, cette révolte où nous conduit d’abord l’absurdité apparente de tout et l’incohérence des prétendues lois qui semblent régir notre univers, cette angoisse panique de l’être que ne rassurent ni les explications sommaires du rationalisme ni les affirmations dogmatiques, puis cette résignation devant la vie et la mort également incompréhensibles… Mais elle a formulé avec un accent qui n’est qu’à elle ses plus déchirantes objurgations. La musique de ses vers lui appartient en propre. Personne n’a dit avec autant de pathétique lucidité son amour de la terre natale : L’odeur de mon pays était dans une pomme… Si nombre de ses poèmes sont nés d’un cri de douleur ou d’extase, elle a su, l’ayant voulu, promouvoir ce cri à la dignité de la Musique. Et je veux dire la vraie musique ; pas de celle qui n’est qu’un assemblage plus ou moins adroit de syllabes agréablement sonores, mais de celle en qui palpitent, secrètes et vives, et peut-être éternelles, la pensée fervente et rare, l’émotion instinctive et humaine d’un être de chair et d’âme dont le cœur et les yeux mêmes blessés, s’ouvrent toujours pour aimer, en dépit de tout et de tous, et qui, malgré le silence obstiné du Sphinx, ou ses réponses dérisoires, ne se lasse ni d’interroger, ni de souffrir. » Car, contrairement à sa prose, qu’elle perçoit souvent comme une activité alimentaire, Lucie Delarue-Mardrus conçoit sa poésie comme l’expression entière de son être, mais aussi comme un gouffre qui aspire ses passions et ses hantises : l’angoisse, la mort, la maladie, la déception continuelle de tous les espoirs mis en l’homme et dont les apothéoses seront les deux guerres mondiales. Malgré un apparent déséquilibre au sein de cette imposante production, ce n’est pas la prose, répétons-le, mais la poésie, qui caractérise le personnage, sa quête comme sa création. « Je ne suis et ne fus qu’un poète », ne cessera d’affirmer Lucie qui, dès l’enfance, étant portée vers d’autres sortes d’activités que les enfants de son âge, prendra tôt conscience de sa différence…
Christophe DAUPHIN
(Extrait de Lucie Delarue-Mardrus, la princesse Amande, Recours au poème éditeurs, 2015).
Critiques
"Si les articles sur Lucie Delarue-Mardrus commencent à se multiplier et permettent de redécouvrir son œuvre, les biographies concernant ce personnage littéraire sont suffisamment rares pour que l'on salue la parution de cet essai de Christophe Dauphin. Ce critique et essayiste s'est appliqué à retracer l'existence de cette femme de lettres en choisissant de l'aborder sous l'angle de la féminité. Les thèmes abordés dans son œuvre sont replacés dans le contexte esthétique de l'époque et mis en relations avec les écrits de ses contemporaines, révélant ainsi que l'esprit novateur qui anime ses premiers écrits.
Un des intérêts majeurs de cette biographie est le portrait assez étoffé que Christophe Dauphin brosse du Dr J.-C. Mardrus qui, jusque-là, n'était qu'à peine esquissé. On comprend mieux dés lors avec quel homme charismatique Lucie Delarue-Mardrus vécut jusqu'à la veille de la Première guerre Mondiale. On y trouvera également une réflexion sur sa démarche spirituelle et sur son homosexualité.
Nous saluons donc ici une belle tentative de concilier les différentes facettes de cette personnalité dont tous les critiques saluèrent l'énergie, la créativité."
Nelly Sanchez (in Cahiers Lucie Delarue-Mardrus, septembre 2015).
*
"Qui est Lucie Delarue-Mardrus ? Le mérite de Christophe Dauphin, outre répondre à cette question, est de nous rendre cette femme d’exception familière et attachante. Ce livre succède au récit de souvenirs de Myriam Harry paru en 1946, et à celui d’Hélène Prat paru chez Grasset en 1994. Il n’est pas possible de résumer cette biographie tant la vie de Lucie fut mouvementée, intense et littérairement extraordinaire. Elle a écrit plus de quatre-vingt romans (de 1901 à 1946), treize recueils de poésie, des pièces de théâtre, elle fut traductrice, critique littéraire et musicale ; conférencière, peintre, auteur de contes, de récits de voyages et de chansons. Colette dira d’elle : elle avait le bonheur d’aller à tous les travaux avec une fougue conquérante. C’est cette même fougue qui anime l’écriture de Dauphin et propulse le lecteur dans les méandres les plus subtiles de la force vitale et créatrice de cette femme hors du commun. L’accent est mis sur sa qualité de poète c’est assurément par le biais de la poésie que l’auteur des Sept douleurs d’Octobre, appréhende le monde avec le plus de force écrit Dauphin. Elle-même affirme : Je l’ai déjà dit, le vers fait partie de ma respiration// Je ne suis et ne fus qu’un poète. Née en Normandie, et ayant habité de nombreuses années à Honfleur dans Le Pavillon de la Reine, ce vers peut emblématiser le fait qu’elle ait été souvent considérée comme une auteure régionaliste : L’odeur de mon pays était dans une pomme. Or sa poésie ne saurait être réduite. Lucie Delarue-Mardrus, dans la lignée d’Anna de Noailles, Renée Vivien, Marie de Hérédia, est une femme de Lettres. De même que sa poésie illustre sa maîtrise de toutes les formes, du rondeau à l’élégie, Lucie multiplie les expériences tant amoureuses que créatrices (sans oublier ses crises mystiques) dans le Paris-Lesbos de la Belle Epoque : Tes yeux ne brûlent plus mon âme de garçon// et mes yeux noirs qui ont des regards de garçon//. Elle fut même comparée à Katherine Mansfield : comme Lucie, Katherine Mansfield a connu cette glorieuse chance d’avoir à dire avant de savoir dire.
La composition du livre de Dauphin : une riche et longue présentation de Lucie Delarue-Mardrus, une biographie passionnante et de larges extraits de son œuvre poétique, fait de la princesse amande une figure proche et émouvante. Son mariage avec Joseph Charles Mardrus son Homme de Feu orientaliste et traducteur des Mille et une nuits (liaison qui durera jusqu’en 1913) l’entraînera pendant plus de deux ans sur un sable d’ailleurs où ses découvertes renforceront sa soif d’engagement et son indépendance, comme l’illustre son rejet farouche de toute maternité : dans mes flancs malgré moi, l’horreur d’une âme humaine. Lucide à la fin de sa vie quant à sa solitude et à sa pauvreté : la triste fée aux doigts perclus/ Que je deviens dans ma ruine// Quoi ! Cette fente dérisoire/ Entre ces deux maisons/ Serait-ce la fin d’une histoire/ Riche de tous les horizons ?//, cela ne l’empêchait cependant pas d’accomplir de façon pérenne ce rêve si justement révélé par Dauphin tout le long de ce livre : Elle rapportera sur ses frêles épaules/ Le monde et tous les ciels aux pointes des ses mâts. Oui, elle a voulu le destin des figures de proue. Sa vie et sa poésie incarnent ce vœu."
Marie-Christine Masset (in revue Phoenix, 2015).