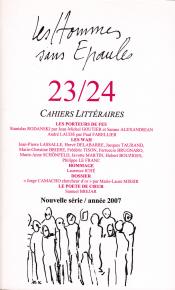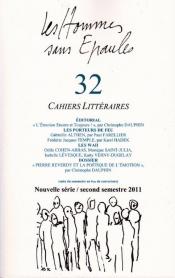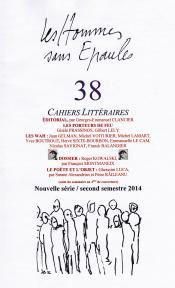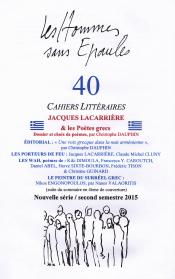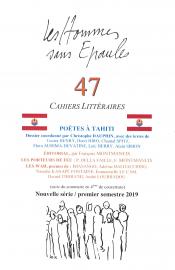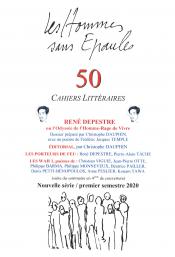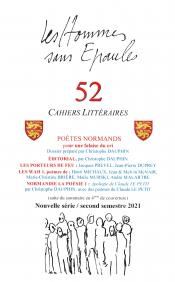Frédéric TISON

PORTRAIT DE FRÉDÉRIC TISON EN POÈTE-JANUS
Frédéric Tison est né le 15 juillet 1972 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Paris est son lieu de vie et de travail, comme responsable d’une bibliothèque scolaire (De la Bibliothèque d’air à la Bibliothèque d’Or - De larmes de brumes au papier de vrai ciel - Je suis lecteur mort, en la Bibliothèque d’Or). Il est l’auteur de six livres de poèmes, d’un récit poétique et de vingt-sept livres de contes et de poésie, à tirages limités ou le plus souvent hors commerce. Frédéric est également un grand mélomane, voyageur des lointains, amateur de textes rares et oubliés des XIIIe, XVe et XVIe siècles (Jehan Renart, Charles d’Orléans, Maurice Scève, Étienne Dolet…). Il publie encore, en tant que photographe, ses propres albums de photographies, et pratique le dessin à l’encre de Chine. Il y a là, une œuvre de poète, un univers foisonnant qui oscille, comme l’a écrit Paul Farellier (son premier lecteur chez Les HSE et son meilleur, son « parrain » en poésie, ainsi qu’Alain Breton, son éditeur) entre deux pôles : d’un côté, la spiritualité, l’abstraction, l’apollinisme ; de l’autre, le dionysisme, le concret, la sensualité : Je suis une ombre qui parle à la vie ; j’ai vu de l’or dans les yeux du monde : serais-je un soupir qui parle à ce désir ? - Je suis l’aphélie - Des falaises rongées du ciel étoilé, je rapporte des gemmes, des comètes, des yeux-ŕ des astres amoureux.
« Pouvez-vous nous parler de cette dualité ? Comment la vivez-vous en tant que poète ? », interroge Paul Farellier (in Les HSE n°47, 2019). Frédéric répond : « « Il est vrai que ce sont là deux pôles de l’expérience d’être au monde, et qui nous constituent, si l’on en croit Nietzsche. Cette dualité, dans le poème, il me semble qu’il ne faut pas la voir comme un dualisme, comme quelque chose de binaire : il est possible de l’interpréter comme une complémentarité, dans un mouvement de balancier ; une complicité peut s’instaurer entre ces deux pôles. D’ailleurs, souvenons-nous de la définition de Paul Valéry (dans les fragments de Tel Quel) selon laquelle le poème est une « hésitation prolongée entre le son et le sens » : le son, ce serait Dionysos, la danse, la musique ou plutôt la musicalité du vers ; le sens, Apollon, la représentation, l’image, l’univers pensé. Dans le poème, il me semble qu’il est difficile de trancher entre ce qui relèverait exclusivement du mental et ce qui aurait trait seulement au concret ; il existe selon moi toujours une tension entre les deux, il existe des degrés ; dès lors, on pourrait parler d’une hésitation entre l’intellect et les sens - je veux parler de nos sens, l’ouïe, la vue, le toucher, etc. Si j’évoque une ville par exemple, une « ville précieuse » comme il en est question dans Le Dieu des portes, c’est non seulement une ville que j’ai visitée bien sûr, avec ses rues, ses bruits, ses palais, ses visages, ses ciels, ses jardins, mais aussi un objet mental, visité par la mémoire et comme enchanté par elle, et je pourrais alors très bien en parler comme d’un souvenir de Ninive, l’ancienne ville d’Assyrie, au VIIe siècle avant J.-C par exemple. »
Qu’est-ce que le poème ? « Le poème est un regard - le résultat d’un regard, et un regard continué. Il est une aventure de l’esprit qui se passe dans le langage. Mais il est aussi tissé de l’expérience sensible d’une personne, dans un lieu donné, dans un temps donné. On pourrait parler d’un tiraillement entre le rêve et le réel : mais le poème est justement le lieu où peut se résoudre ce conflit… - Le poème est un langage qui veille au sein des langues… - Le poème précipite le mot, le condense, le restitue à sa voix à défaut de le réunir à sa source insaisissable ; le poème fait de chaque mot un visage unique, infiniment précieux, à l’image des visages des hommes. »
La poésie a-t-elle jamais réussi à changer quoi que ce soit ? Toute son histoire parmi les hommes n’est-elle pas celle d’un échec total, retentissant, interroge Frédéric Tison, avant de répondre : " Elle n’a rien pu changer au cours abominable des choses du monde, c’est certain ; elle n’a pas rendu, au cours du temps, les hommes moins violents, moins cupides, moins indifférents, moins sots, non plus qu'elle n’a empêché aucune guerre, aucune torture, aucun attentat ; elle n'a jamais fait revenir quelque amour. Mais je dirai, sans pour autant passer légèrement sur ce que je viens d'exprimer, que ses pouvoirs sont ailleurs : ceux-ci sont intimes, intérieurs, ils relèvent de ce qui nous fonde, nous emporte, nous élève (et nous rêve, peut-être). Vous parliez d’admiration tout à l’heure, et cela m’y fait penser : la poésie est ce qui admire en nous ; elle est ce qui s’émerveille d’admirer, ou en souffre ; elle est également ce qui détermine en nous le près et le lointain, le bas et le haut, le hideux et le beau. Rappelez-vous les mots mis en avant par les poètes du Surréalisme, mouvement qu’on a tôt fait de réduire à un mouvement, justement : « Changer la vie » (mots repris de Rimbaud) ; cette formule qui s’est vite réduite, pour certains, à un slogan, c’est-à-dire à quelque dérisoire ralliement politique ou idéologique, inéluctablement balayé par l’histoire, et ridiculisé par elle, cette formule a encore tout son sens pour qui sait l’entendre comme l’exigence d’un certain regard sur le monde. Ce regard, c’est celui qui sourd de la fameuse pensée de Hölderlin, « habiter poétiquement la terre » ; je ne vais pas ici recopier mon étude sur cette pensée, laquelle a paru naguère dans le n° 43 des Hommes sans Épaules, mais, pour résumer, je dirai que selon moi cette pensée ne fait pas référence à une injonction mais à un état, à un fait, qu’il s’agit de reconnaître ici et maintenant.
Cela (ce regard qui se métamorphose) peut commencer, si j’ose dire, par quelque chose qui semble au premier abord tout simple : le rapport au langage. Certains, auxquels je me joins, ont remarqué qu’il se passe de nos jours quelque chose de grave : tout le langage ou presque qu'on entend et lit aujourd'hui est détraqué. Les mots ne soulignent plus, ne sont plus alentis. Ils tournent dans un vide hébété, comme le hamster dans sa roue. Écoutons un discours politique, lisons une analyse journalistique de la même eau, écoutons les gens qui parlent un peu partout : approximations, mots employés pour d’autres (et parfois, il me semble que les paroles de la fameuse pièce de Jean Tardieu se sont répandues dans le monde entier !), perte du sentiment de l’équivocité, perte de la nuance, de la synonymie, oubli de l’étymologie (c’est-à-dire du passé tout entier), sans parler de l’avachissement de la syntaxe, ni de l’effondrement de l’orthographe et de la ponctuation, lesquels s’observent dans le moindre message électronique que nous recevons, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans la moindre conversation que nous surprenons dans le métro ou à une terrasse de brasserie. Ce n’est pas ici le lieu ni le moment pour développer, mais si je puis clore provisoirement ce propos, je proposerais volontiers ceci : le poème, qui se passe dans le langage, sait le mensonge, sait les mots : il a creusé ceux-ci, il n’en est pas dupe ; d’ailleurs, il les a tournés, retournés, il a soufflé dedans comme jadis on soufflait dans un os pour le faire chanter ; il les a déclinés, comme jadis on tendait des boyaux animaux sur la carapace lissée d’une tortue pour les faire résonner ; cette carapace devenue lyre, avec des cordes chantantes. Le poème est peut-être le seul langage libre. Serait-il un « mensonge qui dit toujours la vérité », comme disait Jean Cocteau ? La formule est séduisante, peut-être trop séduisante ; mais chez Cocteau, la subtilité est elle-même subtile, aussi j'accepte volontiers cette formule, même si elle me semble réductrice. Peu importe : elle est belle, cela suffit..."
C’est par la Poste que je reçois en 2007 la première lettre et les premiers poèmes de Frédéric Tison. D’emblée, nous (le comité de lecture des Hommes sans Épaules) sommes saisis, au premier abord, par cette écriture « décalée » (par rapport à l’époque, ce que l’on peut lire et recevoir) et son ton personnel. Paul Farellier restitue très bien la réception de Frédéric chez Les HSE : Dans un français très pur, moderne certes, mais irrigué en profondeur du passé de la langue, Frédéric Tison sait défendre sa jeune indépendance et l’originalité de sa pensée poétique. Les mythes antiques, tout autant que le trobar, ou encore le souci mallarméen du « Livre » et les hantises de l’inactuel et de l’inachèvement brossent l’arrière-fond, le décor mental d’une création ambitieuse et très évolutive.
Nous faisons, dans la foulée, Les HSE, la rencontre de Frédéric, qui m’apparait comme un être fragile, délicat, sensible et raffiné, tant dans son langage, sa manière de s’exprimer, sa culture très vaste (sa nourriture, dans laquelle il nage avec science et aisance), que dans son poème et son apparence qui entend jouer sur le mode dandy, dans le lointain voisinage de Brummell, Barbey d’Aurevilly ou Oscar Wilde : À t’entourer de beauté négligeras tu le monde – Forcené ! Exalté ! Entremêlé de toute chose - Belle avec la branche qui n’a pas tout dit encore.
Frédéric semble surgir d’un autre temps, d’une autre époque. Il en a l’allure, le langage et l’exigence. On peut l’imaginer aux côtés du prince-poète Charles d’Orléans, dans son château royal de Blois, entre 1457 et 1460. Charles d’Orléans (1394-1465) organisa, dans son domaine de Blois, un concours de poésie nommé « puy ». Onze ballades sur le thème « Je meurs de soif auprès de la fontaine » illustrèrent ce fameux « concours de Blois », sous la plume de poètes renommés, tels que Charles lui-même, François Villon, Gilles des Ormes ou Jean Robertet. Frédéric a réuni ces poètes et leurs poèmes dans un livre qu’il a auto-édité en 2011 (et aussi, Le Lai de l'Ombre, de Jehan Renart, en 2013) dans leur langue originale du XVe siècle, et qu’éclaircissent des notes de vocabulaire du moyen français. Frédéric, on l’imagine encore, au XIXe siècle, dans les pages de Marcel Proust, dans les cercles parnassiens, décadentistes ou symbolistes, assistant aux mardis de Stéphane Mallarmé. Telle d’Écho la pensée splendide - De perdre à la fin Narcisse dans l’Eau - Je sais ce jardin où je me sème, écrit Frédéric.
Pour rendre une idée de l’univers de Frédéric Tison, lisons un extrait de son récit, Selon Silène[1] (2018) : « J’aime les rois mous, les princes légers, les petits maîtres et les poètes mineurs. J’aime ces silences, ces murmures – j’entends là les silences, les murmures dans les chroniques, dans les livres célèbres ou célébrés, parmi les paroles humaines convoquées au grand banquet des opinions délébiles : n’y décèlent-on pas cette sorte de paix blanche, de paix secrète et scintillante qui est celle d’après l’orage ? Or il est des orages ignorés, au cœur du silence, qui ne font aucun bruit – j’évoque aussi le calme des pensées et des mœurs, l’absence d’ambition vulgaire, les chatoiements discrets, les rêveries précises et délicates, les propositions sans cri, l’ironie simple - mais aussi les ombres étranges et douces, les eaux qui dorment, les choses sombres, toute la menace sourde et perpétuelle de la vie ; et ces divinités discrètes des bois, les elfes furtifs, les fées malicieuses, peut-être dangereuses. M’attirent les coulisses, la porte dérobée, la cave ou le grenier, l’autre chemin, l’impasse apparente qui soudain, ou lentement, se révèle passage ou traversée. J’aime les règnes fades, les royaumes flous, les royautés minuscules, le Judicat d’Arborée, les petites églises et les chemins sans pavement. J’aime la Neustrie et l’Austrasie, j’aime le nom du canton de Thurgovie, celui de la Transylvanie. J’aime Mélisende de Jérusalem, l’épouse de Foulques V d’Anjou ; j’aime la Dame de Castel d’Oze. J’aime, en parcourant les livres d’histoire, les amants sans nom, ou les noms des amants, les épouses répudiées, les héritiers sans descendance, l’enfant sans père - ou Louis XVII abandonné -, les oubliés, les tardifs, les retardataires, les tombés du dictionnaire : Dominique Phinot, Claude Hopil, Michel Vieuchange, maints et maints autres… J’aime les digressions, les détails, les allusions, les bifurcations, les versions contraires et les Quatre Évangiles… ; les défets dans les livres, les prières d’insérer, l’erratum, les notes de bas de page, les index, les glossaires, les cartes, les bibliographies et les généalogies - et dans les dictionnaires, j’aime les préfaces, les « avant-propos » et les « avertissements »…Dans les musées, le tableau oublié, au cartel indécis, l’attribution incertaine, l’esquisse, le marbre négligé, ou l’angle imprévu que crée un regard, sur la statue qui semble anodine ; dans les églises, ce vitrail minuscule, cette obscure chapelle enfumée. J’aime la sonate et la sonatine, la note intime au sein du cosmos symphonique, et toute l’œuvre d’Erik Satie. J’aime l’anecdote, le filigrane, la surprise (au sens aussi de ce moment de la Quatre-vingt-quatorzième Symphonie en sol majeur de Joseph Haydn), l’épisode, les traces oubliées, incertaines, les variantes des mythes et des légendes - et l’interprétation qui tâtonne et doute… J’aime des romans, des fables et des récits les personnages secondaires… »
Lorsque nous le rencontrons en 2007, Frédéric Tison écrit au secret et n’a encore jamais eu le moindre contact avec le milieu littéraire et poétique. À ce stade relativement précoce, nous avions (Les HSE) perçu la poésie de Frédéric Tison, écrit encore Paul Farellier, plus comme un exercice de la pensée descendant en soi-même que comme une approche sensitive des choses. Nous avions cru y déceler une trace mallarméenne qu’attestaient, dans le chant, certains de ses poèmes, mais aussi le goût de l’inachèvement et de l’annulation, sans compter le beau phrasé de certains vers (comme celui-ci par exemple : « Ou renais, selon, tel le songe du héros des mythes d’Or ») qui sonnaient pour nous en une harmonie dont l’époque semblait avoir perdu jusqu’au souvenir. Ensemble, l’énigme et le sens brillaient pour nous dans des fragments
Mais, Frédéric est bien sûr un homme de son temps et non pas du XIXe siècle. Il le dit lui-même : « La poésie du monde est un immense « Il était une fois » : mais cette histoire n’a plus nécessairement pour cadre les châteaux sombres ou de cristal et les forêts enchantées des contes, ni pour protagonistes le prince et le paysan imaginaires - mais nous-mêmes, dans la ville sauvage ou la campagne menacée.« Il était une fois ce qui est arrivé » - « Il était une fois ce qui m’est arrivé » - et je chante. »
Rejoignant notre groupe, il devient l’une des révélations, confirmées, de la troisième série des Hommes sans Épaules, revue qui publie ses premiers poèmes dans le numéro 23/24, en 2007. Frédéric (qui écrit : « Publier un livre, ou publier quelque écrit dans une revue, c’est donner rendez-vous dans le monde à un ami que l’on ne connaît pas toujours, à une heure inconnue ») est accueilli par la suite à quinze autres reprises. Durant ce laps de temps, de 2010 à 2021, les HSE publient sous la houlette d’Alain Breton et avec les éditions Librairie-Galerie Racine, les six principaux livres de poèmes de Frédéric, lesquels sont travaillés dans le vivre et ciselés dans l’orfèvrerie du langage. Des livres de poèmes qui délivrent un univers personnel et bien à part, qui lui est propre. C’est rare de nos jours : Je suis ici le vent d’un autre port, d’un autre pays, d’une autre fois. - Je suis ici l’audace qui meut les bras chargés d’oiseaux affamés — les branches exténuées, les fleurs avides. - Je suis ici le chemin dévorant — et cette offrande-là, unique soleil parmi les herbes, entre les pierres, c’est mon ardente éclipse. / Dans ce pays j’ai des yeux plus clairs. - Mon cœur y est un nombre, une immédiate danse. Je souffle là dans un os qui me chante. - Dans ce pays mon corps est moins étrange ; une seule fleur est mon insolence, et toute ma pensée. - Dans ce pays mes bras sont lierres et pampres, dans ce pays j’ai des jambes plus légères.
Nous trouvions (Les HSE) dans la poésie de Frédéric Tison, résume Paul Farellier, un lieu où semblait pouvoir se renouveler le dialogue avec les mythes : « ici, celui d’Adonis - aussi maîtrisé que possible car, non pas pris tel qu’en lui-même, mais transporté en esprit (le poète évoque un « Adonis de lettres dans un livre ») ; le mythe était donc devenu lisible dans notre contemporain, tout en restant fidèle à ses sources où le héros se partage entre la clarté vivante en Aphrodite et, en Perséphone, l’ombreuse mort ; et nous constations que le poète mythologue se gardait d’oublier l’ascendant végétal légendaire (Adonis est né d’un arbre et, ici, il y a la « branche » évoquée en incipit, et il y a « cet arbre » en finale) ; et n’était pas négligée non plus l’origine lointaine du mythe, l’Adonaï étymologique, qui est Seigneur (le poète l’invoque comme « faux Seigneur de Moi-même »). S’il apparaît ainsi clairement dans le poème une relation aux mythes et si l’on reconnaît très vite son importance, on comprend pourtant qu’elle n’est que médiate et seconde. Et il en va de même du rapport entretenu avec ce qu’il est convenu d’appeler la Nature : la poésie de Frédéric Tison n’habite pas non plus directement la nature ; elle n’a pas pour demeure primordiale, mais seulement pour résidence secondaire, pour appartenance dérivée, la maison de ces quatre éléments - la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu - que nous légua Empédocle et qu’est venue consolider l’analyse bachelardienne. Entendons-nous bien cependant : par nécessité évidente de notre condition d’êtres animés, le poème y gardera toujours, ne serait-ce qu’en résonance indirecte, en simple écho, une attache de caractère élémentaire. »
L’univers de la poésie de Frédéric est à double visage, à l’instar de Janus[2], dieu cher à Frédéric, et c’est ce qui oriente sa parole. Ce vrai lieu est celui du Regard et du Désir : le regard (singulier) que le poète porte en lui-même et les regards (au pluriel infini) dont il est entouré et où il se cherche, souvent en vain, dans un Autre désiré : Tu sièges dans l’air d’un parc plus grand qu’un nuage et plus petit qu’un étang. Tu déclenches un rêve en te promenant. – L’allée claire - le long oiseau noir et vert - la longue musique des gestes de la statue dont le regard est blanc… Et l’arbre, qui ouvre les bras.
La poésie de Frédéric Tison, loin d’être totalement hermétique est vie et le désir comme l’Éros y jouent, y compris, au-delà du sentiment, sur le plan charnel, un rôle prépondérant. Cela n'est pas implicite, mais cet Eros ne concerne pas la femme, mais l'homme : Toute sa voix, ses membres amoureux - Parmi les allées - Dessinées dans les lignes de mon image coloriée. Frédéric le « masque » dans ses poèmes et ne s’en ouvre que peu, sauf peut-être dans ses poèmes plus récents ou en tirages hors commerce : Non pas l’amour, l’admirable amour, - Non pas lui mais son corps, - Non pas lui mais ses mains, mais - Son navire, son havre et son chagrin - Aimer un corps est-ce seule offrande ? – L’amour ! Non pas lui mais son corps, sa courtine et son port - Mais le ventre brûlant de son large, mais - Ses demeures et ses âges, ses heures, ses épaves - Dans l’herbe sous l’œuvre de vent - Aimer un corps est-ce seule grâce ? - Non pas lui : son visage qui parle - Mais ses roses démasquées. Ajoutons : C’est lui, c’est lui que tu aimes — ses empreintes sur ton corps et tes draps — il s’en va lui aussi, parfois il n’est plus là — Il te révèle ta beauté, ton amour et ton miroir — Oh ! Ne jamais détruire la joie...
Frédéric le mystique écrit encore : (De certaines affirmations, 29 avril 2022) : J'aime à lire la plupart des théologiens chrétiens, des Pères de l'Église aux plus modernes parmi nos contemporains, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants. Il m'arrive toutefois d'avoir envie de leur dire, lorsque je tombe sur certains passages de leurs livres : « Mais enfin, qu'en savez-vous ? », (De l'amour, 24 janvier 2022) : « « Que l'amour soit d'une extrême rareté me rappelle que le christianisme l'identifie à Dieu. Saint Jean, dans sa si belle Lettre, eût pu dire également de Dieu qu'il était la tendresse, si rare elle aussi. » De Dieu, 29 mars 2021) : « Moi qui suis « croyant », j'ai toujours trouvé qu'il était curieux que quelqu'un se dise croyant... Et puis, que m'importe si quelqu'un est d'accord ou non avec moi ? Les fanatiques m'étonnent, aujourd'hui. Lorsque j'étais médiéval, lorsque j'étais antique, je savais bien tout cela, et déjà je trouvais que l'intolérance était désolante. Mais aujourd'hui ? (Tu ne crois pas en Dieu ? Crois-tu que je sois certain moi-même de son existence ? Etc.) »
Frédéric-Janus, le poète-dieu des portes n’est en aucun cas un poète maudit, puisqu’il est reconnu et publié d’emblée par Les Hommes sans Épaules, en revue comme en livres. Sa reconnaissance, en tant que poète, dépasse le seul cadre des HSE pour s’étendre au milieu de la poésie, comme en témoigne les notes de lecture consacrées à ces livres, les revues qui l’accueillent ou les deux prix de poésie qu’il obtient et le fait, encore, par exemple, qu’il soit à plusieurs reprises retenu dans la sélection du Prix Mallarmé.
S'il existe une « part maudite », ou que Frédéric-Janus perçoit ainsi lui-même (Qu’est-ce qu’une terre ? C’est un abîme revenu d’une ombre. Ou encore : Qu’est-ce que l’amour ? C’est un trésor qu’on abandonne, écrit-il en 2022), Henri Rode[3] (1917-2004), notre ami et grand aîné en poésie et en littérature (celui de trois générations d’Hommes sans Épaules : Jean Breton, Alain Breton et moi-même, pour résumer), nous aide peut-être à l’appréhender lorsqu’il écrit dans son Journal impubliable : « Mon goût des hommes. Je revis le matin de printemps où je le jetai à la tête de ma mère, comme un reproche à ma mise au monde : pourquoi m’avait-elle fait ainsi, sans se douter qu’un garçon anormal (c’est l’épithète alors en usage) n’était attendu que par le rejet et l’ironie de la société ? Sentait-elle mon exil, ce matin, route de Réalpanier, et la sourde douleur que me valait partout ma différence. Les sanglots se pressaient dans ma gorge. »
Henri Rode, malgré l’époque problématique, pour un homosexuel, dont il parle, celle des années 40/50, n’est pas rejeté pour cela par sa famille (qui manifeste plutôt de l’indifférence) et assume ce qu'il appelle, sa différence. Cela semble plus compliqué chez Frédéric Tison : mourir derrière la vitre d’huile des fenêtres... - Je n’aurai pas été prévu dans le château — je n’y étais pas attendu. Toutes ses pierres m’étaient ronces et donjons.
Henri ajoute : « Cet état permanent de frustration chez l’homosexuel, les gens de la norme n’y croient pas. Ils l’imaginent couvert de conquêtes, ou se livrant au dévergondage à plusieurs et fourni à discrétion, dans ses plaisirs, par l’accès à des « lieux privilégiés ». Les homos selon eux sont de vilains jouisseurs. Ils ne voient pas le contre-poids du jugement social qui est bel et bien là, ni sa solitude presque sans remède. Non seulement ces assouvissements de l’homosexuel que guette la menace des maladies ne sont donnés qu’à quelques-uns, parfois des insatisfaits fonciers ; mais ils n’ont rien à voir avec cette hantise : ne pouvoir obtenir, en gros, qu’un type d’homme, le double de celui qu’il est lui-même. Quant aux autres, qu’il pense être de vrais mâles ; ils n’existent pour lui qu’en vitrine, avec l’écriteau invisible : pas touches !… Tout ce qui rattache l’homophile à l’homme – cette connaissance intime qu’il a de lui, de sa spécificité, de sa valeur en tant que gibier amoureux – c’est la femme qui l’obtiendra. Sans apprécier comme lui ce qu’il sait être un homme : ce monde mystérieux, absolu, dont lui seul devine et explore la vraie saveur, en imagination. Même comblé apparemment, l’homo reste privé de la virilité authentique. C’est son injuste punition à tant désirer son semblable, dont les dieux ne lui accordent qu’une contrefaçon, ou des miettes seulement suffisantes pour qu’il en aiguise sa frustration. Laissé à la porte du paradis de la masculinité, il continue de tourner dans la morsure. Rien n’est pire que la défense pour suggérer les assouvissements interdits. » Tourner dans la morsure, c’est bien ce que fait Frédéric Tison : Sa pensée est un monde manqué… - J’ai tant perdu dans l’Orphée des nuits…
En 2007, nous faisons, Les HSE, la connaissance d’un Frédéric timide, effacé, mais toujours souriant, d’une fine intelligence, érudit, curieux, vivant en poésie, très présent dans la vie et les activités de notre groupe. Puis, nous le voyons s’affirmer, gagner en maturité et en confiance, avant, soudain, de le voir tomber inexorablement : Où sont tes traces ? Les vents sur tes rives et les blessures de tes rames. Nous le voyons se faire happer par ses « démons », dans sa chair comme dans son esprit : Une bouche me recrache avec ses voix. De cela, je n’ai pas été le témoin direct. Frédéric sait donner le change, du moins avec moi. Pourquoi ? Parce que je suis le directeur des Hommes sans Épaules ? Je l’ignore. Mais il lui importe d’être « impeccable » et de faire « bonne figure » lorsque nous nous rencontrons. Il a toujours « masqué » devant moi, minoré ou tut ses problèmes qui vont pourtant en s’accentuant, avec de sérieux ennuis de santé : Il y a sur la mer un silence que tu traverses en oiseau qui s’est effrayé.
Il a notamment contracté une maladie grave (« constituée de lésions hépatiques diffuses et irréversibles au niveau du foie ») en raison probable d’excès du « fameux » dérèglement de tous les sens. « Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, — et le suprême Savant — Car il arrive à l’inconnu ! Puisqu’il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables : viendront d’autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé ! », écrit Arthur Rimbaud (in Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871).
On sait que le Rimbe cultive ce dérèglement pour se faire Voyant. Il en va autrement pour Frédéric, qui vise à lutter, étourdir, enivrer la douleur et le mal être : Je reviens avec l’Enfer comme une pierre. Silène et Dionysos lui sont alors de bien piètres amis, contrairement au Friedrich Nietzsche des Dithyrambes (1889), le dernier livre de poèmes qu’il parvient à mener à bien, comme un ultime accès de lucidité inouïe avant de sombrer dans la nuit de la raison. Henri Rode à lui aussi tout comme Frédéric mis sa santé en péril : « Souvent je pense que j’aurai fait tout ce qu’il faut pour mourir d’un ulcère ou d’un cancer. » Mais ses ailes l’ont toujours relevé dès qu’il effleurait de trop près l’abîme, lorsque Frédéric y plonge, abandonne progressivement le combat, pour s’assoir à table avec le mal de vivre qui le ronge et se livrer au dérèglement, avec lui : J’emporte avec moi tous les instants sinon toute la perte. Je ne suis pas dupe de cette descendente en enfer (une descente que rien, ni lui-même, ni ses amis ou sa famille ou le médecin, ne parviennent à enrayer, hélas), malgré les apparences dont Frédéric prend soin de se parer lorsqu’il me rencontre : Ta réalité ! Le vent souffle sur ta réalité, les herbes la recouvrent. Il arrive un point de rupture où il n’est plus possible de donner le change. Un point où la déchirure devient un masque qui s’empare du visage : j’étais ce creux d’où la musique veut fuir.
La santé de Frédéric devient de plus en plus préoccupante : Le roi est-il ici ? Oui, mais il est souffrant. Sa présence, rare : Peut-on le visiter ? Personne ne voit véritablement le roi. Il se terre : Cette ombre où rôde un visage porte-t-elle encore un nom, et serait-ce le mien ? Son moral est une interminables rue longée à travers les « villes précieuses », entre rêves perpétuels et cauchemars : Va-t-il mourir ? Nullement, il ne s’agit que de son ombre. Et pourtant, il forme des projets, comme un voyage aux Etats-Unis. Mais, la nuit fatidique tombe sur le Passage Abel Leblanc, à Paris : la porte du poète-Janus se dégonde de la vie, notre ami Frédéric s’effondre définitivement le 14 novembre 2023, à l’âge de 51 ans : Perdre est notre long chemin. C’est un choc brutal et profond pour l’équipe des Hommes sans Épaules… Frédéric tu étais et demeure des nôtres, Les Hommes sans Épaules, le poète qui marche dans les regards croisés sur l’infini d’une déambulation frémissante d’amour, de beauté et de douleurs. Je suis une larme, disais-tu…
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
[1] Silène, le compagnon de Dionysos, est un des rares satyres dont nous connaissons le nom propre. Au-delà du personnage hilare et ivre se dévoile une figure complexe et largement méconnue : Silène est un sage, un géographe, un historien, un poète même. En marge des grands récits, c'est à une promenade livresque, esthétique et philosophique en compagnie du satyre Silène que le lecteur est convié.
[2] Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifrons (« à deux visages ») et représenté avec une face tournée vers le passé, l’autre sur l’avenir. Il est fêté le 1er janvier. Son mois, Januarius (« janvier »), marque le commencement de la fin de l’année dans le calendrier romain. Son temple est situé sur le forum de Rome. Il est rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix. « Mais pourquoi te cacher en temps de paix et rester ouvert quand s’ébranlent les armes ? Aussitôt, ma question reçoit une explication : Pour assurer aux hommes partis à la guerre la possibilité de rentrer, ma porte est complètement ouverte, sans aucun verrou. » L’une des collines de Rome, le Janicule, lui est consacrée. C’est un dieu de premier rang dans la hiérarchie religieuse romaine, le seul avec Jovis - Jupiter et Mars - Marspiter à être qualifié de « Dieu le père », Januspater.
[3] Christophe Dauphin : Henri Rode, l’émotivisme à la bouche d’orties, dessins de Lionel Lathuille (Numéro spécial de la revue Les Hommes sans Épaules, 2010).
Illustration: Renaud Allirand : portrait de Frédéric Tison, Paris, 2022.
Œuvres de Frédéric Tison : Les Ailes basses (éd. Librairie-Galerie Racine, 2010), Les Effigies (Collection Les Hommes sans Epaules, éd. Librairie-Galerie Racine, 2013), (Le Dieu des portes (Collection Les Hommes sans Épaules, éd. Librairie-Galerie Racine, 2016), Prix Aliénor 2016, Aphélie, suivi de Noctifer (Collection Les Hommes sans Épaules, éd. Librairie-Galerie Racine, 2018), Selon Silène : Étude sur la figure du satyre Silène, compagnon de Dionysos (L’Harmattan, 2018), La Table d’attente (Collection Les Hommes sans Épaules, éd. Librairie-Galerie Racine, 2019), Prix Louis-Guillaume du poème en prose 2021, Nuages rois, Ballades en prose 2018-2020 (Collection Les Hommes sans Épaules, éditions Librairie-Galerie Racine, 2021), Le Dernier chant d’Edwine, Œuvre poétique complète, préface de Christophe Dauphin, Édition établie par Norbert Crochet & Christophe Dauphin (Les Hommes sans Epaules éditions, 2025).
Livres d'artistes, tirages limités, éditions hors commerce : Anuho, Les Quatre Livres (éd. Larbaud et Cie, 2005), Genèse aux pensées blanches (Lulu Press, 2008), Deux Contes d'Occident (Lulu Press, 2008), Histoires amnésiques (Lulu Press, 2008), Scènes pour un Poème du Jeune Homme-Licorne (Lulu Press, 2008), Le Clair du temps, 4 volumes, carnets de notes et de photographies, une promenade dans le temps (HC, 2013), Le Clair du temps, 2 volumes, Carnets de photographies & de notes, nommées "minuscules", prises lors de voyages et de promenades (2013), Les Effigies, un carnet de photographies, satellite du livre de poèmes Les Effigies, variations sur des ombres et des voix (HC, 2013), Neuf images pour le rêve d'un château, Portfolio de quelques photographies au château de Champs, à Champs-sur-Marne (HC, 2014), Ombres reines, 2 volumes, carnets de photographies autour de l'ombre (qui signifie également "reflet"), accompagnées de notes (HC), Carnet d'oiseaux, encres de Renaud Allirand (HC, 2015), Une autre ville, encres de Chine et gravures de Renaud Allirand (HC, 2013), Glyphes, peintures de Renaud Allirand (Les Lieux-Dits éditions, collection Bandes d'artistes, mai 2019). Château transparent, dessins de Damien Brohon (HC, 2018), Rues gris sable, images de Sylvie Ledouxe (HC, 2016), Lettre à la nuit, notes en marge d'un texte effacé, illustrations de Danielle Berthet (collection Apostilles, 2017), Double noir, Notes de carnets, photographies et minuscules peintes (HC, 2021), Écho, tes lèvres, Suite de poèmes, Un narrateur s'adresse à Écho, qu'un jeune homme délaissa (HC), Ogives (sur un peintre oublié), notes en marge d'un texte effacé, illustrations de Danielle Berthet (HC, 2022), Dialogues autour d'un prince ému (Les Lieux Dits éditions, collection Cahiers du Loup bleu, 2022), James au bord de la mer (HC, 2023, Une suite de petits poèmes sur un Aimé, à Paris en 2019-2023), La Demeure aux infinis, précédé de Château, dessins de Damien Brohon (La Lucarne des Ecrivains, 2023).
À consulter : Paul Farellier, La poésie de Frédéric Tison, étude, entretien et inédits (in revue Les Hommes sans Épaules n°47, 2019), Jean-Louis Bernard, Frédéric Tison, essai (in revue Diérèse n°77, 2019), Claire Boitel, Frédéric Tison, la voix derrière la voix, étude (éditions Pétra, collection "Pierres écrites/Granits", 2023).
Le Blog de Frédéric Tison: Les Lettres blanches, par Frédéric Tison (hautetfort.com)
*
FRÉDÉRIC TISON, L’HOMME-POÈME
C’est un non-sens absolu d’exister hors de l’œuvre poétique quels que soient les belles manières et les appâts de l’existence. Toute la vie de Frédéric est un acte décisif, un refus du semblant, de l’imitation, une indifférence enjouée au ramage, aux mimiques et aux faux plumages, un degré second exclusif, créatif, un vol sur-le-champ et relayable, une migration en poésie.
Pourtant, sa sphère de mouvements se limitait souvent à sa pièce principale où se jouaient tous ses sentiments et son écriture, et dont la fenêtre complice de son ciel, de l’apogée de son espoir et de son sourire, ne pouvait pas se refermer.
Il m’a dit dialoguer avec un moineau (- mais Frédéric, les moineaux sont farouches, ne s’approchent pas ! – si, si, celui-ci revient tous les jours !) et il avait raison, il y avait un moineau qui n’avait été créé que pour lui !
Ce qu’il travaillait, il le devenait, une feuille, un arbre, un oiseau, les différentes ailes ou dermes d’un sentiment, c’était si joyeux, si naturel en lui, ce phénomène de métamorphose, de tendre incorporation. Ainsi ses creusets se remplissaient-ils d’odeurs de corps, de passion et de pluie.
Les jours passent, les années passent, à quoi s’emploie Frédéric Tison ? À sa vie commune avec le verbe et l’amour, à résoudre leurs énigmes si proches, si communicatives, à enrayer, à stimuler – parce qu’il est soudain enivré d’un parfum de toute neuve création – leurs emprunts, leurs usurpations.
Alors elles peuvent bien à présent, les années, se dérouler à l’envers ou dans n’importe quel sens, Frédéric est à sa table et s’apprête à nous lire son dernier poème – Tu veux bien ? Tu es sûre ? Cela ne t’ennuie pas ? Tu sais ce n’est pas long… il n’est pas fini, je vais le retravailler…
Je suis sûre Frédéric, absolument sûre, tu peux commencer
Odile COHEN-ABBAS
(Revue Les Hommes sans Épaules).
*
FRÉDÉRIC TISON, LE POÈTE DE L’AVANCÉE
Frédéric Tison est le poète de l’avancée. L’écriture sur l’épaule, il capte tous les angles, les aléas, les perspectives d’une vision du monde. Mais, de par sa constitution, sa vision ne demeure en aucun cas un objet inerte, extérieur, elle se combine avec une vocation intérieure qui trouve, à l’aune et au rythme de ses pas, l’un des fils édifiants du dicible et de la mission poétique pour faire de lui plus que le diseur, le prophète de la marche du déplacement. « Quel calme dans la ville, sous le soleil grave du soir ! Son grand corps semble celui du monde ; il se répand et tombe dans mes bras. - Je sens des hommes qui passent autour de moi, qui tous portent un nom – et cet oiseau qui s’écoute dans l’arbre et que personne ne voit. Tout est à l’heure. - Quel silence dans la rue, parmi les choses qui sont là ! J’ai peur qu’une fenêtre s’ouvre avec un cri, et qu’une porte s’entrebâille lentement sur un sanglant visage. »
Le poète porte en lui, superbement, talonnée par les ciels, le vent et les nuages qu’il aime, la solitude de l’être qui s’est trouvé. Il n’y a pas d’antithèse, pas de pièges, pas d’antagonismes à sa progression. Tout lui cède. Parce que sa marche se règle sur la respiration de ce qui est devant lui, à part égale du connu et de l’inconnu, mais pas seulement, d’une proximité qui se compose lumineusement avec l’à venir. Tout se descelle, tout se dégonde, par jeu de justesse et d’évolution, tout se fluidifie de la douleur et de ses déviations sur la ligne d’engagement de son déplacement. Rien ne peut faire obstacle au tempo de sa marche, rien ne peut s’achever en une trace luxée et définitive, lorsqu’il soulève les portes qui le portent, et les déplace à l’infini.
Qu’est-ce qui mérite que l’on se mette en marche ? On peut ouvrir le livre à n’importe quelle page, il foisonne d’arguments substantiels et vivants : « Tu es à Ribadesella, sur la plage aux poussières d’ambre, sous un soleil qui ne te connaît pas encore. À Florence en été se suspend l’arroi des anges sur les toits, et c’est encore toi, près du couvent San Marco. Au matin, Prague te voit dans la mélodie de ses ocres et de ses dômes verts ; Munich encore, sous la pluie d’été, dans le vent qui s’égare parmi les lignes droites. » L’avenir et l’ouvert seuls valent la peine qu’on se mette en chemin contre tout ce qui se fige et meurt aussitôt corrompu. Voici donc l’engagement dans la marche et l’étrange creusement sous le sol, ce haut-le-cœur du chemin qui condamne le poète à poursuivre dans l’alternance de nouveaux jours et de nouvelles nuits. « Maintenant il sort dans la nuit qui le sème. - « Nuit, dit-il, nuit que je sais, nuit que j’admire, je sors aujourd’hui dans une autre nuit, une nuit qui te ressemble à peine : je sors dans la nuit que j’entr’ouvre et que j’aime. » - Son heure commence avec les mains qui se joignent. »
Mais de quel haut-le-cœur s’agit-il ? D’une absence. De soi, de l’autre, qui fait que le voyage, contre le péril de ce qui demeure, est à entreprendre. L’absence n’est-elle pas en elle-même voyage ou impulsion au voyage pourvu qu’on ne la laisse pas en rade ou au loin, et quand ce que l’on a perdu, redevenu « manque », trace le chemin.
L’absence de l’autre et l’absence de soi sont-elles mêmes ? Chez Frédéric Tison, le tissage entre ces deux états trace la lumière. Sa manière de dire, j’entends l’offrande du corps, du geste, de la voix, recèle une chose très estimable. Car il parle avec des mots tout neufs et propres, lavés dans sa mémoire, dans sa naissance, dans ses hasards, il parle avec la précaution des mots, toujours, pas un – ils y viennent d’eux-mêmes – ne se refuse à lui, tel un officiant de l’amour, et tout au long de son beau livre, comme on s’adresse à un enfant intelligent. Voilà qu’il se retourne, et dans son retournement ruisselle quelque chose qui est la toute confiance, voilà qu’il a ce très joli mouvement de son être qui repart en arrière pour nous dire : oui, c’est bien toi, je ne me suis pas trompé, tu es le bon destinataire. Et nous pouvons alors mettre notre main dans sa main sans masque, dans sa main de nature et de poésie perpétuelles.
Le texte de Frédéric Tison a la modestie des textes élus, sans faille, sans mélange ni méprise. Il est fait de petits fragments, de petites étincelles de vie qui tracent, à rebours comme dans l’avenir, une longue ligne droite et pure."
Odile COHEN-ABBAS (in Les Hommes sans Épaules n°44, 2017).
« LA TABLE D’ATTENTE », PRIX LOUIS-GUILLAUME DU POÈME EN PROSE 2021
Quand on aborde ce livre[1] de Frédéric Tison pour la première fois, et que, bien évidemment, on ne connaît pas encore la richesse poétique que sa lecture va révéler, on se trouve sur un chemin d’apparence modeste. L’auteur nous y accueille d’abord par un titre d’aspect plutôt « tranquille » – La Table d’attente –. Puis la définition académique qui nous en est donnée, assure-t-elle aussi une sérénité relative : Table d’attente. Plaque, pierre, planche, panneau sur lequel il n’y a encore rien de gravé, de sculpté, de peint. Fig : C’est une table d’attente, ce n’est qu’une table d’attente, se dit d’un jeune homme dont l’esprit n’est pas entièrement formé, mais qui est propre à recevoir toutes les impressions qu’on voudra lui donner.
En réalité, dès le premier poème (Je suis ici le chemin dévorant – et cette offrande-là, unique soleil parmi les herbes, entre les pierres, c’est mon ardente éclipse), on découvre très vite que l’on va avoir affaire à des enjeux immenses. Et tout d’abord, le poète se posera la question fondamentale de sa propre existence et de sa présence au monde : J’avais vingt-quatre ans, et je veillais près d’un château. Et je me disais : « Je suis sur une terrasse, à ne toujours pas savoir. Suis-je en ce monde un regard ? Suis-je une pensée ? Suis-je un monde d’os et de sang qui passe en écartant quelques voiles, ne suis-je que cette ombre, cette écume-là, vaine sur les dalles ? Car la table d’attente n’a rien de la mythique page blanche qui, dans la légende littéraire, impatiente si souvent l’inspiration. Elle est le lieu d’une recherche héroïque de soi-même, lieu faste parfois, riche de découvertes revivifiantes, mais aussi lieu pouvant devenir hostile et désertique. Là, sur cet écran de voyance, se nourrit l’invincible mélancolie dont le poète évoquera les ombres multiples, les fera monter sur l’horizon de son histoire.
Que sont-elles, ces ombres ? Elles sont lui-même : regardées, rejointes à plusieurs âges de la vie, chacune témoignant d’une étape de la connaissance, d’une étape de la sensibilité, d’une étape aussi vers « l’autre ami », celui de cet autre visage ardemment recherché bien que le poète craigne qu’il « ne se rencontre peut-être pas ». Car ce livre est en quête perpétuelle d’un amour jamais rejoint, alors même que sa présence peut être si forte à travers les évanescences du rêve : Une respiration, un baiser sur mes lèvres : est-ce toi qui viens jusqu’à mon corps troublé ? - Jadis je caressais tes oublis — J’attends le jour où je mettrai tes mains au creux des miennes : fuira-t-il assez cet oiseau qui est toi, loin de mes bras ? - (Il paraît que la haute mer connaîtra son corps épuisé — ses regards, ses saisons, ses années — dont les eaux feront des vents et des chansons.) Un doigt sur tes lèvres et je viens m’y échouer.
Le poète lui-même se tient dans un espace d’ombre dont il dit qu’il lui est infiniment précieux (approfondir ma pénombre est mon entier trésor). Dans cet espace, sa ressouvenance est discontinue : non pas un flot de mémoire, mais un archipel d’étincelles où le passé regarde intensément le visage de l’avenir, et où se remémorer n’est qu’une suite de morts à l’éternel désir, à la beauté toujours mystérieuse, où chaque fois persévère malgré tout un espoir réenchanté. Au terme, certainement provisoire, que constitue la dernière page de ce livre, le poète se trouve enseigné de son mode d’être au monde ; rien ne le fixe, rien ne l’arrime – se mouvoir, devenir, passer, mais tenir le monde par la mémoire et le regard : Je suis ici le rythme et l’élan d’un autre vent, d’un autre chant, d’un autre temps. - Nuages ! Haltes incessantes, je suis ici le mouvant. - Je suis ici l’eau vivante — Mort ! Que je te peigne sur fond d’or ou d’océan… Soirs ! Que je vous baigne dans mes miroirs et mes rouges… Amour ! Que je t’invente… Je serai là l’image qui manque, la ressouvenance, la pleine fenêtre et l’innombrable passant.
La vérité de ce très beau livre ne réside ni dans le caractère introspectif de sa démarche, ni dans le semblant d’autobiographie auquel on aurait grand tort de le réduire. Intemporelle, cette vérité n’a pu naître cependant que de la fluidité du temps et de la présence-absence du poète à chacune des étapes de son âge et dans leur entremêlement. De là dérive, pour ce livre, avec ces mots qui descendent vers nous dans leur tremblement et leur écho, la grâce de ce que Bonnefoy appelait « vérité de parole » et qui est seul garant de vraie poésie. C’est à quoi nous avons été particulièrement sensibles.
Il faut ajouter qu’en couronnant ce livre, notre jury s’est sans doute également souvenu qu’il avait à distinguer un ouvrage de poèmes en prose, c’est-à-dire un ouvrage composé d’authentiques poèmes, eux-mêmes écrits dans une véritable prose. La Table d’attente est, à cet égard, tout proche de ce qu’on pourrait appeler « notre idéal » : les quatre-vingt-dix-neuf pièces qui le composent sont indiscutablement d’admirables poèmes ; mais, de surcroît, la prose qui en forme le corps nous est apparue comme l’une des plus éblouissantes qui se puissent rencontrer dans la poésie de langue française d’aujourd’hui, en même temps que l’une des plus musicales. Lire ou écouter ce livre est un rare plaisir de l’esprit.
Paul FARELLIER
(Revue Les Hommes sans Epaules)
[1] Frédéric Tison : La Table d’attente (Collection Les Hommes sans Épaules, éd. Librairie-Galerie Racine, 2019), Prix Louis-Guillaume du poème en prose 2021.
POUR LE POÈTE DEVENU « MAÎTRE DES MARGES »
« Le Dieu des portes est une errance où se mêlent intimement quête de soi, quête de l’écriture et quête mystique. Ajoutons que son pouvoir poétique tient certes à la solide architecture du livre mais aussi à un rythme, une prosodie qui répond à l’exigence, selon laquelle « le poème en prose doit proposer un autre Chant », en témoigne une musique, comme par exemple celle de ces alexandrins : « C’est une fleur souterraine et c’est un visage, c’est un jardin qui fait d’une fleur un visage » (XV, cahier II).
Béatrice MARCHAL (Allocution de remise du Prix Aliénor 2016).
« Il est un vrai poète – à découvrir. Un poète qui atteint à la célébration de la beauté : « Plus seule, plus fière que toi, elle te sait ; elle est là où tu t’admires ; là où tu te hais ; là où tu comprends que parmi les savoirs et les regards sont tant et tant de rêves peints de couleurs vives ; et tu devines à tâtons dans la lumière. »
Pierre PERRIN (in revue Possibles, 14 mai 2016).
« Frédéric Tison extrait de la nuit des essences, tantôt sombres, tantôt lumineuses. Extraction lente, alchimique ou extraction fulgurante, magique. Les mots les habillent afin de les rendre visibles, elles se font histoires. Les sens se contractent pour mieux exploser dans la conscience du lecteur. Parfois cris, souvent chants, ces altérations poétiques de la continuité de l’apparence sont autant de portes à pousser, de songes en lesquels s’enfouir, ou s’enfuir. »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 4 avril 2018).
« Frédéric Tison nous emporte dans une vaste odyssée poétique dans laquelle nous embarquons éclairés par l’« aphélie », autrement dit le lointain, à l’œuvre dans notre traversée existentielle, ainsi que par cette étoile du soir, « Noctifer » dont la lumière retentit en nos abîmes/bâtisses de profondeurs sidérales. L’écriture du poète hisse ses mots jusqu’au pont de nos navires, d’où le ciel et la terre s’entrevoient via le regard des profondes vigies voyageuses, légendaires, oniriques, de l’existence. »
Murielle Compère-Demarcy (in lacauselitteraire.fr, octobre 2018).
« Frédéric Tison engage un combat contre le temps, s’élève au-dessus des conditionnements pour marcher sur les morceaux de temps brisés comme autant de marches vers la clarté. »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 10 février 2020).
« Pour le poète devenu « maître des marges » après en avoir été l’apprenti depuis plusieurs recueils, l’expérience est bien de fiancer la neige et le feu, le ciel et la terre et de relier poétiquement, « habiter poétiquement le monde ». Il nous appelle à « Regarder mieux, après les larmes de murs, de grottes et de sommeil » et si nous voyons toujours mal il se destine à changer l’image : « Je serai là, l’image qui manque, la ressouvenance, la pleine fenêtre et l’innombrable passant ».
Monique W. LABIDOIRE (www.francopolis.net, juin 2020).
Frédéric Tison a baigné chaque mot dans son Styx, son fleuve de mort personnel, avant de le déposer, rutilant, neuf, dans le poème. Chaque mot lâché par la bouche du poète est capital, sa vie en dépend. Sa vie ? Son chant intérieur, qu'on entend comme si le poète parlait à côté de nous. Mieux : en nous. C'est de la musique, c'est un rythme, discret et intime. Musique de l’âme.
Claire BOITEL (in Les Hommes sans Épaules n°52, octobre 2021).
LA POÉSIE DE FRÉDÉRIC TISON [1]
(..) Oiseau, image, ville, rue. Ces termes reviendront en leitmotiv chez Frédéric Tison. Il y en a d’autres, qui peuplent, bien au-delà de leur signification première, et avec toute leur charge symbolique, une œuvre emplie d’innombrables références temporelles et spatiales et en même temps complètement inclassable. Impossible de définir la poésie de Frédéric Tison : toute définition exclut, et ici tout est ouvert. Tout juste peut-on la considérer comme en permanence à la jointure du tangible et de l’impalpable. Au milieu de ce foisonnement, je ne peux que tenter de faire ressortir quelques lignes de force, pas forcément les plus importantes, mais en tout cas, celles ayant fait le plus appel à mon imaginaire de lecteur (..)
Ce n’est bien sûr pas un hasard si le syncrétisme revendiqué par Frédéric Tison avec la beauté se traduit par une relation très forte avec les autres arts, en particulier avec la peinture (proximité avec des peintres aussi différents que les miniaturistes médiévaux, Claude Gellée ou James Ensor), ainsi que par ses nombreuses collaborations avec divers plasticiens (peintres, graveurs, photographes...), l’art en général étant ici considéré comme une utopie de transformation intime. À quoi finalement sommes-nous confrontés ? À une œuvre affûtée au tranchant de l’absence et du perdu, et en même temps en désir permanent d’élévation, marche obstinée à la fois vers l’infime et l’infini, les deux intimement mêlés dans « toute l’eau lente et légère, celle où tu ne t’es pas encore connu ». L’imaginaire de Frédéric Tison n’invente pas, ne déserte pas : il recompose le monde.
Sa poésie manifeste la plénitude de la vie dans le jeu tragique entre l’harmonie apollinienne et le désordre dionysiaque. On l’aura compris, le confort n’existe pas quand on lit Frédéric Tison. Il chevauche une monture blessée qui s’appelle le langage, et la mène parfois très au-delà de notre perception première. La forme prend toute sa place dans cette démarche. Les polices de caractères (gras, italiques, capitales) s’entrechoquent. Les ponctuations explosent, parfois en des endroits inattendus, nous forçant à remettre en question nos évidences grammaticales. La résonance elle-même, dont nous parlions précédemment, est parfois syncopée, dissonante. L’objet s’éloigne du sujet (sur la page, mais pas seulement).
Certaines constructions de phrases, venues d’on ne sait où, nous laissent assoiffés, le poète nous mettant au défi de trouver la fontaine adéquate, et en proie à une fascination quasi chamanique. « L’autre chemin est sans chemin » disait Maître Eckhart. Ici on marche vers l’insu. Les réflexions du lecteur sont sans cesse empêchées de se dérouler linéairement, elles ne peuvent que tenter de rattraper le poème qui lui-même essaie de les semer, se laisse frôler pour bifurquer à nouveau sans prévenir. Un poème devient poème lorsqu’il cesse d’être une suite de vers pour devenir autre chose, dont on ne sait pas ce que c’est. Frédéric Tison nous fait devenir, presque malgré nous, « lecteur de lenteur en la Bibliothèque d’Or ».
Mais serons-nous capables, nous lecteurs, de consentir à notre propre métamorphose à la lecture de cette œuvre ? Et si oui, serons-nous disponibles ? Si nous le sommes, il nous faudra entrer à fond dans cette écriture de l’intervalle, puis s’en éloigner. Puis revenir, mais plus au même endroit, et on n’est plus le même. On ajuste passé un cap essentiel, celui de l’hermétisme, au sujet duquel on pourra dire, comme Jacques Dupin à propos de Char : « Son questionnement ouvre, dans les parois de la nuit qui le détient, les brèches par où s’engouffre et se fortifie la lumière ». Et on aura compris que le langage de Frédéric Tison, parfois difficile, met un baume sur les plaies que l’oubli du mystère trace sur la langue.
Le philosophe Giorgio Agamben a écrit : « La poésie est une opération dans le langage qui désactive les fonctions communicatives et informatives pour les ouvrir à un nouvel usage possible ». Dit autrement : à lire Frédéric Tison, on se prend à rêver d’un monde où le primordial serait le discours poétique, au-delà de toute autre préoccupation.
Je ne sais pas si l’écriture apporte le bonheur à Frédéric Tison, mais je citerai Foucault : « Ce n’est pas l’écriture qui est heureuse, c’est le bonheur d’exister qui est suspendu à l’écriture, ce qui est un peu différent ». Quoi qu’il en soit, l’œuvre de Frédéric Tison, nourrie du lointain passé, nous précipite en devenir, nous invitant à nous mettre en quête des mystères qui nous fondent, quête à la fois infructueuse et indispensable. Alors peut-être parviendrons-nous à « ouvrir d’un doigt délicat les ailes de l’oiseau noir aux yeux clairs ». Obscur et lumière une dernière fois mêlés.
Jean-Louis BERNARD
(Revue Les Hommes sans Epaules).
[1] Texte extrait de la conférence donnée par Jean-Louis Bernard sur l’œuvre de Frédéric Tison, le 25 novembre 2017 à Saint-Mandé, dans le cadre des rencontres de Arts & Jalons.
À Frédéric Tison, en mémoire.
La question est de granit
J’ai ta voix dans l’oreille
J’ai tes mots devant les yeux
La question devient tourbillon
Faut-il mourir pour être vu
Je prends ce livre que tu as grainé d’amitié
Je frôle une âme douce
De nature volcanique
Tu es là en demeure avec ton chant
Comme le sont Elodia
Jean et un autre Frédéric
Au détour d’un chemin
Là où la tempête a laissé son empreinte
Près d’un arbre majestueux
Tombé au travers de la rivière
Se sculpte dans un silence bercé par le vent
Ton beau visage
André PRODHOMME
(Revue Les Hommes sans Epaules).
*
Saisir la ville où l’ombre de toi-même est vague
Assez pour se confondre avec celles des arbres
Et murmurer… : l’empire où tout bruit est si vaste
Que tes lèvres en d’autres lèvres sont tombées ;
D’autres ici ont passé comme toi pour trouver
Au carrefour de branches et de pierre un visage.
Frédéric TISON
Poème extrait du livre Les Effigies (Librairie-Galerie Racine, 2013)
*
J’HABITE UN FEU NOIR, une herbe courbée — une tour aux premières marches brisées.
Je me meus dans la marge des livres : c’est moi, le petit visage d’encre qui regarde ailleurs ; moi, le rinceau rêveur ; moi encore, la petite main crayonnée qui signale le passage.
Je suis une ombre qui parle à la vie ; j’ai vu de l’or dans les yeux du monde : serais-je un soupir qui parle à ce désir ?
Je suis l’aphélie — Des falaises rongées du ciel étoilé, je rapporte des gemmes, des comètes, des yeux — des astres amoureux.
Frédéric TISON
*
Vesper
C’est comme cela que règne le soir
Au loin, dans le ciel, versant ses arènes
Noires et ses derniers soleils.
Ta lampe est une étoile plus pâle
Ton visage un automne plus frêle
Sous la voûte où dérivent les êtres sombres.
Touche de ta main le soir qui vient
C’est ainsi que se brisent les miroirs.
Frédéric TISON
*
Entretien sur le poème, et le poème en prose en particulier (22 février 2022).
Jean de Rancé.-. Cher Frédéric Tison, vous venez de publier un nouveau livre de poésie, Le Dieu des portes, dans le collection Les Hommes sans Epaules, aux éditions Librairie-Galerie Racine. En le feuilletant tout d'abord j'ai été surpris : c'est là un livre entier de poèmes en prose, ce qui est une première pour vous, si je ne me trompe.
Frédéric Tison.-. Vous avez tout à fait raison, cher Jean de Rancé. J'ai bien écrit, naguère, ou plutôt jadis, des livres entiers de prose (Histoires amnésiques, puis Les Contemporains intérieurs), mais il ne s'agissait pas véritablement de poèmes en prose, plutôt de courts récits ou de contes.
J. de R.-. Précisément, pourquoi le poème en prose ?
F. T. -. Le vers, que je creuse par ailleurs et qui m'est très cher, laisse parfois de côté certains états de la pensée et de l'émotion. Le poème en prose est propice à quelque traduction nouvelle, m'est-il apparu. Son exigence n'est pas moins grande que celle du poème en vers, et son rythme particulier me tentait depuis longtemps. D'autre part, j'essaie de construire des livres qui ne soient pas de simples recueils de poèmes épars, mais qui possèdent une cohérence interne forte, où chaque poème trouve sa place unique, et dont la fluidité suppose une lecture continue, et "logique", de la première à la dernière page. Adopter d'abord une même forme pour l'ensemble des textes m'a semblé, dans le cas précis de ce livre, l'une des conditions de cette cohérence, même si, naturellement, il me serait tout à fait envisageable de composer un livre de poèmes en prose et en vers mêlés, de même qu'il n'entre pas ici de considérations exclusivement formelles. Disons tout simplement, à la fin, que tout le livre s'est écrit dans l'intention d'en faire un livre de poèmes en prose.
J. de R.-. Le sous-titre du Dieu des portes est "Histoires en peu de phrases" : est-ce à dire qu'il s'agit là de contes rapidement narrés ?
F. T.-. Vous pouvez très bien entendre le mot histoire dans le sens de conte, en effet, et plusieurs textes ont pour trame une "histoire", un "récit", ou plutôt un fragment d'histoire ou de récit, même s'ils n'en sont pas à proprement parler. Mais histoire possède également le sens d'image (songeons aux manuscrits historiés des monastères médiévaux ou à ceux de la Librairie de Jean de Berry, par exemple). Quant au reste du sous-titre, il s'agissait, notamment, de souligner la brièveté des textes : il me semble en effet qu'un poème en prose, de même qu'un poème en vers, a plus de force quand il tient sur une page, quand le regard peut l'appréhender tout ensemble immédiatement. Dès lors, me direz-vous, les épopées en vers de jadis et de naguère, de la Chanson de Roland à Victor Hugo en passant par Agrippa d'Aubigné, ne pourraient plus faire aujourd'hui figure de poèmes ! Il serait stupide de le dire, bien sûr, mais il me semble (je précise que ceci ne vaut que pour moi) que notre époque appelle le poème court, lequel est de nature à dire ce qui nous arrive : le morcellement, la déréliction, la fluidité, l'extase, le moment saisi dans sa verticalité, mais aussi le tâtonnement, au sein de (et contre) la vitesse et la surcharge. Certains poèmes en prose selon Baudelaire, dans Le Spleen de Paris, me semblent tendre parfois vers la nouvelle, voire vers l'étude ; je pense au "Mauvais Vitrier", ou à "La Solitude", tandis qu'un texte comme "Le Port" atteint d'emblée la dimension du poème, sans que l'on se préoccupe, pour le définir en tant que poème, qu'il soit de vers ou de prose. De même, "Frisson d'hiver" ou "Réminiscence", chez Mallarmé, me semblent tendre davantage vers le "véritable" poème en prose que, par exemple, "La Déclaration foraine", qui est pourtant présenté comme tel par le poète — où je ne dis pas, faut-il le préciser, que ce dernier texte n'est pas en tout point admirable. Chez les modernes, c'est du côté de Pierre Reverdy, Antonin Artaud, Robert Desnos ou Louis Guillaume que se trouvent, selon moi, les plus belles réussites de ce genre à part.
J. de R.-. Le poème en prose n'est pas, bien sûr, de la prose poétique...
F. T.-. ... Non pas !
J. de R.-. ... mais il n'est pas non plus comparable à une suite de versets, dont l'origine est biblique, voire védique, et que l'on retrouve à l'époque moderne, notamment, chez des poètes tels que Paul Claudel ou Saint-John Perse, et aujourd'hui chez Pierrick de Chermont.
F. T. -. Il est vrai qu'il n'est ni l'une ni l'autre, même si le rythme particulier du verset peut s'y manifester parfois, je pense par exemple à certaines anaphores. Mais le poème en prose, est-ce une hésitation entre le verset et la prose française classique ? Je ne le crois pas ; ce n'est pas un genre hybride ; il s'agit d'une possibilité infiniment fertile, d'une autre solution du rythme de la langue. Et de même que le vers dit "libre" de la poésie moderne est l'objet de très nombreuses métamorphoses, d'ailleurs plus ou moins heureuses, le poème en prose peut être réinventé par celui qui en use. Quant à la "prose poétique", j'y reviens, cela n'a bien sûr rien à voir : le poème en prose n'est en rien une prose ornée, ni une prose qui imiterait lointainement le vers : chacune de ses phrases doit pouvoir se tenir solidement de telle sorte qu'en modifier un mot en amoindrirait la structure tout entière. Je ne parle pas seulement d'une syntaxe forte, que je crois absolument nécessaire par ailleurs, mais aussi du fait que le poème en prose doit proposer un autre Chant. Un bon poème en vers est celui dont les vers ne tremblent plus, et il en est de même pour les phrases du poème en prose — et si le poème ralentit le regard, je veux dire toutes nos lectures, en élargissant, en espaçant.
J. d. R.-. Je reviens à cette idée d'histoire au sens de récit. Déjà, Les Ailes basses, un livre que vous avez publié en 2010, avait pour sous-titre "Poèmes pour un Narrateur". Quelle serait la relation entre le poème et la narration ?
F. T.-. Cette relation est essentielle et lointaine à la fois. Le poème ne raconte pas comme un récit, une nouvelle ou un roman le feraient, mais il se nourrit de récits et d'histoires, de légendes et de mythes tout aussi bien. L'une de ses trames profondes, ou l'une de ses lames de fond, est le temps, où se déploie l'histoire, où s'amorcent, se développent et s'achèvent des histoires, et non seulement celles de l'auteur. Il est dans mes projets de composer un jour un livre de ballades en prose ; et dans toute ballade n'entre-t-il pas les éléments d'une histoire vécue ou légendaire ?
J. de R. -. Vous avez évoqué Mallarmé. Avez-vous lu ce qu'on écrit de vous à propos du « souci mallarméen » de vos écrits ? Qu'en pensez-vous ?
F. T. -. Oui, je l'ai lu bien sûr, ce sont les mots louangeurs de Paul Farellier. M'inscrirais-je dans une lignée mallarméenne ? J'en serais bien aise, et honoré — cependant ce n'est pas à moi de dire si mes écrits sont dignes ou non de ces mots. Vous connaissez sans doute ce qu'écrivit Paul Léautaud, au lendemain de la mort de Mallarmé, le 10 septembre 1898, dans son Journal littéraire : « Les journaux, ce matin, annoncent la mort de Mallarmé, hier, subitement, dans sa petite maison de Valvins. Celui-là fut mon maître. Quand je connus ses vers, ce fut pour moi une révélation, un prodigieux éblouissement, un reflet pénétrant de la beauté, mais en même temps qu'il me montra le vers amené à sa plus forte expression et perfection, il me découragea de la poésie, car je compris que rien ne valait que ses vers et que marcher dans cette voie, c'est-à-dire : imiter, ce serait peu digne et peu méritoire. (…) Les vers de Mallarmé sont une merveille inépuisable de rêve et de transparence. (…) Mallarmé est mort. Il a enfoncé le cristal par le monstre insulté. Le cygne magnifique est enfin délivré. Et quelle qualité : il était unique. » Je n'ai nullement été « découragé », pour ma part, de la poésie, devant un modèle ; même les plus beaux vers de Charles d'Orléans, de Scève, de Hugo, de Baudelaire, de Verlaine, de Mallarmé, de Jouve, de Reverdy ou d'Aragon n'ont su entamer ni briser mon désir d'écrire des mots qui tentent de former un poème. Jamais je n'ai voulu imiter, tout du moins jamais après mon adolescence. Je n'ai jamais pensé que « rien ne valait que » les vers de l'un ou de l'autre, même si j'étais ébloui par eux ; mais précisément, ils étaient si différents les uns des autres, ils exprimaient tant, et cela, avec des moyens si souvent étrangers les uns aux autres, qu'il ne m'a pas semblé que je ne pusse entreprendre d'ajouter, même modestement, ma voix aux leurs — fût-ce au prix d'une naïveté ou d'un orgueil, peut-être, mais qu'importe, à la fin, si cela est un désir. Vous voyez que j'ai cité Mallarmé parmi d'autres poètes que j'aime : il ne faudrait pas croire que sa figure éclipse selon moi toutes les autres, bien au contraire.
J. de R.-. Pourriez-vous tout de même préciser ce que représente, en particulier, pour vous la poésie selon Mallarmé ?
F. T.-. J'ai déjà, à la fin d'un précédent entretien, évoqué avec vous sa troublante définition selon laquelle
« La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle dote ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle ». Cette fameuse « tâche spirituelle », qu’il est très délicat de définir exactement selon les termes généraux du poète, n’est-elle pas elle-même fort troublante ? Qu’entendait le poète par-là ? Et ce « sens mystérieux », renvoie-t-il à l’énigmatique trouble "commun", dirai-je, celui auquel le monde nous soumet, par notre seule présence, d’abord insensée, au monde, ou bien également, ou premièrement, au Mystère médiéval chrétien, auquel fait référence le poème d’Hérodiade, Mystère en tant que scène théâtrale, où se joue, se rejoue plutôt, quelque épisode décisif, ultime et sacré, quelque Drame, écho lui-même des antiques tragédies grecques données au cœur de la cité ? Ces mots de Mallarmé sont si gorgés, voire si saturés de sens qu’il nous appartient, selon moi, de les examiner avec autant de soin que nous examinons le sonnet en yx. C'est cette exigence que j'aime chez Mallarmé, et l'élégance étonnante qui en résulte. Il nous resterait encore à examiner l'autre proposition de Mallarmé selon laquelle tout, au monde, existe pour aboutir à un Livre. Il est indéniable que cette pensée m'a profondément troublé, et que je n'ai jamais achevé l'un de mes ouvrages sans y songer. Mais ceci nous mènerait trop loin aujourd'hui, dans cet entretien qui est déjà peut-être trop long...
J. de R.-. Eh bien, nous aurons l'occasion d'y revenir. Avant de clore cet entretien, j'aimerais revenir au Dieu des portes. Il me semble que de nouveaux thèmes y sont abordés, et certains passages pourront peut-être apparaître un peu surprenants sous votre plume...
F. T.-. Une poésie accomplie (ou plutôt, en train de s'accomplir) est celle qui peut tout accueillir en son sein sans se trahir ; le poème sait coucher dans le lit de sa voix le murmure de la rivière comme le haut chant du torrent, l'ordure comme la grâce. Mais elle ne saurait le faire qu'en y soufflant, comme on souffle sur une braise pour faire un grand feu rougeoyant.
(Propos recueillis le lundi 11 avril 2016.)
Entretien avec Jean de Rancé — Sur 'Selon Silène' (29 mai 2018)
Jean de Rancé.-. Cher Frédéric Tison, après Aphélie, suivi de Noctifer, qui parut en février dernier aux éditions Librairie-Galerie Racine, vous publiez votre sixième livre, Selon Silène, paru en mai 2018 aux éditions L’Harmattan, qui n’est pour une fois pas un livre de poésie.
Frédéric Tison.-. Cher Jean de Rancé, c’est exact, même si j’ai écrit des livres de contes, jadis — mais ces derniers, je les ai auto-édités seulement.
J. de R.-. Comment l’idée de consacrer un livre à un tel personnage vous est-elle venue ?
F. T.-. Je m’en souviens, c’était en 2009, je lisais l’excellent livre de Georges Minois, Histoire du rire et de la dérision. Je retrouve devant vous ce passage qui me toucha vivement : « Dans un mythe raconté par Théopompe de Chios, Silène parle d’un pays extraordinaire où les hommes sont deux fois plus grands et vivent deux fois plus longtemps que chez nous ; ils n’ont pas à travailler et meurent dans un grand rire » (éditions Fayard, 2000, p. 20). Pour moi, Silène n’était alors qu’un simple satyre, figurant parmi bacchants et bacchantes dans le thiase, ce cortège bruyant du dieu du vin Dionysos : qui était donc ce personnage qui racontait de telles histoires ? Je cochai la page et me promis d’approfondir la question. Peu de temps après, je regardai mieux, au Louvre, une fort belle statue de marbre datée de l’époque romaine impériale, représentant Silène et intitulée Silène ivre : cette œuvre se souleva en quelque sorte devant moi, je me rappelai les propos du satyre rapportés par Georges Minois, et je me mis à faire des recherches ; je m’aperçus que le personnage était bien plus riche que l’on croit, que sa figure était bien plus complexe ; je lus, pris quelques notes, j’envisageai une sorte d’article ; mes notes de lecture enflèrent considérablement, et cela devint un petit livre, que j’élaborai entre 2009 et 2017, par fragments, lentement.
J. de R.-. Votre livre, je dois le dire, est assez déroutant : il oscille sans cesse entre le traité mythologique et la réflexion originale, voire le poème en prose. Ainsi certaines parties du livre sont-elles très personnelles, quand d’autres le sont moins.
F. T.-. Oui, c’est un livre hybride, vous l’avez noté : hybride… comme le satyre ! Je n’ai pas la prétention d’avoir toujours été original, notamment dans les passages du livre où j’évoque la geste de Dionysos, l’origine des satyres-silènes, ou encore la préfiguration possible de Silène observable dans la figure du dieu égyptien Bès. C’est qu’il est difficile, voire impossible d’être original en la matière : déjà Ovide, au Ier siècle après Jésus-Christ, s’inspirait de sources mythologiques parfois perdues pour nous, déjà Diodore de Sicile, dans sa Bibliothèque historique composée au Ier siècle, et Pausanias, dans sa Description de la Grèce écrite au IIe siècle, puisaient dans les livres de plus anciens mythographes. Plus tard, le Dictionnaire de la Fable (1801) de François Noël, le Dictionnaire mythologique universel ou Biographie mythique (1854) de Adolf Edward Jacobi, sans oublier le magistral Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines (1877-1919) de Charles Daremberg et Edmond Saglio, qui sondent les profondeurs de la littérature et de l’art antiques, ces dictionnaires inspireront les récits des traités mythologiques de Pierre Commelin, Jean Richepin ou Mario Meunier qui, dans leurs pages, en reprendront nombre d’éléments, de même que Pierre Grimal, dans son Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine (1951). J’ai fait de même, en rassemblant et synthétisant des éléments épars glanés dans les bibliothèques ; je dois dire que je fréquente depuis l’adolescence les ouvrages des mythographes, et je relis souvent Les Métamorphoses d’Ovide, au point que je me suis en quelque sorte approprié ces œuvres, et que j’en suis tellement nourri que j’ai pu parfois rédiger de mémoire, pour ce livre, tel épisode ou telle interprétation, en veillant toutefois à formuler de façon personnelle ce qui était narré (même si dans ce domaine la paraphrase est inévitable) : mais comment inventer, quand il s’agit de mythologie et d’anciennes traditions ? Et c'est, toujours, le phénomène séculier de la cryptomnèse. Aussi bien, ce n’est pas dans ces passages du livre que j’ai fait œuvre d’imagination : il ne s’agissait pas ici de récrire quelque mythe, mais de présenter ce que dictionnaires et traités avaient depuis longtemps mis au jour, afin d’avancer.
J. de R.-. Vous avez parlé de vos notes de lecture : comment avez-vous procédé ?
F. T.-. Je me suis retrouvé devant une masse considérable de documents, aux informations parfois contradictoires, si bien qu’il m’a fallu opérer un tri, choisir une version, en signaler quelques variantes. Mais l’exhaustivité fut impossible, de même que fut irréalisable la mention systématique, dans le corps de mon texte, de toutes les sources que j’ai consultées, et dont je me souvenais. C’est que j’ai pris de façon erratique, depuis 2009, beaucoup de notes glanées ça et là, sans esprit « scientifique » ; sans parler des réminiscences de mes années à l’Université… D’autre part, j’ai tenu à ce que les notes apparaissent en bas des pages et non à la fin (j’ai toujours trouvé assommant le fait de se reporter à la fin d’un volume pour consulter des notes qui souvent ne sont que de caractère bibliographique) ; si j’avais voulu tout référencer, à chaque occurrence, les notes auraient mangé presque la moitié de chaque page !
C’est d’ailleurs ainsi que j’ai pu mesurer combien les auteurs de l’Antiquité, pour rédiger leurs traités, devaient nécessairement avoir l’assistance de secrétaires. Virgile, ou Origène, par exemple, étaient secondés, dans l’écriture de leurs ouvrages, par de petites mains érudites anonymes — ces auteurs l’évoquent eux-mêmes au détour des pages de leurs écrits. Selon Silène fut rédigé par moi seul, d’où sans doute quelques approximations et peut-être, qui sait ? mais c’est inévitable, quelques erreurs, sans parler des oublis !
Le sujet est inépuisable, et les sources, bien cachées. On peut passer à côté d’elles bien souvent. Tenez, à titre d’exemple : je faisais récemment, sur un tout autre sujet, quelques recherches dans la Description de la Grèce de Pausanias : et voici qu’au Chapitre XXIV du Livre VI, je tombai sur un passage qui évoque Silène, passage qui m’avait échappé :
« On voit aussi dans cet endroit [Élis, une ancienne cité grecque de la région de l’Élide] un temple de Silène ; c'est à ce dieu seul qu'il est érigé, et non à lui et à Bacchus (Dionysos) à la fois. L'Ivresse lui présente du vin dans une coupe. Les Silènes sont une race mortelle, comme on peut le conjecturer par leurs tombeaux. On voit un tombeau de Silène dans le pays des Hébreux, et un autre dans les environs de Pergame. » (Traduction de M. Clavier, Paris : A. Bobée, 1821.)
Or, ce sont précisément ces remarques que l’érudit Samuel Bochart et le mythographe Pierre Commelin, auteurs que je nomme dans le Chapitre VIII de mon livre, avaient notées à propos des tombeaux de silènes respectivement chez les Hébreux et à Pergame, sans mentionner leur source !
La difficulté fut grande de construire un texte cohérent, s’articulant en chapitres. Cela reste pour moi une belle et enrichissante expérience d’écriture.
J. de R.-. Revenons à Silène : en quoi le personnage vous a-t-il semblé si intéressant ?
F. T.-. Je me suis aperçu que Silène n’est nullement réductible à l’image du vieux satyre hilare et aviné que les peintres et les sculpteurs nous montrent le plus souvent. À y regarder de plus près, Silène, et les satyres dans leur ensemble, précédent Dionysos, lequel les enrôle dans sa suite. Il ne faut pas oublier que, s’il représente une force vitale, violente, « primitive », Dionysos (tel qu'il apparaît dans l'entourage de Silène) est un dieu tardif : c’est lorsqu’il invente le vin qu’il entraîne à sa suite le cortège que nous connaissons, composé notamment de bacchants, de bacchantes, de bassarides (ces conductrices de tigres et porteuses de tambours) et de satyres.
C’est ainsi qu’il faut, à mon sens, distinguer deux ivresses : celle du vin, qui suppose une civilisation (le vin se fabrique, il n’est pas « naturel »), une ivresse incarnée par Dionysos (même s’il n’incarne pas que cela, bien sûr), et celle de la vie elle-même, que représentent les satyres, lesquels sont à l’origine des sortes de génies des sources, des arbres, des vents. On peut détacher Silène, peu à peu, à travers les textes des Anciens, du dieu du vin : s’il n’est qu’un pleutre chez les auteurs tragiques, d’autres auteurs en esquissent une image correspondant davantage à ce qu’il fut avant de rencontrer Dionysos ; d’ailleurs, il deviendra le précepteur du dieu, lui enseignant la science cachée des choses.
J. de R.-. Avant de représenter un être sous l’influence du vin, Silène incarne donc, si je vous comprends bien, l’ivresse de la vie elle-même ?
F. T.-. Selon nos sources, il est les deux, alternativement, ou successivement, il est à la fois un autre Dionysos et une autre forme d’ivresse, il est insaisissable. C’est une figure qui puise dans « l’archétypal », dans les émotions les plus primitives qui sont enfouies en nous. Il a beaucoup à nous apprendre, et mon livre n’est qu’une interprétation très personnelle de sa figure. Mais vous me permettrez de ne pas dévoiler le cœur du livre ni déflorer quelques histoires ; je laisserai le lecteur découvrir par lui-même.
J. de R.-. N’avez-vous pas craint de vous éloigner des exégèses traditionnelles, plus « autorisées »?
F. T.-. Il n’y a rien à craindre. Silène, comme tous les dieux ou les visages mythologiques, parle de nous autres hommes. « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », disait Chrémès dans l’Heautontimoroumenos de Térence. Cependant, nous ne pourrons jamais vraiment tout comprendre de la pensée des Grecs, c’est un monde trop éloigné de nous, même s’il nous donne l’illusion d’une plus grande proximité que ceux de l’Afrique ou de l’Asie. Nous en héritons, certes, nous en sommes tissés, comme du monde de Jérusalem, mais nous ne pouvons qu’en avoir une image partielle, partiale, voilée, lointaine. Paul Veyne a fait remarquer, si je résume, que la question de savoir si les Grecs croyaient ou non en leurs mythes ne se posait pas en ces termes, qui sont les nôtres, selon notre conception moderne, d’ailleurs assez floue elle-même, de la croyance : les Grecs savaient que les dieux existaient, c’est à peu près tout ce qu’on peut en dire, ils le savaient comme nous savons que nous sommes dans la Voie lactée, aujourd’hui. Cela dit, nous avons certainement perdu le sentiment, partagé chez les Anciens, que le sacré est agissant, que le dieu, les dieux, sont avant tout des forces, des énergies, avant d’être des idées soumises à la spéculation.
J. de R. -. Quel rapport entretient Selon Silène avec vos autres ouvrages ?
F. T. -. Silène apparaît de façon furtive dans nombre de mes livres, notamment dans Les Ailes basses et Le Dieu des portes. On peut très bien considérer Selon Silène comme une longue, très longue note de bas de page pour mes autres livres.
J. de R.-. Vous intervenez vous-même en tant que narrateur dans ce livre, vous mettant en scène en train de dialoguer, dans de courtes scènes, avec Silène lui-même.
F. T.-. Ah, ne confondez pas auteur et narrateur !
J. de. R.-. Non pas…
F. T.-. Mais vous avez raison, bien sûr : je n’ai pas eu la prétention de concurrencer un Jean-Pierre Vernant ou un Pierre Grimal, par exemple ; mon livre n’est pas « scientifique » ; je n’ai pas les compétences d’un philologue ni celles d’un universitaire mythographe. J’invite seulement mon lecteur à découvrir un regard. C’est pour cela que j’ai introduit un narrateur conversant avec Silène à certains moments du livre. Mon livre est, comme je l’ai mentionné sur la quatrième de couverture, « une promenade livresque, esthétique et philosophique » (modestement philosophique, naturellement). Se promener, n’est-ce pas une part essentielle de nos vies ? Et toute promenade n’est-elle pas l’itinéraire particulier d’un regard ?
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|

|

|
| Les Effigies | Le Dieu des portes | Aphélie, suivi de Noctifer |

|

|

|
| La Table d'attente | Nuages rois | Le Dernier chant d’Edwine, Œuvre poétique complète |