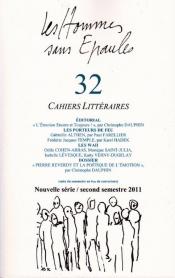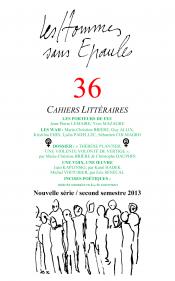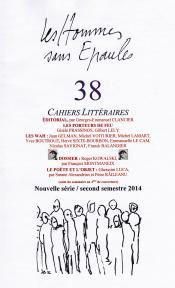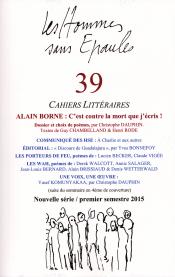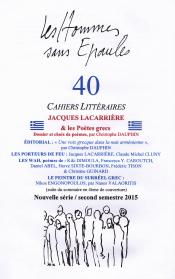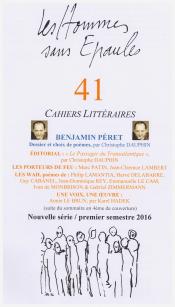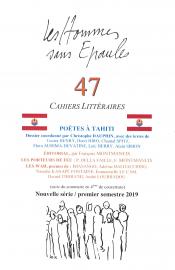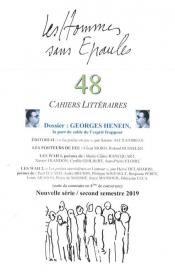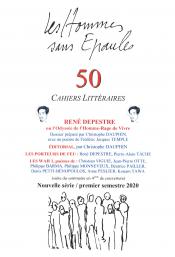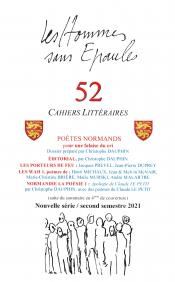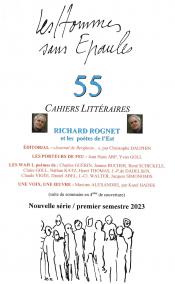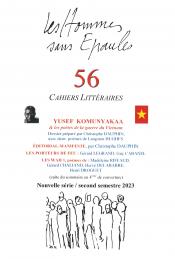Odile COHEN-ABBAS

Danseuse, poète, romancière, collaboratrice permanente de la revue Les Hommes sans Épaules, Odile Cohen-Abbas (née en 1957), a été membre du comité de rédaction de la revue néo-surréaliste Supérieur Inconnu. En vers comme en prose (où elle brouille les cadres traditionnels de la narration : ses textes n’ont pas une allure segmentée mais organique), l’écriture d’Odile Cohen-Abbas, éminemment poétique, est assurément l’une des plus étonnantes de notre époque. Sarane Alexandrian n’a pas écrit en vain (sa postface aux Fosses célestes) : « Comme Odile Cohen-Abbas prononce deux fois le mot « surréel », je confirme, au nom de mon livre Le Surréalisme et le rêve, qu’elle crée bien une surréalité intégrale, se situant entre Le Pèse-nerfs d’Antonin Artaud et Aurora de Michel Leiris. Avec une obstination inébranlable, elle poursuit une œuvre sans équivalent dans la littérature française d’aujourd’hui, préférant aux vanités de l’autofiction et aux banalités du réalisme l’invention audacieuse d’un univers fantasmagorique. »
Odile Cohen-Abbas déconcerte par la richesse de son univers et de ses images hallucinatoires, comme elle fait sensation en apparaissant dans la droite lignée de femmes surréalistes, hantées, à l’image de Joyce Mansour ou Léonor Fini, par un érotisme « funèbre » (par opposition à l’idéalisation de la femme) et par un onirisme tout à fait exceptionnel, comme par un humour qu’elle utilise comme une arme de dérision pour conjurer le sort : Les lèvres harponnées, condensée dans les ouïes - de son ventre, elle se laisse écrire les consignes et l’offrande, - voit le sang qui fatigue sa fleur, - loue le goût sans suture de sa langue, - et dentelle sa muqueuse à l’équerre de son membre. En fusion, l’image regorge de fureur intérieure et semble jaillir d’une bouche de feu : Les larmes guerrières comme des éclats de quartz, de silex, des cailloux, des galets qui déchirent la paupière inférieure – la peau des pleurs sur les genoux.
Décapante par son langage et déroutante par sa thématique, onirique de lumière et réaliste des abîmes, cruelle jusqu’à l’os et amour dans l’aorte de l’Éros. L’œuvre d’Odile Cohen-Abbas, prose et poésie, récit ou poème, chair de la jouissance grattée au scalpel et spirituelle dans un désert lucide avec ses appels du cœur, est inclassable, car chaque livre a une nouvelle charpente, qui échappe à toute définition, qui meure en garnison imaginaire. Elle dérange et vous mord les lèvres en mettant vos viscères à l’envers. Elle est corps, mouvement, désir et cri de femme qui met en joue le peloton d’exécution du réel : Que sortent les bataillons de la femme que j’esquisse ! Corps, désir et cri qui brûlent le socle de la convenance et de l’aphasie du quotidien : Pégase ailé de la femme ! – Donne ton coup de pied dans l’air, - fais tes albums avec les doublures du réel – et laisse l’origine sur la brèche !
Lamentations de la nuit ! Vers quel haut degré tendent les peurs dans l’obscurité ! - Des plaintes sans prunelles gisent dans l’encadrement de la porte de la ville, dans ses trèfles pourris de poussière et dans l’esprit abattu du veilleur. Femme libre, indépendante et assumée, Odile Cohen-Abbas n’en ressent pas moins la douleur de la condition de la femme, la violence subie à bien des égards, qu’elle dénonce : La femme s’inonde, - sa figure fuit dans la foule des tombes - comme une poule qui perd du sang - qui aurait avalé à la fois - son désir, ses prières, - et son propre bouillon de cendre. - Tu musardes, outragé ? Époux scindé ? - Fission d’ovaires, - sa jouissance se sauve en piaulant, - selon l’obédience à la terre – où chaque doigt, chaque métatarse - est compté. - Relapse, elle retombe inégale au cercueil défait. - Tu musardes, roitelet ? Défunt désert ? - Sur le tertre, des vents se pavanent, - amnistient l’ombre du cadran, puis celle de la femme. - Sous la pierre, son sexe est comble, - une fermeture éclair tirée jusqu’au ciel.
Lisons encore (in La Face proscrite, 2023), « Je m’emploie à faire recouvrer la santé à moi-même » : Si on ouvre le miroir facial de la Grande Prostituée, on s’aperçoit qu’il contient à l’intérieur une ennéade : vouivre, mère, fille, vierge, veuve, pauvresse, bacchante, strige, sauterelle (un nonet de sons – vielles, lyres, pianos à bande perforée) - elles, les bâtisseuses et les écroulées chantant un amour de l’être dans le miroitement à terreur sacrée, le miroir de la Grande Prostituée, leurs traits, sang, rides, grains de beauté mêlés à Ses traits qui ont tout gaspillé du bonheur, du malheur, elles, les biches de Dieu, nées par le siège, dans la broyeuse du miroir, - la non-mixité du Jugement dernier.
Odile Cohen-Abbas interroge les mains perdues dans la bataille du vivre autant que le mouvement primitif des nuits, sachant que les mots voulant sa savonner de leur peur, - meurent au fond des baignoires. Elle met mal à l’aise par la pierre dans la chair et l’incise du rythme du poème : Ligote le gigot de la langue saigneuse, - pique tes signes de chamade neuves ! Mais elle éclaire, réconforte, lorsqu’elle fait rouler l’os de l’imaginaire dans la cavité du Merveilleux : Là-haut c’est déjà les comices agricoles des gigues – et des barcarolles, - des cheveux d’aube au milieu des atolls, - il y a un quart d’heure d’une étoile à l’autre. – J’ai tant d’impatience, - de ressource en ma chair – pour avec toi, - ta parallèle ! Les royaumes suspendus de l’imaginaire sont des mises à nu sans trompe l’œil et la patrie d’Odile Cohen-Abbas, ainsi que son vers tiré sur un bord d’horizon, sa phrase : derrière les yeux seconde – jetés dans le tronc du sommeil, - il y a eu une mer, - une mer facile, possible – peut être la vraie, peut-être un mime, - un ton au-dessous de tous les bleus. – Et du rêve de la mer… - naissait une seconde mer…
En une vingtaine de livres, de Le Livre des virginités (2001) à La Maison des gestes (2021), Perditio (Unicité, 2022) ou La Face proscrite (2023), en passant par Long feu aux fontaines (2018), Odile Cohen-Abbas s’est imposée comme l’une des voix les plus singulières et déroutantes, à la fois, de la scène poétique contemporaine. Singulière, car sa voix ne ressemble à aucune autre. Ses œuvres font toujours fi des lieux communs. Aucune complaisance ni clichés au sein de cette œuvre authentiquement poétique, qui n’est pas enfermée dans un corset formaliste. Odile Cohen-Abbas est le meilleur antidote à la platitude. Voyelle (2018), par exemple, ne fait pas exception à la règle, qui a paru quelques mois avant Long feu aux fontaines, le grand œuvre poétique odilien, qui reprend trois livres de poèmes épuisés et trois inédits : à lire d’urgence ! Voyelle est un condensé de l’art odilien, mêlant vers, prose et théâtre. Ce récit-poétique initiatique débute dans un jardin, où le groupe des idolâtres, constitué de dix personnes, s’active, avec une pelleteuse, à déterrer un golem. Ce jardin, c’est celui de la narratrice-poète Ilinnaé, que l’on devine double du poète. Poème en prose, pièce de scène, récit initiatique et ontologique fuyant l’ennui et la prétention, Voyelle ne se raconte pas, Voyelle se lit et se vit dans le cousinage de Dada et d’Alfred Jarry, par son haut sens de la dérision et de l’absurde, du jubilatoire et du rêve inassouvi. Voyelle est un texte magnifiquement, sublimement odilien !
Restons avec « Voyelles », dont Arthur Rimbaud dans son célèbre sonnet de 1872 fait correspondre une couleur à chaque voyelle. A noir (« noir corset », « mouches »), E blanc (l’innocence, « candeur », « vapeurs », « Ombelle »), I rouge (« pourpres », « sang », « lèvres », « colère »), U vert (« virides », vert bleuté et transparent), O bleu (« suprême Clairon », « Anges », le divin associé à la couleur bleue). Odile va de son côté s’attaquer à une autre prouesse, thème récurrent dans son œuvre : l’Aleph Bet, l’alphabet hébraïque, qui n’est pas qu’un simple alphabet. Au commencement Dieu créa l’alphabet. Dans la tradition juive, en effet, on dit que Dieu créa le monde à l’aide des lettres hébraïques. Par la combinaison de ces vingt-deux lettres fondamentales se forma l’ensemble de la création, et c’est à partir du nom formé des deux premières lettres « Aleph-Bet », que naquit la parole. « Aleph », c’est le Un, l’Unique, l’expression simple de la divinité, contenant tout et dont tout découle. Le commencement du commencement. Les lettres hébraïques ont une valeur numérique symbolique et mystique qui est abondamment illustrée par la Kabbale.
Si Rimbaud fait correspondre une couleur à chaque voyelle, Odile va, elle, réaliser une prouesse encore plus grande que le Rimbe et écrire (in La Face proscrite, 2023) « Répondances pour les 22 lettres de l’Alphabet hébraïque » : « Je me suis concédée non pas toute la liberté, puisqu’il me fallait tenir compte de la symbolique et des éléments constitutifs de chacun de ces signes, mais une certaine forme de liberté qui est la mienne, aussi illusoire soit-elle, et à laquelle je me suis toujours efforcée. Le résultat, je l’espère, sera musical, car l’harmonique capte en elle tout le sens et les extrapolations conscientes et subsidiaires du message. » Ainsi, comme dans la tradition ou chaque lettre est un voile qu’il faut soulever pour voir apparaître son mystère. Il en va de même avec les 22 poèmes odiliens : Alèf, visions du monde gestationnelles, associées dans une coupe d’ailes, d’étincelles mélodiques, comme un essaim de golems femelles, de coursiers de lumière, d’ici doucement mortel… Alèf, dont il est interdit de capturer l’instant dans un seau terrestre, un seau d’étable, dans l’eau froide d’une prière.
Le livre d’Odile Cohen-Abbas peut être uniquement constitué de poèmes en vers comme il peut prendre l’apparence d’un texte de scène, propre à être joué au théâtre. Le poème peut également s’immiscer, de manière à l’innerver, dans le récit en prose. Le linéaire et le cartésien ont ici peu de prises. C’est sans doute, pour une part, ce qui explique la proximité d’Odile Cohen-Abbas avec le surréalisme, l’une de ses influences majeures, mais digérée ; mouvement qui n’est surtout pas étroitesse de forme ou d’esprit, mais au contraire ouverture totale de l’Être : Une corde pour l’écrit, - une corde pour le sexe : - deux couleurs différentes pour empêcher - qu’elles ne se confondent ou fassent des nœuds, - ou ne descendent trop longtemps l’une dans l’autre en apnée, - comme deux exécutées, - avec leur coffre à futurs inondés.
Odile Cohen-Abbas n’a pas besoin de tuteur et de chemin balisé. Elle prend, au contraire, un malin plaisir à emprunter les chemins de traverse. Et lorsque ceux-ci n’existent pas : elle les invente.
Le poème mauvais
Au commencement sous la mort je retourne le protocole,
je fais serment de toujours mystifier la lettre,
je suis, sans filiation, l’appel haineux du poème,
l’anti thème de déconstruction,
mes ingérences ont des pansements plein les épaules.
Au commencement, j’ai baigné dans l’effigie du revers,
ma face est vive et mes membres sont paralysés,
mais je souffle encore ma nécrose de vindictes
avec ma langue non appareillée.
Je suis l’affect funeste du texte, son corps spirituel, désaxé.
Ceux qui me courtisent, me pratiquent dans l’ascèse,
m’ont fait le diagnostic d’un verbe sanguinaire.
Je mange sur les phalanges la viande anthracite
des derniers repères.
Je suis l’esprit de gibet des feuillets,
je procède par nœuds et par cordes,
je suis l’esprit de fer des poèmes
quand il m’arrive de planter des clous dans les paumes.
J’introduis le mal en leur sein,
parfois j’en sauve et soigne certains,
j’aime à voir un livre ouvert changer de couleur
au contact de ses drains.
Ce qui coule hors de moi s’infecte,
contamine le dédale des pages, leurs infimes sillons.
Nul ne peut me défier au dialogue,
la nécessité qui me crée a caché mon nom.
Je suis le souffle, le sang d’aliénation dans les hymnes,
peut-être ! mais sans cette contrainte,
ce crochet à l’envers que je suis,
rien ne se pense ni ne s’écrit.
Mais il est tard, j’ai vidé ma semence
au cœur des signes qui pensent,
j’ai souscrit aux impasses de la main, suffisamment,
et l’imprimeur m’attend.
(Poème extrait de Long feu aux fontaines, Les Hommes sans Épaules éditions, 2018).
Nous partons toujours de la réalité et parfois la plus grave, mais, très vite, la réalité dérape, déborde, pour être absorbée par un imaginaire des plus fertiles et gagner les hautes terres ou ciels du surréel, dans une langue, un langage, des plus riches, en des vers charnus et charpentés, sensuel, érotiques, et donc, coupants comme des lames ; des phrases cambrées qui fusent comme des flèches. Il n’y a pas de temps morts, mais une dynamique de tous les instants. Le poème ou texte odilien ne tient pas en place, comme son auteur : Alors, la fête de mes membres tonnerait - comme une moisson de hêtres en marche. - Alors je donnerai congé aux oblitérations de l’âme, - une poutre de glaise pour le dos, - deux poutrelles pour les pieds, - des pièces honnêtes pour m’aider à passer. - Place à mon corps, en bonne et due forme ! - Place aux coups dans les vantaux et les chambranles des portes.
Odile Cohen-Abbas écrit dans Perditio (2022), qui est l’un de ses plus grands livres, un chef d’œuvre désarçonnant, merveilleux et terrible à la fois : Qui actionne la mort acrobate ? Qui déroule le deuil ? Qui éprouve la valeur de Gorce ? La métropole qui bientôt changera ses notables, ses clercs, ses artistes, ses petites sectes et sa police contre des brancardiers avertis ? L’air malade coule par les ponts et par les artères, répand ses humeurs pénales en série. Chaque jour, une cohorte de Prières se décroche des murailles, à la nuit, causant çà et là des ulcères, des stigmates sur la pierre, des trous moites comme de clous ou de tiques. Les premiers affectés de ce phénomène, du retrait augural des Prières, sont les femmes nubiles, les poètes et les aliénés, trouvant dans leurs veines, dans leurs âmes moribondes, des bacilles de verbe et de songes. Pourtant la majorité des habitants poursuit encore une marche insoucieuse, se déplace sans vergogne sur des bris de lumière mêlée de bran ou de chloroforme, sans songer qu’à contre-fil, transmuant les données de l’enjeu, un soleil se détruit. Un matin sur Gorce, on n’entend plus une seule Prière… Que reste-t-il à faire, sinon – dîneurs, dîneuses invétérés, et ivres de leurs bombances en ruines –, à engouffrer en rêvant, chacun à sa manière, le membre perdant, blessé de Gorce, le sexe déjeté de la ville entre ses dents…
De ce livre volcanique d’une grande violence physique et émotionnelle, Odile Cohen-Abbas dit à Étienne Ruhaud (in Actualitté.com, 27/10/2022) : « Il y a une divergence troublante, expérimentale entre le contenu de mes textes et ce qui constitue le fond de ma personne, les éléments de ma personnalité, ce par quoi je me suis faite, ce qui se structure et me structure comme conscience et comme loi… La liberté du livre n’est pas celle de la vie. Elle est celle d’une perspective, d’une tentation de l’extrême, d’une mise en œuvre de la connaissance de la matière humaine. Pas une consécration ! De plus il n’est pas de mutilation gratuite ou superfétatoire dans ces lignes. Les quelques violences que tu évoques ne sont pas celles que l’on commet envers soi-même ou envers les autres, mais celles des terreurs qui nous rongent. Et c’est oublier surtout l’argument essentiel de l’ouvrage : la disparition des Prières, des particules des hautes sphères, de l’élévation — fût-elle profane — entraînant cette dramaturgie fantasmagorique d’une fin du monde… Il me semble que j’ai gardé jalousement un potentiel de tendances récurrentes, archaïques, suffisamment antagonistes pour me secouer de tout ce qui n’est pas moi, me secouer de tout ce qui n’est pas le tout, le vrai, acceptant le jugement de l’ambivalence pour accéder aux degrés de ma liberté. Retrouver ainsi l’affranchissement premier, le décollement perdu, le décollement pressenti à l’égard de toute chose. C’est pourquoi mes personnages évoluent aux prises avec des idéalités transgressives, se débattent en des postures vaines, pathétiques, entre les chaînes et les anti-chaînes du plaisir. Le monstre « sadique » et le monstre « masochiste », avatars organiques du bien et du mal, de se vouloir du bien, de se vouloir du mal, de se prendre pour le bien, de se prendre pour le mal, préexistent, mais sont aussi dans la procédure intime, évolutive, des éléments de lutte, d’avancée hors de l’abîme. À condition de ne pas se prendre pour l’autre… L’acte de joie ! L’affirmation d’une position, d’une attitude qui professe : je consens à la vie ! Sans chercher dans ce contexte romanesque à la dépouiller (la vie) de ses assauts, ses contradictions, ses leurres, ses pièges, sans même tenter d’arracher, s’ils sont passages, combats avec l’ombre ou la lumière, ses masques mortifères ! Il y a lutte, défi, expression d’une existence qui à chaque instant se conquiert. Il y a lutte pour restaurer, engendrer, par le cœur et le corps, de nouvelles Prières. C’est la source constante qui sous-tend — se peut-il qu’elle se soit tue ! — Perditio. Pour moi, le mystère, le sordide mystère, serait d’être sans joie ! »
Perdito peut être décrit comme le récit-poème d’un monde apocalyptique. La face apocalyptique chez Odile déverse dans l’érotique de ses multiples agonies toutes ses sonorités animales, toux, éternuement, renâclement, éructation, rires, magma de sons tombés du spéculum glaireux de l’homme primitif, gardant pour seul amant le cabinet de glaces où ses reflets sonores, tonitruants, se multiplient à l’infini.
Est-ce son amour des mots, qu’elle prend un malin plaisir à faire courir ? De la musique, dont elle aime secouer la nappe des notes et des corps ? Le fait d’avoir été danseuse et d’avoir conservé la passion, la « bougeotte » de cet art ? Une chose est certaine, voilà un grand appétit de vie, du vivre. Il y a, qu’aucun thème, aucun sujet, rien ne semble être interdit ou exclu ; ce qui nous renvoie à la personnalité de ce poète dotée d’un grand enthousiasme et sens de l’humour, d’un appétit de vie et de connaissances insatiables, d’une exigeante et insatiable curiosité, d’une grande générosité. Ce que confirment ses œuvres de création tout comme ses essais ou son travail critique dans la revue Les Hommes sans Épaules. Lire Odile Cohen-Abbas relève de la surprise, du jubilatoire, du douloureux parfois, mais toujours avec de l’humour, de la dérision, de la révolte, de la colère aussi et le plus souvent de l’amour, du Merveilleux, du jamais vu et du jamais lu ailleurs.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
À lire : Le Livre des virginités (Comp’Act, 2001), Feu (Abstène et Bobance, 2004), La Rougeur d’Umbriel (L’Esprit des Péninsules, 2004), Marne noire, marne blanche (Lieux-Dits, 2004), Neuf déserts (La Sétérée, 2005), Grand jeté (Lieux-Dits, 2007), Les Fosses célestes (Rafael de Surtis, 2008), L’Agneau de chambre (Rafael de Surtis, 2009), Le Ministère des verges (Librairie-Galerie Racine, 2011), Terpsichore dans les catacombes (Rafael de Surtis, 2011), La Femme mâtée in Le Rendez-vous des amis, ouvrage collectif avec Sarane Alexandrian, Christophe Dauphin, Guy Benoit, Paul Sanda, Jehan Van Langhenhoven (Rafael de Surtis, 2011), Loëlle Bénédicte Losthal (Rafael de Surtis, 2012), L'Emoi du non (Les Hommes sans Epaules/LGR, 2013), Les rires fous d’AlefBêt… (Librairie-Galerie Racine, 2016), Marcel en larmes (éd. Rafael de Surtis, 2016), Voyelle (éd. Rafael de Surtis, 2018), Long feu aux fontaines, oeuvre poétique, préface de Jehan Van Langhenhoven, postface de Christophe Dauphin (Les Hommes sans Epaules éditions, 2018), Virginia Tentindo, les mains du feu sous la cendre, essai, avec Christophe Dauphin (Les Hommes sans Epaules / Rafael de Surtis, 2021), Le canon Sanda, essai (édition unicités, 2021), La Maison des gestes, orné par Alain Breton (Collection Parole et Peinture, Les Hommes sans Épaules éditions, 2021), Perditio (Unicité, 2022), La Face proscrite, postface de Christophe Dauphin (Les Hommes sans Epaules éditions, 2023), La Pluie d’Elma Bauher (éditions uncicité, 2024), Pièces de circonstance, avec Sarah Mostrel, théâtre (Z4 éditions, 2025).
A consulter : Patrick Lepetit, Odile Cohen-Abbas sourcière, essai (éditions Rafael de Surtis, 2025).
ENTRETIEN AVEC ODILE COHEN-ABBAS
par Étienne Ruhaud (in Actualitté.com, 27/10/2022)
Intitulé Perditio (unicité, 2022), le roman décrit un monde dégradé, sinon apocalyptique, et où des êtres cruels évoluent dans la violence, se mutilant les uns les autres, ou s’auto-mutilant. Peux-tu nous en dire davantage ? Qu’est-ce qui t’a poussée à écrire Perditio ?
Odile Cohen-Abbas : Permets-moi de te répondre un peu à côté, car c’est dans les à-côtés que l’on trouve souvent les choses qui nous intéressent. Il me faut d’abord révéler ce que dès longtemps je me suis révélé à moi-même : c’est qu’il y a une divergence troublante, expérimentale entre le contenu de mes textes et ce qui constitue le fond de ma personne, les éléments de ma personnalité, ce par quoi je me suis faite, ce qui se structure et me structure comme conscience et comme loi.
Les livres seraient-ils le lieu d’une enquête illicite, d’un laboratoire où comme dans un succédané du rêve, outrepassant la dualité constitutive du bien et du mal, donnant une autre couleur aux passions, aux affects, contrefaisants, fendant à vif les peurs, les désirs, les émois, se donne libre cours la multiplicité des possibles, des figures contradictoires, contraponctiques que l’on aurait pu devenir ? Il s’en est fallu de peu parfois… les sévices, les meurtres contre les signes et les songes vont bon train. Mais voilà, on choisit, il s’est opéré la puissance positive, la magnificence d’un choix qui va définir la teneur et les frontières de notre être, en découdre avec l’épreuve tout au long d’une existence, d’une voie.
Dans ce sens la liberté du livre n’est pas celle de la vie. Elle est celle d’une perspective, d’une tentation de l’extrême, d’une mise en œuvre de la connaissance de la matière humaine. Pas une consécration ! De plus il n’est pas de mutilation gratuite ou superfétatoire dans ces lignes. Les quelques violences que tu évoques ne sont pas celles que l’on commet envers soi-même ou envers les autres, mais celles des terreurs qui nous rongent. Et c’est oublier surtout l’argument essentiel de l’ouvrage : la disparition des Prières, des particules des hautes sphères, de l’élévation — fût-elle profane — entraînant cette dramaturgie fantasmagorique d’une fin du monde.
Le sexe est également omniprésent dans Perditio. Les personnages — monstrueux — qui peuplent le roman ont en effet de multiples rapports, extrêmement brutaux. Peux-tu nous en dire davantage sur cet érotisme parfois sadomasochiste, souvent déroutant ?
Je crois qu’il faut avant tout retirer l’écorce des mots, les appellations traumatiques (ex. : sadisme, masochisme) pour qu’ils retrouvent un sens plus libre. Trop d’états qui devraient demeurer ce qu’ils sont, des propositions constituantes, caractéristiques, de longues et mystérieuses élaborations en nous, sont réduits à des chocs verbaux. Ainsi en est-il des élucubrations du désir et de l’amour.
En ce qui me concerne, ne pas oublier les spasmes subtils et équivoques de la dualité qui me compose : dans le même mouvement, la même ascension, je suis amoureuse et haineuse de moi-même.
Car il me semble que j’ai gardé jalousement un potentiel de tendances récurrentes, archaïques, suffisamment antagonistes pour me secouer de tout ce qui n’est pas moi, me secouer de tout ce qui n’est pas le tout, le vrai, acceptant le jugement de l’ambivalence pour accéder aux degrés de ma liberté. Retrouver ainsi l’affranchissement premier, le décollement perdu, le décollement pressenti à l’égard de toute chose.
C’est pourquoi mes personnages évoluent aux prises avec des idéalités transgressives, se débattent en des postures vaines, pathétiques, entre les chaînes et les anti-chaînes du plaisir. Le monstre « sadique » et le monstre « masochiste », avatars organiques du bien et du mal, de se vouloir du bien, de se vouloir du mal, de se prendre pour le bien, de se prendre pour le mal, préexistent, mais sont aussi dans la procédure intime, évolutive, des éléments de lutte, d’avancée hors de l’abîme. À condition de ne pas se prendre pour l’autre !
On est également frappé par l’aspect théologique. L’un des personnages s’appelle Prières. Peux-tu nous en dire davantage ? Quelle est donc cette mystérieuse religion ?
L’acte de joie ! L’affirmation d’une position, d’une attitude qui professe : je consens à la vie ! Sans chercher dans ce contexte romanesque à la dépouiller (la vie) de ses assauts, ses contradictions, ses leurres, ses pièges, sans même tenter d’arracher, s’ils sont passages, combats avec l’ombre ou la lumière, ses masques mortifères ! Il y a lutte, défi, expression d’une existence qui à chaque instant se conquiert. Il y a lutte pour restaurer, engendrer, par le cœur et le corps, de nouvelles Prières. C’est la source constante qui sous-tend — se peut-il qu’elle se soit tue ! — Perditio. Pour moi, le mystère, le sordide mystère, serait d’être sans joie !
La couverture est ornée par une illustration médiévale représentant une scène infernale : cinq pendus accrochés au même gibet, en train de brûler, sans doute exécutés par un démon situé sur la gauche. Les chapitres ont souvent quelque chose de très pictural. Quel est ton rapport à la peinture ? As-tu voulu, comme Dante, décrire l’Enfer ? Est-ce le sens de Perditio ?
Les influences s’oublient et se régénèrent, souvent à notre insu. Il y a quelques années, j’ai développé l’argument d’un récit Le Gilles à partir de la seule observation assidue du Pierrot de Watteau. Les heures passées devant un tableau déroulent le fil inextinguible de l’imagination, créent des prises de contact inconscientes, d’une portée, d’une valeur insoupçonnée. C’est un peu l’enjeu d’une intime prophétie, d’une révélation privée et manifeste.
Pour ce qui est de l’illustration de la couverture, il s’agit d’une miniature du XIVe siècle. Son titre : Pèlerinage de l’âme. En enfer, supplice des médisants, en dit suffisamment. Je laisse à chacun sa propre extrapolation.
Composé de chapitres, le livre décrit demeure narratif. Peut-on pour autant parler de roman au sens strict ? Tu as choisi de ne pas indiquer le genre même de Perditio : ni sur le quatrième de couverture ni dans le prologue.
C’est qu’aucune appellation ou classification par genre ne me satisfait. Toute recherche serait affectée. Le texte c’est de la matière, de la matière d’être, du vivant, de la texture poétique, organique. Le livre est nommé, il a un nom, il existe, cela lui suffit.
Perditio possède également une dimension éminemment théâtrale. Chaque chapitre s’ouvre par une brève scène, un court dialogue. Par ailleurs, tu parles un moment de didascalies. Tu as été danseuse professionnelle. Es-tu influencée par le théâtre ?
Cela a été longtemps un conflit pour moi, un dilemme à travailler, à approfondir : voir ou avoir une vision de la scène, de ce que je veux positivement représenter dans l’écrit. Autrement dit l’alliance entre l’aspect, l’option lyrique d’un texte et celle de son impact rationnel et cinématographique, pose-t-elle problème ? Un œil pour comprendre, voir, s’approprier le sens, les images et un œil pour s’en éblouir, s’en affranchir. Mais tranche-t-on dans l’asymétrie d’un visage, d’un regard ? Dans la danse, le corps remplit la fonction de l’œil sensible et l’esprit, la mémoire, de l’œil extatique. La résolution artistique de cette dualité se trouve certainement dans la combinaison prudente et largement énigmatique des deux.
Cela étant, je veux ajouter pour la cohérence constructive de mes livres, que je change perpétuellement d’avis sur les œuvres littéraires, picturales, dramatiques et les êtres au point qu’ils en deviennent une vivace, inexhaustible ressource de surprises, une sorte de déséquilibre de l’imaginaire, quitte à revenir souvent à ma position première. Et c’est probablement ce processus, cette échappée, cette évasion continuelle du spectacle où les influences se courtisent, se contredisent, se défont l’une l’autre, qui stimulent mon propre désordre et mon propre chaos créatif.
Tu es l’auteure de plusieurs recueils. On est frappé par le lyrisme, qui se dégage de Perditio, par le jeu des allitérations. Peut-on ici parler de poésie au sens strict ?
Mes années « Danse » n’auront jamais fini de me distiller les rythmes, les assonances, les montées en faveur, en extase tout ce qui relève des sphères intérieures/extérieures du mouvement. Les phrases, les mots, la ponctuation, les passages à la ligne s’inscrivent pour moi dans une harmonie plénière et physique, un magistère onirique du corps. Il n’y a pas de poésie au sens strict puisque c’est ce déplacement perpétuel de la chair, des humeurs et du sang qui prime, préside aux vues, vision et intellection, à la fois contrôlées et aléatoires, ouvertes sur le hasard et les intempérances de l’élan. L’âme de la danse c’est aussi toucher la corporalité du texte comme un animal qui vous répond !
Tu utilises un vocabulaire médical souvent extrêmement précis, sinon spécialisé. Faut-il y voir une façon de brouiller les pistes, d’accentuer l’hermétisme même du texte ? De s’éloigner du champ commun, des mots de la tribu qu’évoque Mallarmé ?
Il m’a semblé nécessaire parfois d’engager dans les voies du récit, de faire apparaître à des fins de script, de synopsis tangible, des traces, voire des évidences du monde réel, tels une saignée (pardonne-moi la fatalité du terme), une décongestion, un allègement de la trame lyrique. Le vocabulaire de la médecine laisse une traînée de morbidité derrière elle, comme une lésion textuelle, une somatisation scripturaire, autant de preuves, de manifestations concrètes et spectaculaires, pour ainsi dire définitives et irrémissibles, de la dégradation spirituelle. Si ces croisements de registres, ces collections incongrues de lexiques rendent le texte plus obscur, c’est à mon insu. Je serais plutôt naturellement, par goût légitime ou illégitime, du côté des « mots de la tribu ».
On songe naturellement à Dante, cité plus haut, mais aussi au Mirbeau du Jardin des supplices, ou encore à Lautréamont. Quelles sont tes influences ?
Je ne sais. Elles (ces influences) sont libres et multiples, d’origine mystique, artistique ou profane, parfois trouvées dans les petites scènes les plus anodines du quotidien sans que mon esprit n’opère aucune sélection. C’est peut-être cela qui les caractérise, de n’être l’objet d’aucune intention, attention, élective. Elles s’accouplent en secret, se fécondent les unes les autres pendant mon sommeil, mes rêves, mes réflexions, mes lectures, mon introspection, ou pendant que je m’emploie à tout autre chose, au fil de mes expériences et de mon évolution. Je prends tout de l’être, de la matière dispose. J’aime sans borne ni équivoque !
Alors oui, les auteurs que tu as cités et tant d’autres ont traversé ma vie : Dante, Mirbeau, Lautréamont, mais aussi Char, Valery, Saint-John Perse, Mallarmé, Colette, Proust, Yeats, Poe, Shakespeare, Zweig, Schnitzler, les anthologies de la poésie russe et chinoise, les livres anciens, rares, (pardon, je ne sais pas choisir !) les traités de maintien et d’art de vie de l’antiquité, les essais d’historiens sur les thèmes du rire, du diable, des sorcières, du purgatoire, je cite au hasard cette liste inépuisable et enfin interrompue ! Au moment où ils étaient là, je leur donnais toute ma disponibilité, mes heures les plus chères, diurnes et nocturnes, ma responsabilité de lectrice, toutes les facettes de mon énergie. C’est cette force d’amour qui me fertilise.
À cela s’ajoute un engouement qui ne s’est jamais démenti pour les philosophes et les auteurs mystiques. L’histoire de la pensée et des religions me passionne. C’est l’essentiel de mes lectures aujourd’hui.
Lautréamont nous renvoie évidemment au surréalisme, dont il demeure un grand précurseur. Tu as toi-même travaillé avec Sarane Alexandrian au sein de la revue Supérieur Inconnu. Te sens-tu surréaliste ? Perditio possède-t-il une dimension surréaliste ?
Sarane Alexandrian a été et demeure la clef de voûte d’un univers qui m’a illuminée. Ce grand penseur et théoricien d’un « art de vivre », auquel il était très attaché, avait aussi un pouvoir de transfiguration. Devant lui quelque chose qui était déjà là en nous, mais non manifesté se mettait soudain à exister, la part la plus brillante de notre destin et de notre passion prenait consistance, car il avait ce don de voyance dans le cœur des êtres, et longtemps son intention éclairée, généreuse (son regard vert était un choc de bonheur) nous guidait par-delà nous-mêmes, chassait l’ignorance et le temps passé à rien.
Nous, c’était (c’est toujours) le petit groupe, la « famille » qu’il avait constituée autour de lui : Christophe Dauphin, Marc Kober, Virginia Tentindo, Virgile Novarina, Paul Sanda, Constantin Makris, Remi Boyer, Roselyne Gigot, Patrick Lepetit, Jehan Van Langhenhoven, Patricia Heckenbenner, Lou Dubois, et d’autres encore avec lesquels par sa volonté et sa tendresse insignes, mais aussi par tout ce que nous avons construit et vécu depuis, je me sens éternellement liée !
Avant lui, c’est-à-dire avant les années 2000, mes rapports avec le surréalisme étaient très disparates, et pour ainsi dire muets, comme si une force attractive, refoulée, trop intense ou trop signifiante m’en tenait à distance et attendait l’instant de sa révolution. Ma rencontre avec Sarane Alexandrian devait peu à peu en révéler les étapes et le mûrissement. Alors mon livre est-il surréaliste ? Mais c’est à lui qu’il faut le demander. Sarane, Perditio — oh toujours ce regard vert plein d’optimisme, d’ironie tendre, qui brille ! — est-il surréaliste ?
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|

|

|
| L’Émoi du non | Long feu aux fontaines, Oeuvre poétique | Virginia Tentindo, Les mains du Feu sous la cendre |

|

|
|
| La Face proscrite | La Maison des gestes |