| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 >
|

|
|
Critiques
" Lisez ce beau recueil qui convie le lecteur à une recherche patiente, là où jour et nuit se mélangent en de curieuses et bouleversantes alchimies, alors que l’instant, par sa fragilité même, ouvre les chemins de la durée: (...) il te faudra te ressaisir, / recommencer contre l’obscurité, / l’amenuiser de son triomphe même, / tenir des promesses précaires. Car il s’agit bien d’un perpétuel recommencement, non sans douleur, mais sans amertume, puisque cette vie quotidienne et menacée doit conduire à sa propre naissance. "
Catherine FUCHS, in La Revue de Belles-Lettres, n° 2, 1995, p. 137.
" Dans les trois parties de cet ouvrage […], Paul FARELLIER se met à l’épreuve, avec une rigueur impitoyable et douce. Être est d’abord descendre en soi, avec certitude et quelque effroi mais c’est aussi en venir à ce point d’acuité qui épouse les choses défaites, jusqu’à délivrer « le flux rapide de l’éternel ». […] Toujours, Paul FARELLIER a un sens aigu des pouvoirs de perception : la moindre vibration libère un sens multiple, une lumière dont l’excès serait mortel. La fin provisoire du chemin, dans la complexité indiscernable, s’émerveille des cris les plus élancés malgré la lancinante prison intérieure. Un secret, terrible, rassurant, veille. "
Gilles LADES, in Friches, n° 45, hiver 1994.
|
|

|
|
Critiques
"La joie comme la peine se mesurent en centigramme." (Benjamin Péret). Joie ? parce qu'un nouveau numéro de Supérieur Inconnu, le trentième, est paru. Peine ? parce que c'est le dernier et qu'il est consacré à son fondateur Sarane Alexandrian, disparu en 2009 emporté par une leucémie. La couverture est de Madeleine Novarina, épouse de l'écrivain, et vient clore une série commencée en octobre 1995. Le comité de rédaction de la revue a dans son ensemble participé à l'hommage rendu à Alexandrian. Nous trouvons des textes et des entretiens d'anciens compagnons: Alain Jouffroy, des lettres d'André Breton et de Malcolm de Chazal, des illustrations de Victor Brauner, Ljuba, Denis Bellon. Sous la plume de Christophe Dauphin, auteur chez l'Âge d'Homme d'un essai Sarane Alexandrian, le grand défi de l'imaginaire, on peut lire un très intéressant et émouvant portrait de ce dernier. Les documents publiés sont nombreux et la période d'après-guerre est riche en témoignages: exposition surréaliste en 1947 à la galerie Maeght, création de la revue Néon et de Cause... Le sommaire est parsemé de textes inédits de Sarane Alexandrian, écrivain, critique d'art et fondateur d'une des revues les plus fascinantes de ces dernières années: Supérieur Inconnu, qui a paru en trois séries, trente numéros au total de 1995 à 2011. Adieu Grand Cri-chant nous en sommes pas prêts de vous oublier, d'ailleurs: "c'est les jeunes qui se souviennent. Les vieux oublient tout." (Boris Vian).
Michel Jacubowski (in Cahiers Benjamin Péret n°1, septembre 2012)
« Supérieur Inconnu.., est le titre qu'André Breton avait choisi, en novembre 1947, pour nommer la publication qu'il envisageait de fonder... » Aujourd'hui, c'est le dernier numéro d'une revue « ouverte à la prose autant qu'à la poésie» et qui a mis « à l'honneur, dans chaque numéro, un écrivain qui est souvent injustement méconnu du public et de la critique »... Dernier numéro consacré à Sarane Alexandrian, mort le 11 septembre 2009. Sarane Alexandrian et Madeleine Novarina, poète et son épouse, « le couple héroïque faisant face à tout » selon Christophe Dauphin. Un dossier complet avec des textes de l'auteur, bien sûr, des analyses de sa création romanesque, des fac-similés des lettres, des photos, des reproductions de tableaux et de dessins, des hommages de ses proches, des souvenirs... Et tout cela donne une image vivante de ce familier des surréalistes. Un exemplaire à conserver !
Alain Lacouchie, (revue Friches, n° 109, janvier 2012).
"Sarane Alexandrian nous a quittés le 11 septembre 2009 pour le Grand Réel. Spécialiste des avant-gardes et de la littérature érotique, biographe de Victor Brauner, cet homme exceptionnel, érudit incarnant l’élégance intellectuelle et spirituelle, fut aussi, c’est moins connu, un hermétiste de talent, ce qui apparût clairement à travers la revue Supérieur Inconnu qu’il dirigea brillamment. Deux ans après sa disparition, Supérieur Inconnu, désormais sous la direction de Christophe Dauphin, rassemble ses amis pour un numéro spécial, n°30, consacré à l’homme de l’art et à son œuvre multiple, inattendue, et absolument non-conformiste comme il savait si bien le revendiquer. Christophe Dauphin avertit le lecteur d’une ambiguïté toute française : « La France raffole des surréalistes quand ils sont morts ; mais quand ils étaient dans l’éclat de la jeunesse ou dans la force de l’âge, elle a tout fait pour les acculer à la misère. C’est d’ailleurs le lot de tout grand artiste révolté, de tout prophète de l’anticonformisme, de connaître une gloire tardive ; les conformistes lui préfèrent toujours le pantin remodelable après chaque rebut. Sarane Alexandrian n’a pas échappé, malheureusement, à ce principe ; du moins en France, car à l’étranger, au Liban, en Roumanie, en Angleterre, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Turquie, aux Etats-Unis, en Chine (où son Histoire de la littérature érotique a été traduite en 2003), ou à l’Île Maurice, notre ami jouit d’un prestige qui ne s’est jamais démenti. » Ce numéro spécial débute par une présentation des trois périodes de la revue, les 21 numéros de la première série, 1995-2001, les 4 numéros de la deuxième série, 2005-2006 et la troisième série, 2007-2011 qui propose 5 numéros. D’une grande exigence, Sarane Alexandrian a veillé à la haute tenue de sa revue qui demeure la plus belle publication d’avant-garde des vingt dernières années. Supérieur Inconnu a inscrit le message du surréalisme éternel dans la période si dangereuse et si passionnante du changement de millénaire, message que l’art du XXIème siècle devra s’approprier pour demeurer art. Ce numéro, qui mêle articles, poèmes, illustrations, témoignages, écrits de Sarane, illustre la puissance, la densité et la richesse de ce message non-conformiste, au plus près de la liberté de l’être. Et il y a ce couple, Madeleine Novarina et Sarane Alexandrian, un amour fou qui n’a cessé de nourrir la création de l’un comme de l’autre. Parmi les textes de Sarane Alexandrian rassemblés dans ce numéro, citons : Madeleine Novarina poète – La création romanesque – Autour de « Socrate m’a dit » – Considérations sur le monde occulte – Ontologie de la mort, ces deux derniers inédits. Sarane Alexandrian contribua grandement au renouvellement de l’alliance salutaire entre avant-garde et initiation, par ses écrits bien sûr, plus encore par sa médiation entre des mondes qui s’ignorent encore à tort. Parmi les très nombreux contributeurs à ce numéro qui, davantage qu’un hommage, constitue une démonstration de la permanence de Sarane Alexandrian, citons : Madeleine Novarina, Virgile Novarina, André Breton (Trois lettres à Sarane Alexandrian), Malcom de Chazal (Lettre à Sarane Alexandrian), Jean-Dominique Rey, Odile Cohen-Abbas, Paul Sanda, Marc Kober, Fabrice Pascaud, Jehan Van Langhenhoven, etc. Ce numéro exceptionnel est diffusé par Les Hommes sans Epaules, 8 rue Charles Moiroud, 95440 Ecouen, France.
Remi Boyer (Incohérism.owni.fr, 21 septembre 2011)
"Un numéro hommage de Supérieur Inconnu à son fondateur, Sarane Alexandrian (1927-2009). Un lien étroit avec les HSE : le directeur de publication en est aussi Christophe Dauphin, et les HSE en gèrent la publication. Les contributeurs sont nombreux, poètes, artistes, amis, qui apportent leur voix pour cet hommage quasi unanime (seule voix dissonante, celle d’Alain Jouffroy) qui tente d’aborder toutes les facettes de cet homme à l’élégance légendaire qui sut ne pas faire de concession aux modes. On croisera ainsi entre autres Françoise Py, Lou Dubois, Olivier Salon, Virgile Novarina, César Birène, Marc Kober, Odile Cohen-Abbas, mais aussi, évoqués largement, par le document, lettre ou dessin, Madeleine Novarina, sa femme, les peintres Jean Hélion et Victor Brauner (dont une œuvre fait la couverture, comme pour le n°1), le poète mauricien (et toujours trop méconnu) Malcolm de Chazal, etc. Un numéro qui marque aussi la fin d’une aventure de 15 ans, puisque ce dernier numéro est aussi l’ultime d’une série de trente."
Jacques FOURNIER (levure littéraire.com, 2011).
"C’est la première fois que je parle de cette revue et ce sera l’ultime puisqu’il s’agit d’un numéro spécial consacré à son fondateur : Sarane Alexandrian, décédé en 2009. Ce dernier a longtemps été considéré comme le successeur désigné d’André Breton, c’est dire dans quelle mouvance, surréaliste, il s’est positionné toute sa vie. Le titre de la revue d’ailleurs, Supérieur inconnu, a été trouvé par André Breton lui-même en 1947, pour une revue qui n’a pas vu le jour alors. La publication a connu trois séries : la première de 1995 à 2001, avec 21 numéros, et un nombre impressionnant de poètes reconnus aujourd’hui ; la deuxième de 2005 à 2006 (4 n°), avec au comité de lecture des membres plus jeunes comme Marc Kober ou Christophe Dauphin qui rejoignent Alexandrian et les plus anciens, prenant comme axes principaux quatre vertus cardinales que sont le rêve, l’amour, la connaissance et la révolution. Cette série sera interrompue, faute de subvention du CNL, mais suivie par la troisième et finale (2005-2011) avec un comité de rédaction élargi : 5 numéros dont ce dernier. Sarane Alexandrian exerçait une véritable fascination sur tous ceux qui l’ont approché et qui témoignent dans cet ouvrage. Né en 1927 à Bagdad, son père était médecin du roi Fayçal 1er, il vient en France en 1934. Il rencontre le dadasophe Raoul Hausmann, ce qui va être déterminant dans son apprentissage intellectuel, puis André Breton, Victor Brauner et Madeleine Novarina, qui va devenir sa femme et à laquelle sont consacrés deux articles forts de la livraison. Théoricien n° 2 du surréalisme, il rompt rapidement avec André Breton, dès 1948. Christophe Dauphin montre comment il écrit sous autohypnose, à la Robert Desnos, autour de l’onirisme, la magie sexuelle et la gnose moderne. Une idée intéressante, c’est qu’il a souhaité être un anti-père pour les jeunes qui l’admiraient, afin qu’ils le dépassent à leur tour. Ses conceptions romanesques sont très éclairantes, puisqu’il a voulu certainement être davantage reconnu comme écrivain de romans plutôt que poète. Beaucoup de contributions suivent à la gloire de ce grand personnage, dont le charisme et l’ouverture intellectuelle impressionnaient grandement ses interlocuteurs, à noter la fausse note signée Alain Jouffroy qui donne en contrepoint un éclairage inverse au concert de louanges ; également avant de renvoyer à la revue qui propose une quarantaine de témoignages (dont Jehan Van Langenhoven ou Michel Perdrial entre autres), le Sarane Alexandrian, critique d’art, lequel lui confère pour conclure sa véritable dimension. Un homme hors du commun, sans contestation possible. Un grand écrivain de la fin du surréalisme."
Jacques MORIN (Site internet de la revue Décharge, novembre 2011).
Avec ce trentième numéro de Supérieur Inconnu s'achève l'aventure de cette revue fondée par Sarane Alexandrian en octobre 1995, aventure qui dura donc 16 ans et connut trois séries différentes. Ce dernier numéro consiste en un hommage à la figure tutélaire de Sarane Alexandrian, disparu le 11 septembre 2009. Nous y trouvons les signatures des acteurs majeurs ayant fait l'histoire de cette revue qui se revendiquait du non-conformisme intégral.
C'est à César Birène que revient la tâche d'ouvrir ce numéro mémorial par un texte retraçant clairement les grandes étapes de Supérieur Inconnu. A l'origine imaginée par André Breton, la revue aurait dû voir le jour en 1947 chez Gallimard sur les conseils de Jean Paulhan. Une revue ayant l'ambition d'unir les conservateurs fidèles à l'esprit du Second manifeste, et les novateurs. Le nom même de la revue vient directement de Breton qui voyait dans le "Supérieur Inconnu" l'objectif idéal de la recherche poétique de l'avenir. Elever l'esprit vers les hauteurs et explorer l'inconnu. Un désaccord empêcha ce projet que Sarane Alexandrian, en héritier légitime du Surréalisme – il avait été le secrétaire général du mouvement – reprend et mène à son point d'épanouissement au moment charnière du passage au troisième millénaire. Une revue issue du Surréalisme mais désireuse d'accueillir dans ses pages les voix d'un avenir poétique émancipé du passé, et fervente admiratrice de figures peut-être injustement mal connues telles celles de Claude Tarnaud, Charles Duits, Stanislas Rodanski, Gilbert Lely, Jeanne Bucher par exemple. César Birène retrace avec fidélité ces quelques quinze années d'engagement littéraire autour de Sarane Alexandrian. Il en synthétise l'esprit, les contenus, évoque les grands acteurs tels Alain Jouffroy et Jean-Dominique Rey, à la fondation de l'aventure avec Sarane. Puis rejoints par la jeune génération des Christophe Dauphin, Marc Kober, Alina Reyes. Je me permets d'ajouter Pablo Duran, Renaud Ego, Jong N'Woo, Malek Abbou, etc. Les transitions des séries 1 à 2 et 2 à 3 sont bien explicitées, ainsi que les raisons qui présidèrent chaque fois au changement de visage par ces nouvelles moutures de la revue. On notera avec étonnement au moins deux grands absents sous la plume de César Birène, deux absents de taille qui contribuèrent pourtant à l'envergure de la revue par le rôle qu'ils y tinrent au sein du comité de rédaction de la première série, en les personnes d'Alain Vuillot et de Matthieu Baumier…
La revue poursuit ensuite son hommage à Sarane avec les textes de Christophe Dauphin, les photos de Sarane et de sa femme Madeleine Novarina, les poèmes de Madeleine Novarina, les photos du bureau de Sarane où nous eûmes tous l'honneur, à un moment, d'être reçu pour une conversation d'une politesse exquise sous le charme silencieux et magiques des œuvres de Victor Brauner. Des textes inédits de Sarane, comme illustrés par des reproductions de toiles de Ljuba, sont ici publiés, comme La création romanesque issue de ses Idées pour un Art de vivre, Art de vivre qui était la passion de sa vie tant il considérait que cet Art induit tous les plans de l'émancipation de l'humain. Nous y trouvons également trois lettres inédites adressées à Sarane, deux par André Breton, la troisième par Malcolm de Chazal, lettres qui témoignent de l'engagement intellectuel intégral qui était celui d'Alexandrian.
Suit un entretien d'Alain Jouffroy par Jean-Dominique Rey autour de la figure de Sarane, entretien surprenant au sein d'un hommage tant Jouffroy n'use d'aucune langue de bois pour évoquer le souvenir de son ami Sarane. A juste titre d'ailleurs car Alexandrian, non-conformiste revendiqué, aurait eu en horreur les passages de pommade de circonstance. Jouffroy évoque un Alexandrian supportant mal la contradiction qu'on pouvait lui opposer et nombreux sont, parmi ceux qui le fréquentèrent, à avoir essuyé ses colères et sa susceptibilité... (..) Un homme généreux. Une figure tutélaire à qui l'on devait une manière d'allégeance à partir du moment où il nous avait accueilli dans son clan. Un écrivain ayant sa propre conception de la fidélité, souffrant avec difficulté qu'on lui oppose des vues différentes de ce en quoi il croyait. Mais généreux, je le répète, comme peu en sont capables. Aussi la version de Sarane par Alain Jouffroy a-t-elle lieu d'être tant elle rend fidèlement le caractère haut en couleur qui était le sien. D'ailleurs, s'ensuit la reproduction d'une réponse de Sarane à un message de Jouffroy laissé sur son répondeur téléphonique. Illustration significative des rapports qui furent ceux des surréalistes, faits de franchise, d'orgueil, de rodomontades, d'hystérie surjouée, de joutes oratoires, de ruptures, de réconciliations. Parmi les textes, passionnants, de ce numéro hommage, (nous ne les citerons pas tous), mentionnons celui de Paul Sanda consacré à l'ouvrage majeur d'Alexandrian, Histoire de la philosophie occulte, et aux prolongements de ce livre, d'abord dans le rapport qu'entretint Sanda avec Sarane, ensuite dans la vie de Sanda.
Remercions Christophe Dauphin, maître d'œuvre de cette ultime livraison, pour ses contributions à la réussite de ce beau numéro, tant lorsqu'il se consacre au couple Madeleine Novarina-Sarane Alexandrian que lorsqu'il dresse un portrait biographique de Sarane, situant son importance dans la deuxième génération surréaliste mais aussi dans le monde littéraire et intellectuel, lui dont l'œuvre fut traduite partout dans le monde sans que jamais l'intelligentsia officielle et médiatique ne lui rende le moindre hommage. Hommage encore à l'érudition époustouflante d'un homme hors-norme, qui n'avait cure de savoir pour savoir mais entendait savoir pour vivre plus et transmettre ses connaissances pour aider à vivre plus. Jean Binder, lui, choisit dans les multiples visages d'Alexandrian, l'écrivain d'art. Il rappelle que le premier livre de Sarane fut consacré au peintre Victor Brauner, Brauner l'illuminateur, dont on ne peut ici que conseiller la lecture tant ce livre est, à mes yeux, fondamental. Et poursuit en dressant l'itinéraire des écrits sur l'art de Sarane. Palpitant. Gérald Messadié quant à lui tire son chapeau à l'impertinence, pour employer un euphémisme, de Sarane, lui qui, en 2000, publia un livre étrange intitulé Soixante sujets de romans au goût du jour et de la nuit, livre dans lequel Sarane propose aux romanciers en mal d'inspiration 60 sujets mirifiques pour surseoir à leur manque de talent et d'imagination. Un livre volontairement passé inaperçu tant le bras d'honneur d'Alexandrian aux plumitifs desséchés en tous genres relève, comme le souligne Messadié, du terrorisme.
Il y a aussi le très beau texte de Marc Kober, d'une justesse et d'une mesure admirables, brossant l'image de surface qu'offrit à beaucoup Sarane Alexandrian pour nous montrer un peu le vrai cœur de cet homme : "Pourtant, la vérité de Sarane est ailleurs, écrit Kober : moins dans l'homme de lettres qu'il voulut être que dans une volonté d'élargir le périmètre humain".
Il y a enfin, et je m'arrêterai là, le beau poème que Matthieu Baumier offre ici à Sarane, intitulé "A l'étoile vive", assorti de cette émouvante dédicace Pour Sarane, par-delà. Ce trentième numéro rend ainsi un hommage mérité à un écrivain méconnu, dont l'œuvre théorique continuera d'irriguer les temps à venir tant elle se situe à la croisée de la Tradition dont notre société se targue de ne vouloir rien savoir, et de l'avenir qui l'aimante par un besoin vital de prendre sa respiration.
Supérieur Inconnu, ce furent 30 volumes en quinze ans, mais aussi des lectures publiques dont chacun des membres garde en mémoire les éclats et les reliefs. (Conciergerie de Paris, Mairie du XIIème arrondissement de Paris, Bateau-lavoir). A titre personnel, sans Supérieur Inconnu, sans Sarane Alexandrian, je n'aurais sans doute pas rencontré la danseuse Muriel Jaër, petite-fille de la galeriste Jeanne Bucher avec qui, au sortir d'une lecture de poèmes, je devais me lier d'amitié.
Je n'aurais pas non plus eu la grande chance de rencontrer Matthieu Baumier, dont l'amitié dans le Poème m'est absolument vitale. Pour ceci, Sarane, merci.
Gwen Garnier-Duguy (in Recoursaupoeme.fr, août 2012).
*
"Dernier numéro de la revue consacré à Sarane Alexandrian, écrivain surréaliste. Son oeuvre est une aventure humaine et intellectuelle. Le non-conformisme caractérise le mieux l'oeuvre et la vie de Sarane Alexandrian."
Electre, Livres Hebdo, 2012.
|
|
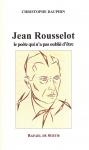
|
|
Critiques
"A l’occasion du centenaire de la naissance de ce grand poète que fut Jean Rousselot (1913-2004), Christophe Dauphin a dressé un portrait riche et touchant de cet homme aux multiples talents dont le parcours complexe est un exemple de foi en l’humanité et d’engagement pour la liberté.
A propos de son enterrement, quelques jours après son décès le 23 mai 2004, Christophe Dauphin confie : « Nous venions d’enterrer soixante-dix ans de poésie française. Jean était la poésie, une poésie sans cesse aux prises avec la vie, le fatum et l’Histoire ; un homme d’action, qui a durablement marqué les personnes qui l’ont approché. ».
Ce fut Louis Parrot, son mentor, qui l’initia à la poésie contemporaine. Ils se rencontrent en 1929. Cette initiation dépasse le cadre de la poésie, il est question aussi de philosophie, de psychologie, de politique et de religion. Il fut, dit Jean Rousselot de Louis Parrot, « mes universités ». C’est à Poitiers, ses nuits, ses cafés, le quartier ouvrier où vit Rousselot, les campagnes environnantes, que le poète se forge, que le génie se fraie un passage dans une forêt hostile faite de préjugés, de combats intérieurs, d’un isolement, peut-être salutaire, mais seulement apparent : « Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais Un. Je me tourmente pour des douleurs qui tiennent éveillée, la nuit entière, la vieille repasseuse qui m’a nourri ; pour la soif qui calcine un soldat au ventre ouvert… La douleur, l’angoisse, l’exil et le danger, voilà mes chemins de communication, voilà mes adhérences au placenta du monde… »
Proche des Jeunesses socialistes, puis en 1934 de la Ligue communiste, anticolonialiste, ses combats politiques sont, à l’époque, proches de ceux des surréalistes. Mais son combat politique reste distinct de sa poésie. En 1932, il participe à l’aventure de la revue bordelaise Jeunesse à la recherche d’un « renouvellement », d’un « rafraîchissement » de la poésie. C’est à partir de la publication en 1936 d’un recueil, intitulé Le Goût du pain, que Jean Rousselot est considéré comme un acteur essentiel de ce renouveau de la poésie.
Quand la guerre arrive, Jean Rousselot se sert de sa fonction de Commissaire de Police pour aider la Résistance et les poètes en danger. Sa poésie devient une poésie de combat, notamment dans cette « école » qui rassembla René Guy Cadou, Jean Bouhier, Michel Manoll, Marcel Béalu et d’autres. Une école, une manifestation de l’amitié.
Poète et homme d’action André Marissel parlera à propos de Jean Rousselot de « surréalisme en action ». Jean Rousselot gardera un grand respect pour le surréalisme qui l’aura éveillé, lui comme ses compagnons, et revendique une continuité entre les surréalistes et lui, tout particulièrement par une collaboration avec l’inconscient.
Après la deuxième guerre mondiale, Jean Rousselot tourne le dos à une vie sociale et poétique facile construite sur la reconnaissance de son action exemplaire pendant le conflit. Il renonce à son métier et veut vivre de sa plume ce qui se révèle évidemment aléatoire. En 1996, tout en affirmant ne pas regretter son choix, il confie à Christophe Dauphin : « Ne lâche jamais ton métier, tu m’entends ! Jamais ! Ne fais pas cette connerie ! Tu pourras ainsi écrire quand tu veux et surtout, ce que tu veux. ».
Jean Rousselot écrira de nombreux articles pour la presse. Le premier est consacré au désastre de Hiroshima qu’il qualifie de génocide, ce qui le brouille avec Aragon. Il va désormais écrire beaucoup, une trentaine de plaquettes et livres jusqu’en 1973, une vingtaine de pièces pour la radio, des romans, mais découvrir aussi et faire découvrir de nombreux poètes talentueux. Tombé amoureux de la Hongrie, il dénoncera le drame de Budapest en 1956, condamnant violemment la contre-révolution russe, et traduira beaucoup de grands poètes hongrois en français comme Attila József, Sándor Petőfi, Endre Ady…
De 1997 à sa disparition, Jean Rousselot continue d’écrire et de publier une « poésie de terrain », au plus proche de la vie, du peuple, des rêves de liberté de tous ceux qui sont contraints. Une écriture de plus en plus dépouillée, directe, grave, sans mensonge, sans artifice, sans effet.
Jean Rousselot, au bout de 137 volumes, continue d’œuvrer. « Les mots de Rousselot restent debout et marchent à nos côtés. Le poète rend la vie possible. C’est pour cela qu’il ne meurt pas tout à fait. » dit avec justesse Christophe Dauphin."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 19 janvier 2014).
"Jean Rousselot aurait eu 100 ans le 27 octobre 2013. C’est l’occasion choisie par son ami, Christophe Dauphin, pour faire paraître cet essai qui nous dit ce qu’est et ce que doit être un poète : celui qui évoque le quotidien, homme parmi les hommes, travailleur parmi les travailleurs, qui, pour eux, fait le don de soi au sens le plus fraternel du mot.
« Ecolier » de Rochefort, proche de Cadou, Manoll ou Bérimont, admirateur fervent de Roger Toulouse, Jean Rousselot laisse une œuvre ample et diverse : l’œuvre d’un romancier, d’un historien, d’un critique aussi, amoureux de la parole, de l’écriture, et de l’émotion que l’une et l’autre procurent, et qui s’appelle poésie. « Le poème est pour moi l’inouïe prise de conscience des pouvoirs du poète sur le temps, qu’il arrête, sur la mémoire, qu’il ressuscite, sur les sentiments, qu’il élève au Sublime, sur le réel, qu’il perce et transmue pour en retrouver l’essence et a pérennité. »
Abel MOITTIE (in roger-toulouse.com, janvier 2014).
"Les analyses de Dauphin, comme d'habitude chez lui, cernent mieux qu'un portrait le personnage réputé impossible, mais il le transforme délibérément. Par exemple, ce qui n'était pas toujours mentionné dans les biographies, le rôle du poète dans la police et dans la résistance à l'occupant nazi est mis en evidence. Lorsqu'il eut quarante ans, Jean Rousselot parla du surréalisme en souriant de se croire un peu "plus surréaliste que les surréalistes eux-mêmes". Sa décision en 1946 de démissionner de tout et de vivre de sa plume fut capitale. Il devient alors grand voyageur et se produit et publie dans le monde entier. Il n'hésite pas non plus à prendre des positions fermes contre les injustices, comme pour Abdellatif Laâbi en 1972. Pour la forme de ses poèmes, il aura adopté tout. Avec force. Il s'insurge encore contre les inutiles: "Pour beaucoup de mes confrères, l'activité poétique consiste à fabriquer des objets de langage avec un langage sans objet... La poésie jetable gagne du terrain." Que n'aurait-il pas dit aujourd'hui ?"
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°267, La Hulpe, Belgique, mars 2014).
"Jean Rousselot aurait eu cent ans en 2013. Et Christophe Dauphin a eu la bonne idée de faire à la fois sa biographie et un essai sur ce poète hors pair. Il divise son livre par chapitre chronologiques, et avec Jean Rousselot, c'est tout le vingtième siècle qu'on revisite... Christophe Dauphin insiste sur le fait que pour le poète, la poésie est surtout une manière d'être. L'homme est derrière son regard - Comme derrière une vitrine - Lavée à grande eau par le jour. Jean Rousselot prône une poésie de terrain et non de laboratoire ajoute l'auteur de la monographie. Je n'ai fait ici que survoler ce livre bien documenté. Ce qui étonne et retient chez Jean Rousselot, c'est la fidélité à ses idées et la rectitude de ses principes et de son action. Cela a toujours conféré à sa poésie une considérable autorité."
Jacques MORIN (in Décharge n°161, mars 2014).
"Le pari de Dauphin – restituer l’une des figures les plus emblématiques de la poésie francophone des années 30/80, à l’occasion du centenaire de sa naissance – est magnifiquement tenu par un autre passeur de poésie, rompu à l’exercice d’analyse et d’admiration d’un aîné qui a compté, qu’il a connu, avec lequel il a pu s’entretenir, avec lequel il a échangé nombre de correspondances.
Et le réseau se poursuit fidèlement : Jean Rousselot, qui a toujours revendiqué ses dettes envers Reverdy, Max Jacob, qui a toujours fait de l’amitié une vertu humaniste et littéraire, passe ainsi le relais à son cadet de l’Académie Mallarmé pour qu’il chante (le mot n’est pas outré) un parcours poétique, celui d’un homme droit, qui s’est toujours voulu, comme il l’a énoncé dans ce beau poème (repris en fin de volume) homme au sens le plus dense du terme: « Je parle droit, je parle net, je suis un homme. » Il est, certes, difficile de rappeler sans tomber dans les poncifs de la biographie et dans ceux de la vénération poétique. Christophe Dauphin, se basant sur une documentation de premier ordre, des témoignages de première main, des entretiens, de nombreuses lectures, une connaissance intime de la foison d’œuvres nées entre 1935 et 2002, rameute les grandes étapes de la formation d’un esprit, d’une conscience littéraire. L’occasion d’un tournage pour la télévision, sous l’impulsion du poète-maire Roland Nadaus, souda le poète des « Moyens d’existence » et son jeune biographe. Le centenaire fêté à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2013.
"Le 23 mai 2014, il y aura dix ans que l’écrivain Rousselot nous a quittés.
Le petit livre de Dauphin, qu’on lit d’une traite tant il respire le respect et le travail en profondeur pour nous faire mieux sentir une voix vraie, agrémenté de photographies (portraits de Rousselot et des groupes d’amis poètes) et d’une belle huile en 4e de couverture due à l’ami peintre Roger Toulouse, offre, en quatre sections chronologiques, une étude précise de soixante-dix ans dévolus à la poésie. Les origines ouvrières, le sens aigu du social et du juste, la lutte contre la tuberculose, les rencontres fondamentales des poètes Fombeure et Parrot, l’ancrage de Poitiers (la province enfin !) et l’effervescence intellectuelle de cette cité natale, une première revue créée (Le Dernier carré), la reconnaissance dès 1936 (avec « Le goût du pain »), le commissaire Rousselot résistant de la première heure (que de tâches et de faux papiers à prévoir !), l’intense expérience de Rochefort-sur-Loire (dont Rousselot est redevable, mais dont la seule mention finira un jour par l’agacer comme si c’était son seul ancrage), les travaux « alimentaires » dès qu’il cesse ses activités de commissaire pour se consacrer uniquement à la littérature…les matières sont multiples et le travail de Dauphin donne poids, relief, consistance à tous les trajets accomplis par le poète entre sens incisif d’une poésie à hauteur d’homme et conscience aussi précise de son devoir d’homme, de poète, d’écrivain solidaire, syndicaliste et engagé dans les mille et une tâches d’écriture poétique, critique, romanesque et de traduction.
Les solidarités littéraires s’inscrivent en grand dans cette perspective : les aînés salués (Reverdy, Jacob, Jouve en tête), les cadets mis à l’honneur (Cadou), les actions multiples dans les journaux et revues (jusqu’à Oran) pour défendre la poésie. Rousselot (que je comparerais volontiers à l’infatigable Armand Guibert, que Christophe ne cite pas) n’a jamais oublié d’être, en dépit de ses cent quarante volumes, en dépit des reconnaissances ; il méritait cette approche soignée.
Que retenir de plus frappant ? Tant de faits, tant de poèmes, tant de gestes ! Allez, sélectionnons : ses coups de gueule au moment où tout le monde se taisait lors des événements de Budapest (ah ! ses amis hongrois, Joszef, Gara, Illyés…) ; sa défense d’Abdellatif Laâbi des geôles hassaniennes ; sa défense d’une poésie de terrain (non de laboratoire)…. Mais, surtout, l’écriture d’une conscience. Et la fidélité souveraine à ses origines : « Et je suis seul à voir pendre derrière moi, - Comme des reines arrachées, -
Les rues de mon enfance pauvre », (« Pour Flora et Gyula Illyés », Jean Rousselot).
Un très bel essai de Christophe Dauphin !"
Philippe LEUCKX (in recoursaupoeme.fr, 11 juin 2014).
"Un remarquable essai de Christophe Dauphin, qui nous fait découvrir le parcours atypique de ce grand poète que fut Jean Rousselot. Ce grand admirateur de Victor Hugo, dont les premiers poèmes portent l'indéniable empreinte du maître, trace un chemin qui nous mène là où il écrit : Malgré moi j'ai pitié des cours profondes et visqueuses - sans oiseaux, sans feuilles tourbillonnantes - Et du pétrin invisible qui geint en bas - Jour et nuit comme un forçat enterré. Ce livre retrace l'itinéraire fondateur d'un poète portant la marque de l'inconscient et l'esprit libertaire, qui ne triche pas avec lui-même, et sur lequel bien d'entre nous feraient bien de méditer: descends vers les gouffres, dit-il, perds ta couleur, tes yeux et le dernier écho, là-haut, de ta présence..."
Bruno GENESTE (in revue Spered Gouez n°20, octobre 2014).
|
|

|
|
Lectures
« Je m'assiérai sur le pas de vos portes»
"Excellence et simplicité... Gérard Cléry s'est détourné des arts poétiques aussi pertinents soient-ils. Il s'est aussi dépouillé du superflu (rhétorique absente, circonlocutions proscrites)... Roi nu(l) n'est pas un titre mais un état des lieux intimes, la mesure abyssale de l'homme rendu à l'essentiel. Et ce n'est pas rien.
Le voyage immobile est fascinant et douloureux à la fois : « permettez cependant/que ma vie vous effleure prêtez/rien qu'un moment l'odeur de votre lit... » Au fil des pages se profile un homme détaché – oh si peu ! - de sa posture poétique pour marcher au pas de l'homme. Le roi nu(l) est une sorte d'albatros baudelairien privé de majesté, d'empire (sur soi, sur les autres), mais perclus de vérités contradictoires, faufilé de tendresse, s'excusant d'être là, comme le Plume de Michaux.
Un livre de chevet qui brûle pendant les nuits blanches et qu'on consulte, qu'on touche et qu'on respire : « voyez j'habite si mal/les pierres que je pose »... Mais la présence sensorielle de cet opus absolument remarquable est obsédante et s'étale comme l'huile sur la toile. On retrouve pourtant la mise en relation de l'homme avec son environnement immédiat : « fenêtre mouillées par les baisers/fenêtre enjouée fenêtres/affûtée/laisse mes mains te reconnaître »... Et le lecteur s'inquiète de cette présence-absence qui ne se repère que dans le chuchotement, dans l'écrit, dans le souffle. Le parcours d'un aveugle ébloui cependant par le monde qu'il traverse blessé par les aspérités de l'univers ambiant, mais aussi touché par : « cette grâce de ceux qui savent s' effacer pour laisser tout son pouls à cette parole qui les dépasse », comme l'écrit Guy Allix dans sa postface.
« Dormir m'est interdit », nous dit le veilleur, sans oublier que la vie ne vaut peut-être que par les « restes », ces insignifiants qui chargent le havresac d'une silhouette de poète : « la peau de ses mains nues/quelques poils de barbe/une écharpe parfumée/la mèche de cheveux/héritée d'une femme/l'aile d'un oiseau/le rire de deux enfants/grimpés près de son cou/une gousse d'ail/une paire de souliers mal tenus... » un inventaire à la Prévert pour « l'idiot d'amour/le fou l'aveugle » qui se cherche des parenthèses sensorielles pour affirmer que le jour existe. Palpitant encore et encore ce coeur « bêlant ce coeur brûlé ce coeur boiteux », qu'il faut bien se dissimuler à soi-même pour ne pas être débusqué et demeurer a fortiori le passager clandestin de ses émotions... Cette mise à nu ou mise à nu(l), c'est selon, apparaît comme l'outil décisif du parcours poétique et humain de Gérard Cléry. Il est bluffant d'authenticité partagée et sa proximité nous renvoie aux veilleuses qui balaient la nuit nos chemins d'existence."
Michel JOIRET (in Revue Le Non-Dit, Art et Littérature N°111, avril 2016, Bruxelles).
*
" Suivi d'une excellente post-face de Guy Allix, voici « Roi nu(l) » nouveau recueil de Gérard Cléry, publié dans la collection « Les Hommes sans épaules» de la Librairie Galerie Racine, Paris.
Tous les poèmes de Gérard Cléry sont pour rejoindre, et, ici, se rejoindre. Rejoindre soi-même. Rejoindre son corps. Sa vie qui fout le camp. Rejoindre les autres.
Surtout rejoindre la femme. Joindre. Et rejoindre, avec des mots, la poésie des mots.
C'est dire qu'ici le « je » n'est pas un autre, mais le pluriel d'un moi qui, d'abord, s'attendra au futur comme pour s'excuser d'avoir fait attendre, puis se dégager pour disparaître en laissant, comme Villon son frêre, les témoignages de son chemin.
Ce testament devient vite un présent de mémoire, avec l'évocation, dans les écarts, comme dans les marges, des bouffées du désir ou de l'espoir :
« Tu prends à présent la barre
jusqu'à la déraison
et tu gouvernes entre les bras du vent
accroupi pour mieux voir
les mains posées sur les genoux
et disant oui
et disant non »
Et le rêve, à petits coups de bec, fait tinter la vitre du vécu duralex.
Ce cri une fois dit il faut, comme l'oiseau qui, d'un coup d'aile, aile sans parenthèse, remonte le vent de mer, le vent d'amer, il faut remonter le texte. « Retour amont » aurait dit René Char. Et, remontant le vent, nous passons du réel, qui un rêve, à la réalité, qui est une illusion. L'hymne à l'amoureuse, avec son feu patient, est une rosée qui irise « jardin-fenêtre-bouche-luisance d'eau ». C'est une caresse que les mots attendrissent encore pour délivrer le corps. Mais surtout c'est une musique que les mots scandent en rythme syncopé :
Le dit du bûcheron
est-ce bien moi qui parle de tes cuisses
pour le couteau
trouvant ta chair aux versants
d'actinies dans l'horizon de quoi je dors
est-ce encore moi
régnant désemparé qui continue
qui épaule ton corps
femme univers de ma manducation.... »
c'est là que la « Royauté » prend sa source, elle qui vient du chaos, comme le torrent d'amont décoche ses eaux sur le vide. Ce torrent qui n'économise pas la matière, mais la bouscule, pour jeter le délire dans la raison lumineuse.
Claude ALABAREDE (in revue Diérèse, 2016).
*
" Ces poèmes au rythme haletant, qui semblent écrits dans l'urgence nous parlent autant de nous que de son auteur. C'est ce lien qui nous touche profondément, cette empathie. Gérard Cléry est à l'écoute du monde et des hommes. Son écriture est sans fioriture, sans réthorique, elle est comme un silex, mais elle cache ou recèle, une tendresse, un amour, celui d'un homme à hauteur d'homme. Sa poésie questionne, parfois avec angoisse, parfois avec brutalité, elle frappe, touche profondément, elle est essentielle. « Gérard Cléry écrit superbement », dit Guy Allix dans sa post-face. Oui, et chaque mot, chaque courte phrase frappent juste, évoquent, appellent, oui, Gérard Cléry est un poète majeur."
Maurice Cury (in revue Les Cahiers du Sens, 2016).
*
" Belle plaquette dont le titre « Roi nu(l) » rappelle un conte d’Andersen « Les habits neufs de l’empereur ». L’expression « le roi est nu » est passée dans le langage courant pour désigner des apparences trompeuses. Gérard Cléry, avec « Roi nu(l) », réunit deux ensembles poétiques affirmant que l’amour laisse celui qui le vit ou l’éprouve nu et nul, le poète ne cherchant pas à tromper qui que ce soit, il aime et c’est tout.
Le premier ensemble, qui donne son titre à la plaquette, commence par ce vers « Ici roi nu » qui sonne comme le début d’une conversation téléphonique. D’ailleurs, un peu plus loin, un autre poème commence par ces mots : « Quand le téléphone n’est plus le téléphone »… Sans doute Gérard Cléry utilise-t-il, quand il en a envie, la parabole du téléphone pour dire ce qu’il ne peut directement à l’aimée. La succession des deux ensembles ne laisse pas d’étonner. Si le second est un chant d’amour, le premier est plutôt un constat sombre de ce que peut devenir l’amour, le temps passant. Si l’on remarque, d’une suite à l’autre, le même vers (en gros, de l’hexasyllabe à l’alexandrin, les deux vers qui se suivent étant toujours séparés par un blanc, contrairement aux proses), la première suite donne aussi à lire une écriture plus torturée, plus écorchée : prose trouée de blancs (p 20) [signe que « les mots renâclent à passer la gorge » (p 13)] ou brisée quant au sens (p 24) comme si le constat aboutissait à l’impossibilité ; même si les choses sont énoncées clairement : les morts qui se sont accumulées, les ruptures et les rencontres avortées, ce moment où « le manteau de la tendresse / glisse des épaules se déchire ». Alors que la seconde suite semble plus épanouie, plus charnelle ; il est vrai que ces vers « et l’amoureuse / feu rêvant / enlumine l’amant » (p 42) poussent à une telle lecture.
Il faut enfin signaler que ce livre se termine par une postface de Guy Allix dans laquelle je relève ces mots : « Parole de roi nu. De roi humble. Parole oxymore en quelque sorte. » Et Allix d’ajouter que ce que laisse le roi après son passage, c’est « presque rien, mais l’essentiel ». Pour mieux montrer ensuite le « double geste de monstration subliminale » et en arriver ensuite à ce constat que « Roi nu(l) » est un « poème d’amour au fond »… Et pour terminer, relever enfin ces mots : « Qui ne sait aimer ainsi, n’a jamais aimé, n’aimera jamais ».
Lucien WASSELIN ("Chemins de lecture" in revue-texture.fr, mars 2016).
*
"La judicieuse citation signée Louis Aragon de la première page (« Ce que je n’ai plus donnez-leur/ je reste roi de mes douleurs ») donne le ton à cet ouvrage de Gérard Cléry qui, dans une mise en pages aérée présente son Roi nu(l) accompagné d’une postface de Guy Allix qui souligne avec émotion et une légitime tendresse les vagues hautes de cette poésie mûre depuis déjà longtemps dans l’esprit et le coeur du poète et qui explose ici, en des vers élégants dont le poids est à la fois cruel et tendre.
En une douzaine de recueils, Gérard Cléry a réussi à se faire un nom qui importe dans notre petit domaine de la poésie. Il est vrai qu’il n’est pas uniquement poète. Depuis longtemps déjà il participe et anime des réunions poétiques en compagnie de jeunes comédiens et d’animateurs (entre autres : Marie-Josée Christien).
Avec Roi nu(l) Gérard Cléry démontre combien le poète, « roi des rois » n’est en définitive qu’un pauvre homme comme vous et moi, un être vivant et donc faillible. Il est nul car il est nu et nu parce qu’il est seul. C’est une question de vocabulaire.
Cependant l’ami Gérard Cléry s’avère ici et comme toujours trop modeste car sa poésie n’a rien de gratuit, rien de superficiel. Elle pèse lourd dans le jardin de la qualité. Elle prend en compte les divers aspects de notre vie ordinaire et en dénonce les abus, les carences, les folies. Il faut...
« laisser brûler l’ampoule de l’incertitude »
... prophétise-t-il avec ce sens aigu de l’à-propos qui caractérise son oeuvre et ses actes.
Dense et charnu, cet ouvrage me semble être l’oeuvre majeure d’un poète aux qualités multiples qui se donne avec fougue et volupté aux complicités et aux caprices de l’instant.
Un livre flamboyant. Un poète vrai."
Jean CHATARD (Revue Les Hommes sans Epaules n°41, mars 2016).
*
« Un titre d’un laconisme flamboyant et qui permet de nombreuses lectures, interprétations et rêveries. Comment ne pas penser, tout d’abord, au jeu d’échecs quand la pièce maîtresse est privée de ses défenses : le roi nu. Quand, en dépit de toute logique, il obtient le pat : le roi nul.
L’exergue, égaré dans une pagination ignorant manifestement les règles les plus élémentaires de la typographie, nous fournit une première indication
précieuse avec ces deux vers d’Aragon : « ce que je n’ai plus donnez-leur / je reste roi de mes douleurs ».
Qui est ce roi des douleurs, sinon le poète régnant sur son désert de mots : « Ici roi nul / roi nul appelle / … / la pitié est horrible / et le bonheur béance ».
Règne ici une tristesse diffuse (celle du poète face à l’incompréhension de ses frères humains) : « je m’assiérai sur le pas de vos portes / sur vos bancs sur vos marches / … / j’essaierai quelque temps vos outils / au seuil de l’œuvre inhabitable / voyez j’habite si mal / les pierres que je pose / permettez cependant / que ma vie vous effleure »…
Une tristesse aux limites du désespoir : « allumer chaque soir le flambeau de l’absence faire le lit du vide vous nommer ne pas vous nommer laisser brûler l’ampoule de l’incertitude (…) regarder votre visage et se crever les yeux / et puis sourire comme font les aveugles ».
Suivent L’ivre lit/Livre lit qui est en somme une lecture du corps de l’autre et une postface de Guy Allix, Breton d’adoption comme Cléry : Oui, Gérard Cléry est un poète. Un vrai poète, en même temps qu’un homme vrai (comment pourrait-il en être autrement ?) et qui ne prend jamais la pose, mais dépose les mots au plus juste de l’émotion. »
Francis CHENOT (in revue Traversées, Virton, Belgique, mai 2016).
*
" C'est un peu l'image du poète. A la fois rayonnant et vain. Superbe au sein de son écriture et désarmé, désolé en même temps. Avec la parenthèse du titre qui redouble et réactualise l'adjectif. C'est aussi plus simplement celle de l'homme, en général, vainqueur et faillible, voyez j'habite si mal - les pierres que je pose; Gérard Cléry semble tirer sa révérence au monde et quitter la société avec pas mal de tendresse enfuie et beaucoup de dignité. Je laisserai si peu de traces. Recueil du désenchantement, de la déconvenue, de la déréliction. Vous ne trouverez rien derrière - mon regard disparu. L'écriture draine dans son lit d'encre, amour, émotion et silence. Le poète ne regrette rien, il n'a pas oublié tous les bonheurs cueillis sur le chemin des jours. Il les voit s'évanouir dans le rétroviseur, maquillés d'ombres charbonneuses. La mémoire relit les pages écornées et relie les chapitres inachevés. Guy Allix donne une belle postface pour relancer la lecture de son ami Gérard Cléry. Le recueil a emporté à juste raison le premier prix Angèle-Vannier."
Jacques MORIN (in revue Décharge n°172, décembre 2016).
|
|

|
|
Critique
Jean BRETON, in Les Hommes sans Épaules, 3ème série, n° 10, 1er trimestre 2001, p. 111 :
"Qui sommes nous, sans cesse « en perte de visage » ? Un labyrinthe que le va et vient onirique éclaire d’une lampe de poche. Il y a chez Paul Farellier une pudeur, un refus aussi de toute surenchère verbale. On est lié à un mot à mot presque janséniste. Le poète se défie de la parole qui « tombe en limaille », il veut l’humilité, la clarté, la sécurité du silence ; il aspire au besoin peu répandu de « loger au point aveugle » des choses. D’où son goût pour la nuit – qui va plutôt à l’essentiel. Nous voici alors à fond dans notre « attente », notre perception accrue. Égalisons les vibrations, les contradictions. Scrupule, modestie, lucidité reine, c’est le tremblé de ce trio qui écrit notre identité, même si elle bouge à peine. […] L’homme est guetté par l’effacement du lieu et de l’être qui l’habite. Mais il sera souvent coopté par le regard des « étoiles » et « le cri de beauté » qu’elles nous lancent. Rôde une certitude que le poète, avare de confidences, ne nous livre que de biais : « une voix » saura un jour nous atteindre. On rejoint ici un mysticisme tout de prudence : J’ai rêvé :/ il restait ce carrefour d’éternités »..."
|
|

|
|
Lectures critiques :
LETTRE À CHRISTOPHE DAUPHIN, À PROPOS DE « TOTEM NORMAND POUR UN SOLEIL NOIR »
Je me permets de vous demander tout de go : de quel bois êtes-vous fait ? Le bois que je cherche à connaître est contenu dans Totem normand pour un soleil noir (Collection Peinture et Parole, Les Hommes sans Épaules éditions). Il m’a laissé pantois ! Il contient la Normandie et l’Afrique, Senghor et les brumes de votre pays natal. Qui a jamais osé ça ? Personne. Vous vous affichez résolument à contre-courant de tout. Même les bocages normands épousent désormais la platitude sahélienne : L’espace est à ras de terre. Mais le plus décapant est ailleurs. Vous plantez votre totem avec un rythme sec et cinglant, un rythme de rock’n’roll comme pour vous défaire de l’humidité normande :
N’en jetez plus j’ai tout avalé jusqu’à l’asphalte
la mer déborde du lavabo
et la flamme de mes doigts
D’où vous vient d’écrire au couteau comme pour effacer jusqu’au bruit du pinceau sur la toile ? Car, je n’entends même pas ses caresses, vous qui êtes si peintre. Je ne fais pas seulement allusion aux œuvres d’Alain Breton qui accompagnent votre totem. Je pense également aux essais que vous avez consacrés à de nombreux peintres, dont le sculpteur Jean-Pierre Duprey. Dois-je me contenter de cet aveu :
Poète
je me suis adressé la parole pour la première fois
lors d’un cauchemar
avec des mots qui dressaient
non pas leurs hosties
mais leurs poings comme des armes
Senghor est retoqué, mais aussi Césaire, le plus rock’n’roll de tous les poètes de la négritude et du surréalisme. Cet Antillais de Basse-Pointe, au nord de la Martinique, qui se voulait volcanique avant tout (pour peu qu’on veuille comparer les paquets de mer aux laves de pierres) devient sous votre plume : Marinade du bas-ventre. C’est un constat et non pas une injure.
Je suis le premier à rire de ma mauvaise foi, mais comment vous appréhender, cher Christophe ? Vous sabotez allègrement votre prénom et votre nom (la poésie n’appelle pas un taxi pour se rendre en ville/mais la hache du cri/oublié au fond d’une poche). J’aime cet « oubli de la hache », c’est là que j’habite. S’il revenait parmi nous, André Breton serait épouvanté par votre usage du surréalisme. Aucun poète de ce mouvement n’a réussi à en faire une arme de combat : tel était pourtant le vœu de son pape ! C’est au vitriol que vous le réalisez. Désormais, Césaire pointera après vous.
À dire vrai, vous êtes l’incarnation du prophète Ézéchiel (je vous renvoie à sa description de la résurrection des morts). Comme la grande voix biblique, surréalisme et apocalypse (la révélation, d’après l’étymologie) se renforcent et se répondent. En tout cas, je risque une analogie soudain claire pour moi qui n’y ai point songé avant la lecture de Totem normand pour un soleil noir. Une question s’impose : quel totem peut bien résister aux fracas de votre prosodie ? Aucun.
Depuis que j’ai lu ce livre (et deux numéros de la revue Les Hommes sans Épaules, ainsi que votre essai magistral Derrière mes doubles (Les Hommes sans Épaules éditions) sur Jacques Prevel et Jean-Pierre Duprey), je passe mon temps à le relire, le cerveau grillé dès que je parcours une dizaine de pages environ. Ayez pitié des lecteurs qui cèdent à la charge de votre infanterie. Et je recommence quelques semaines plus tard. Et j’échoue aussi lamentablement.
Pour diriger une entreprise comme Les Hommes sans Épaules, il faut une énergie de granite. Césaire avait bien raison de se revendiquer du volcan, lui, le natif de l’océan atlantique. Ces deux éléments sont des frères siamois. Et vous les incarnez à merveille !
J’ai suivi de loin votre voyage en Bretagne puis en Aveyron : la mer rugueuse, la montagne de terre et sa plaine métaphysique. Vous avalez tout. Votre revue fera bientôt écho de votre belle moisson, lors même que je continue de reculer avec Totem normand pour un soleil noir. Décidément, nul n’habite vraiment sa terre. J’ai appris cette leçon depuis longtemps ; vous me donnez l’occasion de le vérifier.
J’ai peu d’énergie, et sans chercher à apprivoiser ma révolte, je la chambre constamment afin de pouvoir écrire la plus brève des partitions. Vous m’êtes la grande révélation du printemps déjà révolu.
NIMROD (in recoursaupoeme.fr, 1er novembre 2022).
*
Avez-vous lu Dauphin ?
Infatigable animateur de l’importante revue de poésie Les Hommes sans Épaules, Christophe Dauphin est engagé dans une poésie qui n’exclut pas la révolte devant les horreurs de notre époque. Comme s’il s’agissait de survivre en érigeant, tels des totems, des poèmes. Mais dans ce monde qui s’écroule, demeurent les mots et l’amour. Pour Dauphin, « le poète est un gilet jaune » (p. 75). Je vois dans sa poésie une filiation avec « l’amour et le militant » de Gaston Miron.
Je dois à Christophe Dauphin ma découverte des poètes Ilarie Voronca, Vicente Huidobro, Patrice Cauda et Marc Patin. Dauphin est un formidable lecteur des autres poètes. À notre tour de le lire. J’ai donc commandé un de ses recueils. L’auteur a eu la gentillesse de me le dédicacer ! Voici 3 extraits de « Totem normand pour un soleil noir » que j’ai beaucoup aimé. Je souligne le remarquable travail d’édition, les très nombreuses illustrations d’Alain Breton en font un véritable livre d’artiste.
« Enfin toi
que je tenais et qui renais entre mes bras au-dessus de l’abîme ouvert à la recherche de ton nom sans temps mort à marche forcée vers ton corps ce soleil
Ici commence l’amour la peau de l’aube à l’orage ici commence un pays où la main se creuse un continent plus tranchant que la lame des étoiles… » (p. 131)
« Il ne fait pas assez nuit entre mes épaules » (p. 45)
« Quelle éternité fait-il dans l’oiseau… » (p.66)
Michel PLEAU, Québec, Canada, 27 janvier 2023.
*
« Une poésie épique et de l’historique, proche des grands élans de Neruda, Senghor ou Hikmet, mais elle procède par brèves braises, par flammèches et fulgurances, comme brandons qu’expulserait un VOLCAN. Chapeau ! C’est dans la poétique française actuelle très rare. »
Jean-Paul Klée, décembre 2022
*
« D’abord le titre : il plante son auteur depuis l’origine locale en sa version magique jusqu’au jaillissement vers un ciel où se revendique le surréalisme à la Duprey.
Le livre est d’un bout à l’autre magnifiquement orné par Alain Breton, dans la collection « peinture et Parole ». Christophe Dauphin, c’est l’héritier du mouvement d’André Breton à l’état pur, c’est-à-dire que chaque page, chaque poème, chaque strophe, chaque vers est l’occasion d’innover dans l’image, d’inventer, de construire et déconstruire sens et vision, à la fois stupéfiant et dopant.
On n’est jamais dans l’ordinaire, le banal, le plat. Tout est possible, rien n’est défini. On se balade dans le paroxysme, on cavale dans l’absurde. On passe d’un extrême à l’autre : la mer déborde du lavabo, ou bien : … dans l’œil de verre d’un pare-brise. Ou encore cette série de trois vers, réjouissant : l’olive s’est noyée dans son huile – l’eau à vidé sa carafe – le parpaing a fui la maison…
Quelquefois c’est l’alinéa qui joue le rôle de booster : … jusqu’à faire dérailler la nuit – et le train… La métaphore peut coulisser doublement : … avec sa lyre d’immeuble aux cordes d’étages. Parfois on n’est pas loin de Lichtenberg : … je fais rouler mon œil dans la serrure qui a perdu – sa porte (toujours l’alinéa).
Enfin, ce peut-être le feu d’artifices dans la strophe complète : Je me souviens de ce paysage sans horloge – son ciel coupé au couteau et ses fenêtres de marteau – frappant l’enclume de l’aube.
Voilà quelques zooms pour la forme, qui dans un premier temps éclate au visage du lecteur. Viennent par-dessus, en même temps, gaufrés, les thèmes aussi divers que l’implantation normande entre Caen et Rouen, avec ses paysages viscéraux : la falaise nage en toi comme un œil, et ses sauteurs de prédilection : le cœur n’oublie jamais qu’un cœur nage dans son ventre (à propos de Jacques Prevel), avec deux métaphores parallèles.
Puis les poèmes complets autour d’un lieu, comme Gaza et L’azur court après sa côte de bœuf, la maison Picassiette, à Chartres, ou d’un poète comme Senghor, et Le poète est un Gilet Jaune…
D’autres choses encore comme la drogue : la flamme accuse le feu d’être pyromane, où les îles ici et d’ailleurs : la poésie est le langage de l’Amazonie…
Il y a le ton enfin : l’emportement, la colère, la véhémence, la rage qui secoue les mots et les images.
Le livre superbement enluminé donne la pleine mesure de ce que peut être l’écriture de Christophe Dauphin. »
Jacques MORIN (in revue Décharge n°189, mars 2021).
*
Jamais titre n’a d’emblée touché aussi fort. On reconnaît dans ces quelques mots toute la force de son auteur, sa poésie sans concession et terriblement humaine. Le recueil est scindé en seize sections distinctes par le sens, (quelques titres : Retour contre soi, La cassure qui dort dans les pierres, Une main pour être utile, Vers les îles….) Elles sont cependant propulsées les unes par les autres, entrent en résonances et animent le verbe (et la lecture) d’un cinétisme presque insoutenable, tendu par la puissance des images et celle des émotions. Les peintures d’Alain Breton ornent (le verbe est de l’auteur) chaque page, compagnonnage subtil et fidèle, les couleurs et les formes, jamais semblables, interpellent et n’offrent aux poèmes aucun repos. Le Totem est énergie déployée, ancre unique et cependant diluée dans l’espace et les cœurs.
Le poète est né le 7 août 1968 à Nonancourt dans l’Eure, il n’est pas l’effigie ni l’axe central de sa terre natale, L’enfance de sable/que l’on ne peut pas ramasser, // Normand je suis aussi de ce pays-là/ du pays des ronds-points de notre humanité/ il est homme parmi tous et chante dans ce livre une fraternité sans égale à l’égard de toutes ses sœurs et de tous ses frères d’armes Je suis du pays de Jacques Prevel//Nul homme n’est seul dans le ciel de la Charente/de l’Avre du Rhône ou de la Volga// Normand/je suis aussi de ce pays-là/de cette Provence des Hommes sans Épaules//
L’arme ne blesse pas mais réinvente un monde possible où trahison et injustice sont honnis et donnés en pâture aux mâtins invisibles de la révolte. On connaît l’extraordinaire travail d’écriture de Christophe Dauphin, plus de quatorze recueils de poésie, son œuvre de revuiste, et ses essais sur les autres : Cauda, Lucie Delarue-Mardrus, Voronca, Rousselot, Simonomis, Coutaud… Cet élan pour autrui, ce sourire sans fin, est lié intrinsèquement à sa poésie La poésie c’est le je qui cultive l’autre en moi, écriture du don, écriture salutaire. Dauphin ne se pose pas en sauveur mais en ami, il incarne l’amitié, il est celui qui pose la main sur la plaie béante de l’être aimé ou de l’anonyme, sans le dire (mais en hurlant de colère), sans ostentation (mais en écrivant). Sa poésie est acte, chaque combat le sien.
Ce recueil se lit comme une traversée du monde et de ses feux (pour en réchapper), comme une main tendue quand il fait noir. Dauphin personnifie l’espace, le totémise presque, Le ciel s’enfonce dans la boue du Caux//Les arbres suent du pétrole// Ici l’azur vous offre la main// Les balcons flottent dans les yeux cernés d’une nuit blanche//O îles qui passez au loin//…
Et lui, le poète, se fait espace, se laisse imprégner de toutes parts par les éléments, il fusionne avec la nature, la ville, la réalité et ses pestilences jusqu’à dématérialisation et dilution de son corps un visage éclate dans le bois sec de mes artères// Il ne fait pas assez nuit entre mes épaules//La falaise c’est toi entier dans sa vague//La falaise nage en toi/ elle n’est pas seulement le pic de ton visage// Là même où j’ai vomi les papillons// Un visage que je taille dans la pirogue d’une falaise//Le sang est monté au plafond pour secouer la foudre// Un sanglot que les chevaux traversent (O la beauté de ce dernier vers !)
L’écriture de Dauphin, à la densité presque épique, d’une sensibilité aigüe, draine et emporte, charrie immondices et nuages, lave le monde. Le poète incarne la révolte et avec elle les forces du possible. Sa voix plonge dans les failles, les plus visibles et celles enfouies au plus profond de chacun. Sans jamais céder face à la douleur et aux béances, cette poésie du combat est un hymne des plus mirifiques à la vie. De même que l’on peut compter sur l’homme, cette poésie exfiltre l’espérance sans qu’elle ne soit jamais ni promise ni même nommée.
Totem normand pour un soleil noir est un voyage hallucinant, on est revient vivifié et abasourdi, secoué d’images, tremblant et pacifié. Lire ce recueil c’est accompagner ce totem normand, incarner la force de son souffle et le recevoir en plein cœur, myriades d’émotions jaillies d’une poésie à fragmentation. Salutaire.
Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix n°36, 2021).
*
Critique littéraire, directeur de la revue Les Hommes sans Epaules, membre actif de l’Académie Mallarmé, Christophe Dauphin a aussi écrit une vingtaine de livres de poésie et des essais sur des écrivains tels que Jean Breton, Verlaine, Sarane Alexandrian, Henri Rode, Jean Rousselot. Le lire, dans Totem normand pour un soleil noir, son dernier recueil, c’est prendre en compte deux éléments essentiels qui éclairent ses écrits : la « normandité » et l’émotivisme.
Le premier mot a été forgé par Léopold Sédar Senghor dont on connaît les liens avec la Normandie. Lors d’une conférence privée à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen – le texte intégral en a été publié par les éditions Lurlure en 2018 –, il avait pris grand soin de préciser que le terme de « normandité » tel qu’il le concevait n’était pas la « normanditude » et qu’il ne pouvait être assimilé à celui de « négritude », dont le sens est tout différent. Il y définissait la « normandité » comme « un lyrisme lucide » et disait de l’artiste normand, qu’il soit écrivain, peintre ou musicien, qu’il était un « créateur intégral, avec l’accent mis sur la création elle-même », un créateur de beauté. Christophe Dauphin, qui connut Léopold Sédar Senghor, a fait sienne cette « normandité », à la fois dans sa singularité et son universalisme, une certaine manière de vivre et de penser aux dimensions du monde sans perdre ses racines.
L’autre élément, tout aussi important, est l’émotivisme. Le mot lui-même avait déjà été évoqué par ses amis Guy Chambelland et Jean Breton, mais Christophe Dauphin lui insuffle, avec ses complices de la revue Les Hommes sans épaules, une énergie nouvelle et en précise le sens en l’inscrivant au croisement de la « poésie pour vivre » et du surréalisme, sans oublier le grand ancêtre que fut Pierre Reverdy. Dans un entretien avec la revue Ballast, il proposera cette définition : « L’émotivisme est la création par une œuvre esthétique – grâce à une certaine association de mots, de couleurs ou de formes qui se fixent et assument une réalité incomparable à toute autre – d’une émotion particulière, et non truquée, que les choses de la nature ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme. Car la poésie est uniquement en l’homme et c’est ce dernier qui en charge les choses, en s’en servant pour s’exprimer. » Qu’on n’attende pas de lui une quelconque poésie de recherche, forgée laborieusement à grand renfort de clichés universitaires, et il n’est pas un mécano qui « trafique le moteur du langage ». Si Christophe Dauphin parle d’esthétique, c’est d’une esthétique de la rupture, qui met les nerfs et la pensée à vif, qui « sabote les sens » pour mettre le réel en dérangement – ce qui n’est pas sans faire penser au « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens » d’Arthur Rimbaud.
Avec Totem normand pour un soleil noir, superbement orné par Alain Breton, Christophe Dauphin nous rappelle – par le titre déjà – qu’il appartient à un clan, s’inscrit dans une lignée d’écrivains, d’origine normande mais pas seulement, avec une prédilection pour ces poètes marqués du sceau du « soleil noir » que sont, entre autres, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel, Jean Sénac, Marc Patin. Le livre part d’une adolescence révoltée dans la banlieue ouest de Paris où il déambule, « la vase aux lèvres et la rage en bandoulière », parmi d’autres « compagnons du gravier » au pied des tours.
Dès les premiers mots, le lecteur est bousculé, entraîné dans une « zone d’extrême turbulence » entre l’être et le dire. Il sait qu’il ne sortira pas indemne de cette lecture où la poésie travaille au corps-à-corps, à « la hache d’un cri ». On n’en demandait pas moins de cet écrivain qui « entre par effraction dans l’alphabet », et dans le réel, car c’est « dans l’émotion seule du vécu que se forgent les mots ». Il y a un double mouvement chez ce poète, vers l’extériorité, y compris la réalité la plus sordide qu’il « fracture avec un pied de biche », définitivement du côté des opprimés et des révoltés, en France et ailleurs, ses « frères humains », et vers l’intériorité où il faut creuser pour réveiller les rêves enfouis : « malaxe tes régions reculées qui frottent leurs bois de fables contre l’épaule du cri », écrit-il.
Deux vers expriment clairement ce cheminement : d’une part « les mots boxent la langue avec les poings de la vie », d’autre part « la poésie boxe les mots avec les poings du rêve ». Christophe Dauphin nous entraîne vers une « connaissance par les gouffres », comme l’écrivait si magnifiquement Henri Michaux. La violence de l’écriture n’en masque pas la sauvage et ténébreuse beauté, mais au contraire la révèle :
« Bouquet d’orties en travers du cri qui recrache la mer
dégaine ta vie qui tourne sur toi-même
dégaine et tire à bout portant ton enfance
tes mots-poumons tes tripes qui lèvent l’ancre
ton langage qui plonge comme une sonde
mal aiguisée entre les vagues
dans les mille et un cauchemars de tes os. »
Alain ROUSSEL (in www.en-attendant-nadeau.fr/2021/05/19).
*
Avec les ongles et les dents du langage - je suis un loup dont la meute a été décimée - dans un sac de mots épuisés d'éclairs - qui a fait escale dans le labyrinthe de Minos. Cela ne résume pas les trois âges de l'énigme du sphinx, c'est bien plus vertigineux. Cela résume toute l'histoire de l'humanité. Exclu de la meute, assoifé de pouvoir qu'il était, Minos, enfermé dans le labyrinthe comme le Minotaure, s'envolera-t-il pour se brûler les ailes ou illustrera-t-il par ses actes les dessins de Picasso si mal connus de Minotauromachie, brouillons de Guernica ?
Chapitre VIII, le poète est un gilet jaune: superbe poème à la gloire de la révolte du même nom, de tous les éborgnés, de Geneviève Legay, de l'ancien boxeur Dettinger, qui sauva la vie d'une femme à terre, menacée par une charge aveugle de la police.
Ces lignes le célèbrent : Frappe le malheur et la misère - les canines du néant - qui rendent invisibles à autrui à uex-mêmes - frappe l'oppression jusqu'à son ombre - sur la passerelle les tam-tam galopent - comme un feu de brousse qui te sacre soleil...
A LIRE ABSOLUMENT !
Alain WEXLER (in revue Verso n°184, mars 2021).
*
Totem normand pour un soleil noir, ce magnifique ouvrage poétique de Christophe Dauphin, orné par Alain Breton, lie la parole et la peinture dans une spirale enivrante : Sur le ring de la vie - la poésie boxe les mots avec les poings du rêve - cet insecte qui s’envole entre les pages du Merveilleux.
Ces mots de Christophe Dauphin définissent la poésie, combat implacable et perdu d’avance mais une défaite retournée en victoire, plus exactement en liberté par le dépassement de toute forme. Il avertit : « Réveille-toi dans tes os ». C’est ici et maintenant, dans cette chair là, dans ce corps là, qu’il s’agit de se réveiller, d’ouvrir les yeux sur le réel pour le transformer par la subtile alchimie de la poésie, art de vivre, de mourir et de renaître de ses cendres. En effet, si « L’azur court après sa côte de bœuf » il est toujours question d’aller « Vers les îles ».
La poésie de Christophe Dauphin est au plus près de l’expérience, de la douleur et de ce qu’elle sécrète de lumière, de connaissance de soi. Il nous fait marcher aux côtés des exclus, des parias, des combattants, des fils et filles de la colère, des vivants finalement, contre les Hommes-machines et leurs produits aliénants. C’est un cri et un coup de pied dans la poubelle dorée du monde, un appel à l’insoumission et à la veille. Ne jamais fermer les yeux, ne jamais même ciller, ne jamais baisser la garde des mots, laisser libre la place pour la joie, la fraternité, l’amitié, l’alliance des êtres.
La poésie écarte tes dents pour que la mer se dégorge de toi
et mange ton visage dans un miroir
ce diamant noir qui saigne en moi
Elle libère la colère de ton armure amnésique
volcan au milieu de tout et de rien
dans la déchirure du bocage de la chair
Et vogue la barque de la vie
qui est un refus dont je suis un atome
un refus qui brandit les poings de mille paysages
dont j’aborde les lèvres comme une plage à habiter
D’abord survivre puis vivre intensément entre les instants de la survie. Se désenclaver du monde. Parfois située, Normandie ou Provence, la poésie de Christophe Dauphin creuse les souvenirs et les savoirs, cherche l’expérience originelle en ce qu’elle a d’insituable, d’universel, de permanent. Il appelle dans son chemin anonymes, proches ou poètes disparus, à la fois fantômes et éveilleurs.
Pas de soleil d’or sans soleil noir.
Il ne s’agit pas de changer le monde. Le monde est un donné. Mais de l’inclure dans quelque chose de plus vaste, toujours inscrit dans le regard de qui est attentif, attentif réellement. Le monde n’a pas besoin de sauvetage mais d’entendement.
L’œil ne s’ouvre jamais que de l’intérieur
vers la lumière carnivore
des papillons d’air et de douleur
Le personnel n’est pas le sujet mais la flèche qui oriente, qui ouvre l’horizon, qui pousse vers le soi et vers ces autres qui demeurent, verticaux et vivants, dans les tourmentes comme dans les temps suspendus.
Quelqu’un ici est près de moi
qui jamais ne m’abandonne
cet amour de mes amis
avec qui je tiens à mon tour au soleil les Assises du Feu
Un admirable instant un festin éternel
dans un silex qui n’est pas une hache guerrière
mais la pierre à feu des Hommes sans Epaules
dont l’abîme ne boit pas d’eau plate.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 28 octobre 2020).
*
Il existe dans ce live une foi inébranlable en les mots et la poésie. Dauphin la concocte dans une sorte de néo-surréalisme engagé de bon aloi et une foi dans l’humain démuni face aux divers pouvoirs politiques, idéologiques et religieux.
S’y retrouve - mais sans moindre copie - une doxa héritière des grands anciens, de Vaché à Cendrars en passant par Eluard et bien d’autres. Ils cohabitent avec des tubes d’Ultra Brite mis comme frontières ou blindages pour faire sourire les barbelés qui, en Palestine et à San Diego, partagent le bon grain de l’ivraie.
C’est souvent vif, lyrique tant l’auteur se plaît dans ses mots. La révolte gronde dans des dérives orphiques où il s’agit d’assurer une survivance dans un monde grevé de son lot de perdants : migrants, drogués, etc..
Dauphin veut donc brasser le monde avec ambition pour le secouer…
Jean-Paul GAVARD-PERRET (in le littéraire.com, 25 octobre 2020).
*
Ces poèmes expriment le goût pour le travail de la langue, l'attachement aux paysages de Normandie et de Provence, ainsi que la colère contre les religions et le fanatisme. Le poète plaide en faveur d'un monde plus fraternel et se révolte contre le saccage du vivant.
Livres Hebdo / Electre, 2021.
*
Mûrie dans les désirs, lavée dans le blasphème, indissociable de la douleur/terreur de vivre et de mourir, engendrée par l’irrationnalité morbide de l’injustice, la colère du poète a changé la couleur du soleil. Et l’on voit naitre la force d’un art poétique si naturellement tourné vers la diversité de l’être et des autres, vers la plaque tournante des fondements, que c’est comme à la manière d’un chœur antique qu’il semble relater les événements, les drames, les jugements iniques du monde, et notamment de la cité à la dérive, faire imploser leurs socles, leurs sédiments.
Montée en flammes, montée en mots, usage du vrai, d’un radiocarbone authentique, et degrés conquis sur les domaines antinomiques de l’impossible : voilà les matériaux du livre. Je gratte cette plaie de vivre et d’écrire nous dit Christophe Dauphin et l’on entend que c’est d’une main de guérisseur pour en extraire les étincelles sublimes qui en dépit de l’ombre et de la nuit temporelles y demeurent. Dès lors, entre l’aube et le crépuscule, il faudra chercher les filons dans l’incertitude, dans ce « peu à vivre » de l’adolescence, filons qui ont pour noms, miraculeux, Yves Martin, Léopold Sédar Senghor (et bien d’autres), et comme contenant le jeune Christophe Dauphin qui jamais ne se dédira de sa conviction : la lumière, le soleil est dédicataire du chemin.
Et dès l’enfance, cette enfance à la fois décontenancée et volontaire, qui se déroule dans la cité dortoir de Colombes, et qui constitue le premier mouvement du recueil, il y a toujours un tournant où les lueurs percent au milieu des décombres. Selon le principe d’une nouvelle collection Peinture et Parole des éditions Les Hommes sans Épaules, le texte est orné par Alain Breton. Je recommande vivement d’aller voir du côté de ces « ornements ». Il y a là une manne si riche qu’elle provoque arrêts et illuminations.
L’ouvrage se compose de seize chants qui suivent une chronologie approximative relative aux rencontres et aux épisodes déterminants. L’idée-force est cette ligne de conduite constitutive de la personne comme de l’œuvre, cette exigence morale jamais démentie. La fonction créatrice relève ici de l’intellect autant que des abstractions sensibles et imaginatives. La conscience, la pensée, l’enjeu rationnel engendrent leurs propres mondes, leurs propres cimes, leurs mystères. La raison bâtisseuse, le savoir lucide avec la cassure qui dort dans les pierres détiennent les clés des puissances oniriques. Point ne suffit à l’auteur de se laisser porter par un fluide poétique, il faut que le verbe érige l’avenir, construise les fractions de ciment et de ciel, soit partie prenante avec les données du réel.
Il faut que l’homme, consacré en écriture, secoue la lumière de ce ciel, avec ses essences et le spectre des possibles sur la terre. On ne se repose jamais dans les mots, on les délivre de leur être figé, de leurs fictions, on les revêt et leur confère leur part concrète, éminemment efficiente, d’humanité. Un jour j’ai fracturé le réel avec un pied de biche / j’ai plié mon arbre et je suis parti avec la pluie / qui dort dans les pierres / avec sa cassure gyropharisée / bétonnée avec ton venin / armaturisé avec tes os. La colère migre, amasse des triomphes, des défaites, se retrouve par-delà les mers, par-delà les frontières, à Alger, à Tunis, à Damas, au Caire, partout où les tueries, la haine et l’injustice rivalisent avec le soleil. Et les mots, des mots sans corps devant l’imposture, le mensonge et les faux-fuyants, devraient demeurer des mots de fête et de chandeleur ? Peut-être deviendront-ils un jour célébrations, peut-être l’azur sera-t-il alors libéré du cœur des galets, mais pas ici, pas maintenant, pas tant que la nuit n’a pas encore été décapitée. Révolte qui peut parfois donner le change, sembler se commettre avec un parti-pris de beauté, avec ses leurres, ses camouflages, ses travestis, ainsi que dans ce cinquième chant L’azur court après sa côte de bœuf qui aborde les reflets et les éclats viciés du sud de la France.
Azur dont le poète nous dit comme par prudence j’en ai toujours un au fond de ma poche, combiné ici avec un simulacre d’harmonie, avec la mer et la disparité des hommes et des apparences, tous ensemble bien guindés, bien gainés, bien faussés. Mais la colère n’est pas seule à s’illustrer dans le cycle impétueux de l’auteur. L’altérité, ce sourd ferment communautaire, cette autre forme de l’amour du prochain, prospectif, décanté, inquiète son sommeil, captive ses sens, sa vision, son éthique, stipule son crédo comme au cœur d’une nuit d’insomnie : La poésie ne dit pas seulement : / JE EST UN AUTRE ! / Elle dit aussi surtout : / JE SONT TOUS LES AUTRES ! L’altérité, la passion humaine infiltre ses textes, nourrit sa recherche, sa substance poétique, creuse son sillon dans son corps et ses rêves jusqu’à l’obsession Survivre / il faut survivre… / une phrase de poings jetés dans le sommeil / mille visages en un seul / qui bondissent à ma gorge / affamés / délirants.
Caux, Le Havre, Etretat, Rouen, partout son cœur s’attarde, fait le constat furieux de l’échec et de la cruauté éternels, administre le baume, l’impuissante consolation de ceux qui portent témoignage, partout où Il pleut la mort où des baïonnettes taillent la côte de bœuf du paysage. Les mots ne sont pas que le bleu du ciel. En tous lieux, sa parole sert les bans lésés, criblés, de la mémoire. L’histoire et l’espoir pourront-ils se régénérer, revivre autrement ? Quoi qu’il en soit le poète s’y emploie d’une constance et d’un élan sans cesse rehaussés. Les mots ne sont pas que des organes d’étoiles.
Et comme pour étayer sa voie, son engagement sans partage, se déploie le thème Normand. Il surgit, dénudant un peu de sa splendeur à chacun de ses surgissements, le grand pays normand inséparable de ses desseins, dispensateur d’intégrité, avec sa loi d’honneur, son soleil privé, élu pour sa permanence factuelle, son immédiateté, et parce qu’il dispense la sentence, le décret historique que l’homme retrouve sens et foi dans son origine. Non pour s’y enfermer, Christophe Dauphin est bien l’être de tout repli, de tout retrait stigmatisés, mais pour y retrouver et faire jouer les fibres d’une cohérence intrinsèque. En vertu de cet enracinement indéfectible, des forces, des volontés inextinguibles qui s’y relaient, et en dépit de ce trop de réalité qui nous étrangle, il va actualiser son aptitude à la pluralité du monde Je voudrais vivre jusqu’à la fin à chaque endroit / où je m’arrête / à chaque fois que je m’installe / c’est pour toujours, et accomplir ce qu’il a une fois pour toutes résolu, sa propre voie fraternelle, substantielle parmi le chemin d’hommes. Un admirable instant un festin éternel / dans un silex qui n’est pas une hache guerrière / mais la pierre à feu des Hommes sans Epaules / dont l’abîme ne boit pas d’eau plate.
On le verra partout où se plaident les outrances de l’histoire, dans les nuits laides, nécrosées du passé, des crimes contre l’amour, contre l’aurore, au sein des combattants, des résistants, des Gilets jaunes, on le verra dans les déroutes et les dérives qui se profilent au bord de l’avenir, juste au bord ! Des fureurs venues de tous les âges, de toutes les sphères étoilent sa vocation de poète. Ses mains, son cœur, les forces, les gages de ses écrits sont pris inexorablement au défilé des saccages. Comprenons-nous assez cela !
Jusqu’aux épilogues (non définitifs), jusqu’au retour (non exhaustif) vers ses îles réelles et imaginaires parce que soudain un appel de vie, la requête puissante d’un rêve a frayé la route au désir : La robe frôlée de l’île secouant ses draps - Mes yeux repliés sur toi - Traversant tes yeux je te rencontre - pour aller vers plus de lumière contre toi -tout entier j’en brûle - Grande Fleur des îles cicatrisant les plaies - tu t’ouvres chaude comme une fenêtre - pour traverser la nuit.
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Epaules n°52, octobre 2021).
*
En seize longs poèmes numérotés en chiffres romains et illustrés par les collages d’Alain Breton, Christophe Dauphin nous immerge dans sa poésie iodée et énergique, du pic des falaises au roulis des galets. « Dans l’émotion seule du vécu », il affirme d’emblée le rôle fondateur de son pays normand dans son itinéraire : « il y a un soleil noir qui nage dans une falaise ». « Nombre parmi les nombres », il appartient à ce « pays bercé par les vertèbres des falaises / que la mer escorte ».
Le Havre et Rouen, villes « unies comme deux lèvres qui embrassent leurs morts », portent les cicatrices indélébiles des martyrs et l’empreinte de notre histoire. Il définit sa « normandité » comme un « lyrisme lucide » qui lui a permis d’entrer « par effraction dans l’alphabet » et de s’affranchir des frontières.
Héritier du surréalisme, il se situe aussi dans la filiation des poètes marqués par le sceau du « soleil noir », tels Marc Patin, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel, Henri Rode, Patrice Cauda, Jean Sénac, ses frères en poésie, froudroyés par une tragique destinée. Résolument engagé dans une poésie humaine au souffle lyrique assumé et à l’émotion revendiquée, il laisse éclater des mots « de colère et de feu », car « ce n’est pas en pantoufles / qu’on peut décrocher les étoiles ».
Ce « totem », structuré et composé d’allers-retours entre passé et présent, témoigne des déséquilibres et de la violence de notre temps à la dérive, aux « horizons noyés de matraques », observés et vécus par un poète aux mots généreux, « piéton fiévreux » qui sait remonter aux gouffres et aux abîmes mais aussi nommer en fraternité nos rêves et nos espoirs.
Marie-Josée Christien (chronique "Nuits d'encre", revue "Spered Gouez / l'esprit sauvage" n°27, 2021).
*
Une seule ligne dans l'engagement de Christophe Dauphin, directeur de la revue Les Hommes sans Epaules et secrétaire de l'Académie Mallarmé: la révolte ! La révolte, qui passe par des coups de poings colorés, la révolte, qui passe par une esthétique dynamique fille du surréalisme lui-même issu d'un Rimbaud qui a fait sauter les bouchons de la langue.
Un jour j'ai fracturé le réel avec un pied de biche - j'ai plié mon arbre et je suis parti avec la pluie - qui dort dans les pierres - avec sa cassure gyropharisée - bétonnée avec ton venin - armaturisé avec tes os - La cassure - ton visage en chute libre du 9e étage - La cassure - amour soldé d'un baiser vorace - amitié à la tempe éclatée - des insultes et du mépris plein les veines - La cassure - poing d'une révolte qui n'en finit pas - poing de colère... - La nuit n'a pas encore été décapitée.
Christophe Dauphin boxe la vie et les mots, avec une énergie d'athlète en colère. Images souvent violentes, soeurs de notre violente actualité. Cette poésie est message et tentative de changer le monde, un manifeste permanent. La lutte est la racine-ressort de chaque mot.
La Nature en effet demeure capitale, de même que ce qui se passe entre les humains est capital, et rien n'est oublié dans cet ouragan de métaphores, ponctué par les collages sans concession d'Alain Breton, qui offrent des couleurs savamment déchirées.
La Beauté ici sert une cause, et la multitude de vers beaux et étonnants (le sang est monté au plafond pouir secouer la foudre) se rattache toujours à) une problématique de vie, injustices, tortures, non sans voyages et amour (L'Amazonie a des lèvres de volcan). un ouvrage qui ébouillante.
Claire BOITEL (in revue Poésie première n°85, mai 2023).
*
Est-ce trop tard ? Après tout, des extraits de ce recueil ont déjà été publiés dans la revue (numéro 33), en 2020, accompagnés d’un dossier incontournable pour qui s’intéresse à l’auteur. Voilà bien plus d’un quart de siècle que je fréquente Christophe Dauphin, l’homme, le poète et sa poésie et l’amitié qui nous réunit est ce prodige qui nous renouvelle, produit du neuf, de l’inépuisable depuis le familier, le très proche de notre relation.
Ainsi, lisant, avec retard, son recueil, il me semble découvrir une intimité nouvelle chez notre poète. Sa voix s’en-lyrise, verse des confidences, non celles d’un je – le poète est un homme sans je - mais celles d’un loup qui se laisserait approcher La vigueur de ses vers, soudain sertie d’émaux « comme une plage à habiter », nous ouvre à des poèmes-souvenirs et des poèmes-hommage pour des fusillés de la survie.
Avant de découvrir ce nouvel opus, se rappeler que Christophe Dauphin est le grand héritier de la tradition surréaliste, de ceux qui fracturent « le réel avec un pied de biche », de ses inamovibles gardien des « taudis d’étoiles » de l’avenir, pour que vite on y signe « l’azur du soleil » et non qu’on s’en détourne ; de même, ne pas oublier qu’il est le poète des combats, contre « l’avocat-cigare », les « palmiers-Matisse » et le « Passage Jouffroy ».
La poésie, par lui, rend vivante et humaine sa vocation sacrée (lire dangereuse) car elle est la voix de la justice, ou plutôt elle « frappe de justice » notre monde, et rien ne pourra la taire, ni la détourner. Lisez Christophe Dauphin. Et goûtez, aussi, dans ce recueil les dessins de son ami (et mien) Alain Breton.
Quelques-uns des vers parmi ceux qui m’ont touché : « Poète / je me suis adressé la parole la première fois / lors d’un cauchemar » ; « Réveille-toi dans tes os / la mort fermente comme un chien dans tes os » ; « Survivre / il faut survivre tour à tour exalté et honni » ; « Je mailloche la pluie ce balbutiement des nuages » ; « à chaque fois que je m’installe / c’est pour toujours » ; « Jusque dans ton sommeil qui n’a jamais nié / les yeux des autres » ; « À toi de creuser le tunnel dans la respiration des choses » ; « Je suis de ceux / dont les yeux sont partis pour l’horizon » ; « La poésie c’est la journée perdue au fond de la grammaire de nos poches / la chaise renversée du paysage qui boit le verre dans le vent / c’est le je qui cultive l’autre en moi » ; « Îles qui délaissez vos corsages sur le corail des pluies / je vous ramènerai dans mes filets de naufrage »
Pierrick de CHERMONT (in revue Les Hommes sans Epaules n°56, octobre 2023).
*
LECTURES de l'essai de Odile COHEN-ABBAS "Christophe DAUPHIN, les yeux grands ouverts", 156 pages, 15 €, éditions unicité, 2025.
Christophe Dauphin est un passeur hors pair, qui se consacre à sortir de l’oubli des poètes qui ne bénéficient pas de la reconnaissance qu’ils méritent. C’est à son tour d’être « l’objet d’un parcours de lecture sensible » (Marc Kober dans sa préface) qui met en lumière son œuvre personnelle. Odile Cohen-Abbas reprend ici par ordre chronologique quinze recueils poétiques de Christophe Dauphin, les présente et y sélectionne quelques textes fondamentaux, d’où émerge « une démarche de don et de réceptivité totale à l’autre ». Extrayant un thème dans chaque recueil, elle en tire « un fil sensible, électif, pour indiquer le sens, marquer l’évolution de l’homme et de l’œuvre ». Son étude fait apparaître l’unité de la démarche du poète et essayiste. La bibliographie exhaustive de Christophe Dauphin réunie en fin d’ouvrage est impressionnante par sa cohérence et par le nombre d’études et d’anthologies, de manifestes et d’essais publiés.
Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°31, 2025)
*
Christophe Dauphin tient une place essentielle dans la communauté des poètes, il en est un phare et une mémoire qui révèlent des talents oubliés ou cachés, il rassemble, il soutient, il éveille.
Dans cet essai, c’est son œuvre qui est explorée et, sans aucun doute, le regard et la plume d’Odile Cohen-Abbas sont les plus aptes à nous guider dans une œuvre marquante. La rencontre de ces deux esprits libres est une bénédiction et constitue en soi une féérie et une férie.
« Au-delà des courants auxquels immanquablement la critique pourra se référer, note Marc Kober dans la préface, révolte et quête du merveilleux surréaliste, nouvelle morale pour vivre sur terre, poésie pour vivre en accord avec le rêve conçu comme un état à accroître, émotivisme, les propositions rassemblées ici par Odile nous aident à mieux lire une œuvre poétique et vitale tout à la fois. Elles sont une injonction persuasive à l’aimer. »
Odile Cohen Abbas a choisi de parcourir l’œuvre selon le temps linéaire, elle qui ne cesse d’abolir le temps. Derrière cette apparence évolutive, elle n’hésite pas à emprunter des couloirs temporels pour mettre au jour une autre actualité poétique, une verticalité de l’œuvre qui échappe à toute analyse linéaire.
« Lisez-les tous ! clame-t-elle.
Lisez tous les livres de Christophe Dauphin ! Ils vous administreront des stimuli sensibles, puissants, des toniques pour le cœur et l’esprit, concrets ou imaginaires, des démentis sur les bassesses et les échecs de l’existence, des ardeurs proactives sur l’histoire humaine réalisables à l’infini, des vertus aphrodisiaques, par absorption de substance poétique, des essences, des simples, hybridations secourables entre harmonies et dissonances des chemins, des remèdes au sujet des ombres, des ténèbres concentriques qui s’approchent ou s’éloignent, ils dessineront de plus vifs contours, des auras hantées de fantasmes et de rêves inaliénables, de pièces héraldiques et révolutionnaires, d’alliances rationnelles et irrationnelles, ils conféreront une logistique de paix, d’amour, et de son contraire, à vos jours et à vos nuits d’insomnie. »
Certaines œuvres littéraires nécessitent une initiation. Elles échappent aux méthodologies académiques. C’est le cas de l’œuvre de Christophe Dauphin et Odile Cohen-Abbas se constitue initiatrice pour une œuvre symbolique et enchanteresse. Symboles et enchantements exigent avant tout une lecture lucide du réel et une maîtrise de l’art du langage, déterminant des réalités actualisées ou alternatives.
C’est un voyage, initiatique par conséquent, semé d’embûches et d’épreuves. Si l’émotion est la matière des voiles du vaisseau du poète, la langue en est le vent. Nous retrouvons avec Christophe Dauphin et Odile Cohen-Abbas, la fonction sacrée et secrète de la langue qui oriente, révèle, fige ou libère, hypnotise ou éveille, la langue qui demande d’instant en instant à être conquise.
« A travers l’ensemble des recueils, glisse Odile, c’est un chemin de vie qui se trace où chaque tronçon d’histoire est à sa place, où chaque oscillation, hésitation, transige, s’illustre plusieurs fois et trouve sa résolution. La répétition des choses et des situations est un exercice, un entraînement ou les manières du corps et de l’esprit se perfectionnent ; la répétition est un entredeux fertile qui, sortant du brouhaha et des discours informes, apporte la boisson de la continuité, de l’ardeur et de l’espérance. »
Une fois encore, ce n’est que vus du ciel que les chemins serpentins s’affirment comme les plus directs.
Rémi BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, août 2025).
|
Lectures critiques :
LETTRE À CHRISTOPHE DAUPHIN, À PROPOS DE « TOTEM NORMAND POUR UN SOLEIL NOIR »
Je me permets de vous demander tout de go : de quel bois êtes-vous fait ? Le bois que je cherche à connaître est contenu dans Totem normand pour un soleil noir (Collection Peinture et Parole, Les Hommes sans Épaules éditions). Il m’a laissé pantois ! Il contient la Normandie et l’Afrique, Senghor et les brumes de votre pays natal. Qui a jamais osé ça ? Personne. Vous vous affichez résolument à contre-courant de tout. Même les bocages normands épousent désormais la platitude sahélienne : L’espace est à ras de terre. Mais le plus décapant est ailleurs. Vous plantez votre totem avec un rythme sec et cinglant, un rythme de rock’n’roll comme pour vous défaire de l’humidité normande :
N’en jetez plus j’ai tout avalé jusqu’à l’asphalte
la mer déborde du lavabo
et la flamme de mes doigts
D’où vous vient d’écrire au couteau comme pour effacer jusqu’au bruit du pinceau sur la toile ? Car, je n’entends même pas ses caresses, vous qui êtes si peintre. Je ne fais pas seulement allusion aux œuvres d’Alain Breton qui accompagnent votre totem. Je pense également aux essais que vous avez consacrés à de nombreux peintres, dont le sculpteur Jean-Pierre Duprey. Dois-je me contenter de cet aveu :
Poète
je me suis adressé la parole pour la première fois
lors d’un cauchemar
avec des mots qui dressaient
non pas leurs hosties
mais leurs poings comme des armes
Senghor est retoqué, mais aussi Césaire, le plus rock’n’roll de tous les poètes de la négritude et du surréalisme. Cet Antillais de Basse-Pointe, au nord de la Martinique, qui se voulait volcanique avant tout (pour peu qu’on veuille comparer les paquets de mer aux laves de pierres) devient sous votre plume : Marinade du bas-ventre. C’est un constat et non pas une injure.
Je suis le premier à rire de ma mauvaise foi, mais comment vous appréhender, cher Christophe ? Vous sabotez allègrement votre prénom et votre nom (la poésie n’appelle pas un taxi pour se rendre en ville/mais la hache du cri/oublié au fond d’une poche). J’aime cet « oubli de la hache », c’est là que j’habite. S’il revenait parmi nous, André Breton serait épouvanté par votre usage du surréalisme. Aucun poète de ce mouvement n’a réussi à en faire une arme de combat : tel était pourtant le vœu de son pape ! C’est au vitriol que vous le réalisez. Désormais, Césaire pointera après vous.
À dire vrai, vous êtes l’incarnation du prophète Ézéchiel (je vous renvoie à sa description de la résurrection des morts). Comme la grande voix biblique, surréalisme et apocalypse (la révélation, d’après l’étymologie) se renforcent et se répondent. En tout cas, je risque une analogie soudain claire pour moi qui n’y ai point songé avant la lecture de Totem normand pour un soleil noir. Une question s’impose : quel totem peut bien résister aux fracas de votre prosodie ? Aucun.
Depuis que j’ai lu ce livre (et deux numéros de la revue Les Hommes sans Épaules, ainsi que votre essai magistral Derrière mes doubles (Les Hommes sans Épaules éditions) sur Jacques Prevel et Jean-Pierre Duprey), je passe mon temps à le relire, le cerveau grillé dès que je parcours une dizaine de pages environ. Ayez pitié des lecteurs qui cèdent à la charge de votre infanterie. Et je recommence quelques semaines plus tard. Et j’échoue aussi lamentablement.
Pour diriger une entreprise comme Les Hommes sans Épaules, il faut une énergie de granite. Césaire avait bien raison de se revendiquer du volcan, lui, le natif de l’océan atlantique. Ces deux éléments sont des frères siamois. Et vous les incarnez à merveille !
J’ai suivi de loin votre voyage en Bretagne puis en Aveyron : la mer rugueuse, la montagne de terre et sa plaine métaphysique. Vous avalez tout. Votre revue fera bientôt écho de votre belle moisson, lors même que je continue de reculer avec Totem normand pour un soleil noir. Décidément, nul n’habite vraiment sa terre. J’ai appris cette leçon depuis longtemps ; vous me donnez l’occasion de le vérifier.
J’ai peu d’énergie, et sans chercher à apprivoiser ma révolte, je la chambre constamment afin de pouvoir écrire la plus brève des partitions. Vous m’êtes la grande révélation du printemps déjà révolu.
NIMROD (in recoursaupoeme.fr, 1er novembre 2022).
*
Avez-vous lu Dauphin ?
Infatigable animateur de l’importante revue de poésie Les Hommes sans Épaules, Christophe Dauphin est engagé dans une poésie qui n’exclut pas la révolte devant les horreurs de notre époque. Comme s’il s’agissait de survivre en érigeant, tels des totems, des poèmes. Mais dans ce monde qui s’écroule, demeurent les mots et l’amour. Pour Dauphin, « le poète est un gilet jaune » (p. 75). Je vois dans sa poésie une filiation avec « l’amour et le militant » de Gaston Miron.
Je dois à Christophe Dauphin ma découverte des poètes Ilarie Voronca, Vicente Huidobro, Patrice Cauda et Marc Patin. Dauphin est un formidable lecteur des autres poètes. À notre tour de le lire. J’ai donc commandé un de ses recueils. L’auteur a eu la gentillesse de me le dédicacer ! Voici 3 extraits de « Totem normand pour un soleil noir » que j’ai beaucoup aimé. Je souligne le remarquable travail d’édition, les très nombreuses illustrations d’Alain Breton en font un véritable livre d’artiste.
« Enfin toi
que je tenais et qui renais entre mes bras au-dessus de l’abîme ouvert à la recherche de ton nom sans temps mort à marche forcée vers ton corps ce soleil
Ici commence l’amour la peau de l’aube à l’orage ici commence un pays où la main se creuse un continent plus tranchant que la lame des étoiles… » (p. 131)
« Il ne fait pas assez nuit entre mes épaules » (p. 45)
« Quelle éternité fait-il dans l’oiseau… » (p.66)
Michel PLEAU, Québec, Canada, 27 janvier 2023.
*
« Une poésie épique et de l’historique, proche des grands élans de Neruda, Senghor ou Hikmet, mais elle procède par brèves braises, par flammèches et fulgurances, comme brandons qu’expulserait un VOLCAN. Chapeau ! C’est dans la poétique française actuelle très rare. »
Jean-Paul Klée, décembre 2022
*
« D’abord le titre : il plante son auteur depuis l’origine locale en sa version magique jusqu’au jaillissement vers un ciel où se revendique le surréalisme à la Duprey.
Le livre est d’un bout à l’autre magnifiquement orné par Alain Breton, dans la collection « peinture et Parole ». Christophe Dauphin, c’est l’héritier du mouvement d’André Breton à l’état pur, c’est-à-dire que chaque page, chaque poème, chaque strophe, chaque vers est l’occasion d’innover dans l’image, d’inventer, de construire et déconstruire sens et vision, à la fois stupéfiant et dopant.
On n’est jamais dans l’ordinaire, le banal, le plat. Tout est possible, rien n’est défini. On se balade dans le paroxysme, on cavale dans l’absurde. On passe d’un extrême à l’autre : la mer déborde du lavabo, ou bien : … dans l’œil de verre d’un pare-brise. Ou encore cette série de trois vers, réjouissant : l’olive s’est noyée dans son huile – l’eau à vidé sa carafe – le parpaing a fui la maison…
Quelquefois c’est l’alinéa qui joue le rôle de booster : … jusqu’à faire dérailler la nuit – et le train… La métaphore peut coulisser doublement : … avec sa lyre d’immeuble aux cordes d’étages. Parfois on n’est pas loin de Lichtenberg : … je fais rouler mon œil dans la serrure qui a perdu – sa porte (toujours l’alinéa).
Enfin, ce peut-être le feu d’artifices dans la strophe complète : Je me souviens de ce paysage sans horloge – son ciel coupé au couteau et ses fenêtres de marteau – frappant l’enclume de l’aube.
Voilà quelques zooms pour la forme, qui dans un premier temps éclate au visage du lecteur. Viennent par-dessus, en même temps, gaufrés, les thèmes aussi divers que l’implantation normande entre Caen et Rouen, avec ses paysages viscéraux : la falaise nage en toi comme un œil, et ses sauteurs de prédilection : le cœur n’oublie jamais qu’un cœur nage dans son ventre (à propos de Jacques Prevel), avec deux métaphores parallèles.
Puis les poèmes complets autour d’un lieu, comme Gaza et L’azur court après sa côte de bœuf, la maison Picassiette, à Chartres, ou d’un poète comme Senghor, et Le poète est un Gilet Jaune…
D’autres choses encore comme la drogue : la flamme accuse le feu d’être pyromane, où les îles ici et d’ailleurs : la poésie est le langage de l’Amazonie…
Il y a le ton enfin : l’emportement, la colère, la véhémence, la rage qui secoue les mots et les images.
Le livre superbement enluminé donne la pleine mesure de ce que peut être l’écriture de Christophe Dauphin. »
Jacques MORIN (in revue Décharge n°189, mars 2021).
*
Jamais titre n’a d’emblée touché aussi fort. On reconnaît dans ces quelques mots toute la force de son auteur, sa poésie sans concession et terriblement humaine. Le recueil est scindé en seize sections distinctes par le sens, (quelques titres : Retour contre soi, La cassure qui dort dans les pierres, Une main pour être utile, Vers les îles….) Elles sont cependant propulsées les unes par les autres, entrent en résonances et animent le verbe (et la lecture) d’un cinétisme presque insoutenable, tendu par la puissance des images et celle des émotions. Les peintures d’Alain Breton ornent (le verbe est de l’auteur) chaque page, compagnonnage subtil et fidèle, les couleurs et les formes, jamais semblables, interpellent et n’offrent aux poèmes aucun repos. Le Totem est énergie déployée, ancre unique et cependant diluée dans l’espace et les cœurs.
Le poète est né le 7 août 1968 à Nonancourt dans l’Eure, il n’est pas l’effigie ni l’axe central de sa terre natale, L’enfance de sable/que l’on ne peut pas ramasser, // Normand je suis aussi de ce pays-là/ du pays des ronds-points de notre humanité/ il est homme parmi tous et chante dans ce livre une fraternité sans égale à l’égard de toutes ses sœurs et de tous ses frères d’armes Je suis du pays de Jacques Prevel//Nul homme n’est seul dans le ciel de la Charente/de l’Avre du Rhône ou de la Volga// Normand/je suis aussi de ce pays-là/de cette Provence des Hommes sans Épaules//
L’arme ne blesse pas mais réinvente un monde possible où trahison et injustice sont honnis et donnés en pâture aux mâtins invisibles de la révolte. On connaît l’extraordinaire travail d’écriture de Christophe Dauphin, plus de quatorze recueils de poésie, son œuvre de revuiste, et ses essais sur les autres : Cauda, Lucie Delarue-Mardrus, Voronca, Rousselot, Simonomis, Coutaud… Cet élan pour autrui, ce sourire sans fin, est lié intrinsèquement à sa poésie La poésie c’est le je qui cultive l’autre en moi, écriture du don, écriture salutaire. Dauphin ne se pose pas en sauveur mais en ami, il incarne l’amitié, il est celui qui pose la main sur la plaie béante de l’être aimé ou de l’anonyme, sans le dire (mais en hurlant de colère), sans ostentation (mais en écrivant). Sa poésie est acte, chaque combat le sien.
Ce recueil se lit comme une traversée du monde et de ses feux (pour en réchapper), comme une main tendue quand il fait noir. Dauphin personnifie l’espace, le totémise presque, Le ciel s’enfonce dans la boue du Caux//Les arbres suent du pétrole// Ici l’azur vous offre la main// Les balcons flottent dans les yeux cernés d’une nuit blanche//O îles qui passez au loin//…
Et lui, le poète, se fait espace, se laisse imprégner de toutes parts par les éléments, il fusionne avec la nature, la ville, la réalité et ses pestilences jusqu’à dématérialisation et dilution de son corps un visage éclate dans le bois sec de mes artères// Il ne fait pas assez nuit entre mes épaules//La falaise c’est toi entier dans sa vague//La falaise nage en toi/ elle n’est pas seulement le pic de ton visage// Là même où j’ai vomi les papillons// Un visage que je taille dans la pirogue d’une falaise//Le sang est monté au plafond pour secouer la foudre// Un sanglot que les chevaux traversent (O la beauté de ce dernier vers !)
L’écriture de Dauphin, à la densité presque épique, d’une sensibilité aigüe, draine et emporte, charrie immondices et nuages, lave le monde. Le poète incarne la révolte et avec elle les forces du possible. Sa voix plonge dans les failles, les plus visibles et celles enfouies au plus profond de chacun. Sans jamais céder face à la douleur et aux béances, cette poésie du combat est un hymne des plus mirifiques à la vie. De même que l’on peut compter sur l’homme, cette poésie exfiltre l’espérance sans qu’elle ne soit jamais ni promise ni même nommée.
Totem normand pour un soleil noir est un voyage hallucinant, on est revient vivifié et abasourdi, secoué d’images, tremblant et pacifié. Lire ce recueil c’est accompagner ce totem normand, incarner la force de son souffle et le recevoir en plein cœur, myriades d’émotions jaillies d’une poésie à fragmentation. Salutaire.
Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix n°36, 2021).
*
Critique littéraire, directeur de la revue Les Hommes sans Epaules, membre actif de l’Académie Mallarmé, Christophe Dauphin a aussi écrit une vingtaine de livres de poésie et des essais sur des écrivains tels que Jean Breton, Verlaine, Sarane Alexandrian, Henri Rode, Jean Rousselot. Le lire, dans Totem normand pour un soleil noir, son dernier recueil, c’est prendre en compte deux éléments essentiels qui éclairent ses écrits : la « normandité » et l’émotivisme.
Le premier mot a été forgé par Léopold Sédar Senghor dont on connaît les liens avec la Normandie. Lors d’une conférence privée à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen – le texte intégral en a été publié par les éditions Lurlure en 2018 –, il avait pris grand soin de préciser que le terme de « normandité » tel qu’il le concevait n’était pas la « normanditude » et qu’il ne pouvait être assimilé à celui de « négritude », dont le sens est tout différent. Il y définissait la « normandité » comme « un lyrisme lucide » et disait de l’artiste normand, qu’il soit écrivain, peintre ou musicien, qu’il était un « créateur intégral, avec l’accent mis sur la création elle-même », un créateur de beauté. Christophe Dauphin, qui connut Léopold Sédar Senghor, a fait sienne cette « normandité », à la fois dans sa singularité et son universalisme, une certaine manière de vivre et de penser aux dimensions du monde sans perdre ses racines.
L’autre élément, tout aussi important, est l’émotivisme. Le mot lui-même avait déjà été évoqué par ses amis Guy Chambelland et Jean Breton, mais Christophe Dauphin lui insuffle, avec ses complices de la revue Les Hommes sans épaules, une énergie nouvelle et en précise le sens en l’inscrivant au croisement de la « poésie pour vivre » et du surréalisme, sans oublier le grand ancêtre que fut Pierre Reverdy. Dans un entretien avec la revue Ballast, il proposera cette définition : « L’émotivisme est la création par une œuvre esthétique – grâce à une certaine association de mots, de couleurs ou de formes qui se fixent et assument une réalité incomparable à toute autre – d’une émotion particulière, et non truquée, que les choses de la nature ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme. Car la poésie est uniquement en l’homme et c’est ce dernier qui en charge les choses, en s’en servant pour s’exprimer. » Qu’on n’attende pas de lui une quelconque poésie de recherche, forgée laborieusement à grand renfort de clichés universitaires, et il n’est pas un mécano qui « trafique le moteur du langage ». Si Christophe Dauphin parle d’esthétique, c’est d’une esthétique de la rupture, qui met les nerfs et la pensée à vif, qui « sabote les sens » pour mettre le réel en dérangement – ce qui n’est pas sans faire penser au « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens » d’Arthur Rimbaud.
Avec Totem normand pour un soleil noir, superbement orné par Alain Breton, Christophe Dauphin nous rappelle – par le titre déjà – qu’il appartient à un clan, s’inscrit dans une lignée d’écrivains, d’origine normande mais pas seulement, avec une prédilection pour ces poètes marqués du sceau du « soleil noir » que sont, entre autres, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel, Jean Sénac, Marc Patin. Le livre part d’une adolescence révoltée dans la banlieue ouest de Paris où il déambule, « la vase aux lèvres et la rage en bandoulière », parmi d’autres « compagnons du gravier » au pied des tours.
Dès les premiers mots, le lecteur est bousculé, entraîné dans une « zone d’extrême turbulence » entre l’être et le dire. Il sait qu’il ne sortira pas indemne de cette lecture où la poésie travaille au corps-à-corps, à « la hache d’un cri ». On n’en demandait pas moins de cet écrivain qui « entre par effraction dans l’alphabet », et dans le réel, car c’est « dans l’émotion seule du vécu que se forgent les mots ». Il y a un double mouvement chez ce poète, vers l’extériorité, y compris la réalité la plus sordide qu’il « fracture avec un pied de biche », définitivement du côté des opprimés et des révoltés, en France et ailleurs, ses « frères humains », et vers l’intériorité où il faut creuser pour réveiller les rêves enfouis : « malaxe tes régions reculées qui frottent leurs bois de fables contre l’épaule du cri », écrit-il.
Deux vers expriment clairement ce cheminement : d’une part « les mots boxent la langue avec les poings de la vie », d’autre part « la poésie boxe les mots avec les poings du rêve ». Christophe Dauphin nous entraîne vers une « connaissance par les gouffres », comme l’écrivait si magnifiquement Henri Michaux. La violence de l’écriture n’en masque pas la sauvage et ténébreuse beauté, mais au contraire la révèle :
« Bouquet d’orties en travers du cri qui recrache la mer
dégaine ta vie qui tourne sur toi-même
dégaine et tire à bout portant ton enfance
tes mots-poumons tes tripes qui lèvent l’ancre
ton langage qui plonge comme une sonde
mal aiguisée entre les vagues
dans les mille et un cauchemars de tes os. »
Alain ROUSSEL (in www.en-attendant-nadeau.fr/2021/05/19).
*
Avec les ongles et les dents du langage - je suis un loup dont la meute a été décimée - dans un sac de mots épuisés d'éclairs - qui a fait escale dans le labyrinthe de Minos. Cela ne résume pas les trois âges de l'énigme du sphinx, c'est bien plus vertigineux. Cela résume toute l'histoire de l'humanité. Exclu de la meute, assoifé de pouvoir qu'il était, Minos, enfermé dans le labyrinthe comme le Minotaure, s'envolera-t-il pour se brûler les ailes ou illustrera-t-il par ses actes les dessins de Picasso si mal connus de Minotauromachie, brouillons de Guernica ?
Chapitre VIII, le poète est un gilet jaune: superbe poème à la gloire de la révolte du même nom, de tous les éborgnés, de Geneviève Legay, de l'ancien boxeur Dettinger, qui sauva la vie d'une femme à terre, menacée par une charge aveugle de la police.
Ces lignes le célèbrent : Frappe le malheur et la misère - les canines du néant - qui rendent invisibles à autrui à uex-mêmes - frappe l'oppression jusqu'à son ombre - sur la passerelle les tam-tam galopent - comme un feu de brousse qui te sacre soleil...
A LIRE ABSOLUMENT !
Alain WEXLER (in revue Verso n°184, mars 2021).
*
Totem normand pour un soleil noir, ce magnifique ouvrage poétique de Christophe Dauphin, orné par Alain Breton, lie la parole et la peinture dans une spirale enivrante : Sur le ring de la vie - la poésie boxe les mots avec les poings du rêve - cet insecte qui s’envole entre les pages du Merveilleux.
Ces mots de Christophe Dauphin définissent la poésie, combat implacable et perdu d’avance mais une défaite retournée en victoire, plus exactement en liberté par le dépassement de toute forme. Il avertit : « Réveille-toi dans tes os ». C’est ici et maintenant, dans cette chair là, dans ce corps là, qu’il s’agit de se réveiller, d’ouvrir les yeux sur le réel pour le transformer par la subtile alchimie de la poésie, art de vivre, de mourir et de renaître de ses cendres. En effet, si « L’azur court après sa côte de bœuf » il est toujours question d’aller « Vers les îles ».
La poésie de Christophe Dauphin est au plus près de l’expérience, de la douleur et de ce qu’elle sécrète de lumière, de connaissance de soi. Il nous fait marcher aux côtés des exclus, des parias, des combattants, des fils et filles de la colère, des vivants finalement, contre les Hommes-machines et leurs produits aliénants. C’est un cri et un coup de pied dans la poubelle dorée du monde, un appel à l’insoumission et à la veille. Ne jamais fermer les yeux, ne jamais même ciller, ne jamais baisser la garde des mots, laisser libre la place pour la joie, la fraternité, l’amitié, l’alliance des êtres.
La poésie écarte tes dents pour que la mer se dégorge de toi
et mange ton visage dans un miroir
ce diamant noir qui saigne en moi
Elle libère la colère de ton armure amnésique
volcan au milieu de tout et de rien
dans la déchirure du bocage de la chair
Et vogue la barque de la vie
qui est un refus dont je suis un atome
un refus qui brandit les poings de mille paysages
dont j’aborde les lèvres comme une plage à habiter
D’abord survivre puis vivre intensément entre les instants de la survie. Se désenclaver du monde. Parfois située, Normandie ou Provence, la poésie de Christophe Dauphin creuse les souvenirs et les savoirs, cherche l’expérience originelle en ce qu’elle a d’insituable, d’universel, de permanent. Il appelle dans son chemin anonymes, proches ou poètes disparus, à la fois fantômes et éveilleurs.
Pas de soleil d’or sans soleil noir.
Il ne s’agit pas de changer le monde. Le monde est un donné. Mais de l’inclure dans quelque chose de plus vaste, toujours inscrit dans le regard de qui est attentif, attentif réellement. Le monde n’a pas besoin de sauvetage mais d’entendement.
L’œil ne s’ouvre jamais que de l’intérieur
vers la lumière carnivore
des papillons d’air et de douleur
Le personnel n’est pas le sujet mais la flèche qui oriente, qui ouvre l’horizon, qui pousse vers le soi et vers ces autres qui demeurent, verticaux et vivants, dans les tourmentes comme dans les temps suspendus.
Quelqu’un ici est près de moi
qui jamais ne m’abandonne
cet amour de mes amis
avec qui je tiens à mon tour au soleil les Assises du Feu
Un admirable instant un festin éternel
dans un silex qui n’est pas une hache guerrière
mais la pierre à feu des Hommes sans Epaules
dont l’abîme ne boit pas d’eau plate.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 28 octobre 2020).
*
Il existe dans ce live une foi inébranlable en les mots et la poésie. Dauphin la concocte dans une sorte de néo-surréalisme engagé de bon aloi et une foi dans l’humain démuni face aux divers pouvoirs politiques, idéologiques et religieux.
S’y retrouve - mais sans moindre copie - une doxa héritière des grands anciens, de Vaché à Cendrars en passant par Eluard et bien d’autres. Ils cohabitent avec des tubes d’Ultra Brite mis comme frontières ou blindages pour faire sourire les barbelés qui, en Palestine et à San Diego, partagent le bon grain de l’ivraie.
C’est souvent vif, lyrique tant l’auteur se plaît dans ses mots. La révolte gronde dans des dérives orphiques où il s’agit d’assurer une survivance dans un monde grevé de son lot de perdants : migrants, drogués, etc..
Dauphin veut donc brasser le monde avec ambition pour le secouer…
Jean-Paul GAVARD-PERRET (in le littéraire.com, 25 octobre 2020).
*
Ces poèmes expriment le goût pour le travail de la langue, l'attachement aux paysages de Normandie et de Provence, ainsi que la colère contre les religions et le fanatisme. Le poète plaide en faveur d'un monde plus fraternel et se révolte contre le saccage du vivant.
Livres Hebdo / Electre, 2021.
*
Mûrie dans les désirs, lavée dans le blasphème, indissociable de la douleur/terreur de vivre et de mourir, engendrée par l’irrationnalité morbide de l’injustice, la colère du poète a changé la couleur du soleil. Et l’on voit naitre la force d’un art poétique si naturellement tourné vers la diversité de l’être et des autres, vers la plaque tournante des fondements, que c’est comme à la manière d’un chœur antique qu’il semble relater les événements, les drames, les jugements iniques du monde, et notamment de la cité à la dérive, faire imploser leurs socles, leurs sédiments.
Montée en flammes, montée en mots, usage du vrai, d’un radiocarbone authentique, et degrés conquis sur les domaines antinomiques de l’impossible : voilà les matériaux du livre. Je gratte cette plaie de vivre et d’écrire nous dit Christophe Dauphin et l’on entend que c’est d’une main de guérisseur pour en extraire les étincelles sublimes qui en dépit de l’ombre et de la nuit temporelles y demeurent. Dès lors, entre l’aube et le crépuscule, il faudra chercher les filons dans l’incertitude, dans ce « peu à vivre » de l’adolescence, filons qui ont pour noms, miraculeux, Yves Martin, Léopold Sédar Senghor (et bien d’autres), et comme contenant le jeune Christophe Dauphin qui jamais ne se dédira de sa conviction : la lumière, le soleil est dédicataire du chemin.
Et dès l’enfance, cette enfance à la fois décontenancée et volontaire, qui se déroule dans la cité dortoir de Colombes, et qui constitue le premier mouvement du recueil, il y a toujours un tournant où les lueurs percent au milieu des décombres. Selon le principe d’une nouvelle collection Peinture et Parole des éditions Les Hommes sans Épaules, le texte est orné par Alain Breton. Je recommande vivement d’aller voir du côté de ces « ornements ». Il y a là une manne si riche qu’elle provoque arrêts et illuminations.
L’ouvrage se compose de seize chants qui suivent une chronologie approximative relative aux rencontres et aux épisodes déterminants. L’idée-force est cette ligne de conduite constitutive de la personne comme de l’œuvre, cette exigence morale jamais démentie. La fonction créatrice relève ici de l’intellect autant que des abstractions sensibles et imaginatives. La conscience, la pensée, l’enjeu rationnel engendrent leurs propres mondes, leurs propres cimes, leurs mystères. La raison bâtisseuse, le savoir lucide avec la cassure qui dort dans les pierres détiennent les clés des puissances oniriques. Point ne suffit à l’auteur de se laisser porter par un fluide poétique, il faut que le verbe érige l’avenir, construise les fractions de ciment et de ciel, soit partie prenante avec les données du réel.
Il faut que l’homme, consacré en écriture, secoue la lumière de ce ciel, avec ses essences et le spectre des possibles sur la terre. On ne se repose jamais dans les mots, on les délivre de leur être figé, de leurs fictions, on les revêt et leur confère leur part concrète, éminemment efficiente, d’humanité. Un jour j’ai fracturé le réel avec un pied de biche / j’ai plié mon arbre et je suis parti avec la pluie / qui dort dans les pierres / avec sa cassure gyropharisée / bétonnée avec ton venin / armaturisé avec tes os. La colère migre, amasse des triomphes, des défaites, se retrouve par-delà les mers, par-delà les frontières, à Alger, à Tunis, à Damas, au Caire, partout où les tueries, la haine et l’injustice rivalisent avec le soleil. Et les mots, des mots sans corps devant l’imposture, le mensonge et les faux-fuyants, devraient demeurer des mots de fête et de chandeleur ? Peut-être deviendront-ils un jour célébrations, peut-être l’azur sera-t-il alors libéré du cœur des galets, mais pas ici, pas maintenant, pas tant que la nuit n’a pas encore été décapitée. Révolte qui peut parfois donner le change, sembler se commettre avec un parti-pris de beauté, avec ses leurres, ses camouflages, ses travestis, ainsi que dans ce cinquième chant L’azur court après sa côte de bœuf qui aborde les reflets et les éclats viciés du sud de la France.
Azur dont le poète nous dit comme par prudence j’en ai toujours un au fond de ma poche, combiné ici avec un simulacre d’harmonie, avec la mer et la disparité des hommes et des apparences, tous ensemble bien guindés, bien gainés, bien faussés. Mais la colère n’est pas seule à s’illustrer dans le cycle impétueux de l’auteur. L’altérité, ce sourd ferment communautaire, cette autre forme de l’amour du prochain, prospectif, décanté, inquiète son sommeil, captive ses sens, sa vision, son éthique, stipule son crédo comme au cœur d’une nuit d’insomnie : La poésie ne dit pas seulement : / JE EST UN AUTRE ! / Elle dit aussi surtout : / JE SONT TOUS LES AUTRES ! L’altérité, la passion humaine infiltre ses textes, nourrit sa recherche, sa substance poétique, creuse son sillon dans son corps et ses rêves jusqu’à l’obsession Survivre / il faut survivre… / une phrase de poings jetés dans le sommeil / mille visages en un seul / qui bondissent à ma gorge / affamés / délirants.
Caux, Le Havre, Etretat, Rouen, partout son cœur s’attarde, fait le constat furieux de l’échec et de la cruauté éternels, administre le baume, l’impuissante consolation de ceux qui portent témoignage, partout où Il pleut la mort où des baïonnettes taillent la côte de bœuf du paysage. Les mots ne sont pas que le bleu du ciel. En tous lieux, sa parole sert les bans lésés, criblés, de la mémoire. L’histoire et l’espoir pourront-ils se régénérer, revivre autrement ? Quoi qu’il en soit le poète s’y emploie d’une constance et d’un élan sans cesse rehaussés. Les mots ne sont pas que des organes d’étoiles.
Et comme pour étayer sa voie, son engagement sans partage, se déploie le thème Normand. Il surgit, dénudant un peu de sa splendeur à chacun de ses surgissements, le grand pays normand inséparable de ses desseins, dispensateur d’intégrité, avec sa loi d’honneur, son soleil privé, élu pour sa permanence factuelle, son immédiateté, et parce qu’il dispense la sentence, le décret historique que l’homme retrouve sens et foi dans son origine. Non pour s’y enfermer, Christophe Dauphin est bien l’être de tout repli, de tout retrait stigmatisés, mais pour y retrouver et faire jouer les fibres d’une cohérence intrinsèque. En vertu de cet enracinement indéfectible, des forces, des volontés inextinguibles qui s’y relaient, et en dépit de ce trop de réalité qui nous étrangle, il va actualiser son aptitude à la pluralité du monde Je voudrais vivre jusqu’à la fin à chaque endroit / où je m’arrête / à chaque fois que je m’installe / c’est pour toujours, et accomplir ce qu’il a une fois pour toutes résolu, sa propre voie fraternelle, substantielle parmi le chemin d’hommes. Un admirable instant un festin éternel / dans un silex qui n’est pas une hache guerrière / mais la pierre à feu des Hommes sans Epaules / dont l’abîme ne boit pas d’eau plate.
On le verra partout où se plaident les outrances de l’histoire, dans les nuits laides, nécrosées du passé, des crimes contre l’amour, contre l’aurore, au sein des combattants, des résistants, des Gilets jaunes, on le verra dans les déroutes et les dérives qui se profilent au bord de l’avenir, juste au bord ! Des fureurs venues de tous les âges, de toutes les sphères étoilent sa vocation de poète. Ses mains, son cœur, les forces, les gages de ses écrits sont pris inexorablement au défilé des saccages. Comprenons-nous assez cela !
Jusqu’aux épilogues (non définitifs), jusqu’au retour (non exhaustif) vers ses îles réelles et imaginaires parce que soudain un appel de vie, la requête puissante d’un rêve a frayé la route au désir : La robe frôlée de l’île secouant ses draps - Mes yeux repliés sur toi - Traversant tes yeux je te rencontre - pour aller vers plus de lumière contre toi -tout entier j’en brûle - Grande Fleur des îles cicatrisant les plaies - tu t’ouvres chaude comme une fenêtre - pour traverser la nuit.
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Epaules n°52, octobre 2021).
*
En seize longs poèmes numérotés en chiffres romains et illustrés par les collages d’Alain Breton, Christophe Dauphin nous immerge dans sa poésie iodée et énergique, du pic des falaises au roulis des galets. « Dans l’émotion seule du vécu », il affirme d’emblée le rôle fondateur de son pays normand dans son itinéraire : « il y a un soleil noir qui nage dans une falaise ». « Nombre parmi les nombres », il appartient à ce « pays bercé par les vertèbres des falaises / que la mer escorte ».
Le Havre et Rouen, villes « unies comme deux lèvres qui embrassent leurs morts », portent les cicatrices indélébiles des martyrs et l’empreinte de notre histoire. Il définit sa « normandité » comme un « lyrisme lucide » qui lui a permis d’entrer « par effraction dans l’alphabet » et de s’affranchir des frontières.
Héritier du surréalisme, il se situe aussi dans la filiation des poètes marqués par le sceau du « soleil noir », tels Marc Patin, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel, Henri Rode, Patrice Cauda, Jean Sénac, ses frères en poésie, froudroyés par une tragique destinée. Résolument engagé dans une poésie humaine au souffle lyrique assumé et à l’émotion revendiquée, il laisse éclater des mots « de colère et de feu », car « ce n’est pas en pantoufles / qu’on peut décrocher les étoiles ».
Ce « totem », structuré et composé d’allers-retours entre passé et présent, témoigne des déséquilibres et de la violence de notre temps à la dérive, aux « horizons noyés de matraques », observés et vécus par un poète aux mots généreux, « piéton fiévreux » qui sait remonter aux gouffres et aux abîmes mais aussi nommer en fraternité nos rêves et nos espoirs.
Marie-Josée Christien (chronique "Nuits d'encre", revue "Spered Gouez / l'esprit sauvage" n°27, 2021).
*
Une seule ligne dans l'engagement de Christophe Dauphin, directeur de la revue Les Hommes sans Epaules et secrétaire de l'Académie Mallarmé: la révolte ! La révolte, qui passe par des coups de poings colorés, la révolte, qui passe par une esthétique dynamique fille du surréalisme lui-même issu d'un Rimbaud qui a fait sauter les bouchons de la langue.
Un jour j'ai fracturé le réel avec un pied de biche - j'ai plié mon arbre et je suis parti avec la pluie - qui dort dans les pierres - avec sa cassure gyropharisée - bétonnée avec ton venin - armaturisé avec tes os - La cassure - ton visage en chute libre du 9e étage - La cassure - amour soldé d'un baiser vorace - amitié à la tempe éclatée - des insultes et du mépris plein les veines - La cassure - poing d'une révolte qui n'en finit pas - poing de colère... - La nuit n'a pas encore été décapitée.
Christophe Dauphin boxe la vie et les mots, avec une énergie d'athlète en colère. Images souvent violentes, soeurs de notre violente actualité. Cette poésie est message et tentative de changer le monde, un manifeste permanent. La lutte est la racine-ressort de chaque mot.
La Nature en effet demeure capitale, de même que ce qui se passe entre les humains est capital, et rien n'est oublié dans cet ouragan de métaphores, ponctué par les collages sans concession d'Alain Breton, qui offrent des couleurs savamment déchirées.
La Beauté ici sert une cause, et la multitude de vers beaux et étonnants (le sang est monté au plafond pouir secouer la foudre) se rattache toujours à) une problématique de vie, injustices, tortures, non sans voyages et amour (L'Amazonie a des lèvres de volcan). un ouvrage qui ébouillante.
Claire BOITEL (in revue Poésie première n°85, mai 2023).
*
Est-ce trop tard ? Après tout, des extraits de ce recueil ont déjà été publiés dans la revue (numéro 33), en 2020, accompagnés d’un dossier incontournable pour qui s’intéresse à l’auteur. Voilà bien plus d’un quart de siècle que je fréquente Christophe Dauphin, l’homme, le poète et sa poésie et l’amitié qui nous réunit est ce prodige qui nous renouvelle, produit du neuf, de l’inépuisable depuis le familier, le très proche de notre relation.
Ainsi, lisant, avec retard, son recueil, il me semble découvrir une intimité nouvelle chez notre poète. Sa voix s’en-lyrise, verse des confidences, non celles d’un je – le poète est un homme sans je - mais celles d’un loup qui se laisserait approcher La vigueur de ses vers, soudain sertie d’émaux « comme une plage à habiter », nous ouvre à des poèmes-souvenirs et des poèmes-hommage pour des fusillés de la survie.
Avant de découvrir ce nouvel opus, se rappeler que Christophe Dauphin est le grand héritier de la tradition surréaliste, de ceux qui fracturent « le réel avec un pied de biche », de ses inamovibles gardien des « taudis d’étoiles » de l’avenir, pour que vite on y signe « l’azur du soleil » et non qu’on s’en détourne ; de même, ne pas oublier qu’il est le poète des combats, contre « l’avocat-cigare », les « palmiers-Matisse » et le « Passage Jouffroy ».
La poésie, par lui, rend vivante et humaine sa vocation sacrée (lire dangereuse) car elle est la voix de la justice, ou plutôt elle « frappe de justice » notre monde, et rien ne pourra la taire, ni la détourner. Lisez Christophe Dauphin. Et goûtez, aussi, dans ce recueil les dessins de son ami (et mien) Alain Breton.
Quelques-uns des vers parmi ceux qui m’ont touché : « Poète / je me suis adressé la parole la première fois / lors d’un cauchemar » ; « Réveille-toi dans tes os / la mort fermente comme un chien dans tes os » ; « Survivre / il faut survivre tour à tour exalté et honni » ; « Je mailloche la pluie ce balbutiement des nuages » ; « à chaque fois que je m’installe / c’est pour toujours » ; « Jusque dans ton sommeil qui n’a jamais nié / les yeux des autres » ; « À toi de creuser le tunnel dans la respiration des choses » ; « Je suis de ceux / dont les yeux sont partis pour l’horizon » ; « La poésie c’est la journée perdue au fond de la grammaire de nos poches / la chaise renversée du paysage qui boit le verre dans le vent / c’est le je qui cultive l’autre en moi » ; « Îles qui délaissez vos corsages sur le corail des pluies / je vous ramènerai dans mes filets de naufrage »
Pierrick de CHERMONT (in revue Les Hommes sans Epaules n°56, octobre 2023).
*
LECTURES de l'essai de Odile COHEN-ABBAS "Christophe DAUPHIN, les yeux grands ouverts", 156 pages, 15 €, éditions unicité, 2025.
Christophe Dauphin est un passeur hors pair, qui se consacre à sortir de l’oubli des poètes qui ne bénéficient pas de la reconnaissance qu’ils méritent. C’est à son tour d’être « l’objet d’un parcours de lecture sensible » (Marc Kober dans sa préface) qui met en lumière son œuvre personnelle. Odile Cohen-Abbas reprend ici par ordre chronologique quinze recueils poétiques de Christophe Dauphin, les présente et y sélectionne quelques textes fondamentaux, d’où émerge « une démarche de don et de réceptivité totale à l’autre ». Extrayant un thème dans chaque recueil, elle en tire « un fil sensible, électif, pour indiquer le sens, marquer l’évolution de l’homme et de l’œuvre ». Son étude fait apparaître l’unité de la démarche du poète et essayiste. La bibliographie exhaustive de Christophe Dauphin réunie en fin d’ouvrage est impressionnante par sa cohérence et par le nombre d’études et d’anthologies, de manifestes et d’essais publiés.
Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°31, 2025)
*
Christophe Dauphin tient une place essentielle dans la communauté des poètes, il en est un phare et une mémoire qui révèlent des talents oubliés ou cachés, il rassemble, il soutient, il éveille.
Dans cet essai, c’est son œuvre qui est explorée et, sans aucun doute, le regard et la plume d’Odile Cohen-Abbas sont les plus aptes à nous guider dans une œuvre marquante. La rencontre de ces deux esprits libres est une bénédiction et constitue en soi une féérie et une férie.
« Au-delà des courants auxquels immanquablement la critique pourra se référer, note Marc Kober dans la préface, révolte et quête du merveilleux surréaliste, nouvelle morale pour vivre sur terre, poésie pour vivre en accord avec le rêve conçu comme un état à accroître, émotivisme, les propositions rassemblées ici par Odile nous aident à mieux lire une œuvre poétique et vitale tout à la fois. Elles sont une injonction persuasive à l’aimer. »
Odile Cohen Abbas a choisi de parcourir l’œuvre selon le temps linéaire, elle qui ne cesse d’abolir le temps. Derrière cette apparence évolutive, elle n’hésite pas à emprunter des couloirs temporels pour mettre au jour une autre actualité poétique, une verticalité de l’œuvre qui échappe à toute analyse linéaire.
« Lisez-les tous ! clame-t-elle.
Lisez tous les livres de Christophe Dauphin ! Ils vous administreront des stimuli sensibles, puissants, des toniques pour le cœur et l’esprit, concrets ou imaginaires, des démentis sur les bassesses et les échecs de l’existence, des ardeurs proactives sur l’histoire humaine réalisables à l’infini, des vertus aphrodisiaques, par absorption de substance poétique, des essences, des simples, hybridations secourables entre harmonies et dissonances des chemins, des remèdes au sujet des ombres, des ténèbres concentriques qui s’approchent ou s’éloignent, ils dessineront de plus vifs contours, des auras hantées de fantasmes et de rêves inaliénables, de pièces héraldiques et révolutionnaires, d’alliances rationnelles et irrationnelles, ils conféreront une logistique de paix, d’amour, et de son contraire, à vos jours et à vos nuits d’insomnie. »
Certaines œuvres littéraires nécessitent une initiation. Elles échappent aux méthodologies académiques. C’est le cas de l’œuvre de Christophe Dauphin et Odile Cohen-Abbas se constitue initiatrice pour une œuvre symbolique et enchanteresse. Symboles et enchantements exigent avant tout une lecture lucide du réel et une maîtrise de l’art du langage, déterminant des réalités actualisées ou alternatives.
C’est un voyage, initiatique par conséquent, semé d’embûches et d’épreuves. Si l’émotion est la matière des voiles du vaisseau du poète, la langue en est le vent. Nous retrouvons avec Christophe Dauphin et Odile Cohen-Abbas, la fonction sacrée et secrète de la langue qui oriente, révèle, fige ou libère, hypnotise ou éveille, la langue qui demande d’instant en instant à être conquise.
« A travers l’ensemble des recueils, glisse Odile, c’est un chemin de vie qui se trace où chaque tronçon d’histoire est à sa place, où chaque oscillation, hésitation, transige, s’illustre plusieurs fois et trouve sa résolution. La répétition des choses et des situations est un exercice, un entraînement ou les manières du corps et de l’esprit se perfectionnent ; la répétition est un entredeux fertile qui, sortant du brouhaha et des discours informes, apporte la boisson de la continuité, de l’ardeur et de l’espérance. »
Une fois encore, ce n’est que vus du ciel que les chemins serpentins s’affirment comme les plus directs.
Rémi BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, août 2025).
|
|
|