| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
|

|
|
Critiques
"Un recueil surprenant, dense et varié. Marie-Christine Brière a l'art d'écrire des poèmes cadrés. En une page, on découvre un portrait, souvent de quelqu'un, nommé parfois en titre, ou bien un paysage d'un lieu de même titré. Et l'on embarque pour ces photos comme dans un album, chaque texte guidant une visite aux confins des êtres ou du monde... le mot bonheur qui répandu placerait son bandeau - lisse sur les yeux d'enfants perdus. Amour, amitié, voyage. Empathie avec les gens et la nature. La seconde observation que l'on retient se trouve être dans la forme; les mots passent les vers, enjambant facilement, et enchaînant les phrases, ce qui provoque fluidité et vitesse: l'eau passe à peine sur le dos des pierres. Son écriture si particulière ne se prive pas de raconter, tout en chevauchant l'image si l'occasion se présente. Rien n'est prémédité, la poésie se matérialise au fur et à mesure que l'encre sèche sur le cahier. Un nuage a égaré sa guimbarde. On pense surréalisme bien sûr, dans une version baroque, et pourquoi n'en serais-ce pas ? mais je crois qu'il y a surtout le regard de Marie-Christine Brière à focalisations variées, et qui bouge instantanément, macro, plan large ou panoramique... le lecteur change de plan à chaque vers: Un train dans son roulement d'oreille - révèle une route lointaine, oubliée."
Jacques Morin (in Décharge ,n°160, décembre 2013).
"Le titre du recueil de Marie-Christine Brière sonne comme une invitation à embarquer aux côtés du poète, à nous laisser emporter au gré des lignes noircies de mots. Ainsi le parcours proposé au lecteur est-il jalonné par les titres de parties qui annoncent les étapes du voyage : « Amarrages », « A bord penchés tremblants », « Attaches », « Embarqués », « Humour rameur », « Et sur l’arche, un pépiement de création ». Comment ne pas deviner ici qu’il s’agit d’une liste des étapes progressives qui mènent à l’accomplissement du parcours poétique, ainsi qu’une manière d’énumération du périple auquel est invité le lecteur enserré à l’énoncé dans les pluriels employés par l’auteur ?
Alors qu’est-ce à dire ? Avant même la lecture des textes nous voyons se déployer le champ lexical de la navigation, métaphore de la traversée du réel portée par l’énonciation poétique dans sa puissance à décaler les rouages du signe. Un trajet au-delà des apparences données à voir à travers un quotidien dont le poète s’imprègne et dont elle énonce les détours sans apitoiement mais avec toujours un regard à l’Humanité. Le paysage habituel n’est plus insignifiant, il n’est plus tableau d’habitudes égrainées jour à jour. Grâce aux mises en œuvres paradigmatiques, dans le choix du lexique, et à une syntaxe qui permet les glissements sémantiques, il se dévoile à travers des dispositifs ainsi dévolus à la parole poétique.
En plongée dans les attentes
A la table du café
Les paroles contenues
Disent le dehors des femmes
Talons fins, robes noires
Un planeur descend des yeux
Le repas, heure légale
Assène son cliquetis
Par un trou de porte ouverte
Barreau de fer midi coupe
L’ombre en loques des auvents
Vêtus de bleu unanime
Les passants cherchent le soir
Dans sa forme, une poésie au vers et à la rime libres de toute contrainte, et des titres qui précèdent chaque texte. Pas de ponctuation ou rarement employée, et une syntaxe qui rythme la structure du vers. Une disposition à la page qui fait sens tant la gestion de l’espace typographique est signifiante : strophes en retrait, groupes de vers détachés, la forme soutient le paradigme dévolu à un lexique servi par des mots appartenant au registre courant, afin d’étayer la totalité des envolées du signe.
Alors il n’est pas étonnant lorsque nous suivons ce parcours poétique de constater que cette prégnance du réel au discours en propose une lecture herméneutique. Les étapes du quotidien énoncées par Marie-Christine Brière ne sont qu’occasions d’ouvrir à une dimension qui en transcende les apparences. Et la parole poétique emporte alors au-delà des contours. Ainsi ce titre oxymore, telle la poésie du recueil qui dit les apparences et leurs revers, Flocons noirs :
De là-bas et si haut tout est oie
Mais tout n’est pas cygne
Les nuages tombèrent en suie
Un jour où nous avions gobé l’œuf
Entrées dans une maison à terre
Les mésanges de l’enfance
Ne pouvaient en sortir
Sans curiosité de nous
De là-bas en bas des gloires
Portaient bonheur pas de nuage
Sans frange d’argent dit le proverbe
Mais les humains occupés donnent
Miettes à celui-là le crucifié
Etonnés de trouver l’homme-dieu
Dément, torturé même à l’offert
Sur la table d’une brocante
A partir d’une lecture sensible du réel, Marie-Christine Brière mène le lecteur au seuil d’un univers poétique qui en dévoile les arcanes grâce à la puissance des images évoquées. Et cette ambition herméneutique des textes de Cœur passager ne se limite pas seulement à une percée métaphorique de la vie ordinaire. Elle se propose aussi d’énoncer une réflexion sur le langage, qui sous-tend certains textes du recueil. Cette écriture spéculaire invite donc le lecteur à s’interroger sur le signe, à l’envisager comme trace inaboutie mais capable dans sa dimension poétique de mener à une vision transcendante du quotidien :
L’Oiseau c’est trop
………
L’accent sur le mot ciel par mégarde
N’a même pas glissé au parapet où l’oiseau
-toujours sans nom-sifflote entre
deux silences. Comment faire sans livre
pour nommer, dessiner sur la paroi leurs
mécaniques de plumes vertes ? bleues ?
bleuvertes ? Le noir n’est que du gris
la mouette et son œil bouton
deviendra plus tard une bottine
Comment approcher du jeune né qui se
Cogne sur la pierre, l’ouvrier l’imitera
Sur son théâtre de planches
….
Comment rendre compte de cette perception accrue et sans concession des évidences, telle est la question que pose ici l’auteur. Comment énoncer une réalité si souvent violente, ancrer la poésie au réel mais ne pas l’y perdre.
Lire Cœur passager c’est se laisser embarquer dans l’univers de Marie-Christine Brière. La prégnance du quotidien ne fait en rien de cette poésie une poésie du réel. Bien au contraire, qu’il s’agisse de l’appareil paratextuel ou du choix d’une mise en œuvre syntaxique et paradigmatique qui permet les envolées sémantiques du signe, tout est prétexte à porter une réflexion sur la nature du langage poétique ainsi que sur l’ordinaire de l’existence dont l’auteur propose une lecture sensible. Les épigraphes sont à cet égard éloquentes : pour épigraphe d’œuvre, choisir une citation d’Anne Teyssiéras qui précède immédiatement une phrase de Philippe Jaccottet tirée de L’Ignorant, placée au début du premier chapitre, n’est pas neutre : ici s’énonce la volonté de se placer dans le sillage de ces auteurs et dit l’ambition de faire de la parole poétique un outil qui ouvre à une perception herméneutique du monde, et qui mène à son exégèse. Et Bernard Noël convoqué au chapitre trois sous le titre « Embarqués » soutient ces présences liminaires. La poésie est carte et boussole, outil et objet, nécessaires assemblages des signes qui peuvent rendre compte de ce regard prégnant, spéculaire, révélateur. Mais n’est-ce pas là, dans les déflagrations du signe, que se trouve l’accomplissement, que s’énonce la liberté ?
La Pédagogie
Mâchez la poésie
Mâchez le poème
Elèves inouïs
Sortis des bois à peine
Sauvages nez à nez
Avec ceux qui les ont écrits
vous êtes de ce monde
Ou alors naviguez
C’est le bon moment
Prenez le large
Dans le débris du bruit aigu
Des carreaux cassés
Dans les fuites des décharges
Dans vos minuscules incendies
Vos nuées oranges
Et jeux de cailloux
Carole Mesrobian (in recoursaupoème.fr, sommaire n°112, septembre 2014).
|
|
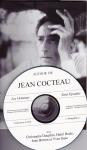
|
|
Dans la revue Les Cahiers du Sens
"Chaque abonné aux HSE, avec ce seizième numéro, a reçu un CD passionnant intitulé « autour de Jean Cocteau ». Le témoignage de Jean Breton, direct et chaleureux, sur Cocteau, un « aîné capital », est sans nul doute utile. Il remet en place la vérité historique sur ce « Feu » qui ne voulait pas être comparé au Jeu. Dans le même esprit, l’ensemble de ce CD (avec Christophe Dauphin, Henri Rode, Jean Breton et Yves Gasc) constitue une sorte d’événement poétique à ne pas manquer…. En ce début de vingt-et-unième siècle, Les Hommes sans Épaules me semble être une grande revue de poésie, ouverte et libre qui mérite un coup de chapeau par son esprit de découverte poétique, le sérieux de sa démarche, l’indépendance des auteurs qui rendent compte des nouveautés poétiques de l’année. Elle me semble de haute tenue et d’utilité publique."
Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens n°14, mai 2004).
|
|
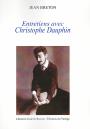
|
|
Critique
(..) Il s'agit de deux entretiens accordés par Jean Breton, décédé en septembre 2006, à Christophe Dauphin en 2003 et début 2006. Christophe Dauphin, toujours très bien documenté interroge Jean Breton en suivant deux chronologies imbriquées: la biographique et la bibliographique. Et sur l'une comme sur l'autre, ses questions pertinentes permettent aisément de mieux cerner à la fois l'homme et le poète... Je dois dire que j'ai été assez séduit par le poète à partir de son recueil Serment-tison en 1990. son manifeste Poésie pour vivre, écrit avec Serge Brindeau en 64, avait nettement matérialisé la séparation entre poètes de la sensibilité, l'émotivisme en effet, et la tendance tel quel qui commençait à sévir sérieusement à l'époque. Cette disjonction bruyante est toujours de mise aujourd'hui et la ligne de démarcation durable. Sa définition de l'image est intéressante, à l'opposé de celle de Reverdy et des surréalistes, elle "naît d'un choc de deux réalités les plus proches possibles." Jean Breton conclut son prmeier entretien par cette constatation à laquelle j'adhère entièrement: On ne peut faire joujou avec la poésie. On est obligé de passer sa vie avec celle-ci dans notre tête, en sachant qu'on ne gagnera jamais un sou et que le public non initié, jusqu'au bout, nous boudera... Le second est offert sur disque. on y perçoit à peu près la même chose. Les question y sont lues d'une voix atone, les réponses donnent à entendre la parole chaleureuse de Jean Breton.
Jacques MORIN
(Revue Décharge n°152, novembre 2011).
|
Dans Inédit Nouveau
Disparu en 2006, Jean Breton, né en 1930, voit publier ses Entretiens avec Christophe Dauphin, après avoir fondé la revue Les Hommes sans Epaules en 1953 et la remarquable collection (je ne veux pas l'appeler seulement revue) Poésie 1, gageure qui au départ ne coûtait qu'un seul franc (de l'époque), grâce à l'idée géniale d'y introduire des pages de publicité, mais hélas ratrappée par le marché ! Elle n"a donc pu durer que de 1969 à 1987. Il fut l'auteur aussi, avec Serge Brindeau, d'un remarquable "Manifeste de l'homme ordinaire" et d'une oeuvre poétique importante, de 1952 à 2004. Un CD joint au livre reprend un entretien réalisé quelques mois à peine avant sa mort. Il fallait rappeler cet animateur que d'ailleurs le petit monde littéraire surtout parisien a tant "utilisé". Merci à Dauphin de célébrer ainsi son ami de la Librairie-Galerie Racine.
Paul VAN MELLE
(Revue Inédit Nouveau n°250, mai/juin 2012, La Hulpe, Belgique).
Seul sait écrire qui se permet de vivre. La poésie, ce qui nous est donné par surcroît, est le luxe ordinaire des riches en vie. Jean Breton (1930-2006) écrit son premier poème à 19 ans. Parmi ses lectures initiales, il faut mentionner Blaise Cendrars, Henry Miller... Il va rapidement s'engager dans la revue Les Hommes sans Epaules. S'il se dit influencé par le Sud, par sa rencontre avec le surréalisme et avec le peintre Antonio Guansé, Jean Breton sera sa vie entière tourné contre l'odre bourgeois et proche de l'érotisme. Parmi ses titres principaux: Chair et Soleil (1960), L'Eté des corps (1966), En mon absence (1992), Nus jusqu'au coeur (1999). Il résume lui-même sa philosophie de vie : "Je n'étais pas d'accord avec le protocole. J'ai écrit pour dire que j'étais là, pour regarder le monde dans les yeux, pour me venger et pour jouir, sans écarter les autres du soleil, parce que l'amour rôdait à pas de loup entre les pages." Quelques photographies, un CD et des extraits de poèmes vont clore cet entretien avec Christophe Dauphin, qui a su mettre en valeur, après tant d'autres (Ilarie Voronca, Marc Patin...) la personnalité de Jean Breton.
Gérard PARIS
(Revue Bleu d'encre n°27, 2012).
|
Dans Texture
"La Librairie-Galerie Racine publie les entretiens de Jean Breton avec Christophe Dauphin, qu’ils ont réalisés à Paris les 12 mars 2003 et 29 janvier 2006 (année du décès de Jean Breton). Ce livret d’une quarantaine de pages comprend également, outre le texte des entretiens, quelques photos et extraits de textes ; il est accompagné d’un CD de l’interview, qui permet d’entendre la voix de Jean Breton. Celui-ci parle de ses rapports difficiles avec son père, comment et pourquoi il a créé la revue « Les Hommes sans épaules » en 1953 (revue relancée et aujourd’hui animée par Christophe Dauphin, entre autres), explique ses rencontres et amitiés avec René Char, Follain, Becker, Bérimont, Rousselot, Chambelland, Pierre Chabert, puis sa défense et illustration d’une poésie de l’émotion et de l’image, de la sensualité et, le cas échéant, de l’engagement, en tout cas du refus des ukases religieux comme de l‘intellectualisme pédant qui prétendait imposer son carcan aux poètes de l’époque - bref d’une « poésie pour vivre », comme la définit le manifeste écrit avec Serge Brindeau. Jean Breton évoque aussi ses principaux recueils, « Chair et soleil » et « L’été des corps » dont les titres disent assez l’inspiration solaire, érotique et amoureuse. Un document éclairant."
Michel BAGLIN
(revue en ligne Texture, août 2012).
|
|

|
|
Lectures critiques:
Alain Breton est l’un des poètes les plus marquants de la fin du siècle précédent et de ce début de siècle, à l’articulation difficile de deux millénaires. En ces périodes, nous n’entendons jamais assez les poètes.
Dans la préface à ce recueil qui couvre près de quarante années de poésie, Paul Farellier remarque la profonde et audacieuse originalité d’Alain Breton qui, nous dit-il, « s’est jeté dans la marge inhabitée de la poésie française, loin des « lieux poétiques » à haute densité de fréquentation ». Parfois, les marges se constituent en centres où le témoignage de l’être devient puissance qui interroge les évidences. Le poète assume alors la fonction philosophique et va jusqu’à faire penser les morts, très majoritaires en nos temps lourds.
Dans une longue postface, Christophe Dauphin qui a établi cette édition importante, peint la complexité et la richesse du poète qui fuit les éloges. C’est en retraçant un parcours fait de travaux qu’il rend compte du personnage et de l’œuvre, étonnante par sa constance et sa durabilité, tant dans le travail éditorial que dans la création poétique. Alain Breton a déjà marqué son époque. Plus encore, il a inspiré, formé, libéré d’autres plumes qui préparent le futur.
Les poèmes d’Alain Breton sont étrangement vivants. Ils prennent chair à partir du fil des émotions qui dessinent d’improbables thèmes. L’éphémère, l’incertain, l’intranquille demeurent tandis que le lecteur cherche les fondements de cette beauté dérangeante mais qui attire irrésistiblement. Il y a quelque chose de l’ordre du scandale chez Alain Breton, un scandale élégant qui approche sans faire le moindre bruit pour mieux nous bouleverser.
Cette écriture, très resserrée sans être minimaliste comme le note Christophe Dauphin, est presqu’effrayante de justesse. C’est que l’humain à peur des songes comme du réel, il préfère les chimères et évite ainsi les miroirs poétiques, trop révélateurs. La précision des mots, du rythme, des sons, impose ici de voir l’invisible comme le dissimulé. Une réelle beauté. Le titre de ce recueil, Infimes Prodiges, désigne très exactement de quoi il s’agit.
Rémy BOYER (in incoherism.wordpress.com, mai 2018).
*
Fils du poète Jean Breton, qui fut aussi le fondateur des éditions St Germain-des-Prés puis de la revue et des éditions Les hommes sans épaules, Alain Breton est lui aussi poète-éditeur et il dirige la librairie-galerie Racine depuis 1996, après la disparition de son fondateur, Guy Chambelland, ami des frères Breton. Si on peut considérer Alain Breton comme héritier de la mouvance « émotiviste », définie et revendiquée dans le manifeste de Jean Breton & Serge Brindeau, Poésie pour vivre, fédérant, sans constituer une école, Patrice Cauda, Henri Rode, Yves Martin, Georges-Louis Godeau, et de nombreux autres, le fils ne s’est pas contenté d’être un disciple accompli. En effet, cette succession en poésie n’a pas replié Alain Breton sur sa propre création ni déterminé son exclusion sociale mais l’a ouvert généreusement à d’autres écritures contemporaines et l’a lancé à la découverte de nouveaux auteurs. Il définit lui-même la mission du poète avec une exigence de liberté et d’accueil : « Seul à jouer au meccano du monde, à l’amour, le poète exaspère ses limites. Nous rêvons que son ambitieuse quête, que sa fouille minutieuse de la langue ne soient pas perverties par une futile autant que dérisoire volonté de prise de pouvoir sociale ! Que le poète, débarrassé de l’engourdissante course aux concours-articles-subventions-relations (la fameuse tétralogie) se montre enfin accueillant aux textes de ses confrères ! […] Or la poésie devrait être avant tout accueil, méditation-lucidité, communication aimantée. » L’ouvrage comporte une douzaine de recueils publiés de 1979 à 2014, de Tout est en ordre, sûrement… à Les éperons d’Eden.
Dès les premiers textes, la veine érotique s’affirme avec une sensualité ardente. Le corps féminin, à peine entrevu à la lueur clignotante d’un néon, est évoqué en blasons successifs dérivant en variations métaphoriques luxuriantes comme en un dérèglement rimbaldien des sens : « Ô toi. Dépliements de toi, à peine humides, comme d’hypnoses qu’on écoute. / Rare Coccyx. Roseau. Rosier des reins. […] Mousse et glaise aux seins minuscules // Lèche […] Alchimie grave de ton ventre // Ta bouche / Ta paix // commencée tantôt des étoiles. » En un magnifique hommage à Maria, sa mère basque, le poète revit sa propre naissance dans l’ivresse d’une fusion charnelle : « Tu es fœtus, bouquet de gélatine, pélamide de suif […] / Tu souriais, bandé, dans ton buisson liquide / et voici que ton cri vide la peau ancienne. // Pour toi, sourcier du lieu, / nul accord ni défaite possibles. // Mais ton obéissance au seuil ? » Et dans le Final, détaché du corps de la mère, il en appelle, sur un rythme syncopé, au refus de grandir, à l’angoisse de vivre : « Ô ravin-mère, initiale ligne de feu, / je cherche ma voix dans tes déluges, / je reste seul dans mon visage, / pieds nus - sur le vacarme originel. […] J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement, / que l’incompréhensible tatoué entre tes cuisses, / une non-existence jusqu’au tombeau parfait, // livide à finir l’à-pic. » Et il reprend, évoquant le ventre maternel « tambouriné », comme en écho au célèbre poème de Blaise Cendrars, Le ventre de ma mère : « Ma mère, tu le sais, / je suis la grenouille de sang entre tes cuisses, / je pends encore dans le labyrinthe de l’air… » L’angoisse existentielle est récurrente dans Planètes : « En moi le deuil de chaque jour. Et tant de terre à attendre. » Et à propos du suicide du jeune Michel Conte, l’empathie saigne, prosodie haletante, cœur à vif : « L’âme dans l’évier. Sales, les veines. Maladroit, tu as taché même tes os. […] Il a fallu identifier le vieillard de vingt ans. »
Dans Juste la terre (1991), Alain Breton, alternant vers et proses, fait coïncider l’amour des paysages de la nature et celui des paysages charnels : « Il respire, sueur libre d’aimer. C’est comme mettre une grande échelle jusqu’au visage. » Et de laisser le lecteur en suspens sur une note baudelairienne : « Juste / la terre // née de fleurs inconnues ». Bivouacs (1992) s’ouvre sur un éloge énigmatique de Robert Doisneau : « On le sait. La photo vient au monde pour acculer les visages. » S’adressant à Jean, son père, le poète revendique une filiation atavique active : « De père en fils, le ciel a voyagé. Mais on travaille avec la même application, la même rude fatigue, les mêmes champs garnis. » Il célèbre aussi la demeure familiale, l’humanise avec une touche d’humour : « Pour que la maison vous adopte / il faudra un peu de fatigue, / des jeux et des odeurs. » Dans Une chambre avec légende (1999), la veine érotique, tantôt ludique, tantôt lyrique, joue des codes de l’amour courtois pour les transgresser, les retourner en images fortement suggestives : « dans un coin se débarbouille le soir / qui déroute sur des cahiers d’école / les seins trotte-menu et tous les doigts de miel ». La météorologie à fleur de peau s’affole, féconde les métaphores : « Aujourd’hui beau temps sur ton dos / seins à bouillir de fine intempérie / je joue ton sexe à la roulette […] A force d’oindre les creux de ma lionne / j’aurai oublié l’or dans sa crypte / et négligé le mot de passe… » Les remparts de robes à vertugadin s’effondrent en descentes de lit. Jubilatoire !
Sous le nom de sa grand-mère maternelle, Aramburu (Jacques), Alain Breton, changeant totalement de registre et de voix, a publié plusieurs recueils : Maison-Buffle (1993), Messe noire des vagues (1999) -Aventure maritime et pillages des pirates du Revenge-, Le chasseur de rivières (2004), Brûlant sombre (2008). Côté piraterie et messe noire, le rythme s’accélère, à boulets rouges : « La lune suffoque au ras des cabestans / ou des murailles / s’ouvrent dévoilant des canons. / De sabords à sabords, / bien moins qu’une encablure ; / les marins s’entassent derrière les lisses, / un sabre à la mâchoire. / Des tillacs, on crie ‘’feu !’’ / Et l’ennemi répond d’une mitraille. / Les orgues du diable saluent les pièces de chasse / - catins à foison des aubes. » D’une veine nonsensique, à tonalité dadaïste, dans Pour rassurer le fakir (2000), l’auteur explore l’inconscient sur le mode ludique, décline des aphorismes funambulesques. Le poète, magicien onirique, se métamorphose au gré de sa fantaisie, il met à distance ses angoisses : « Cette nuit, mon miroir m’a réveillé en sursaut : ses songes avaient disparu. » Il ressort apaisé de ses cauchemars : « Ils m’ont ausculté sous mon scaphandre. Mes os chantaient. J’avais le côté gauche paralysé, le crâne aplati et toute l’eau contenue dans mon corps était déformée, j’étais libre. »
« Tombeau » pour Jean Breton, Les Eperons d’Eden (2014) s’ouvre sur une lettre au père : « Père, tu le fus assez peu. Le temps te manquait, et la vocation […] tu avais choisi d’être plutôt mon ami […] Tu as rendu ton alphabet, trois jours après avoir vomi noir – le jus de la mort. » Au plus près de l’intimité rêvée, plutôt que retrouvée, le dialogue enfin semble possible : « Je bois dans ton bol / et m’enchaîne à tes livres ». L’émotion est forte, sans effusion, d’une sensibilité juste : « A toute vitesse, / j’ai accumulé ton visage // Pour annoter tes poèmes / de salves de toi. // Désormais je t’emporte / de meuble en planète, // Je me fais spacieux / pour ta survie [...] Pourvu que / tu écrives encore / sous la dictée / des météores [...] Je bêche le silence / je demande hospitalité à tes livres. »
Christophe Dauphin, dans une longue et belle postface, retrace l’aventure éditoriale des frères Breton, et de père en fils, salue l’ardeur de leur engagement, évoque la réussite vertigineuse et la débâcle des éditions Saint-Germain-des-Prés, la force des liens familiaux et de leurs amitiés en poésie. Il souligne surtout la singularité d’Alain Breton, l’univers propre de ce créateur pour qui, « de fait, l’être du poème est nombreux, peuplé à foison d’autres masques ou d’autres lui-même, ouvrant toujours des possibles et délivrant ce mode d’emploi à tiroirs d’une toujours plus lointaine et profonde féerie. » Il cite plusieurs critiques, dont Robert Sabatier qui a remarqué très tôt les qualités d’attention du jeune poète aux êtres et aux choses : « Elliptique, il a le sens des silences et traduit de manière limpide les spectacles de la vie. » Et Paul Sanda, de conclure l’ouvrage par un hommage, rédigé en 2016, « à la justesse d’Alain Breton » : « Enfin le reconnaître, le connaître ici à sa juste valeur : un authentique grand poète de notre temps, avec un souffle ardent, bousculant et brûlant violemment le poncif. »
Michel MÉNACHÉ (in revue Europe, 2018).
*
Établie par Christophe Dauphin qui signe également une longue et riche présentation d’Alain Breton, cette édition préfacée par Paul Farellier et accompagnée d’un hommage de Paul Sanda, est une somme de près de 500 pages réunissant l’Œuvre poétique complète d’un auteur qui est aussi critique, peintre, éditeur, fils du poète (et éditeur lui-même), Jean Breton.
De « Tout est en ordre » (1979) aux « Eperons d’Eden » (2014) en passant par « Juste la terre » (1991), « Bivouacs » (1992), « Une chambre avec légende » (1999) ou « Pour rassurer le fakir » (2000), - sans oublier des inédits, et les quatre recueils publiés sous le nom de Jacques Aramburu - les poèmes réunis ici sont ceux d’un auteur qui s’est toujours méfié de l’hermétisme, optant bien plutôt pour ce que Jean Breton et Serge Brindeau, dans leur fameux manifeste de l’homme ordinaire, ont appelé une « poésie pour vivre ».
Poésie de la vie, oui, en prise avec la quotidien le mieux partagé, pour nous parler des hommes et des bêtes, du sport (boxe, lutte, foot, judo…), du jazz, de l’amour, de la campagne, évoquer aussi les êtres dont il est ou fut proche, telle la grand-mère, ou sa mère, tel son oncle Michel, qui fonda la revue Poésie 1 où Alain fit ses premières armes d’éditeur et qui se suicida, tel son père bien sûr (« Eperons d’Eden », lire ici). Une poésie qui respire, mise sur l’émotion (vécue et transmise), la sensualité, mais sait aussi les pouvoirs du verbe et les vertiges de l’inquiétude métaphysique. Une mélancolie discrète s’y faufile, cependant l’énergie y domine l’âme grise. « Ainsi voyage le luxe des jours / dans l’appétit de vivre ».
Michel BAGLIN (cf. "Mes lectures de 2018" in revue-texture.fr, 12 juin 2018).
*
"Une vraie malle au trésor. je ne cesse d'y fouiller, puiser. Belle et sobre préface de Paul Farellier. Présentation de Christophe Dauphin (pari de nouveau gagné), qui retrace, dans ce livre, l'itinéraire étonnant, forçant l'admiration, de ce poète-éditeur aux talents multiples. Il y est bien sûr question du grand Jean Breton, le père d'Alain (évoqué in Coup de Soleil n°32), de Guy Chambelland, que j'ai rencontré naguère dans sa librairie-galerie à Paris, tout comme Yves Martin (évoqué in Coup de Soleil n°15), cité, lui aussi, de Daniel Biga, etc. "
Michel DUNAND (in revue Coup de Soleil n°103, juin 2018).
*
« Émotiviste par essence », selon Christophe Dauphin, le poème s’ouvre au merveilleux chez Alain Breton. Voici, rassemblée en plus de 400 pages, son œuvre depuis Tout est en ordre sûrement (1974) jusqu’à Les Éperons d’Éden (2014). Des inédits complètent ce volume, ainsi que les poèmes publiés sous le nom de Jacques Aramburu.
Isabelle Lévesque (cf. "Que lire cet hiver?", in La Quinzaine sorti n°1204, 15 novembre 2018).
*
Les anthologies qui proposent un focus sur un poète à découvrir dans une contextualisation biographique et sociologique fonctionnent de la même manière. Les extraits d’œuvres sont placés dans le moment et le lieu de leur production. Cet éclairage n’est pour autant jamais envahissant. Le lecteur est ainsi libre d’apprécier les textes proposés sans que les éléments d’une biographie qui prendrait facilement le pas sur la portée artistique des textes ne viennent perturber la portée sémantique des extraits.
Il est tout à fait admirable de feuilleter le volume consacré à Alain Breton. Un tour d’horizon de son œuvre qui regroupe les plus beaux de ses poèmes nous permet d’apprécier la richesse de son œuvre, mais aussi la trame épaisse de son parcours, car il est aussi critique et éditeur. Il est également possible comme pour chaque auteur abordé de suivre l’évolution de ses productions, leur édification, de percevoir les changements et la logique qui sont à l’œuvre dans la genèse de la globalité.
Et nonobstant le fait qu’Alain Breton est aujourd’hui le directeur littéraire de la Librairie-Galerie Racine, il est aussi un poète extraordinaire qui offre au langage une amplitude servie par des images puissantes et inédites. Le choix de mise en œuvre est chronologique, et on découvre autant de poèmes en prose que de textes versifiés.
Tu gis en Provence
dans les palabres des fleurs
Rincé
par la lumière
Tu monnayes
Le poignard des anges.
Des vers brefs, vifs et qui n’en travaillent pas moins toute l’amplitude du signe. Les antithèses servent des métaphores inédites, et le lexique pourtant usuel déploie toutes ses potentialités. Une langue revivifiée, renouvelée, retrouvée en somme, parce que cette poésie nous offre de nous l’approprier à travers la libération d’une multiplicité d’acceptions. 462 pages dont on ne peut que se réjouir, et qu’il est bon d’avoir près de soi, pour s’immerger dans la magie des vers d’Alain Breton.
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
*
Il triture les mots, il les essore, les malaxe, les compacte jusqu’à la fibre intime. Infinie recherche dans un subconscient qui se rebelle mais qui finit par donner en juste offrande ce que la raison ne voulait avouer en pleine lumière. La poésie s’y terre : elle y devient humus, union de molécules langagières empreintes de rencontres, de ferments.
Alain Breton nous offre ici une anthologie sécrétée au long des années en une somme impressionnante. Plusieurs recueils, des textes révélés, agrémentés par une préface de Paul Farellier, une remarquable mise en mots de Christophe Dauphin, un hommage à la justesse de Paul Sanda. Lire en fin de volume sa bibliographie (y-compris celle parue sous le pseudonyme quelque peu rocambolesque de Jacques Aramburu) est chose intrigante, pour ne pas dire impressionnante, tant on sent que la poésie a été pour cet auteur, non pas une compagne dilettante ou un exercice de style, mais une véritable manière de vivre.
Poète, écrivain, éditeur, galeriste, peintre, amateur de musique, tout à la fois rigoureux et un peu bohème, discret mais pourfendeur de médiocrité, riche en paroles et en pensées dans la pénombre de son antre du quartier latin où palpitent des milliers de livres, manuscrits, toiles, articles et incessants projets artistiques ou littéraires, Alain Breton nous bouscule et nous déconcerte. Il n’est pas aisé de résumer ces 477 pages d’une œuvre poétique qui se décline tout à la fois en vers et en prose. On y ressent les racines des surréalistes jusqu’à ce concept contemporain d’émotivisme : l’émotion serait-elle finalement, au-delà de toute technique du langage, ce qu’il y a de plus natif (dans le sens rousseauiste du terme), de meilleur en nous ? La créativité ne pouvant se passer d’intuitions, de fusions impromptues, de frottement d’idées originales à la synapse des mots, à la faille de la matière verbale qui, elle-même, surprend leur créateur. On y ressent une perpétuelle quête d’un plus loin, d’un plus intime, dans le chaudron d’une expression écrite que les druides n’ont pu autrefois exprimer.
Trois facettes, au gré desquelles s’épanouit une trace finement ciselée et singulière, ont particulièrement retenu notre attention. La première est cet attachement viscéral, pour ne pas dire charnel à sa mère, dans Le long du fleuve Orénoque. L’auteur assiste à sa propre naissance, se tutoyant lui-même ou donnant voix aux lèvres de la parturiente, comme si ces lignes brûlantes étaient issues de l’aimée :
On ne cesse de vider le ventre
On donne l’assaut aux couleurs
Que l’on hisse les yeux !
Sans répit
pour baiser un peu ta tête violente.
Puis, prenant la parole :
Ô ravin-mère, initiale ligne de feu,
je cherche ma voix dans tes déluges,
je reste seul dans mon visage
pieds nus – sur le vacarme originel.
Indicible chronologie de l’être : au forceps, une traduction langagière de la gésine et du cri primal.
Par ailleurs, l’itinéraire d’Alain Breton est sans cesse ourlé d’humour. Non par calembours, mais par sens du cocasse, de la chose inversée, du retournement de la situation. Pour rassurer le fakir : en fait, c’est celui-ci qui nous rassure sur son tapis clouté par les choses insignifiantes de l’existence.
Lorsque je commence un dessin, que le jour faiblit et que je veux en finir, je lui fais subir des pressions, je viens à le menacer pour qu’il se termine tout seul.
*
Parfois l’enfance me rattrape, ses bateaux pirates, les cales à esclaves, l’ourlet des ponts, le mât qui laisse échapper un fanion, tout le bouquet des nuits et la grosse fée qui fait une scène.
*
Au fil du temps, les poches ont appris à lutter contre les invasions clandestines. Poches retroussées, détroussées, soumises à fouilles et interrogatoires, remplies par les courants des rivières souterraines.
Mise en perspective et coloration particulière à mi-chemin entre onirisme, originalité d’esprit et ironie. Comme l’écrit Henri Rode (cité par Christophe Dauphin dans sa Postface) : Alain Breton est épieur d’absurdie dans le quotidien déconcertant, tout de discrétion. Félin qui se garde d’être ébloui dans le jeu de miroirs érotiques.
Ce qui nous donne un marchepied vers la troisième facette (parmi tant d’autres possibles, cette note de lecture n’étant nullement une exégèse) que nous aimerions évoquer ici. Celle où le désir se fait lumière, en toute délicatesse :
Tout
ce que tu touches
fait l’amour.
Même
l’ampoule
où brûle un butin rose.
Ton ventre
arrange l’ombre
de la chambre.
(…)
Qui t’appelle
s’apaise.
Moi,
novice
devant la beauté
La difficulté d’une recension en poésie, c’est de s’arrêter devant les contingences de la page. Qu’il nous soit finalement permis de citer Paul Farellier devant « Lentement, Mademoiselle » d’Alain Breton : averses pyrotechniques où chaque image-fusée, à peine éclatée, est bousculée par la suivante (…) : la femme gouverne les éléments dont elle est la puissance salvatrice.
3Infimes prodiges3 d’une profonde et très humaine poésie.
Claude LUEZIOR (in revue Traversées, Belgique, 26 mars 2019).
*
Qu’y a-t-il de commun entre les œuvres de jeunesse où l’on découvre la poésie et celles de la maturité quand on maîtrise l’outil poétique, le vers ou la prose ? C’est que réunir en un seul volume l’œuvre de toute une vie est chose complexe. Et pourtant, Christophe Dauphin s’y emploie, s’agissant d’Alain Breton que les plus anciens parmi nos lecteurs connaissent pour avoir été l’un des animateurs de Poésie1… Reste alors à passer en revue les plaquettes constitutives de ce volume (de plus de 460 pages, si l’on ne compte pas la table)…
Les proses de Tout est en ordre, sûrement qui datent de 1979 font comme un fouillis, comme un désordre à l’image du monde et ce n’est pas le portrait de Ray Sugar Robinson qui viendra me démentir… Les poèmes (brefs) de la deuxième suite (parfois réduits à un vers) sont sertis d’allusions et disent parfaitement la sensualité de cette musique. La troisième suite est écrite en vers…
La deuxième plaquette qui s’appelle ça y est le monde ! (1990) commence par une suite intitulée Le long du fleuve Orénoque, dédiée à la mère du poète. C’est le récit d’un accouchement distancié, qui ne va pas sans émotion : « J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement » (p 50). La deuxième suite, La Terre encercle les oiseaux, commence par ces vers « Ma mère, tu le sais / je suis toujours la grenouille de sang entre tes cuisses » (p 51) : tout est dit dans ce distique. La troisième suite, Planètes, est sans doute la plus personnelle, car constellée de souvenirs intimes (comités, dédicaces, jazz, poètes…) ; mais je préfère les poèmes d’amour ou de tendresse à ceux écrits la gloire du sport : je sais bien que j’ai sans doute tort mais je suis ainsi !
La troisième plaquette est intitulée Juste la terre. Elle s’ouvre sur un poème intitulé « Montagnard » : pourquoi faut-il qu’il me rappelle les photographies de Henri Didelle ou les poèmes de maints marcheurs. Ça ne manque pas de nostalgie comme ces premiers stylos aux quatre couleurs (p 112). Alain Breton a l’art de la sentence mais cela ne va pas sans mystère : « même si quelques ruelles, de moins savantes, / embrasent encore, le matin // un chien, un coq, un lézard, / le temps qui compte ses boxes, ses visages » (p 114).
La quatrième plaquette est intitulée Bivouacs, elle date de 1992. Et une part d’un certain surréalisme est présente, en 2018, cela fait une cinquantaine d’année qu’un certain André Breton est mort…
Avec Maison-Buffle (1993), Alain Breton est à l’affût de ces infimes prodiges qui donnent son titre à ce volume de mille cauchemars ou de mille rêves. Son réalisme est à l’image de ces nuages qui ne sont que le rapprochement de deux réalités très éloignées …
Le sixième recueil intitulé Messe noire des vagues a été publié en 1999. Ce sont des histoires de pirates en vers ou en prose. La fantaisie y est présente : « De Zanzibar à Chandernagor […] / […] il faut déterrer / la botte de sept lieues / » (p 179). Histoires de pirates : Alain Breton fait preuve d’une forte maîtrise du vocabulaire de ces contes et histoires, des us et coutumes des boucaniers, des grands mythes…
Le septième recueil intitulé Une chambre avec légende (1999) est marqué par l’amour fou et l’émerveillement, accentués par la brièveté des poèmes qui confinent à des notes prises à la volée : « les tables sous les chaises rejoignent le / cimetière des éléphants » (p 205) font parfois penser à celui qu’écrivait un demi-siècle plus tôt (« Je te vertige, je te hanche ») Henri Pichette.
Dans le recueil suivant (Pour rassurer le fakir, 2000), sous-titré Carnets d’atelier, on peut deviner que ce fut écrit après la visite d’un atelier de peintre. Certes, le mot dessin, la lumière qui pare les corps et la recherche fondamentale sur les peintres le disputent à la présence des sportifs (qui est Attila Zopf ?). Mais très vite, il s’agit plutôt de textes d’ateliers, les sportifs ne sont là que pour le rappeler : le texte (poème) sur Evariste Galois (p 237) n’est là que pour le prouver… Mais la présence de portraits fait penser à l’atelier des peintres, et c’est le début de belles histoires au surréalisme marqué dont l’humour n’est pas absent. A moins qu’il ne s’agisse d’un atelier de textes (???) dans lequel Alain Breton expérimente des sujets différents ???
Dans Le Chasseur de Rivières (2004), Alain Breton a une vision très précise : « Je ne sais pas changer la litière / des orties » ( p 279) ou « ils te donneront / la prophétie des fanges » (p 282), ce qui ne va pas sans une certaine obscurité…
Brûlant sombre (2008) est une ode au jardin traversée par les morts (p 296) ou par le souvenir de Rimbaud (p 298). C’est écrit en dis(ti)ques sauf dans la troisième suite où le lecteur est confronté à la prose…
Des poèmes et des proses de 2011 (qui constituent la partie suivante de l’ouvrage), je relève ces lignes : « … La poésie m’a poussé à faire émerger les problèmes liés à mon identité, la prose m’a permis d’en rire ». Je ne sais pas si ces mots s’appliquent à l’ensemble de l’œuvre complète, mais ils révèlent un bel exemple de clairvoyance.
Les éperons d’Eden (qui datent de 2014) commencent par une prose qui est une ode au père, Jean Breton. Et ça continue par de brefs poèmes en vers qui, mis bout à bout, font comme un tombeau à la gloire de Jean Breton. C’est émouvant et un bel exemple d’amour filial : ainsi ce poème consacré au tueur de doryphores du jardin de Nibelle (p 362). Cela ne va pas sans quelque aspect obscur (mais c’est sans doute le propre de la poésie) comme dans ces poèmes qui ouvrent la deuxième suite (Une poignée de nuit) : « La mer délassée / sur les lèvres de Pénélope » (p 347). Même si l’on sait ce qu’est la mort tout en ignorant quel sens donner à ce qui est une absence éternelle…
Un livre qui valait bien la peine que s’est donnée Christophe Dauphin. Des caractéristiques de cet ouvrage, je veux signaler que le surréalisme n’est pas mort et le lyrisme contenu. Un livre nécessaire dû à Paul Farellier (qui en a signé la préface), à ce même Christophe Dauphin et à Paul Sanda.
Lucien WASSELIN (in recoursaupoeme.fr, 29 mars 2019).
*
Ce volume de près de 500 pages nous rappelle, s’il en est besoin, l’intense activité d’Alain Breton au service de la poésie. De nombreux poètes ont croisé sa route et lui doivent leurs premières publications. Son nom est associé à la célèbre revue Poésie 1, ainsi qu’à la Librairie-Galerie Racine et Les Hommes sans Épaules. La poésie qu’il défend est une poésie vivante, charnelle, accessible, aux antipodes d’un certain hermétisme.
Infimes Prodiges, présenté par Christophe Dauphin et préfacé par Paul Farellier, regroupe plusieurs recueils dont Tout est en ordre, sûrement (1979), Juste la terre (1991), Bivouacs (1992), le très émouvant Les Éperons d’Éden (2014) et, peut-être l’un de ses meilleurs livres, Maison-buffle (1993), publié chez Cheyne sous le pseudonyme de Jacques Aramburu : Elle a des climats, - ses sonnailles, - ses alvéoles, - ses fruits serrés dans le satin – et puis son bon vent d’étoiles – qui va et vient, - change de musique – et d’arbre. – Tous les quatre matins – la maison entre dans la couleur - Dans la maison – les bruits ne s’arrêtent jamais. – Ce sont des bruits intimes, - des bruits de confiance, - Chacun d’eux a la clé du monde, - un instant.
Jean-Christophe RIBEYRE (in revue Verso n°177, juin 2019).
|
Lectures critiques:
Alain Breton est l’un des poètes les plus marquants de la fin du siècle précédent et de ce début de siècle, à l’articulation difficile de deux millénaires. En ces périodes, nous n’entendons jamais assez les poètes.
Dans la préface à ce recueil qui couvre près de quarante années de poésie, Paul Farellier remarque la profonde et audacieuse originalité d’Alain Breton qui, nous dit-il, « s’est jeté dans la marge inhabitée de la poésie française, loin des « lieux poétiques » à haute densité de fréquentation ». Parfois, les marges se constituent en centres où le témoignage de l’être devient puissance qui interroge les évidences. Le poète assume alors la fonction philosophique et va jusqu’à faire penser les morts, très majoritaires en nos temps lourds.
Dans une longue postface, Christophe Dauphin qui a établi cette édition importante, peint la complexité et la richesse du poète qui fuit les éloges. C’est en retraçant un parcours fait de travaux qu’il rend compte du personnage et de l’œuvre, étonnante par sa constance et sa durabilité, tant dans le travail éditorial que dans la création poétique. Alain Breton a déjà marqué son époque. Plus encore, il a inspiré, formé, libéré d’autres plumes qui préparent le futur.
Les poèmes d’Alain Breton sont étrangement vivants. Ils prennent chair à partir du fil des émotions qui dessinent d’improbables thèmes. L’éphémère, l’incertain, l’intranquille demeurent tandis que le lecteur cherche les fondements de cette beauté dérangeante mais qui attire irrésistiblement. Il y a quelque chose de l’ordre du scandale chez Alain Breton, un scandale élégant qui approche sans faire le moindre bruit pour mieux nous bouleverser.
Cette écriture, très resserrée sans être minimaliste comme le note Christophe Dauphin, est presqu’effrayante de justesse. C’est que l’humain à peur des songes comme du réel, il préfère les chimères et évite ainsi les miroirs poétiques, trop révélateurs. La précision des mots, du rythme, des sons, impose ici de voir l’invisible comme le dissimulé. Une réelle beauté. Le titre de ce recueil, Infimes Prodiges, désigne très exactement de quoi il s’agit.
Rémy BOYER (in incoherism.wordpress.com, mai 2018).
*
Fils du poète Jean Breton, qui fut aussi le fondateur des éditions St Germain-des-Prés puis de la revue et des éditions Les hommes sans épaules, Alain Breton est lui aussi poète-éditeur et il dirige la librairie-galerie Racine depuis 1996, après la disparition de son fondateur, Guy Chambelland, ami des frères Breton. Si on peut considérer Alain Breton comme héritier de la mouvance « émotiviste », définie et revendiquée dans le manifeste de Jean Breton & Serge Brindeau, Poésie pour vivre, fédérant, sans constituer une école, Patrice Cauda, Henri Rode, Yves Martin, Georges-Louis Godeau, et de nombreux autres, le fils ne s’est pas contenté d’être un disciple accompli. En effet, cette succession en poésie n’a pas replié Alain Breton sur sa propre création ni déterminé son exclusion sociale mais l’a ouvert généreusement à d’autres écritures contemporaines et l’a lancé à la découverte de nouveaux auteurs. Il définit lui-même la mission du poète avec une exigence de liberté et d’accueil : « Seul à jouer au meccano du monde, à l’amour, le poète exaspère ses limites. Nous rêvons que son ambitieuse quête, que sa fouille minutieuse de la langue ne soient pas perverties par une futile autant que dérisoire volonté de prise de pouvoir sociale ! Que le poète, débarrassé de l’engourdissante course aux concours-articles-subventions-relations (la fameuse tétralogie) se montre enfin accueillant aux textes de ses confrères ! […] Or la poésie devrait être avant tout accueil, méditation-lucidité, communication aimantée. » L’ouvrage comporte une douzaine de recueils publiés de 1979 à 2014, de Tout est en ordre, sûrement… à Les éperons d’Eden.
Dès les premiers textes, la veine érotique s’affirme avec une sensualité ardente. Le corps féminin, à peine entrevu à la lueur clignotante d’un néon, est évoqué en blasons successifs dérivant en variations métaphoriques luxuriantes comme en un dérèglement rimbaldien des sens : « Ô toi. Dépliements de toi, à peine humides, comme d’hypnoses qu’on écoute. / Rare Coccyx. Roseau. Rosier des reins. […] Mousse et glaise aux seins minuscules // Lèche […] Alchimie grave de ton ventre // Ta bouche / Ta paix // commencée tantôt des étoiles. » En un magnifique hommage à Maria, sa mère basque, le poète revit sa propre naissance dans l’ivresse d’une fusion charnelle : « Tu es fœtus, bouquet de gélatine, pélamide de suif […] / Tu souriais, bandé, dans ton buisson liquide / et voici que ton cri vide la peau ancienne. // Pour toi, sourcier du lieu, / nul accord ni défaite possibles. // Mais ton obéissance au seuil ? » Et dans le Final, détaché du corps de la mère, il en appelle, sur un rythme syncopé, au refus de grandir, à l’angoisse de vivre : « Ô ravin-mère, initiale ligne de feu, / je cherche ma voix dans tes déluges, / je reste seul dans mon visage, / pieds nus - sur le vacarme originel. […] J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement, / que l’incompréhensible tatoué entre tes cuisses, / une non-existence jusqu’au tombeau parfait, // livide à finir l’à-pic. » Et il reprend, évoquant le ventre maternel « tambouriné », comme en écho au célèbre poème de Blaise Cendrars, Le ventre de ma mère : « Ma mère, tu le sais, / je suis la grenouille de sang entre tes cuisses, / je pends encore dans le labyrinthe de l’air… » L’angoisse existentielle est récurrente dans Planètes : « En moi le deuil de chaque jour. Et tant de terre à attendre. » Et à propos du suicide du jeune Michel Conte, l’empathie saigne, prosodie haletante, cœur à vif : « L’âme dans l’évier. Sales, les veines. Maladroit, tu as taché même tes os. […] Il a fallu identifier le vieillard de vingt ans. »
Dans Juste la terre (1991), Alain Breton, alternant vers et proses, fait coïncider l’amour des paysages de la nature et celui des paysages charnels : « Il respire, sueur libre d’aimer. C’est comme mettre une grande échelle jusqu’au visage. » Et de laisser le lecteur en suspens sur une note baudelairienne : « Juste / la terre // née de fleurs inconnues ». Bivouacs (1992) s’ouvre sur un éloge énigmatique de Robert Doisneau : « On le sait. La photo vient au monde pour acculer les visages. » S’adressant à Jean, son père, le poète revendique une filiation atavique active : « De père en fils, le ciel a voyagé. Mais on travaille avec la même application, la même rude fatigue, les mêmes champs garnis. » Il célèbre aussi la demeure familiale, l’humanise avec une touche d’humour : « Pour que la maison vous adopte / il faudra un peu de fatigue, / des jeux et des odeurs. » Dans Une chambre avec légende (1999), la veine érotique, tantôt ludique, tantôt lyrique, joue des codes de l’amour courtois pour les transgresser, les retourner en images fortement suggestives : « dans un coin se débarbouille le soir / qui déroute sur des cahiers d’école / les seins trotte-menu et tous les doigts de miel ». La météorologie à fleur de peau s’affole, féconde les métaphores : « Aujourd’hui beau temps sur ton dos / seins à bouillir de fine intempérie / je joue ton sexe à la roulette […] A force d’oindre les creux de ma lionne / j’aurai oublié l’or dans sa crypte / et négligé le mot de passe… » Les remparts de robes à vertugadin s’effondrent en descentes de lit. Jubilatoire !
Sous le nom de sa grand-mère maternelle, Aramburu (Jacques), Alain Breton, changeant totalement de registre et de voix, a publié plusieurs recueils : Maison-Buffle (1993), Messe noire des vagues (1999) -Aventure maritime et pillages des pirates du Revenge-, Le chasseur de rivières (2004), Brûlant sombre (2008). Côté piraterie et messe noire, le rythme s’accélère, à boulets rouges : « La lune suffoque au ras des cabestans / ou des murailles / s’ouvrent dévoilant des canons. / De sabords à sabords, / bien moins qu’une encablure ; / les marins s’entassent derrière les lisses, / un sabre à la mâchoire. / Des tillacs, on crie ‘’feu !’’ / Et l’ennemi répond d’une mitraille. / Les orgues du diable saluent les pièces de chasse / - catins à foison des aubes. » D’une veine nonsensique, à tonalité dadaïste, dans Pour rassurer le fakir (2000), l’auteur explore l’inconscient sur le mode ludique, décline des aphorismes funambulesques. Le poète, magicien onirique, se métamorphose au gré de sa fantaisie, il met à distance ses angoisses : « Cette nuit, mon miroir m’a réveillé en sursaut : ses songes avaient disparu. » Il ressort apaisé de ses cauchemars : « Ils m’ont ausculté sous mon scaphandre. Mes os chantaient. J’avais le côté gauche paralysé, le crâne aplati et toute l’eau contenue dans mon corps était déformée, j’étais libre. »
« Tombeau » pour Jean Breton, Les Eperons d’Eden (2014) s’ouvre sur une lettre au père : « Père, tu le fus assez peu. Le temps te manquait, et la vocation […] tu avais choisi d’être plutôt mon ami […] Tu as rendu ton alphabet, trois jours après avoir vomi noir – le jus de la mort. » Au plus près de l’intimité rêvée, plutôt que retrouvée, le dialogue enfin semble possible : « Je bois dans ton bol / et m’enchaîne à tes livres ». L’émotion est forte, sans effusion, d’une sensibilité juste : « A toute vitesse, / j’ai accumulé ton visage // Pour annoter tes poèmes / de salves de toi. // Désormais je t’emporte / de meuble en planète, // Je me fais spacieux / pour ta survie [...] Pourvu que / tu écrives encore / sous la dictée / des météores [...] Je bêche le silence / je demande hospitalité à tes livres. »
Christophe Dauphin, dans une longue et belle postface, retrace l’aventure éditoriale des frères Breton, et de père en fils, salue l’ardeur de leur engagement, évoque la réussite vertigineuse et la débâcle des éditions Saint-Germain-des-Prés, la force des liens familiaux et de leurs amitiés en poésie. Il souligne surtout la singularité d’Alain Breton, l’univers propre de ce créateur pour qui, « de fait, l’être du poème est nombreux, peuplé à foison d’autres masques ou d’autres lui-même, ouvrant toujours des possibles et délivrant ce mode d’emploi à tiroirs d’une toujours plus lointaine et profonde féerie. » Il cite plusieurs critiques, dont Robert Sabatier qui a remarqué très tôt les qualités d’attention du jeune poète aux êtres et aux choses : « Elliptique, il a le sens des silences et traduit de manière limpide les spectacles de la vie. » Et Paul Sanda, de conclure l’ouvrage par un hommage, rédigé en 2016, « à la justesse d’Alain Breton » : « Enfin le reconnaître, le connaître ici à sa juste valeur : un authentique grand poète de notre temps, avec un souffle ardent, bousculant et brûlant violemment le poncif. »
Michel MÉNACHÉ (in revue Europe, 2018).
*
Établie par Christophe Dauphin qui signe également une longue et riche présentation d’Alain Breton, cette édition préfacée par Paul Farellier et accompagnée d’un hommage de Paul Sanda, est une somme de près de 500 pages réunissant l’Œuvre poétique complète d’un auteur qui est aussi critique, peintre, éditeur, fils du poète (et éditeur lui-même), Jean Breton.
De « Tout est en ordre » (1979) aux « Eperons d’Eden » (2014) en passant par « Juste la terre » (1991), « Bivouacs » (1992), « Une chambre avec légende » (1999) ou « Pour rassurer le fakir » (2000), - sans oublier des inédits, et les quatre recueils publiés sous le nom de Jacques Aramburu - les poèmes réunis ici sont ceux d’un auteur qui s’est toujours méfié de l’hermétisme, optant bien plutôt pour ce que Jean Breton et Serge Brindeau, dans leur fameux manifeste de l’homme ordinaire, ont appelé une « poésie pour vivre ».
Poésie de la vie, oui, en prise avec la quotidien le mieux partagé, pour nous parler des hommes et des bêtes, du sport (boxe, lutte, foot, judo…), du jazz, de l’amour, de la campagne, évoquer aussi les êtres dont il est ou fut proche, telle la grand-mère, ou sa mère, tel son oncle Michel, qui fonda la revue Poésie 1 où Alain fit ses premières armes d’éditeur et qui se suicida, tel son père bien sûr (« Eperons d’Eden », lire ici). Une poésie qui respire, mise sur l’émotion (vécue et transmise), la sensualité, mais sait aussi les pouvoirs du verbe et les vertiges de l’inquiétude métaphysique. Une mélancolie discrète s’y faufile, cependant l’énergie y domine l’âme grise. « Ainsi voyage le luxe des jours / dans l’appétit de vivre ».
Michel BAGLIN (cf. "Mes lectures de 2018" in revue-texture.fr, 12 juin 2018).
*
"Une vraie malle au trésor. je ne cesse d'y fouiller, puiser. Belle et sobre préface de Paul Farellier. Présentation de Christophe Dauphin (pari de nouveau gagné), qui retrace, dans ce livre, l'itinéraire étonnant, forçant l'admiration, de ce poète-éditeur aux talents multiples. Il y est bien sûr question du grand Jean Breton, le père d'Alain (évoqué in Coup de Soleil n°32), de Guy Chambelland, que j'ai rencontré naguère dans sa librairie-galerie à Paris, tout comme Yves Martin (évoqué in Coup de Soleil n°15), cité, lui aussi, de Daniel Biga, etc. "
Michel DUNAND (in revue Coup de Soleil n°103, juin 2018).
*
« Émotiviste par essence », selon Christophe Dauphin, le poème s’ouvre au merveilleux chez Alain Breton. Voici, rassemblée en plus de 400 pages, son œuvre depuis Tout est en ordre sûrement (1974) jusqu’à Les Éperons d’Éden (2014). Des inédits complètent ce volume, ainsi que les poèmes publiés sous le nom de Jacques Aramburu.
Isabelle Lévesque (cf. "Que lire cet hiver?", in La Quinzaine sorti n°1204, 15 novembre 2018).
*
Les anthologies qui proposent un focus sur un poète à découvrir dans une contextualisation biographique et sociologique fonctionnent de la même manière. Les extraits d’œuvres sont placés dans le moment et le lieu de leur production. Cet éclairage n’est pour autant jamais envahissant. Le lecteur est ainsi libre d’apprécier les textes proposés sans que les éléments d’une biographie qui prendrait facilement le pas sur la portée artistique des textes ne viennent perturber la portée sémantique des extraits.
Il est tout à fait admirable de feuilleter le volume consacré à Alain Breton. Un tour d’horizon de son œuvre qui regroupe les plus beaux de ses poèmes nous permet d’apprécier la richesse de son œuvre, mais aussi la trame épaisse de son parcours, car il est aussi critique et éditeur. Il est également possible comme pour chaque auteur abordé de suivre l’évolution de ses productions, leur édification, de percevoir les changements et la logique qui sont à l’œuvre dans la genèse de la globalité.
Et nonobstant le fait qu’Alain Breton est aujourd’hui le directeur littéraire de la Librairie-Galerie Racine, il est aussi un poète extraordinaire qui offre au langage une amplitude servie par des images puissantes et inédites. Le choix de mise en œuvre est chronologique, et on découvre autant de poèmes en prose que de textes versifiés.
Tu gis en Provence
dans les palabres des fleurs
Rincé
par la lumière
Tu monnayes
Le poignard des anges.
Des vers brefs, vifs et qui n’en travaillent pas moins toute l’amplitude du signe. Les antithèses servent des métaphores inédites, et le lexique pourtant usuel déploie toutes ses potentialités. Une langue revivifiée, renouvelée, retrouvée en somme, parce que cette poésie nous offre de nous l’approprier à travers la libération d’une multiplicité d’acceptions. 462 pages dont on ne peut que se réjouir, et qu’il est bon d’avoir près de soi, pour s’immerger dans la magie des vers d’Alain Breton.
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
*
Il triture les mots, il les essore, les malaxe, les compacte jusqu’à la fibre intime. Infinie recherche dans un subconscient qui se rebelle mais qui finit par donner en juste offrande ce que la raison ne voulait avouer en pleine lumière. La poésie s’y terre : elle y devient humus, union de molécules langagières empreintes de rencontres, de ferments.
Alain Breton nous offre ici une anthologie sécrétée au long des années en une somme impressionnante. Plusieurs recueils, des textes révélés, agrémentés par une préface de Paul Farellier, une remarquable mise en mots de Christophe Dauphin, un hommage à la justesse de Paul Sanda. Lire en fin de volume sa bibliographie (y-compris celle parue sous le pseudonyme quelque peu rocambolesque de Jacques Aramburu) est chose intrigante, pour ne pas dire impressionnante, tant on sent que la poésie a été pour cet auteur, non pas une compagne dilettante ou un exercice de style, mais une véritable manière de vivre.
Poète, écrivain, éditeur, galeriste, peintre, amateur de musique, tout à la fois rigoureux et un peu bohème, discret mais pourfendeur de médiocrité, riche en paroles et en pensées dans la pénombre de son antre du quartier latin où palpitent des milliers de livres, manuscrits, toiles, articles et incessants projets artistiques ou littéraires, Alain Breton nous bouscule et nous déconcerte. Il n’est pas aisé de résumer ces 477 pages d’une œuvre poétique qui se décline tout à la fois en vers et en prose. On y ressent les racines des surréalistes jusqu’à ce concept contemporain d’émotivisme : l’émotion serait-elle finalement, au-delà de toute technique du langage, ce qu’il y a de plus natif (dans le sens rousseauiste du terme), de meilleur en nous ? La créativité ne pouvant se passer d’intuitions, de fusions impromptues, de frottement d’idées originales à la synapse des mots, à la faille de la matière verbale qui, elle-même, surprend leur créateur. On y ressent une perpétuelle quête d’un plus loin, d’un plus intime, dans le chaudron d’une expression écrite que les druides n’ont pu autrefois exprimer.
Trois facettes, au gré desquelles s’épanouit une trace finement ciselée et singulière, ont particulièrement retenu notre attention. La première est cet attachement viscéral, pour ne pas dire charnel à sa mère, dans Le long du fleuve Orénoque. L’auteur assiste à sa propre naissance, se tutoyant lui-même ou donnant voix aux lèvres de la parturiente, comme si ces lignes brûlantes étaient issues de l’aimée :
On ne cesse de vider le ventre
On donne l’assaut aux couleurs
Que l’on hisse les yeux !
Sans répit
pour baiser un peu ta tête violente.
Puis, prenant la parole :
Ô ravin-mère, initiale ligne de feu,
je cherche ma voix dans tes déluges,
je reste seul dans mon visage
pieds nus – sur le vacarme originel.
Indicible chronologie de l’être : au forceps, une traduction langagière de la gésine et du cri primal.
Par ailleurs, l’itinéraire d’Alain Breton est sans cesse ourlé d’humour. Non par calembours, mais par sens du cocasse, de la chose inversée, du retournement de la situation. Pour rassurer le fakir : en fait, c’est celui-ci qui nous rassure sur son tapis clouté par les choses insignifiantes de l’existence.
Lorsque je commence un dessin, que le jour faiblit et que je veux en finir, je lui fais subir des pressions, je viens à le menacer pour qu’il se termine tout seul.
*
Parfois l’enfance me rattrape, ses bateaux pirates, les cales à esclaves, l’ourlet des ponts, le mât qui laisse échapper un fanion, tout le bouquet des nuits et la grosse fée qui fait une scène.
*
Au fil du temps, les poches ont appris à lutter contre les invasions clandestines. Poches retroussées, détroussées, soumises à fouilles et interrogatoires, remplies par les courants des rivières souterraines.
Mise en perspective et coloration particulière à mi-chemin entre onirisme, originalité d’esprit et ironie. Comme l’écrit Henri Rode (cité par Christophe Dauphin dans sa Postface) : Alain Breton est épieur d’absurdie dans le quotidien déconcertant, tout de discrétion. Félin qui se garde d’être ébloui dans le jeu de miroirs érotiques.
Ce qui nous donne un marchepied vers la troisième facette (parmi tant d’autres possibles, cette note de lecture n’étant nullement une exégèse) que nous aimerions évoquer ici. Celle où le désir se fait lumière, en toute délicatesse :
Tout
ce que tu touches
fait l’amour.
Même
l’ampoule
où brûle un butin rose.
Ton ventre
arrange l’ombre
de la chambre.
(…)
Qui t’appelle
s’apaise.
Moi,
novice
devant la beauté
La difficulté d’une recension en poésie, c’est de s’arrêter devant les contingences de la page. Qu’il nous soit finalement permis de citer Paul Farellier devant « Lentement, Mademoiselle » d’Alain Breton : averses pyrotechniques où chaque image-fusée, à peine éclatée, est bousculée par la suivante (…) : la femme gouverne les éléments dont elle est la puissance salvatrice.
3Infimes prodiges3 d’une profonde et très humaine poésie.
Claude LUEZIOR (in revue Traversées, Belgique, 26 mars 2019).
*
Qu’y a-t-il de commun entre les œuvres de jeunesse où l’on découvre la poésie et celles de la maturité quand on maîtrise l’outil poétique, le vers ou la prose ? C’est que réunir en un seul volume l’œuvre de toute une vie est chose complexe. Et pourtant, Christophe Dauphin s’y emploie, s’agissant d’Alain Breton que les plus anciens parmi nos lecteurs connaissent pour avoir été l’un des animateurs de Poésie1… Reste alors à passer en revue les plaquettes constitutives de ce volume (de plus de 460 pages, si l’on ne compte pas la table)…
Les proses de Tout est en ordre, sûrement qui datent de 1979 font comme un fouillis, comme un désordre à l’image du monde et ce n’est pas le portrait de Ray Sugar Robinson qui viendra me démentir… Les poèmes (brefs) de la deuxième suite (parfois réduits à un vers) sont sertis d’allusions et disent parfaitement la sensualité de cette musique. La troisième suite est écrite en vers…
La deuxième plaquette qui s’appelle ça y est le monde ! (1990) commence par une suite intitulée Le long du fleuve Orénoque, dédiée à la mère du poète. C’est le récit d’un accouchement distancié, qui ne va pas sans émotion : « J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement » (p 50). La deuxième suite, La Terre encercle les oiseaux, commence par ces vers « Ma mère, tu le sais / je suis toujours la grenouille de sang entre tes cuisses » (p 51) : tout est dit dans ce distique. La troisième suite, Planètes, est sans doute la plus personnelle, car constellée de souvenirs intimes (comités, dédicaces, jazz, poètes…) ; mais je préfère les poèmes d’amour ou de tendresse à ceux écrits la gloire du sport : je sais bien que j’ai sans doute tort mais je suis ainsi !
La troisième plaquette est intitulée Juste la terre. Elle s’ouvre sur un poème intitulé « Montagnard » : pourquoi faut-il qu’il me rappelle les photographies de Henri Didelle ou les poèmes de maints marcheurs. Ça ne manque pas de nostalgie comme ces premiers stylos aux quatre couleurs (p 112). Alain Breton a l’art de la sentence mais cela ne va pas sans mystère : « même si quelques ruelles, de moins savantes, / embrasent encore, le matin // un chien, un coq, un lézard, / le temps qui compte ses boxes, ses visages » (p 114).
La quatrième plaquette est intitulée Bivouacs, elle date de 1992. Et une part d’un certain surréalisme est présente, en 2018, cela fait une cinquantaine d’année qu’un certain André Breton est mort…
Avec Maison-Buffle (1993), Alain Breton est à l’affût de ces infimes prodiges qui donnent son titre à ce volume de mille cauchemars ou de mille rêves. Son réalisme est à l’image de ces nuages qui ne sont que le rapprochement de deux réalités très éloignées …
Le sixième recueil intitulé Messe noire des vagues a été publié en 1999. Ce sont des histoires de pirates en vers ou en prose. La fantaisie y est présente : « De Zanzibar à Chandernagor […] / […] il faut déterrer / la botte de sept lieues / » (p 179). Histoires de pirates : Alain Breton fait preuve d’une forte maîtrise du vocabulaire de ces contes et histoires, des us et coutumes des boucaniers, des grands mythes…
Le septième recueil intitulé Une chambre avec légende (1999) est marqué par l’amour fou et l’émerveillement, accentués par la brièveté des poèmes qui confinent à des notes prises à la volée : « les tables sous les chaises rejoignent le / cimetière des éléphants » (p 205) font parfois penser à celui qu’écrivait un demi-siècle plus tôt (« Je te vertige, je te hanche ») Henri Pichette.
Dans le recueil suivant (Pour rassurer le fakir, 2000), sous-titré Carnets d’atelier, on peut deviner que ce fut écrit après la visite d’un atelier de peintre. Certes, le mot dessin, la lumière qui pare les corps et la recherche fondamentale sur les peintres le disputent à la présence des sportifs (qui est Attila Zopf ?). Mais très vite, il s’agit plutôt de textes d’ateliers, les sportifs ne sont là que pour le rappeler : le texte (poème) sur Evariste Galois (p 237) n’est là que pour le prouver… Mais la présence de portraits fait penser à l’atelier des peintres, et c’est le début de belles histoires au surréalisme marqué dont l’humour n’est pas absent. A moins qu’il ne s’agisse d’un atelier de textes (???) dans lequel Alain Breton expérimente des sujets différents ???
Dans Le Chasseur de Rivières (2004), Alain Breton a une vision très précise : « Je ne sais pas changer la litière / des orties » ( p 279) ou « ils te donneront / la prophétie des fanges » (p 282), ce qui ne va pas sans une certaine obscurité…
Brûlant sombre (2008) est une ode au jardin traversée par les morts (p 296) ou par le souvenir de Rimbaud (p 298). C’est écrit en dis(ti)ques sauf dans la troisième suite où le lecteur est confronté à la prose…
Des poèmes et des proses de 2011 (qui constituent la partie suivante de l’ouvrage), je relève ces lignes : « … La poésie m’a poussé à faire émerger les problèmes liés à mon identité, la prose m’a permis d’en rire ». Je ne sais pas si ces mots s’appliquent à l’ensemble de l’œuvre complète, mais ils révèlent un bel exemple de clairvoyance.
Les éperons d’Eden (qui datent de 2014) commencent par une prose qui est une ode au père, Jean Breton. Et ça continue par de brefs poèmes en vers qui, mis bout à bout, font comme un tombeau à la gloire de Jean Breton. C’est émouvant et un bel exemple d’amour filial : ainsi ce poème consacré au tueur de doryphores du jardin de Nibelle (p 362). Cela ne va pas sans quelque aspect obscur (mais c’est sans doute le propre de la poésie) comme dans ces poèmes qui ouvrent la deuxième suite (Une poignée de nuit) : « La mer délassée / sur les lèvres de Pénélope » (p 347). Même si l’on sait ce qu’est la mort tout en ignorant quel sens donner à ce qui est une absence éternelle…
Un livre qui valait bien la peine que s’est donnée Christophe Dauphin. Des caractéristiques de cet ouvrage, je veux signaler que le surréalisme n’est pas mort et le lyrisme contenu. Un livre nécessaire dû à Paul Farellier (qui en a signé la préface), à ce même Christophe Dauphin et à Paul Sanda.
Lucien WASSELIN (in recoursaupoeme.fr, 29 mars 2019).
*
Ce volume de près de 500 pages nous rappelle, s’il en est besoin, l’intense activité d’Alain Breton au service de la poésie. De nombreux poètes ont croisé sa route et lui doivent leurs premières publications. Son nom est associé à la célèbre revue Poésie 1, ainsi qu’à la Librairie-Galerie Racine et Les Hommes sans Épaules. La poésie qu’il défend est une poésie vivante, charnelle, accessible, aux antipodes d’un certain hermétisme.
Infimes Prodiges, présenté par Christophe Dauphin et préfacé par Paul Farellier, regroupe plusieurs recueils dont Tout est en ordre, sûrement (1979), Juste la terre (1991), Bivouacs (1992), le très émouvant Les Éperons d’Éden (2014) et, peut-être l’un de ses meilleurs livres, Maison-buffle (1993), publié chez Cheyne sous le pseudonyme de Jacques Aramburu : Elle a des climats, - ses sonnailles, - ses alvéoles, - ses fruits serrés dans le satin – et puis son bon vent d’étoiles – qui va et vient, - change de musique – et d’arbre. – Tous les quatre matins – la maison entre dans la couleur - Dans la maison – les bruits ne s’arrêtent jamais. – Ce sont des bruits intimes, - des bruits de confiance, - Chacun d’eux a la clé du monde, - un instant.
Jean-Christophe RIBEYRE (in revue Verso n°177, juin 2019).
|
|

|
|
Critique
Alain Breton refuse les facilités des "comme" qui dépaysent. les métaphores atteignent aux extrêmes de la compression de sens à laquelle peut résister la métonymie. De justesse. L'image bifurque vers une autre image qui ne semblait pas l'attendre, engendre le plaisir poétique réel, qui est bien de découvrir que ler dévoiement contrôlé des mots, leurs rebonds inattendus sont source d'enchantement et de significations intenses. Dans la Chambre avec légende, on dort dans un éveil secret : "nuit perdue en mer sur la page blanche des seins - nuit tardive aux mouchards du soleil - nuit dans le soupir de l'aulne où des larmes resquillent - fais que jamais je ne retombe - du mâchicoulis de ton amour." Ah! Ce mâchicoulis ! Si près d'un amour à nouveau nommé, trois, voire même quatre sens...
Jean DUBACQ
(in Les Hommes sans Epaules n°9, 2000).
|
|

|
|
Lecture
"L'exercice de l'humour nécessite un recul et une perspective morale ; il charge le rire de gravité, voire de larmes, car le tragique y fait souvent son lit ; il compte autant sur les stratégies que sur les délires de l'imagination.
Drôles de rires est une anthologie de textes d'humour enrichie par de nombreux dessins de Chaval, Piem, Serre... Des pensées d'humour (ou aphorismes) accompagnent les textes - nombre d'elles inédites, les autres nous ont semblé relever du meilleur du genre. L'oeuvre d'humour, mêlant scepticisme et idéalisme, propose des niveaux de survie, ou la vie quotidienne et le fanstastique, la tendresse et la cruauté, le ridicule et l'étrange s'aboutonnent."
Mirela Papachlimintzou (in revue Contact n°81, Athènes, Grèce, mars 2018).
*
Les Hommes sans Épaules éditions publie régulièrement des anthologies. Des volumes généreux, à la couverture blanche, et des mines de diamants taillés par Christophe Dauphin. Il édifie le parcours d’un auteur à travers les œuvres convoquées, dont les étapes sont motivées par ses choix éditoriaux. Ceux-ci sont expliqués dans une préface et une postface, dont il est l’auteur, ou bien qui sont signées par un de ses nombreux collaborateurs.
Le lecteur peut alors apprécier les extraits proposés, les replacer dans u contexte illustré par des documents iconographiques d’une grande richesse, eux aussi. Une immersion dans l’univers d’un auteur, qui est à découvrir ou à comprendre dans la globalité d’une démarche exposée dans le déroulé temporel de ses productions, en lien avec une existence dont certains moments sont éclairés par la mise en œuvre.
Ces anthologies sont élaborées autour de thématiques. Drôles de rires signée Alain Breton et Sébastien Colmagro nous propose un florilège de morceaux choisis parmi les productions d’auteurs tels Sacha Guitry, Alphonse Allais…Un tour d’horizon d’Aphorismes, contes et fables, Une anthologie de l’humour de Allais Alphonse à Allen Woody, avec en ouverture une belle préface des auteurs, et un extrait du Rire de Bergson. Pour clausule un Après rire… Un groupement de textes d’un grande richesse, qui interroge l’ancrage historique et social de l’humour, problématique bien sûr relevée par le paratexte. Et comme pour chaque volume du genre, pléthore de documents iconographiques établissent un dialogisme riche et pertinent avec les textes.
En plus d’un moment jubilatoire, le lecteur peut réfléchir sur la question du rire, car ce groupement de textes propose un cadre de réflexion dont les enjeux nous sont montrés par le paratexte. Mystification, dérision, non-sens, ironie, parodie, la liste peut-être longue, et ces modalités humoristiques sont à prendre très au sérieux. A la fin du dix-neuvième siècle le comique a été le premier moyen d’expression d’une crise du sens, bien avant que l’absurdité ne soit la trame féconde d’oeuvres plus sérieuses…
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
|
Lecture
"L'exercice de l'humour nécessite un recul et une perspective morale ; il charge le rire de gravité, voire de larmes, car le tragique y fait souvent son lit ; il compte autant sur les stratégies que sur les délires de l'imagination.
Drôles de rires est une anthologie de textes d'humour enrichie par de nombreux dessins de Chaval, Piem, Serre... Des pensées d'humour (ou aphorismes) accompagnent les textes - nombre d'elles inédites, les autres nous ont semblé relever du meilleur du genre. L'oeuvre d'humour, mêlant scepticisme et idéalisme, propose des niveaux de survie, ou la vie quotidienne et le fanstastique, la tendresse et la cruauté, le ridicule et l'étrange s'aboutonnent."
Mirela Papachlimintzou (in revue Contact n°81, Athènes, Grèce, mars 2018).
*
Les Hommes sans Épaules éditions publie régulièrement des anthologies. Des volumes généreux, à la couverture blanche, et des mines de diamants taillés par Christophe Dauphin. Il édifie le parcours d’un auteur à travers les œuvres convoquées, dont les étapes sont motivées par ses choix éditoriaux. Ceux-ci sont expliqués dans une préface et une postface, dont il est l’auteur, ou bien qui sont signées par un de ses nombreux collaborateurs.
Le lecteur peut alors apprécier les extraits proposés, les replacer dans u contexte illustré par des documents iconographiques d’une grande richesse, eux aussi. Une immersion dans l’univers d’un auteur, qui est à découvrir ou à comprendre dans la globalité d’une démarche exposée dans le déroulé temporel de ses productions, en lien avec une existence dont certains moments sont éclairés par la mise en œuvre.
Ces anthologies sont élaborées autour de thématiques. Drôles de rires signée Alain Breton et Sébastien Colmagro nous propose un florilège de morceaux choisis parmi les productions d’auteurs tels Sacha Guitry, Alphonse Allais…Un tour d’horizon d’Aphorismes, contes et fables, Une anthologie de l’humour de Allais Alphonse à Allen Woody, avec en ouverture une belle préface des auteurs, et un extrait du Rire de Bergson. Pour clausule un Après rire… Un groupement de textes d’un grande richesse, qui interroge l’ancrage historique et social de l’humour, problématique bien sûr relevée par le paratexte. Et comme pour chaque volume du genre, pléthore de documents iconographiques établissent un dialogisme riche et pertinent avec les textes.
En plus d’un moment jubilatoire, le lecteur peut réfléchir sur la question du rire, car ce groupement de textes propose un cadre de réflexion dont les enjeux nous sont montrés par le paratexte. Mystification, dérision, non-sens, ironie, parodie, la liste peut-être longue, et ces modalités humoristiques sont à prendre très au sérieux. A la fin du dix-neuvième siècle le comique a été le premier moyen d’expression d’une crise du sens, bien avant que l’absurdité ne soit la trame féconde d’oeuvres plus sérieuses…
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
|
|
|