| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
|

|
|
Dans Rimbaud revue
"S'il est poète, André Prodhomme est avant tout un être de chair et de sang qui ne tient pas à s'enfermer dans les "nèbuleuses" de l'intelligentsia poético-mondaine et, d'emblée, il a notre sympathie. Un brin érotique, sa poésie se complaît essentiellement dans la tendresse et l'amitié. C'est dire que ce recueil n'est en aucune manière charpenté par une structure savamment élaborée, mais soumis aux pulsions du désir, de la colère, du refus. Ces textes évoquent tout aussi bien les propres enfants d'André Prodhomme que... Jack Kerouac ou Chagall, selon l'inspiration du moment, selon le plaisir d'écrire, selon la fatigue..., car cette poésie n'hésite pas à entraîner le lecteur dans un marathon ("Funélailles impossibles") ou l'auteur, "les muscles tétanisés au-delà de toute fatigue" / (est) "comme un arbre foudroyé" qui cherche, malgré ses poumons en feu "l'air absolu". Défiant la peur et la mort, ("as-ru caressé la cruauté des choses"?) André Prodhomme nous donne une belle leçon d'optimisme, d'amitié, témoin ce poème en forme de lettre, dédié à Hervé Delabarre, commençant par: "Mon cher ami de Saint-Malo", et se terminant par : "...Je pense à toi / Et je m'invite à I'infini sourire du désespoir qui brille / Je mets mes lèvres à ce silence assourdissant / Et je me nomme au vertige de l'amitié libre // André Prodhomme". Une poésie à hauteur d'homme, c'est à dire proche du coeur qui palpite et de l'imagination qui vagabonde."
Jean CHATARD (Rimbaud Revue, 1996).
|
|

|
|
Critiques
"La joie comme la peine se mesurent en centigramme." (Benjamin Péret). Joie ? parce qu'un nouveau numéro de Supérieur Inconnu, le trentième, est paru. Peine ? parce que c'est le dernier et qu'il est consacré à son fondateur Sarane Alexandrian, disparu en 2009 emporté par une leucémie. La couverture est de Madeleine Novarina, épouse de l'écrivain, et vient clore une série commencée en octobre 1995. Le comité de rédaction de la revue a dans son ensemble participé à l'hommage rendu à Alexandrian. Nous trouvons des textes et des entretiens d'anciens compagnons: Alain Jouffroy, des lettres d'André Breton et de Malcolm de Chazal, des illustrations de Victor Brauner, Ljuba, Denis Bellon. Sous la plume de Christophe Dauphin, auteur chez l'Âge d'Homme d'un essai Sarane Alexandrian, le grand défi de l'imaginaire, on peut lire un très intéressant et émouvant portrait de ce dernier. Les documents publiés sont nombreux et la période d'après-guerre est riche en témoignages: exposition surréaliste en 1947 à la galerie Maeght, création de la revue Néon et de Cause... Le sommaire est parsemé de textes inédits de Sarane Alexandrian, écrivain, critique d'art et fondateur d'une des revues les plus fascinantes de ces dernières années: Supérieur Inconnu, qui a paru en trois séries, trente numéros au total de 1995 à 2011. Adieu Grand Cri-chant nous en sommes pas prêts de vous oublier, d'ailleurs: "c'est les jeunes qui se souviennent. Les vieux oublient tout." (Boris Vian).
Michel Jacubowski (in Cahiers Benjamin Péret n°1, septembre 2012)
« Supérieur Inconnu.., est le titre qu'André Breton avait choisi, en novembre 1947, pour nommer la publication qu'il envisageait de fonder... » Aujourd'hui, c'est le dernier numéro d'une revue « ouverte à la prose autant qu'à la poésie» et qui a mis « à l'honneur, dans chaque numéro, un écrivain qui est souvent injustement méconnu du public et de la critique »... Dernier numéro consacré à Sarane Alexandrian, mort le 11 septembre 2009. Sarane Alexandrian et Madeleine Novarina, poète et son épouse, « le couple héroïque faisant face à tout » selon Christophe Dauphin. Un dossier complet avec des textes de l'auteur, bien sûr, des analyses de sa création romanesque, des fac-similés des lettres, des photos, des reproductions de tableaux et de dessins, des hommages de ses proches, des souvenirs... Et tout cela donne une image vivante de ce familier des surréalistes. Un exemplaire à conserver!
Alain Lacouchie,
(revue Friches, n° 109, janvier 2012).
"Sarane Alexandrian nous a quittés le 11 septembre 2009 pour le Grand Réel. Spécialiste des avant-gardes et de la littérature érotique, biographe de Victor Brauner, cet homme exceptionnel, érudit incarnant l’élégance intellectuelle et spirituelle, fut aussi, c’est moins connu, un hermétiste de talent, ce qui apparût clairement à travers la revue Supérieur Inconnu qu’il dirigea brillamment. Deux ans après sa disparition, Supérieur Inconnu, désormais sous la direction de Christophe Dauphin, rassemble ses amis pour un numéro spécial, n°30, consacré à l’homme de l’art et à son œuvre multiple, inattendue, et absolument non-conformiste comme il savait si bien le revendiquer. Christophe Dauphin avertit le lecteur d’une ambiguïté toute française : « La France raffole des surréalistes quand ils sont morts ; mais quand ils étaient dans l’éclat de la jeunesse ou dans la force de l’âge, elle a tout fait pour les acculer à la misère. C’est d’ailleurs le lot de tout grand artiste révolté, de tout prophète de l’anticonformisme, de connaître une gloire tardive ; les conformistes lui préfèrent toujours le pantin remodelable après chaque rebut. Sarane Alexandrian n’a pas échappé, malheureusement, à ce principe ; du moins en France, car à l’étranger, au Liban, en Roumanie, en Angleterre, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Turquie, aux Etats-Unis, en Chine (où son Histoire de la littérature érotique a été traduite en 2003), ou à l’Île Maurice, notre ami jouit d’un prestige qui ne s’est jamais démenti. » Ce numéro spécial débute par une présentation des trois périodes de la revue, les 21 numéros de la première série, 1995-2001, les 4 numéros de la deuxième série, 2005-2006 et la troisième série, 2007-2011 qui propose 5 numéros. D’une grande exigence, Sarane Alexandrian a veillé à la haute tenue de sa revue qui demeure la plus belle publication d’avant-garde des vingt dernières années. Supérieur Inconnu a inscrit le message du surréalisme éternel dans la période si dangereuse et si passionnante du changement de millénaire, message que l’art du XXIème siècle devra s’approprier pour demeurer art. Ce numéro, qui mêle articles, poèmes, illustrations, témoignages, écrits de Sarane, illustre la puissance, la densité et la richesse de ce message non-conformiste, au plus près de la liberté de l’être. Et il y a ce couple, Madeleine Novarina et Sarane Alexandrian, un amour fou qui n’a cessé de nourrir la création de l’un comme de l’autre. Parmi les textes de Sarane Alexandrian rassemblés dans ce numéro, citons : Madeleine Novarina poète – La création romanesque – Autour de « Socrate m’a dit » – Considérations sur le monde occulte – Ontologie de la mort, ces deux derniers inédits. Sarane Alexandrian contribua grandement au renouvellement de l’alliance salutaire entre avant-garde et initiation, par ses écrits bien sûr, plus encore par sa médiation entre des mondes qui s’ignorent encore à tort. Parmi les très nombreux contributeurs à ce numéro qui, davantage qu’un hommage, constitue une démonstration de la permanence de Sarane Alexandrian, citons : Madeleine Novarina, Virgile Novarina, André Breton (Trois lettres à Sarane Alexandrian), Malcom de Chazal (Lettre à Sarane Alexandrian), Jean-Dominique Rey, Odile Cohen-Abbas, Paul Sanda, Marc Kober, Fabrice Pascaud, Jehan Van Langhenhoven, etc. Ce numéro exceptionnel est diffusé par Les Hommes sans Epaules, 8 rue Charles Moiroud, 95440 Ecouen, France.
Remi Boyer
(Incohérism.owni.fr, 21 septembre 2011)
"Un numéro hommage de Supérieur Inconnu à son fondateur, Sarane Alexandrian (1927-2009). Un lien étroit avec les HSE : le directeur de publication en est aussi Christophe Dauphin, et les HSE en gèrent la publication. Les contributeurs sont nombreux, poètes, artistes, amis, qui apportent leur voix pour cet hommage quasi unanime (seule voix dissonante, celle d’Alain Jouffroy) qui tente d’aborder toutes les facettes de cet homme à l’élégance légendaire qui sut ne pas faire de concession aux modes. On croisera ainsi entre autres Françoise Py, Lou Dubois, Olivier Salon, Virgile Novarina, César Birène, Marc Kober, Odile Cohen-Abbas, mais aussi, évoqués largement, par le document, lettre ou dessin, Madeleine Novarina, sa femme, les peintres Jean Hélion et Victor Brauner (dont une œuvre fait la couverture, comme pour le n°1), le poète mauricien (et toujours trop méconnu) Malcolm de Chazal, etc. Un numéro qui marque aussi la fin d’une aventure de 15 ans, puisque ce dernier numéro est aussi l’ultime d’une série de trente."
Jacques FOURNIER
(levure littéraire.com, 2011).
"C’est la première fois que je parle de cette revue et ce sera l’ultime puisqu’il s’agit d’un numéro spécial consacré à son fondateur : Sarane Alexandrian, décédé en 2009. Ce dernier a longtemps été considéré comme le successeur désigné d’André Breton, c’est dire dans quelle mouvance, surréaliste, il s’est positionné toute sa vie. Le titre de la revue d’ailleurs, Supérieur inconnu, a été trouvé par André Breton lui-même en 1947, pour une revue qui n’a pas vu le jour alors. La publication a connu trois séries : la première de 1995 à 2001, avec 21 numéros, et un nombre impressionnant de poètes reconnus aujourd’hui ; la deuxième de 2005 à 2006 (4 n°), avec au comité de lecture des membres plus jeunes comme Marc Kober ou Christophe Dauphin qui rejoignent Alexandrian et les plus anciens, prenant comme axes principaux quatre vertus cardinales que sont le rêve, l’amour, la connaissance et la révolution. Cette série sera interrompue, faute de subvention du CNL, mais suivie par la troisième et finale (2005-2011) avec un comité de rédaction élargi : 5 numéros dont ce dernier. Sarane Alexandrian exerçait une véritable fascination sur tous ceux qui l’ont approché et qui témoignent dans cet ouvrage. Né en 1927 à Bagdad, son père était médecin du roi Fayçal 1er, il vient en France en 1934. Il rencontre le dadasophe Raoul Hausmann, ce qui va être déterminant dans son apprentissage intellectuel, puis André Breton, Victor Brauner et Madeleine Novarina, qui va devenir sa femme et à laquelle sont consacrés deux articles forts de la livraison. Théoricien n° 2 du surréalisme, il rompt rapidement avec André Breton, dès 1948. Christophe Dauphin montre comment il écrit sous autohypnose, à la Robert Desnos, autour de l’onirisme, la magie sexuelle et la gnose moderne. Une idée intéressante, c’est qu’il a souhaité être un anti-père pour les jeunes qui l’admiraient, afin qu’ils le dépassent à leur tour. Ses conceptions romanesques sont très éclairantes, puisqu’il a voulu certainement être davantage reconnu comme écrivain de romans plutôt que poète. Beaucoup de contributions suivent à la gloire de ce grand personnage, dont le charisme et l’ouverture intellectuelle impressionnaient grandement ses interlocuteurs, à noter la fausse note signée Alain Jouffroy qui donne en contrepoint un éclairage inverse au concert de louanges ; également avant de renvoyer à la revue qui propose une quarantaine de témoignages (dont Jehan Van Langenhoven ou Michel Perdrial entre autres), le Sarane Alexandrian, critique d’art, lequel lui confère pour conclure sa véritable dimension. Un homme hors du commun, sans contestation possible. Un grand écrivain de la fin du surréalisme."
Jacques MORIN
(Site internet de la revue Décharge, novembre 2011).
Avec ce trentième numéro de Supérieur Inconnu s'achève l'aventure de cette revue fondée par Sarane Alexandrian en octobre 1995, aventure qui dura donc 16 ans et connut trois séries différentes. Ce dernier numéro consiste en un hommage à la figure tutélaire de Sarane Alexandrian, disparu le 11 septembre 2009. Nous y trouvons les signatures des acteurs majeurs ayant fait l'histoire de cette revue qui se revendiquait du non-conformisme intégral. C'est à César Birène que revient la tâche d'ouvrir ce numéro mémorial par un texte retraçant clairement les grandes étapes de Supérieur Inconnu. A l'origine imaginée par André Breton, la revue aurait dû voir le jour en 1947 chez Gallimard sur les conseils de Jean Paulhan. Une revue ayant l'ambition d'unir les conservateurs fidèles à l'esprit du Second manifeste, et les novateurs. Le nom même de la revue vient directement de Breton qui voyait dans le "Supérieur Inconnu" l'objectif idéal de la recherche poétique de l'avenir. Elever l'esprit vers les hauteurs et explorer l'inconnu. Un désaccord empêcha ce projet que Sarane Alexandrian, en héritier légitime du Surréalisme – il avait été le secrétaire général du mouvement – reprend et mène à son point d'épanouissement au moment charnière du passage au troisième millénaire. Une revue issue du Surréalisme mais désireuse d'accueillir dans ses pages les voix d'un avenir poétique émancipé du passé, et fervente admiratrice de figures peut-être injustement mal connues telles celles de Claude Tarnaud, Charles Duits, Stanislas Rodanski, Gilbert Lely, Jeanne Bucher par exemple. César Birène retrace avec fidélité ces quelques quinze années d'engagement littéraire autour de Sarane Alexandrian. Il en synthétise l'esprit, les contenus, évoque les grands acteurs tels Alain Jouffroy et Jean-Dominique Rey, à la fondation de l'aventure avec Sarane. Puis rejoints par la jeune génération des Christophe Dauphin, Marc Kober, Alina Reyes. Je me permets d'ajouter Pablo Duran, Renaud Ego, Jong N'Woo, Malek Abbou, etc. Les transitions des séries 1 à 2 et 2 à 3 sont bien explicitées, ainsi que les raisons qui présidèrent chaque fois au changement de visage par ces nouvelles moutures de la revue. On notera avec étonnement au moins deux grands absents sous la plume de César Birène, deux absents de taille qui contribuèrent pourtant à l'envergure de la revue par le rôle qu'ils y tinrent au sein du comité de rédaction de la première série, en les personnes d'Alain Vuillot et de Matthieu Baumier… La revue poursuit ensuite son hommage à Sarane avec les textes de Christophe Dauphin, les photos de Sarane et de sa femme Madeleine Novarina, les poèmes de Madeleine Novarina, les photos du bureau de Sarane où nous eûmes tous l'honneur, à un moment, d'être reçu pour une conversation d'une politesse exquise sous le charme silencieux et magiques des œuvres de Victor Brauner. Des textes inédits de Sarane, comme illustrés par des reproductions de toiles de Ljuba, sont ici publiés, comme La création romanesque issue de ses Idées pour un Art de vivre, Art de vivre qui était la passion de sa vie tant il considérait que cet Art induit tous les plans de l'émancipation de l'humain. Nous y trouvons également trois lettres inédites adressées à Sarane, deux par André Breton, la troisième par Malcolm de Chazal, lettres qui témoignent de l'engagement intellectuel intégral qui était celui d'Alexandrian. Suit un entretien d'Alain Jouffroy par Jean-Dominique Rey autour de la figure de Sarane, entretien surprenant au sein d'un hommage tant Jouffroy n'use d'aucune langue de bois pour évoquer le souvenir de son ami Sarane. A juste titre d'ailleurs car Alexandrian, non-conformiste revendiqué, aurait eu en horreur les passages de pommade de circonstance. Jouffroy évoque un Alexandrian supportant mal la contradiction qu'on pouvait lui opposer et nombreux sont, parmi ceux qui le fréquentèrent, à avoir essuyé ses colères et sa susceptibilité... (..) Un homme généreux. Une figure tutélaire à qui l'on devait une manière d'allégeance à partir du moment où il nous avait accueilli dans son clan. Un écrivain ayant sa propre conception de la fidélité, souffrant avec difficulté qu'on lui oppose des vues différentes de ce en quoi il croyait. Mais généreux, je le répète, comme peu en sont capables. Aussi la version de Sarane par Alain Jouffroy a-t-elle lieu d'être tant elle rend fidèlement le caractère haut en couleur qui était le sien. D'ailleurs, s'ensuit la reproduction d'une réponse de Sarane à un message de Jouffroy laissé sur son répondeur téléphonique. Illustration significative des rapports qui furent ceux des surréalistes, faits de franchise, d'orgueil, de rodomontades, d'hystérie surjouée, de joutes oratoires, de ruptures, de réconciliations. Parmi les textes, passionnants, de ce numéro hommage, (nous ne les citerons pas tous), mentionnons celui de Paul Sanda consacré à l'ouvrage majeur d'Alexandrian, Histoire de la philosophie occulte, et aux prolongements de ce livre, d'abord dans le rapport qu'entretint Sanda avec Sarane, ensuite dans la vie de Sanda. Remercions Christophe Dauphin, maître d'œuvre de cette ultime livraison, pour ses contributions à la réussite de ce beau numéro, tant lorsqu'il se consacre au couple Madeleine Novarina-Sarane Alexandrian que lorsqu'il dresse un portrait biographique de Sarane, situant son importance dans la deuxième génération surréaliste mais aussi dans le monde littéraire et intellectuel, lui dont l'œuvre fut traduite partout dans le monde sans que jamais l'intelligentsia officielle et médiatique ne lui rende le moindre hommage. Hommage encore à l'érudition époustouflante d'un homme hors-norme, qui n'avait cure de savoir pour savoir mais entendait savoir pour vivre plus et transmettre ses connaissances pour aider à vivre plus. Jean Binder, lui, choisit dans les multiples visages d'Alexandrian, l'écrivain d'art. Il rappelle que le premier livre de Sarane fut consacré au peintre Victor Brauner, Brauner l'illuminateur, dont on ne peut ici que conseiller la lecture tant ce livre est, à mes yeux, fondamental. Et poursuit en dressant l'itinéraire des écrits sur l'art de Sarane. Palpitant. Gérald Messadié quant à lui tire son chapeau à l'impertinence, pour employer un euphémisme, de Sarane, lui qui, en 2000, publia un livre étrange intitulé Soixante sujets de romans au goût du jour et de la nuit, livre dans lequel Sarane propose aux romanciers en mal d'inspiration 60 sujets mirifiques pour surseoir à leur manque de talent et d'imagination. Un livre volontairement passé inaperçu tant le bras d'honneur d'Alexandrian aux plumitifs desséchés en tous genres relève, comme le souligne Messadié, du terrorisme. Il y a aussi le très beau texte de Marc Kober, d'une justesse et d'une mesure admirables, brossant l'image de surface qu'offrit à beaucoup Sarane Alexandrian pour nous montrer un peu le vrai cœur de cet homme : "Pourtant, la vérité de Sarane est ailleurs, écrit Kober : moins dans l'homme de lettres qu'il voulut être que dans une volonté d'élargir le périmètre humain". Il y a enfin, et je m'arrêterai là, le beau poème que Matthieu Baumier offre ici à Sarane, intitulé "A l'étoile vive", assorti de cette émouvante dédicace Pour Sarane, par-delà. Ce trentième numéro rend ainsi un hommage mérité à un écrivain méconnu, dont l'œuvre théorique continuera d'irriguer les temps à venir tant elle se situe à la croisée de la Tradition dont notre société se targue de ne vouloir rien savoir, et de l'avenir qui l'aimante par un besoin vital de prendre sa respiration. Supérieur Inconnu, ce furent 30 volumes en quinze ans, mais aussi des lectures publiques dont chacun des membres garde en mémoire les éclats et les reliefs. (Conciergerie de Paris, Mairie du XIIème arrondissement de Paris, Bateau-lavoir). A titre personnel, sans Supérieur Inconnu, sans Sarane Alexandrian, je n'aurais sans doute pas rencontré la danseuse Muriel Jaër, petite-fille de la galeriste Jeanne Bucher avec qui, au sortir d'une lecture de poèmes, je devais me lier d'amitié. Je n'aurais pas non plus eu la grande chance de rencontrer Matthieu Baumier, dont l'amitié dans le Poème m'est absolument vitale. Pour ceci, Sarane, merci.
Gwen Garnier-Duguy
(in Recoursaupoeme.fr, août 2012).
|
|

|
|
Lectures :
"Christophe Dauphin a pris l'heureuse initiative de publier dans cet ouvrage non pas l'intégralité de l'oeuvre d'Hervé Delabarre mais une grande partie de celle-ci en réunissant les titres épuisés (soit huit au total) à l'exception des Dits du Sire de Baradel et en ajoutant plusieurs inédits. Hervé Delabarre, poète et peintre, né à Saint-Malo en 1938, rencontre André Breton en 1963 qui avait salué ses poèmes de manière enthousiaste: "J'aime ces poèmes que vous m'avez fait lire, le mouvement qui les anime est le seul que je tienne pour apte à changer la vie, leur ardeur est ce que je continue à mettre le plus haut".
Sa découverte du surréalisme, vers le début des années soixante, est pour Hervé Delabarre une manière de vivre et de sentir: "Benjamin Péret: je m'en nourris, je m'en délecte... Amour, révolte, humour s'y retrouvaient exprimés dans une intransigeance et uen liberté absolue qui me menaient enfin à respirer le large, déclarait-il dans un entretien en 2014. Christophe Dauphin le souligne dans sa préface : avec Péret... Hervé Delabarre "est probablement le poète dont l'oeuvre porte le plus l'empreinte de l'automatisme". Même s'il ne s'agit pas toujours d'un automatisme pur sa poésie possède un pouvoir insurrectionnel qui entretient un rapport direct avec le merveilleux et l'humour noir entre lesquels elle oscille en permanence. Le climat particulier qui se dégage de cette poésie relève, comme l'écrit Jean-Pierre Guillon, "de l'humour spectral etd'un érotisme chargé d'attentions tout en même temps délicates et perverses."
Depuis le recueil Dits du Sire de Baradel, illustré par Jorge Camacho et édité en 1968 par Jehan Mayoux (éd. Péralta), jusque dans les tout derniers poèmes, la tendresse et le violence rythment le lyrisme des images: Dans les pages arrachées d'un carnet de bal - Des lèvres imprégnées de sang - S'efforcent en vain - D'étreindre un dernier serment.
Gérard ROCHE (in Cahiers Benjamin Péret n°5, septembre 2016).
*
« C’est vers 1963 qu’Hervé Delabarre est entré en contact avec André Breton qui l’a invité à participer aux activités du mouvement surréaliste. Et depuis, il n’a pas cessé aussi bien d’affirmer la subversive pertinence du projet surréaliste que d’explorer et d’interroger par les moyens de l’écriture (et aussi, quelque peu, de la peinture et du collage – mais de façon si discrète !) le « fonctionnement réel de la pensée » dans ses rapports avec les souveraines injonctions du désir comme avec les dérobades, si séduisantes ou si égarantes, du réel devant les fragiles puissances du langage. Les jalons de cette aventure poétique, si farouchement éloignée – est-il besoin de le préciser ? – des diverses casernes littéraires, sont autant de paliers dans l’assez énigmatique tour, non d’ivoire, mais bien de guet, à la pierre d’angle jadis (c’était en 1968) blasonnée aux armes du sire de Baradel, et qui se dresse – sans que l’on n’en ait encore vraiment mesuré l’ombre portée – sur le paysage sensible que le surréalisme, depuis la mort de Breton, s’obstine à dévoiler comme la face utopique du réel. Ces paliers furent, au fil du temps, de nombreux recueils de poèmes, parus à l’enseigne de divers petits éditeurs, le plus souvent en province ; il faut remercier Christophe Dauphin et les éditions Les Hommes sans Epaules d’avoir rassemblé en un volume de plus de 300 pages tous ces titres devenus pour la plupart introuvables et que complète des inédits.
Cet ensemble court de 1962 à 2014, et quoiqu’il me paraisse jouer sur trois tessitures différentes, c’est bien la même voix qui signifie, toujours avec l’audace orphique, les injonctions du désir, lumineuses ou noires, pour que le langage exalte sa puissance métamorphique. Cette voix, Hervé Delabarre en a, dès sa découverte du surréalisme, éprouvé ce que l’écriture automatique pouvait lui offrir, non seulement comme ressource, mais aussi comme repère fixe pour mener ses investigations lyriques.
Ainsi, alternant avec des proses automatiques, comme par exemple Marrakech (Notes d’hôtel), dont le burlesque n’est pas sans rappeler Benjamin Péret, se succèdent des poèmes dans lesquels la dictée de l’inconscient est, semble-t-il, suffisamment ralentie pour que l’attention puisse aussi se porter fragmentairement sur le monde environnant, quitte alors à ce qu’en réponse l’accent soit alors impérativement mis sur l’humour ou la révolte et le blasphème puisque « les cycles Lucifer, vous dis-je, il n’y a rien de mieux. »
Et viennent enfin, portés par une troisième tessiture, une série de poèmes, tels Les Paroles de Dalila ou Avide d’elle avilie, dans lesquels l’urgence déchirée-déchirante du désir envers la femme aimée se résout en une lancinante suite de brefs éclats de silex, suite fantasmatique où Au carrefour des cris – S’érige un corps – Labouré de nuit. Hervé Delabarre, ne ces moments où l’œil dans la calebasse – continue de frire semble situable au voisinage de Georges Bataille, mais contrairement à celui-ci, qui les qualifiait en termes de haine, les dangers de cette poésie érotique sont surmontés dans sa propre minutie à confronter le drame intime non seulement avec le miroir mémorial, mais aussi et surtout avec ce qui étincelle Au plus noir – Du cri d’Eurydice : non pas la mort mais encore une voix voilée – Venue du plus loin de la nuit des pôles.
D’un poème à l’autre, en ces divers élans, Hervé Delabarre a su, comme peu d’autres, rester à l’écoute de cette voix. Et aujourd’hui, il me plait que le poème qui donne son titre à ce volume commence sardoniquement par cet impératif : Pas de crème fraiche pour les martyrs. »
Guy GIRARD (in Infosurr n°120, 2015).
*
"Un ouvrage dont le format et l’épaisseur rompent avec ceux de la plupart des recueils poétiques. Le lecteur est plutôt habitué à trouver ces 328 pages regroupées sous l’indication générique du roman. Et sur la couverture rien n’indique d’ailleurs à quoi il doit s’attendre. Un titre discret laisse place à la reproduction d’une toile abstraite de Jacques Hérold, et les couleurs pastel du dispositif contribuent à créer le cadre d’un recueil qui suscite toutes les interrogations. Ce n’est qu’en feuilletant ses pages que l’évidence d’une parole dévolue à la poésie apparaît car des vers courts et justifiés à gauche se suivent entrecoupés par des titres qui rythment l’ensemble. Quelques moments dédiés à la prose n’en démentent pas l’horizon d’attente : il s’agit bien de poésie. Et ce livre imposant s’organise autour de chapitres et de parties bien délimitées et reprises en index. Le titre, Prolégomènes pour un ailleurs, convoque le métalangage de la philosophie et sonne presque comme un oxymore. Et ce qu’il annonce n’est certes pas démenti, tant il est vrai que se dévoile au fil de la lecture une poésie inédite qui met au service d’une trame diégétique la puissance d’un langage dévolu à la création d’un univers fantasmagorique. Soutenu par un appareil tutélaire foisonnant, les poèmes et textes d’Hervé Delabarre se succèdent en suivant une chronologie presque linéaire car leur date de création est indiquée pour chaque ensemble. Des personnages féminins se dessinent et le poète leur confère une dimension charnelle toute particulière.
« Le rêve défriche la charmille des yeux
Ecaille les géographies amoureuses
Inquiétantes et friables
A la lisière des paumes
Sur les mâchicoulis où les nerfs entendent leur monstrueux
cérémonial
Il y a tant à découvrir
Dans leur tracé voluptueux
Jusqu’aux abords de la mort électrique et rose »
Ces amantes croisées dont il évoque le souvenir s’inscrivent près de noms de personnages contemporains de l’auteur, ou bien jouxtent l’évocation de noms appartenant à l’histoire, telle Jeanne d’Arc à laquelle il consacre un poème. Le lecteur est ainsi convié à entrer dans cet univers prégnant qui absorbe la matière du réel pour la donner à entendre au fil de textes façonnés avec un langage plus prosodique que poétique, mais dont la puissance évocatoire à force de rythme et de jeux avec l’espace scriptural donne vie à une poésie inédite. Et ces souvenirs amoncelés comme un puzzle grâce à la rémanence de sensations sous-tendent également les pages où la prose ne cède en rien à la qualité évocatoire de la langue d’Hervé Delabarre. Les femmes à nouveau sont la matière de l’écriture. Mais est-ce là tout ce qu’il est permis d’entendre aux Prolégomènes pour un ailleurs ? Il semble que dans cette pulsion vitale énoncée grâce à la force d’un langage lourd de sensations et ancré aux trames du réel le poète va sonder la désespérance, celle d’un corps dont la mort est inévitable.
« Des lèvres agonisantes
Dans les couloirs
Où l’ombre se nourrit
De sanglots
Et s’exténue enfin
Près de la porte
Là-bas
Au bout
Où tout se joue »
Ce désespoir est également prégnant dans l’évocation de la disparition de la mère du poète, qui apparaît à plusieurs reprises. Une poésie dont la profondeur ne s’énonce que grâce au poids de ce qui n’est que suggéré, et dont toute concession à un lyrisme compatissant est exclu.
« Pas de crème fraîche pour les martyrs
Un ventre vaut mieux qu’un sac à main
pour s’abriter de la pluie.
La mort, elle-même, ronge son frein,
se désespère de ne plus pouvoir venir à bout d’elle-même.
Alors que faire,
sinon se précipiter à la gare,
et s’engouffrer dans un train
enfoui au cœur des herbes folles
et des itinéraires froissés jusqu’à la nuit des pôles. »
Carole MESROBIAN (cf. "Fil de lectures in www.recoursaupoeme.fr, mars 2016).
*
"Hervé Delabarre, né à Saint-Malo en 1938, est peintre et poète qui s’inscrit dans l’esprit du surréalisme tout en portant une originalité qui lui est propre. Tout comme André Breton, sa poésie est un véhicule pour traverser les voiles qui dissimulent le réel.
Dans une longue et riche préface, Christophe Dauphin dit toute l’importance de l’œuvre qui fascina André Breton.
« Hervé Delabarre est un poète dont chaque œuvre est un défi à l’abstraction, une plongée dans le concret, le merveilleux. Ses poèmes possèdent un pouvoir insurrectionnel qui n’est pas sans rapport direct, avec le Merveilleux, l’humour noir, le mystère, l’amour, certes, mais avant tout avec l’être et ces fêlures… »
Au cœur de la démarche de ce « Chevalier du Merveilleux », la femme est à la fois inspiratrice et initiatrice, celle qui introduit la merveille dans la réalité pour mieux révéler l’être en ses intensités. Dans un long poème dédié à l’actrice Louise Lagrange, c’est la queste du Féminin libre et secret qu’il invoque. Extrait :
Vos lèvres tachées
Vos lèvres peintes
Soigneusement tracées au crayon
Vos regards tristes
Mouillés d’araignées mauves sous le parasol blanc du songe
Surgissent dans l’une de ces rues
Où je suis la ligne de cœur
L’émotion du désir fait refluer le sang de votre visage
Les narines pincées sous l’étau des yeux d’hommes
Vous essayez de découvrir
Sous le déferlement des oiseaux de proie
Sous les ailes séchées des corbeaux et des papillons carnassiers
Le tableau peint de toute éternité dans le midi du noir
Quand le glaive y descend pour entrouvrir les fruits
Où dorment emprisonnées les femmes…
Hervé Delabarre développe un rapport particulier au langage. Il rend étrangement vivants les mots qui tendent à devenir cadavres sous les chaînes du conformisme. En libérant la langue, c’est le monde qu’il délie. Ainsi, avec l’ouverture des Portraits-Flashs :
Contrairement à ce qui se dit
On n’a jamais vécu ici d’amour et d’eau fraîche
Le tabernacle ne contient plus que des cendres
L’encens s’épand dans l’air comme une cicatrice
Si la poésie d’Hervé Delabarre est initiatique, si elle rapproche de l’être, c’est par discipline, la discipline de l’arcane, presque naturelle au poète, qu’il décrit ainsi à Jean-Claude Tardif :
« Encore faut-il faire le vide, m’éloigner de toute réflexion, de toute pensée contrôlée, rejeter tout jugement critique, demeurer en état de réceptivité, à l’écoute. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela nécessite aussi un labeur, une discipline, ouvrant une brèche qui nous relie à cette voix intérieure et nous permet de rester « branchés », d’aucuns diraient « connectés ». »
Roncevaux
Un ciboire peut en cacher un autre
A même de nous enivrer
Et la Bible n’est plus désormais
Que le versant doré d’un corps
Les lèvres saignent de trop aimer
Tandis qu’un cœur
S’ouvre comme une blessure
Et nous conduit tout droit aux enfers
Il n’y a pas ici de nautonier
C’est Roncevaux
Roncevaux vous dis-je
Avec à son extrémité
La belle Aude pour nous accueillir
Rémy BOYER (in incoherism.wordpress.com, octobre 2015).
*
"Le mot Prolégomènes est connoté : André Breton n'a-t-il pas écrit (en 1942) Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non ? Les Prolégomènes (le terme s'emploie toujours au pluriel) désignent une longue et ample préface ou l'ensemble des notions préliminaires à une science… Ce n'est sans doute pas un hasard si Hervé Delabarre a titré son florilège Prolégomènes pour un ailleurs car il appartient au surréalisme. De 1960 à 2014, il a publié 18 recueils et la présente anthologie rassemble 8 titres épuisés et 6 ensembles inédits, étroitement imbriqués aux précédents pour respecter un ordre chronologique. C'est dire, qu'actuellement, avec un peu de chance, le lecteur intéressé peut trouver en librairie (ou sur internet) toutes les œuvres de Hervé Delabarre et que Prolégomènes pour un ailleurs représente (pour reprendre les paroles de Christophe Dauphin, le préfacier) le Grand Œuvre du poète ; c'est en tout cas "le livre le plus important et le plus ambitieux publié à ce jour [2015] par Hervé Delabarre" (p 22).
Hervé Delabarre, qui est né en 1938, appartient à la constellation surréaliste. Christophe Dauphin rappelle dans sa préface qu'il rencontra André Breton au début des années 60 du siècle dernier et qu'il lui remit un manuscrit de poèmes fin 1962. Breton le salue alors comme un véritable surréaliste et publie la photographie de Louise Lagrange (qui était une actrice de cinéma, chose que Delabarre ignorait en ces années) et le "Poème à Louise Lagrange" du même Delabarre dans le n° 5 de La Brèche (1963), la grande revue du surréalisme à l'époque. Breton reçoit alors Hervé Delabarre dans son atelier mythique de la rue Fontaine à Paris ; le devenir littéraire de ce dernier est désormais fixé. De fait, cette photographie "rencontrée par hasard" fut pour Delabarre "un merveilleux privilège". On peut affirmer, sans risque d'erreur, que Louise Lagrange fut pour Hervé Delabarre ce que Nadja fut pour André Breton…
Hervé Delabarre semble reprendre -sur un autre registre, celui du poème- la problématique qui avait poussé André Breton à écrire son essai des Prolégomènes de 1942. Mais son premier livre publié est daté de 1962 : d'où, pour lui, l'impression que tout est réglé, que le surréalisme est toujours vivant (comme Breton qui l'illustre bec et ongles) autant que nécessaire. L'histoire littéraire a montré que d'autres expériences étaient possibles, y compris les plus réactionnaires. Mais Hervé Delabarre écrit fermement à la mode surréaliste car le combat est toujours à continuer. D'où cette poésie si reconnaissable entre mille. Trois expressions surréalistes la caractérisent : le hasard objectif, l'amour fou et l'écriture automatique. Hervé Delabarre n'est pas un écrivain réaliste qui expérimente ce qu'il écrit, qui écrit ce qu'il vient de faire. Il écrit ce qu'il vit, y compris sur le plan fantasmatique. Les fantasmes se cachent, se disent, éclatent dans sa poésie. Tout ce qui est écrit peut s'interpréter : "Elle prend plaisir à savourer l'intrus / Venu desceller l'huis" (p 154). Tout concourt à suggérer un paysage érotique : "Harnachée pour susciter le rêve et le désir / Elle s'offre au premier gémissement venu / Aux larmes venues la bénir // Altière / Elle préfère la cravache à la chambrière" (Id).
Quelle plus belle illustration du hasard objectif que cette rencontre inopinée de la photographie de Louise Lagrange que ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, pourrait-on dire, Delabarre ? Découverte-rencontre qui va orienter définitivement son destin poétique. Louise Lagrange est bien la Nadja du poète sur laquelle se fixent ses fantasmes. Mais il y a plus dès lors qu'on décrypte attentivement la notion d'amour fou dans ces poèmes. C'est un amour fou plutôt noir et déchiré comme on le rencontre dans un certain romantisme. La mort, la torture, la souffrance en sont les faces cachées (encore qu'elles s'étalent dans les poèmes non sans un certain goût de la provocation) que symbolisent le fouet, la cravache, le fer rouge, les clous qu'on rencontre souvent dans les vers de Delabarre. Est-ce la traduction de l'impossibilité d'un amour calme, sans cruauté ? On ne sait. Mais le goût du blasphème (il faut noter la présence des mots prie-dieu ou profanation dans les poèmes) vient relever cette tendance et contribue à dessiner cet érotisme si particulier. Reste l'écriture automatique. Christophe Dauphin place Hervé Delabarre aux côtés de Benjamin Péret pour l'empreinte de l'automatisme dans l'œuvre. Soit ! Les exemples ne manquent pas, il faut laisser le soin aux lecteurs de les découvrir. Mais un exemple : "De mes lèvres à l'Etna du réveil" (p 201), ce vers, s'il rappelle les rêves éveillés, est cependant une belle expression automatique comme celle-ci, qui ne va pas sans jeu sur les mots : "Les larmes ne savent plus à quels seins se vouer" (p 207…
Ce livre trouvera ses lecteurs et intéressera les spécialistes ou les amateurs du surréalisme. L'éditeur a eu la bonne idée de clore l'ouvrage sur un texte (datant de 2005) de Jean-Pierre Guillon qui fut un proche de Hervé Delabarre. Jean-Pierre Guillon parle, à propos de ce dernier, d'automatisme radical et il termine son article par ces mots : "La littérature ne gagne rien à cette dictée d'un nouveau genre, mais c'est la poésie qui y trouve son compte, dans une alliance d'avant et d'après-jouir, de la fantaisie, de l'humour spectral et d'un érotisme chargé d'attentions tout en même temps délicates et perverses". Ce qui est bien vu. Mais d'autres lecteurs relèveront le contraste très fort entre l'écriture de Delabarre et les photographies illustrant l'ouvrage : elles montrent un homme dans un intérieur plutôt bourgeois. Heureusement Delabarre tire sur une énorme bouffarde (p 29), ce qui prouve qu'il est politiquement incorrect dans ce monde si soucieux des apparences…"
Lucien WASSELIN (cf. "Fil de lecture" in www.recoursaupoeme.fr, novembre 2015).
*
"Une anthologie des poèmes de l'auteur, accompagnée de textes inédits et de contes. Composés de 1962 à 2014, ils sont marqués par une esthétique surréaliste, entre écriture automatique, éloge de l'amour fou, érotisme et propos blasphématoires. "
Electre, Livres Hebdo, 2015.
|
|

|
|
Lectures :
" Réunit le journal tenu par le poète en 1946, l'année de son suicide dont il permet d'éclairer certaines zones d'ombre, quelques témoignages et études (Tristan Tzara, Stéphane Lupasco, Jean Cassou, Jean Follain, Guy Chambelland...), ainsi que l'intégralité de ses poèmes écrits entre 1940 et 1946."
Electre, Livres Hebdo, 2018.
*
" Le tapuscrit de ce journal fut retrouvé très récemment, en 2016, dans les archives de Sașa Pană, directeur de la revue Unu, proche d’Ilarie Voronca (1903 – 1946) et figure centrale de l’avant-garde roumaine. En 1946, Ilarie Voronca s’est donné la mort. Le journal permet de mieux comprendre ce qui l’aura conduit à ce geste puisqu’il rend compte de l’année 1946. Il faut noter que Voronca est l’un des rares roumains exilés à Paris qui reviendra régulièrement en Roumanie, amplifiant sans doute, par ses retours, de terribles déchirures. Nous découvrons dans ces pages la puissance de ses angoisses et de ses tendances suicidaires. L’errance de Voronca, territoriale et spirituelle, malgré le recours permanent à la poésie comme seule axialité, n’a pas été contenue par les amitiés de Brauner, Tzara et autres. Le talent et l’amour ne suffisent pas toujours à compenser l’arrachement.
« C’était la femme d’avant la séparation que je cherchais. La femme de maintenant m’offrait les rides de son visage comme celles de son âme mais moi, je m’obstinais à ne pas les voir. J’aurais voulu l’emporter hors de la pièce, telle qu’elle était et m’enfuir avec elle vers le rivage de la mer d’où un bateau devait me reconduire vers le pays où j’avais organisé ma vie. J’avais décidé d’emprunter la voie maritime parce que les routes terrestres étaient exposées à trop de fatigues et de périls. Mais la femme et les amis et les parents qui l’entouraient ne l’entendaient pas ainsi. Il fallait emporter une partie de ce qui avait constitué sa vie pendant les années de la séparation. Remplir des coffres et des valises avec les choses matérielles de sa vie. (…) Embarqués à Constantza, nous n’avons quitté le bord qu’après trois jours de mouillage. J’étais encore dans l’extase de l’incroyable réunion et la femme réelle avait encore tous les aspects de la femme de ma mémoire ! Ce n’est que le sixième jour, pendant une longue escale dans le port bulgare de Varna que les premiers symptômes d’une vie qui m’était inconnue, se manifestèrent. »
La lecture de ce journal démontrera une fois de plus que la poésie demeure bien supérieure à la psychologie dans la connaissance des méandres de la psyché.
La deuxième partie du livre rassemble divers témoignages de Tristan Tzara, Stéphane Lupasco, Georges Ribemont-Dessaignes, Jean Cassou, Jean Follain, Claude Sernet, Eugène Ionesco, Yves Martin, Alain Simon, Guy Chambelland.
Ecoutons Yves Martin :
« Relire Ilarie Voronca, non pas dans le douillet, le silence d’un appartement, mais dans les lieux où il a dû être tellement perdu, les lieux qui l’ont usé, broyé après bien d’autres, Voronca, tu marches, c’est toi dans ce coin de métro, c’est toi qui regardes les draps de la Mort que chaque matin étend derrière l’hôpital Lariboisière. Tu te demandes si parfois il y a des survivants. Tu es de toutes les rues de la capitale, celle qu’un peu de soleil fait bouger comme une ville du Midi, celles qui glissent insidieusement comme Jack L’Eventreur. C’est toi qui es sa victime. Toujours toi. Tu ne vis pas le danger. A force de rêver d’indivisibilité pour être mieux présent dans chaque homme, dans chaque objet, tu te crois réellement invisible… »
La troisième partie rassemble l’intégralité de l’oeuvre poétique d’Ilarie Voronca sous le titre Beauté de ce monde.
Extrait de L’âme et le corps :
« Comme un débardeur qui d’un coup d’épaule
Est prêt à se décharger de son fardeau
Ainsi mon âme tu te tiens prête
A rejeter le corps sous lequel tu te courbes.
Est-ce pour quelqu’un d’autres
Pour un fossoyeur ou pour un prince
Que tu portes cette chair un instant vivante
Dont tu es étrangère et qui te fait souffrir ?
Ah ! Peut-être que celui qui t’a confié mon corps
A oublié de te montrer les routes ensoleillées
Et pour me conduire du néant de ma naissance à celui de ma mort
Tu t’égares entre les marais et les ronces.
Réjouissons-nous, mon âme, il y a par ici une ville
Où les femmes sont comme des fenêtres.
On reconnaît leurs sourires dans les vitraux des cathédrales
Leurs voix sont les parcs, les fils de la Vierge.
… »
Lisons et relisons Ilarie Voronca plutôt que le prix Apollinaire 2018, accordé lamentablement au médiocre Ronces de Cécile Coulon."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, novembre 2018).
*
Et enfin un volume qui convoque un poète rare : Ilarie Volonca, présenté dans une édition établie par Pierre Raileanu et Christophe Dauphin. Un Journal inédit et une anthologie de ses textes, Beauté de ce monde, qui offre un panel de poèmes classés par ordre chronologique, de 1940 à 1946. Là encore un paratexte riche et qui propose des éléments pour situer l’homme et l’œuvre. Poète français et roumain, cette figure-phare de la littérature de l’Est participe dans son pays de naissance à l’édification d’une avant-garde qui favorise l’émergence d’une modernité littéraire roumaine. Il fonde avec Victor Brauner la célèbre revue 75 HP qui perdure de nos jours.
Les anthologies publiées par Les Hommes sans Epaules, sont donc des volumes précieux, qui plongent le lecteur dans l’univers d’un auteur, pas uniquement grâce à ses productions artistiques. Elles entrouvrent la porte d’une intimité qui n’est qu’esquissée par les liens effectués entre les éléments biographiques purement factuels et une mise en situation historique. Le plus souvent engagés dans une démarche critique, les poètes dont il est question offrent matière à ce que le lecteur prenne connaissance de leur apport dans l’avancée d’une littérature qui peine à s’engager sur de nouvelles voies en ce début de siècle. Et que leur nom soit peu ou pas connu, il n’en demeure pas moins que Christophe Dauphin et Henri Rode savent où s’écrit la Poésie, de celle qui ne se taira pas.
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
*
Comment échapper à la fascination qu’exerce une œuvre poétique lorsque l’on sait par avance que l’on en sera la victime consentante ? Poète de deux langues, le roumain et le français, Voronca en est le parfait exemple lui qui se suicida en 1946 à l’âge de 42 ans. Sur la corde raide de la recherche d’identité, la fragilité et le doute le tenaillaient en permanence et ravageaient sa conscience.
Son « Journal inédit » enfin édité se lit comme un complément à cette œuvre poétique traversée par des éclairs d’espoir et de désespoir. On ne remerciera jamais assez Christophe Dauphin d’avoir regroupé en cet épais ouvrage ces deux volets complémentaires. Les poèmes sont regroupés sous le titre de l’un des poèmes emblématiques de Voronca : La beauté de ce monde. Certains de ces textes semblent prophétiques dans une dimension lyrique et visionnaire qui n’avait pas été entrevue lors de leur parution malgré l’attention et le dévouement des poètes résistants dans les années sombres de la deuxième guerre mondiale : les Ruthénois Jean Digot et Denys-Paul Bouloc ou, par la suite, les éditeurs posthumes que furent Guy Chambelland et Jean Le Mauve.
On lira aussi avec une attention particulière les contributions d’une quinzaine d’auteurs choisis pour évoquer les multiples facettes d’IlarieVoronca. Exégètes dévoués et compétents, Petre Raileanu et Christophe Dauphin ont réuni leur parfaite connaissance de cette œuvre majeure pour proposer un livre qui fera date.
Georges CATHALO (cf. Lecture flash 2019 in revue-texture.fr, janvier 2019).
*
|
|

|
|
Lectures
Les lecteurs de La Lettre du Crocodile se souviendront, entre autres, de l’hommage au poète Frédéric Tison offert par Claire Boitel pour la disparition du poète en 2023 et de l’essai qu’elle lui consacra sous le titre Frédéric Tison, la voix derrière la voix, aux Editions Petra. Cette fois, Norbert Crochet, Christophe Dauphin et Les Hommes sans Epaules ont rassemblé l’ensemble de l’œuvre poétique de cet auteur d’exception, dont plusieurs inédits.
« L’univers de la poésie de Frédéric Tison, écrit Christophe dauphin, est à double visage, à l’instar de Janus, et le désir comme l’Eros y sont bien présents. Cela n’est pas implicite, mais cet Eros ne concerne pas la femme mais l’homme : Toute sa voix/ ses membres amoureux / Parmi les allées / Dessinées dans les lignes de mon image coloriée. Frédéric le « masque » dans ses poèmes et ne s’en ouvre que peu, sauf peut-être dans ses poèmes plus récents ou en tirages confidentiels (…)
Certains ont pu dire et/ou penser, que Frédéric-Janus, le poète dieu des portes, était un poète maudit. Il n’en est rien. Il était entouré et soutenu, dans sa vie privée comme de poète, reconnu et publié d’emblée par les Hommes sans Epaules, en revue comme en livres. Sa reconnaissance, en tant que poète, dépasse le seul cadre des HSE pour s’étendre au milieu de la poésie… »
Christophe Dauphin retrace son parcours d’auteur, de poète en introduction à ce volume.
« Il est des êtres que jamais rien ni personne ne réconciliera avec la vie. Frédéric Tison était de ceux-là » nous avertit Norbert Crochet avant de préciser :
« Si l’on ne sait pas que Frédéric Tison était un homme pressé parce que menacé, on ne comprend pas sa soif inextinguible de connaissance et sa quête éperdue du Beau et du Vrai, sa recherche désespérée d’un soulagement psychique, physique aussi. Il fallait vite tout voir, tout lire, tout explorer pour connaître la Vérité. »
Parmi les inédits, se trouve Le Dernier chant d’Edwine (2003-2023), journal improbable d’un voyage initiatique dans lequel le « dieu des portes » a préféré prendre le chemin des intervalles, évanescent mais plus direct. Toujours l’urgence.
« Comme elles sont belles, y songe-t-on, ces pages blanches dans ce livre déjà relié avant d’être copié et enluminé – chose impossible –, ou bien Edwine serait-il en train de faire des annotations dans ses marges ? ou bien ce livre était-il un livre blanc, aux lettres blanches, illisibles, indécises, en attente de Dieu, ce Dieu blanc, ce Dieu-Lumière dont les ouvertures murales des cathédrales qui s’élevaient lentement en ce temps-là, selon ce qui sera la Théologie de la Lumière de l’abbé Suger, célébraient la pure couleur, la pure présence, son évidence ruisselante ? »
Revenons à la poésie avec la fin de ce poème inédit, L’automne infidèle.
« Je t’ai tout donné, à toi, automne fugitif,
Dont le sang pourpre est l’encre de ma plume
« Laisse couler les gouttes de pluie sur ton visage,
Ce soir, ce sont les nuages qui pleurent pour toi
« Fermons les yeux, et ne nous réveillons jamais plus.
« Jamais plus », me susurrais-tu dans ton savant vertige
Maintenant tu fuis, loin du parc où Eole se pavane,
Tu t’effaces des arbres et ôtes ta main du ciel
Tu es le soleil de mes larmes, la lune de mes joies,
N’oublie pas que je t’ai pardonné tes cruelles trahisons,
La nature s’ennuie de toi, reviens, et enlace-moi encore »
Parmi les œuvres rassemblés, nous retrouvons notamment : Nuages rois (2021) – La Table d’attente (2019), Prix du poème en prose Louis Guillaume 2021 – Aphélie, suivi de Noctifer (2018) – Le Dieu des portes (2016.), Prix Aliénor 2016 – Les Effigies (2013) – Les Ailes basses (2010) – Les Féeries amères (2008)…
Rémy BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, mai 2025).
|
|
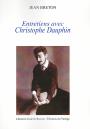
|
|
Critique
(..) Il s'agit de deux entretiens accordés par Jean Breton, décédé en septembre 2006, à Christophe Dauphin en 2003 et début 2006. Christophe Dauphin, toujours très bien documenté interroge Jean Breton en suivant deux chronologies imbriquées: la biographique et la bibliographique. Et sur l'une comme sur l'autre, ses questions pertinentes permettent aisément de mieux cerner à la fois l'homme et le poète... Je dois dire que j'ai été assez séduit par le poète à partir de son recueil Serment-tison en 1990. son manifeste Poésie pour vivre, écrit avec Serge Brindeau en 64, avait nettement matérialisé la séparation entre poètes de la sensibilité, l'émotivisme en effet, et la tendance tel quel qui commençait à sévir sérieusement à l'époque. Cette disjonction bruyante est toujours de mise aujourd'hui et la ligne de démarcation durable. Sa définition de l'image est intéressante, à l'opposé de celle de Reverdy et des surréalistes, elle "naît d'un choc de deux réalités les plus proches possibles." Jean Breton conclut son prmeier entretien par cette constatation à laquelle j'adhère entièrement: On ne peut faire joujou avec la poésie. On est obligé de passer sa vie avec celle-ci dans notre tête, en sachant qu'on ne gagnera jamais un sou et que le public non initié, jusqu'au bout, nous boudera... Le second est offert sur disque. on y perçoit à peu près la même chose. Les question y sont lues d'une voix atone, les réponses donnent à entendre la parole chaleureuse de Jean Breton.
Jacques MORIN
(Revue Décharge n°152, novembre 2011).
|
Dans Inédit Nouveau
Disparu en 2006, Jean Breton, né en 1930, voit publier ses Entretiens avec Christophe Dauphin, après avoir fondé la revue Les Hommes sans Epaules en 1953 et la remarquable collection (je ne veux pas l'appeler seulement revue) Poésie 1, gageure qui au départ ne coûtait qu'un seul franc (de l'époque), grâce à l'idée géniale d'y introduire des pages de publicité, mais hélas ratrappée par le marché ! Elle n"a donc pu durer que de 1969 à 1987. Il fut l'auteur aussi, avec Serge Brindeau, d'un remarquable "Manifeste de l'homme ordinaire" et d'une oeuvre poétique importante, de 1952 à 2004. Un CD joint au livre reprend un entretien réalisé quelques mois à peine avant sa mort. Il fallait rappeler cet animateur que d'ailleurs le petit monde littéraire surtout parisien a tant "utilisé". Merci à Dauphin de célébrer ainsi son ami de la Librairie-Galerie Racine.
Paul VAN MELLE
(Revue Inédit Nouveau n°250, mai/juin 2012, La Hulpe, Belgique).
Seul sait écrire qui se permet de vivre. La poésie, ce qui nous est donné par surcroît, est le luxe ordinaire des riches en vie. Jean Breton (1930-2006) écrit son premier poème à 19 ans. Parmi ses lectures initiales, il faut mentionner Blaise Cendrars, Henry Miller... Il va rapidement s'engager dans la revue Les Hommes sans Epaules. S'il se dit influencé par le Sud, par sa rencontre avec le surréalisme et avec le peintre Antonio Guansé, Jean Breton sera sa vie entière tourné contre l'odre bourgeois et proche de l'érotisme. Parmi ses titres principaux: Chair et Soleil (1960), L'Eté des corps (1966), En mon absence (1992), Nus jusqu'au coeur (1999). Il résume lui-même sa philosophie de vie : "Je n'étais pas d'accord avec le protocole. J'ai écrit pour dire que j'étais là, pour regarder le monde dans les yeux, pour me venger et pour jouir, sans écarter les autres du soleil, parce que l'amour rôdait à pas de loup entre les pages." Quelques photographies, un CD et des extraits de poèmes vont clore cet entretien avec Christophe Dauphin, qui a su mettre en valeur, après tant d'autres (Ilarie Voronca, Marc Patin...) la personnalité de Jean Breton.
Gérard PARIS
(Revue Bleu d'encre n°27, 2012).
|
Dans Texture
"La Librairie-Galerie Racine publie les entretiens de Jean Breton avec Christophe Dauphin, qu’ils ont réalisés à Paris les 12 mars 2003 et 29 janvier 2006 (année du décès de Jean Breton). Ce livret d’une quarantaine de pages comprend également, outre le texte des entretiens, quelques photos et extraits de textes ; il est accompagné d’un CD de l’interview, qui permet d’entendre la voix de Jean Breton. Celui-ci parle de ses rapports difficiles avec son père, comment et pourquoi il a créé la revue « Les Hommes sans épaules » en 1953 (revue relancée et aujourd’hui animée par Christophe Dauphin, entre autres), explique ses rencontres et amitiés avec René Char, Follain, Becker, Bérimont, Rousselot, Chambelland, Pierre Chabert, puis sa défense et illustration d’une poésie de l’émotion et de l’image, de la sensualité et, le cas échéant, de l’engagement, en tout cas du refus des ukases religieux comme de l‘intellectualisme pédant qui prétendait imposer son carcan aux poètes de l’époque - bref d’une « poésie pour vivre », comme la définit le manifeste écrit avec Serge Brindeau. Jean Breton évoque aussi ses principaux recueils, « Chair et soleil » et « L’été des corps » dont les titres disent assez l’inspiration solaire, érotique et amoureuse. Un document éclairant."
Michel BAGLIN
(revue en ligne Texture, août 2012).
|
|
|